
Gallica

Gallica

Le mystérieux comte de Saint-Germain : rose-croix et diplomate / Pierre Lhermier
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


Lhermier, Pierre (1904-1940). Auteur du texte. Le mystérieux comte de Saint-Germain : rose-croix et diplomate / Pierre Lhermier. 1943.
1/ Les contenus accessibles sur le site Galilea sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Galilea sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Galilea constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Galilea sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Galilea en haute définition, contacter
utlllsatlon.commerclale@bnf.fr.

Source galllca.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
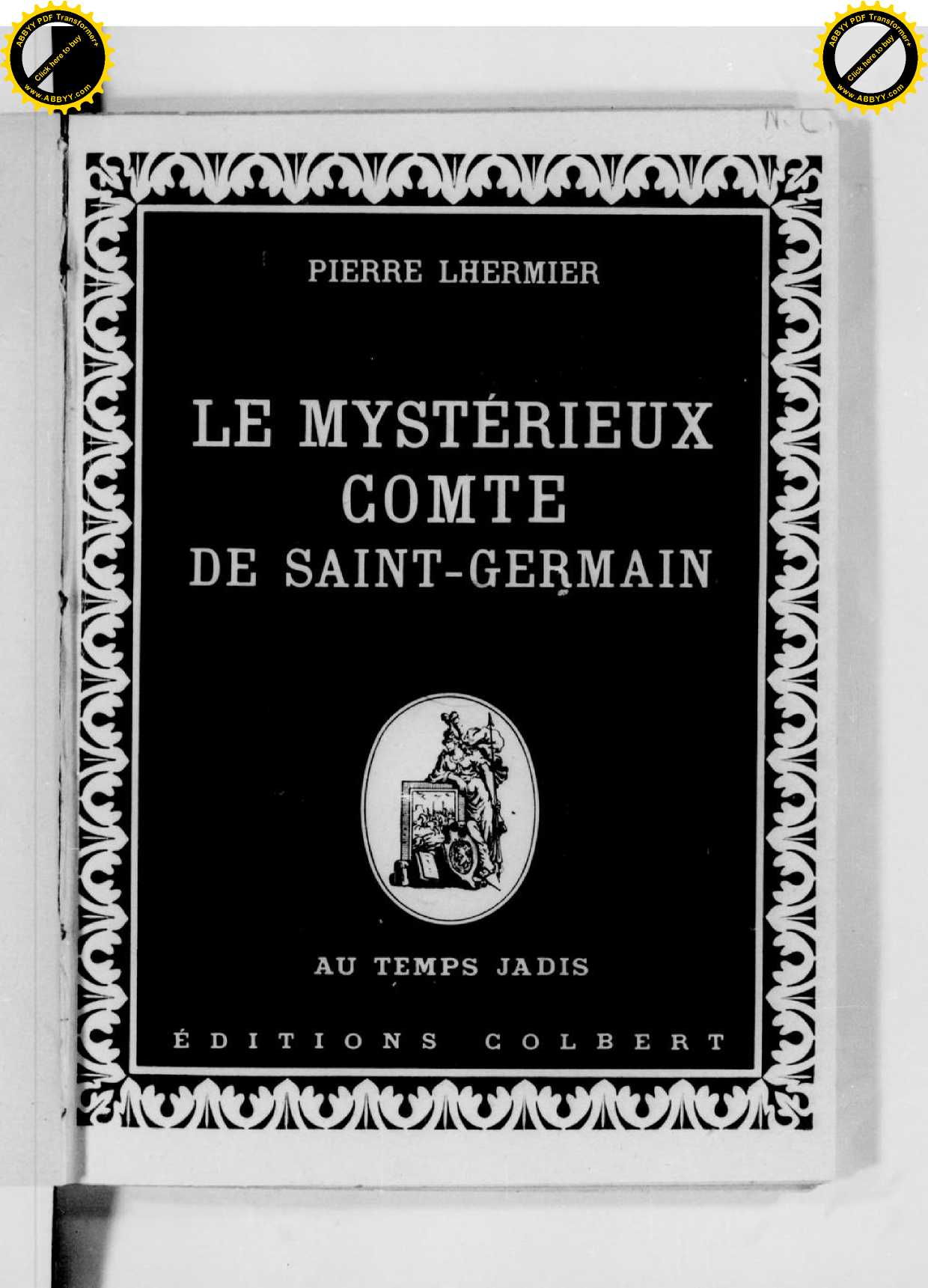
PIERRE LHERMIER
LE MYSTERIEUX COMTE
DE SAINT-GERMAIN



LE MYSTÉRIEUX COMTE DE SAINT-GERMAIN
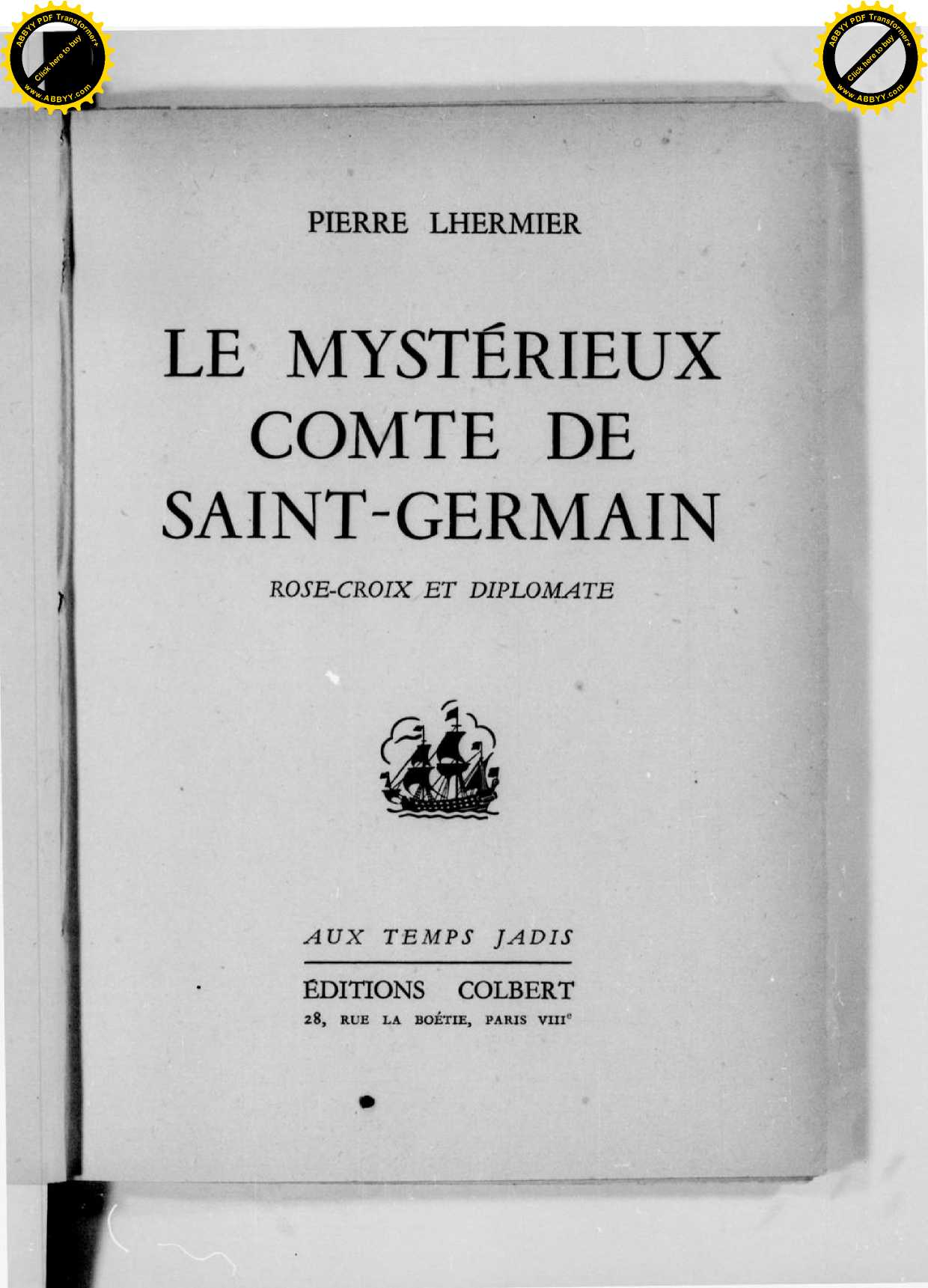
PIERRE LHERMIER
LE MYSTÉRIEUX
COMTE DE
SAINT-GERMAIN
ROSE-CROIX ET DIPLOMATE
EDITIONS COLBERT
28, RUE LA BOÉTIE, PARIS VIIIe


IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE DIX EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DES PAPETERIES DE CONDAT.
Collection creee par Jean d'Agraives et dirigée par Edmond l’ilon.
Copyright 19+3 by les Éditions Colbert.
Tous droits d’adaptation ,de traduction et de reproduction réservés.
«

A MM. Édouard Estaunié et André Bellessort, qui m'ohí ¿aidé et encouragé^ ce Modeste téMoignage de reconnaissance.
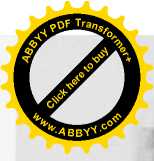

AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR
C’est une œuvre posthume.
Né le 20 Septembre 1904, Pierre Lhermier est décédé le 25 Juillet 1940, en pleine guerre, alors qu’il était mobilisé au 6)6" Régiment d’Infanterie.
On verra par ce texte quelle brillante carrière, à la fois d’écrivain et d’historien, il eut pu faire s’il n’avait prématurément disparu.
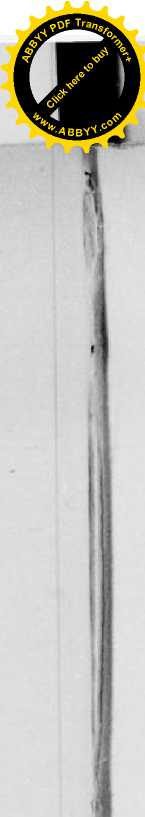
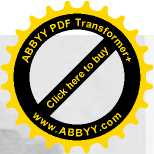
I

L’aventure et le mystère ont de tous temps exercé sur les hommes un invincible attrait. Jamais le prestige de l’inconnu ne s’cśt révélé plus vi£ qu’aux crépuscules des civilisations, en ces heures où pâlit le rayonnement des principes dont dépendent la cohésion des régimes et la direction de l’a&ivité des peuples. C’est là une règle constante dont l’évolution humaine nous fournit de nombreux exemples. Ainsi, la fin de la civilisation grecque ouvre l’ère des capitaines de mercenaires tandis que l’aurore des religions orientales perce après l’orage qui emporte l’indépendance d’Athènes. L’esprit hellène, si épris de mesure et de clarté, se voue à des cultes étrangers, par un goût morbide d’inconnu.
La décadence de l’empire romain voit s’élever des chefs de fortune et l’antique religion cède la place à des pratiques magiques, qui, bien mieux qu’elle,
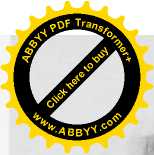
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN peuvent satisfaire au besoin d’infini qui travaille les esprits. Le xve siècle reSte le temps des routiers et des capitaines, mais aussi des sorciers et des astrologues. Le xvme apparaît comme le temps d’une incrédulité philosophique trop violente pour être durable et à laquelle vient s’opposer la candeur la plus aveugle, comme nous le prouve la croyance aux apparitions, aux divinations, aux évocations d’effrontés magiciens.
Des la Régence, les esprits forts crurent aux souffleurs et recherchèrent la pierre philosophale. Le duc d’Orléans tenta d’évoquer dans les carrières de Vaugirard, non pas un Dieu, mais l’ennemi de Dieu, Satan lui-même. L’aStrologic conserva des fidèles convaincus, comme le comte de Boulainvilliers, dont M. Bernard Fay nous a, dans un livre récent, tracé un si vivant portrait.
Aux fanatiques jansénistes, aux convulsionnaires de Saint-Médard, succédèrent les disciples d’un Cagliostro ou d’un Casanova. Les précurseurs d’idées, comme les Encyclopédistes, veulent aller vite. Il profitent, d’une manière générale, de périodes de lassitude pour répandre leurs idées. Mais des doctrines semblables ne peuvent être adoptées sans une évolution progressive pendant laquelle une réaction plus ou moins forte met la substance de cette philosophie en péril.
— io —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
A cause des divergences d’opinion qui le caractérisent, ce siècle fut particulièrement propice à la fructueuse industrie des aventuriers. La lente désagrégation de l’ancien régime, la monotonie d’une vie compassée à IV.w^ offrirent à ces êtres étranges des circonstances de plus en plus favorables à leur adivité. Ils surgissent brusquement un jour, on ne sait d’où, et leur audacieuse assurance, jointe à des dons réels qu’il serait puéril de ne point reconnaître, n’a pas de peine à étendre le prestige que leur confère déjà, sur une société assoiffée d’inconnu, le mystère de leur origine.
Parmi ces personnages énigmatiques, deux sont restés célèbres : Cagliostro et le comte de Saint-Germain. Ce dernier exerce une attra&ion plus forte que son rival dont il semble avoir été l’initiateur à la franc-maçonnerie, dans une loge dc HolStein1.
Mais tandis que Cagliostro compromettait sa réputation par des pratiques frauduleuses qui le firent mourir à Rome dans les cachots de l’Inquisition, M. de Saint-Germain, thaumaturge et homme du monde, sut se faire présenter à la cour de Versailles et acquérir, en peu de temps, sur Louis XV monarque distant que minait une neurasthénie incurable, un
i. Friedrich Bulau, Gtbeimt Gescbichten and raistUafis Venschen* brochure de 80 pages consacrée à Cagliostro, Saint-Germain et Vari Alton-Crotkau, p. 37, D. Rudun Verlag von Fhilipp Richam Jr., Leipzig.
— —
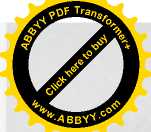
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
pouvoir tel qu’il participa à la diplomatie personnelle du gouverneur au fameux Secret du Roi. Cette situation privilégiée lui permit en 1760 de tenter en Hollande des pourparlers avec l’Angleterre et la négociation d’un emprunt néerlandais. Mme de Pompadour et le maréchal de Belle-Isle le protégeaient. Il manqua de réussir, mais le ministre en titre, le duc de Choiseul, très jaloux de son propre rôle, donna l’ordre de faire arrêter Saint-Germain. Les Etats Généraux de Hollande promirent de favoriser son extradition mais profitèrent de la nuit poulie faire évader en Angleterre sous les auspices de leur président. Abandonné de son roi, pour qui se posait un dilemme tragique et, naturellement, des amis de ses beaux jours, notre héros continua en Europe, surtout en Russie et en Italie, une campagne favorable au prestige français qui aboutit, en 1762, à renverser du trône de Saint-Pétersbourg le tsar germanophile Pierre 111 et à proclamer impératrice la femme de ce dernier, Catherine II, proteétrice de Diderot, très éprise de pensée française.
Si le jour a été fait sur la vie de Cagliostro, bien des points restent à éclaircir dans la vie de l’inconnu ou plutôt du méconnu qui, pendant vingt ans, intrigua la cour de Paris de son luxe et de ses propos, pour aller mourir, solitaire, dans le petit village d’Eckenforde où nous avons visité son tombeau, à peu près ignoré.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Il semble avoir pris un malin plaisir à surexciter la
curiosité dc 1’hiśtoire, en parlant d’un sombre secret dont la révélation aurait eu, pour lui, des conséquences terribles. Sans doute, peut-on voir là les réticences calculées d’un charlatan soucieux de son
preśtige. Quel intérêt pourtant avait cet homme à l’affirmer jusqu’à son lit de mort?
Méconnu avons-nous dit. Pour nous, en effet, Saint-Germain n’eSt pas l’impoSteur qu’on s’e^t plu à représenter, qui se joua de ses dupes, avec d’autant plus de facilité que la hâblerie fut plus forte. C’est un illuminé, parce qu’une mystique le conduit. La protection constante que lui donna le maréchal de Belle-Islc,
nécromant notoire, ne saurait être évoqués en sa faveur, mais l’intimité dont l’honora le roi eśt une preuve suffisante pour qu’on ne puisse, sans injustice, le confondre avec les aventuriers de l’époque.
Avant d’examiner les nombreuses hypothèses construites sur le nom de notre héros et sur ses origines, précisons d’abord les points qui paraissent indiscutables.
Le fameux comte eśt mort en 1784 à Eckenforde, dans le landgraviat de Liesse, ainsi qu’en fait foi l’état civil de cette localité. C’eSt à M. GuStavc Bord que revient l’honneur de cette découverte1.
T. Voici sa traduction en français : “ Celui qui sc faisait passer pour le comte de Saint-Germain et de Welldonc et sur lequel on n’a point d’autres

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Nous savons, d’autre part, qu’il avait, à cette date, quatre-vingts ans environ1. U aurait donc vu le jour au début du xvine siècle ou dans les dernières aimées du xviie. Cela dit, essayons d’expliquer l’origine du nom de Saint-Germain, sous lequel notre héros fut connu en France. Aucun lien de parenté — eśt-il besoin de le dire? — ne l’unissait au comte Robert de Saint-Germain, né à Lons-le-Saulnier en 1708. Ce dernier, un moment jésuite, servit ensuite dans les régiments français, palatins, autrichiens et prussiens pour devenir sous Streunçee, ministre de la Guerre du royaume danois, le chef d’une armée qui campa aux environs de Saint-Pétersbourg et » inquiéta fortement l’état-major de Pierre 111. Au debut du règne de Louis XVI, ce Saint-Germain fut, en France, secrétaire d’Etat à la guerre, réorganisa l’armée et s’en fut mourir en 1778, dans ses terres, proche de la frontière suisse.
On a proposé plusieurs explications du nom. Suivant von Weber, historien allemand, ce serait simplement la transcription de San-Germano, bourg de Savoie, où l’un des pères supposés de notre héros, un certain M. Rotondo aurait été receveur des finances. D’autres voient la traduction de Sanétus-Germanus
renseignements a été enterré dans cette église. ” G. Bord, l^a franc-maçon-verte au XVIII'' siècle. (
1. G. Bord, La franc-maçonnerie au XI IIP siècle (Profils maçonniques").
(le saint frère) pseudonyme assez transparent par lequel le soi-disant comte aurait voulu affirmer
ses attaches maçonniques. Cependant, il convient
d’ajouter à ce sujet que Saint-Germain n’a pas été le seul nom d’emprunt de ce personnage. Dans les
différentes contrées de l’Europe où sa course errante
l’a mené, il se parait tour à tour de titres plus ou moins ambitieux : prince Râkôczi, prince Tzarogy, général Soltikoff, comte de Bellamye et enfin comte de Welldone.
Saint-Germain, d’après Guśtare Volz1, aurait donné, au moment où il se faisait appeler prince Râkôczi, cette interprétation de son pseudonyme.
“ Deux autres frères, issus commcmoide Rackoczi, ont reçu de l’empereur d’Autriche les titres res-pe&ifs de marquis de Saint-Marc et marquis de Sainte-Elisabeth, j’ai pris, à certains moments, le nom de Saint-Germain, le saint parmi les frères. ”
Cette déclaration d’un personnage aussi inquiétant doit être acceptée avec la plus entière prudence. Les autres hypothèses sont, certes, bien fragiles. Aucun renseignement précis ne les appuie. Le mieux eśt donc de s’incliner devant ce mystère qui n’eśt d’ailleurs pas le seul ni le plus irritant de ceux qu’offre cette énigmatique personnalité.
i. G. Volz, Der Graf van Sabii-Gfrthain.
— IJ —
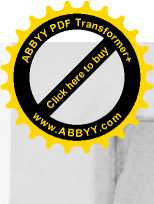
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Même obscurité en ce qui concerne son origine. Comment choisir entre les multiples suppositions qu’ont échafaudées d’ingénieux chercheurs. Pas de documents authentiques, pas de pièces d’archives, qui, sans résoudre le problème, puissent mettre sur la voie de la solution. Là encore, on doit se contenter de vraisemblances et de présomptions.
Nous passerons rapidement sur un certain nombre de conjectures qui ne paraissent être que des affirmations gratuites. Ainsi de nombreux écrivains ont voulu voir en Saint-Germain un marquis de Betmar, d’origine portugaise, d’autres le fils d’un jésuite espagnol, le père Aymar.
L’opinion de von Weber, qui assigne pour père à notre héros un certain M. Rotondo, ne paraît guère plus satisfaisante, si séduisante que paraisse au premier abord l’explication du nom d’emprunt de notre inconnu.
Une autre affirmation mérite une considération plus sérieuse car son auteur est le duc de Choiseul lui-même, premier ministre de Louis XV. Dans ses intéressants “ Souvenirs ” M. de Gleichen1 diplomate danois, raconte la scène suivante :
ÎC Au cours d’un dîner sans cérémonie, M. de Choiseul demanda brusquement à la duchesse pour-
i. Ai. de Gleichen, diplomate danois d’origine allemande, 1735-1767, ambassadeur à Madrid puis à Paris. Soutanirs.
— 16 —



LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
quoi elle ne buvait pas. Elle, lui ayant répondu qu’elle pratiquait, ainsi que moi et avec bon succès, le régime de AI. de Saint-Germain, Choiseul lui dit : “ Pour ce qui est du baron, à qui j’ai reconnu un “ goût tout particulier pour les aventuriers, il est “ maître de choisir son régime, mais vous, madame, “ dont la santé m’eśt précieuse, je vous défends de “ suivre les folies d’un homme aussi équivoque. ” Pour couper une conversation qui devenait embarrassante, le bailli de Solar demanda à Al. de Choiseul s’il était vrai que le gouvernement ignorait l’origine d’un homme qui vivait en France sur un pied si distingué.
“ Bien certainement, nous le savons, répliqua Ai. de “ Choiseul, c’e§t le fils d’un juif portugais de Stras-“ bourg, Wolf, qui trompe la crédulité de la ville et “de la cour. Il eśt étrange, ajouta-t-il, que l’on “ admette que le roi soit souvent seul avec un tel “ homme, tandis qu’il ne sort jamais du palais “ qu’environné de gardes, comme si tout était rempli “ d’assassins. ”
Rien de plus précis que cette assertion. Bien que la police fût loin d’être, sous l’ancien régime, aussi fortement organisée qu’elle allait le devenir sous la République et sous l’Empire, elle savait bien des choses, et le plaisir éprouvé par Louis XV à pénétrer le secret des familles, par le moyen des rapports de

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN police qui lui étaient quotidiennement remis, fut toujours un sujet d’indignation pour notre esprit moderne.
Par ses fondions de premier ministre, Choiseul était à même d’être renseigné sur une foule de personnes et de faits qui restaient mystérieux pour le vulgaire. Sa déclaration était corroborée par l’opinion des brasseurs d’affaires d’AmSterdam et de La Maye, qui tenaient aussi Saint-Germain pour le fils de Volff, et c’eSt peut-être à leur croyance en son origine Israélite que l’aventurier dût d’entrer aussi facilement en relation avec eux, comme nous le verrons plus loin. Cependant, si catégorique qu’il soit, le témoignage du ministre ne laisse point de soulever des objections. Très autoritaire, Choiseul supportait avec peine qu’un autre que lui eût l’oreille du maître. Scs paroles nous le montrent visiblement dépité de la confiance mise par le roi en Saint-Germain et tous scs efforts ont constamment tendu à la ruiner. S’il avait eu la preuve de ce qu’il avançait avec tant d’assurance, il aurait été trop heureux de la communiquer à Louis XV. Comment .admettre, dès lors, que le monarque ait continué ses faveurs à un tel homme et, bien plus, l’ait chargé d’une mission délicate qu’il ne pouvait confier qu’à une personne absolument sûre, et les Juifs n’inspiraient alors qu’une estime bien médiocre. La conduite du roi de


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
France à l’égard de Saint-Germain nous semble donc très propre à infirmer l’impressionnante assertion de Choiseul, laquelle s’expliquerait par le double désir de paraître savoir ce que tout le monde ignorait (ainsi qu’il sied à un ministre) et de rabaisser un homme qui lui portait ombrage. C’cSt d’ailleurs l’opinion de Gleichen, qui ne fut pas dupe de ce mouvement d’humeur.
Reśtcnt à examiner deux hypothèses : la première, après avoir longtemps reçu l’adhésion du plus grand nombre des historiens, eśt de nos jours complètement abandonnée à cause de son romanesque trop accentué. Elle fait de Saint-Germain un bâtard de la reine d’Espagne, Marie de Palatin-Neubourg, veuve de Charles 11, celle qu’Hugo a idéalisée dans “ Ruy Blas ”; mais l’on sait que le poète, malgré ses affirmations catégoriques, a pris maintes libertés avec 1’hiśtoirc. Nulle part, peut-être, il n’a affiché un aussi grand dédain de la vérité.
Le mariage de cette princesse avait été arrêté le 15 mai 1689. Le 27 janvier suivant, la nouvelle reine d’Espagne partit de Flessingue et fut remise, le 4 mai, entre les mains du roi Charles. Le désir de la noblesse espagnole, qui méprisait son souverain incapable et malade, était d’assurer, par la naissance d’un héritier, la succession du trône. Suivie d’une duègne bavaroise, qui loin d’être rigide, aurait plutôt
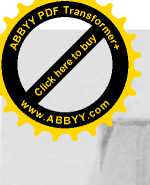

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
favorisé sa débauche, la reine ne tarda point à se dégoûter du fantôme d’homme qu’on lui avait donné pour époux. Pliant à ses caprices la rigide étiquette, elle mena une vie où l’amour tenait autant de place que la politique, et quand Philippe V accéda au trône, elle alla continuer à Bayonne son existence de prodigalités et de plaisirs.
Parmi les nombreux amants qu’on lui prête, Flaês, l’historien des “ Reynas Catholicas ” en cite particulièrement deux : le banquier Adanore que la reine anoblit et Ht nommer ministre des Finances, malgré ses ascendances modeśtes; il représentait l’ami, sur lequel cette femme sans moralité pouvait compter dans le cas toujours possible d’une révolution et d’un exil; l’autre, le beau ténor Mateucci, était sans doute l’ami de cœur, le ténébreux, dont le regard et les talents musicaux avaient séduit la souveraine.
M. de Saint-Germain paraissait cinquante ans, en 1750. Tous les Mémoires et récits du temps sont d’accord pour affirmer qu’il ne portait certainement pas son âge. 11 aurait donc pu naître des relations adultères de la reine et de ce cavalier servant. Pié-montais d’origine, artiśte de valeur, Mateucci aurait pu transmettre à son fils ces dons universellement reconnus, par exemple cette native prestance, cette sobre diśtinćlion, qui frappèrent de Gleichen, quand


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
il vit, pour la première fois à Paris, le comte de Saint-Germain dans le salon de Mme Lambert1. Fils adultérin de la reine, il aurait vécu, sinon à la cour, ce qui aurait été inadmissible, mais dans le sud de la péninsule, avec un précepteur.
Ainsi pourraient s’expliquer les curieux propos que l’on a recueillis de sa bouche. Il arrivait que, dans certaines conditions, Saint Germain était en proie à une sorte d’hallucination? Dans une sorte de songe éveillé, il perdait le contrôle de lui-même; alors revivaient tous les souvenirs de l’enfant, toutes les espérances de l’éphèbe, toutes les impossibilités que l’homme n’avait pu surmonter.
Un soir, raconte dans scs “ Correspondances ” Mercier de la Rivière, l’auteur de 1’“ Ordre Naturel2 ”, on entendit Saint-Germain s’exclamer dans les jardins de Versailles :
“ La vie était belle là-bas. Des tapis recouvraient les terrasses, des roses s’écrasaient sous nos pas, les fifres jouaient pour nous devant deux lignes de gardes, l’or des manteaux s’irradiait, dans la cour intérieure, sous le soleil de midi; les chiens, dans leur joie de vivre, sautaient allègrement à nos côtés et le
i. Souvenirs dc M. de Gleichen.
2. Ces quelques lettres sont à la bibliothèque de Vienne. Elles sont d’ailleurs confirmées par un récit de Fr. Bulau dans Gehtime Geschichten, Leipzig.
-- 21 --
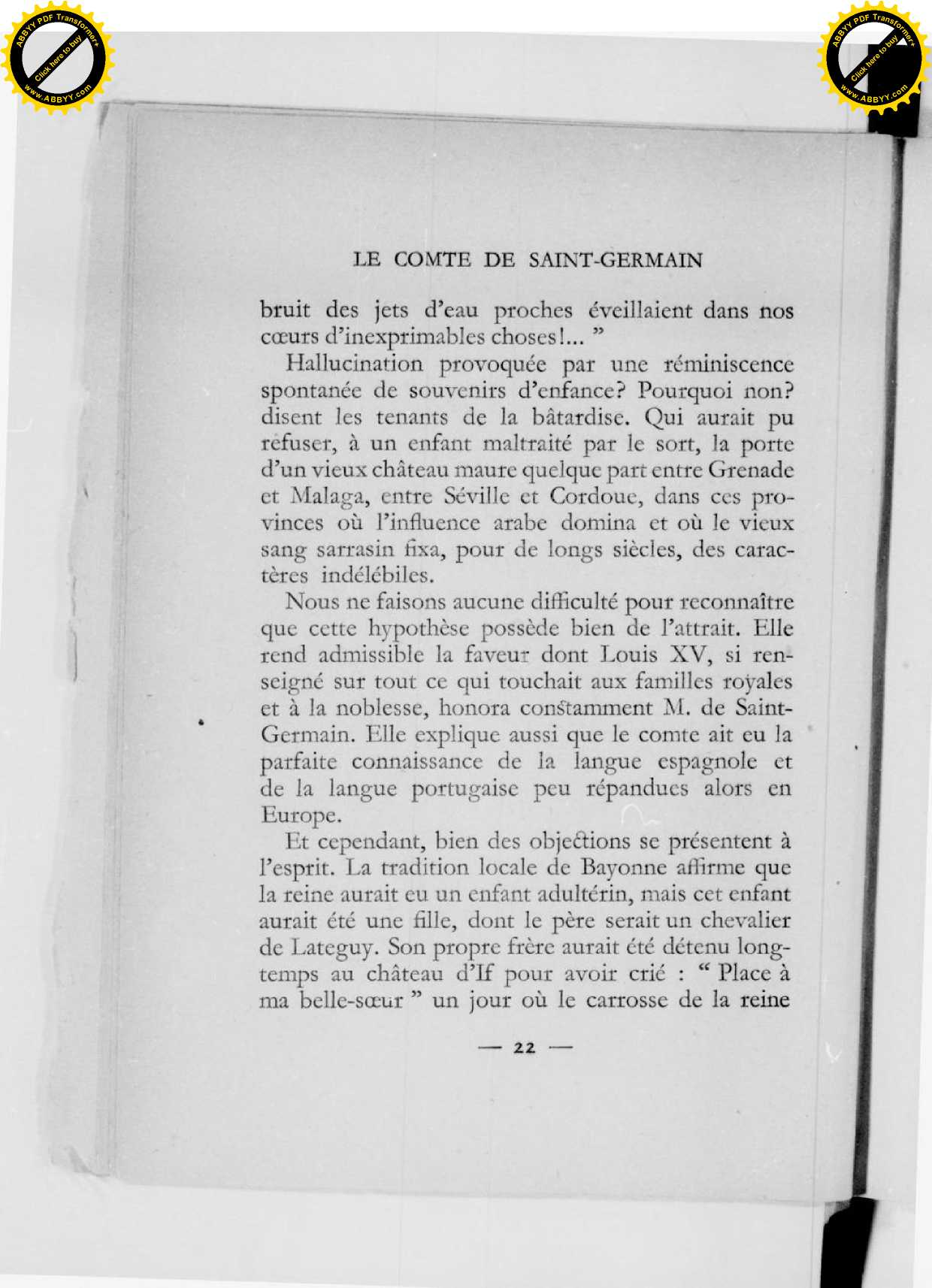

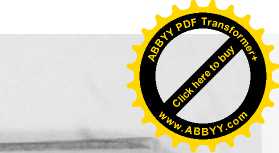
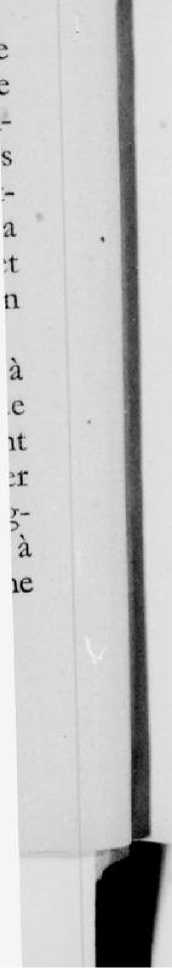
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
avait été arrêté dans les rues de Bayonne par un encombrement.
Comment admettre aussi que Louis XV, après s’être servi de Saint-Germain comme agent secret et •comme collaborateur au “Secret du Roi”, l’aurait froidement sacrifié à la rancune de Choiseul? D’autre part, le souvenir d’enfance de notre héros n’a rien de particulièrement espagnol et la scène qu’il décrivait à Versailles peut aussi s’être passé en Italie ou en Orient.
L’extraordinaire colleéfion de diamants et de pierres précieuses qu’il possédait ont fait assimiler Saint-Germain à certain prince d’Espagne qui aurait subtilisé au 'Trésor de Madrid des pièces de choix. Cette fantaisie, d’ailleurs apparentée à celle que nous venons d’exposer, fait de notre homme un héritier de Charles-Quint, avec la complicité de Marie de Neubourg. Elucubration de chroniqueurs flamands, elle ne mérite point d’être discutée.
La seconde hypothèse cśt seule digne d’attention. Donnée comme vraisemblable par M. Bord1, elle a été reprise par M. Wittemens2. Cette fois, Saint-Germain n’eśt plus un bâtard mais, pour être moins illuśtre, Son origine n’en cśt pas moins princièrc. Il serait le fils de François-Léopold de Râkôczi et de
I, Profils >naf(>»>}i(jues,
2. Histoire lies Rose-Croix.
— 23 —
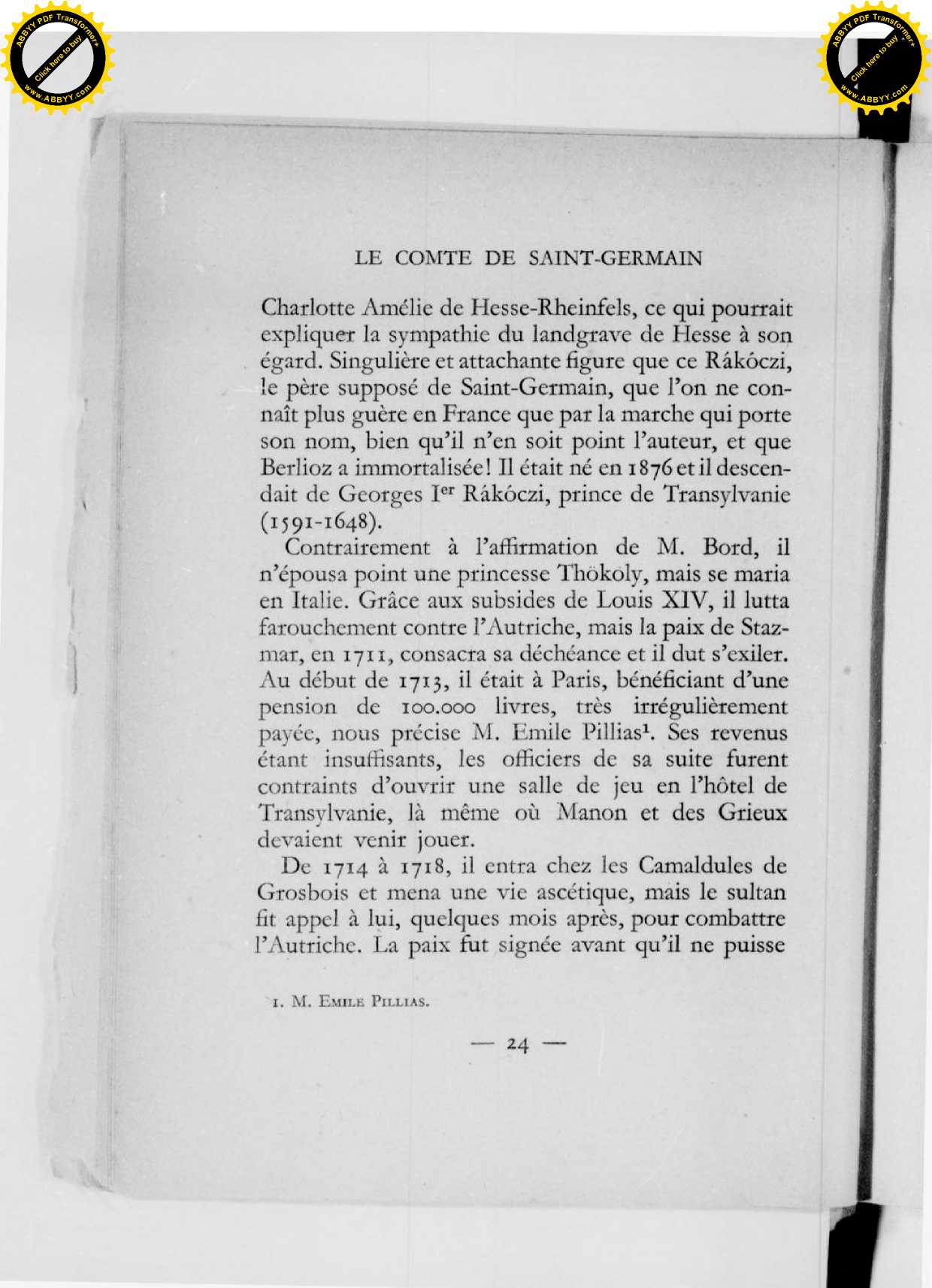
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
ment
pension
les officiers de sa suite furent
M. Emile Pillias.
étant insuffisants, contraints d’ouvrir
loo.ooo livres, très irrég
Charlotte Amélie de Hesse-Rheinfels, ce qui pourrait expliquer la sympathie du landgrave de Hesse à son égard. Singulière et attachante figure que ce Rákóczi, le père supposé de Saint-Germain, que Ton ne connaît plus guère en France que par la marche qui porte son nom, bien qu’il n’en soit point l’auteur, et que Berlioz a immortalisée! Il était né en 1876 et il descendait de Georges Ier Rákóczi, prince de Transylvanie (1591-1648).
Contrairement à l’affirmation de M. Bord, il n’épousa point une princesse Thokoly, mais se maria en Italie. Grâce aux subsides de Louis XIV, il lutta farouchement contre l’Autriche, mais la paix de Staz-mar, en 1711, consacra sa déchéance et il dut s’exiler. Au début de 1713, il était à Paris, bénéficiant d’une
Transylvanie, là même où Manon et des Grieux devaient venir jouer.
De 1714 à 1718, il entra chez les Camaldules de Grosbois et mena une vie ascétique, mais le sultan fit appel à lui, quelques mois après, pour combattre l’Autriche. La paix fut signée avant qu’il ne puisse


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
rien entreprendre et il se retira alors à RodoStc, où il mena une vie monacale jusqu’à sa mort qui survint le 8 avril 1735. On conçoit que cette version ait séduit les esprits pondérés et scientifiques comme ceux de MM. Bord et Wittemens. Nulle autre, en effet, ne présente autant de rapports avec ce que l’on sait de Saint-Germain. Elle se fonde, d’abord, sur les propres déclarations de l’aventurier que nous avons exposées plus haut. Elle cadre avec la date de sa naissance, fin du xvne siècle, début du xvnie. Elle rend compte de sa vie vagabonde, de sa connaissance de l’Europe entière, et de la Turquie notamment. Elle donne raison de son apparition tardive sur la scène du monde, après la mort de Râkôczi.
Malheureusement, des trois fils qu’eut le héros transylvanien deux sont morts à des dates historiquement établies (Joseph en 1738, Georges en 1756) et le troisième, celui que Saint-Germain prétendait être, a succombé en bas âge, en 1700.
Mais si l’on eStime que l’incertitude touchant sa fin autorise l’hypothèse d’une vie plus longue et permet de l’assimiler avec celle de notre héros, comment expliquer que celui-ci n’eût pas songé à revendiquer sa haute origine dans les derniers temps de son existence? Pourquoi n’cût-il pas suivi, en France,
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
son frère Georges qui mourut dans notre pays en 1756?
Pourquoi encore, lorsqu’il apparut, deux ans apres le décès du Transylvain, ne se donna-t-il pas aussitôt pour ce qu’il se disait être au lieu de prendre le nom de Saint-Germain? Craignait-il d’être taxé d’impoSture par les familiers de son prétendu père?
Cette théorie eSt donc aussi spécieuse que les autres, et, tant que des pièces indiscutables ne seront pas venues la confirmer, l’historien, bien qu’il en ait le désir, devra la rejeter et confesser son ignorance touchant l’identité de Saint-Germain.
Oserons-nous, cependant, risquer à notre tour une explication de cette énigme? Nous sommes, en effet, frappés par les constatations suivantes.
Saint-Germain était Rose-Croix, c’eSt-à-dire qu’il appartenait à la franc-maçonnerie de rite écossais, à tendance catholique et śtuarriśte, dont plusieurs loges s’étaient constituées, en France, après l’arrivée sur notre sol du roi fugitif Jacques II d’Angleterre. Note personnage a joué un rôle dans la tentative exécutée par Charles Édouard, fils du prétendant Jacques III, pour reconquérir le Royaume-Uni. Ne serait-ce point dans la famille de ce dernier, ou tout au moins dans son entourage, qu’il faudrait trouver la solution du problème?
Le gazetier Jean-Henri Maubcrt de Gouveât nous
— 26 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

dit, dans un article de mai 1760, que Saint-Germain cśt né en Italie en 17121.
Or, le fils de Jacques II, le chevalier de Saint-Georges, après sa malheureuse équipée en Ecosse, en 1716, se retira à Rome où il tint une cour.
Le journaliste bruxellois a pu faire une erreur sur le lieu même de la naissance de Saint-Germain, et il aurait assigné l’Italie comme patrie à notre héros parce qu’il aurait appris que celui-ci y avait séjourné dans son enfance. Des lors, s’expliquent les confidences de l’aventurier à Mme de Gcnlis2.
“ Le comte avait même quelque chose de si grave et de si rcspcétable dans sa personne que ma mère n’osait pas l’interroger sur les singularités qu’on lui attribuait. Enfin, un soir, après m’avoir accompagné d’oreille plusieurs airs italiens, il me dit que dans quatre ou cinq ans j’aurai une belle voix. Je répondis que j’en serais charmée. Ce peu de mots m’enhardit, je lui demandai s’il était vrai que l’Allemagne fût sa patrie. Il secoua la tête d’un air mystérieux et poussant un profond soupir :
“ Tout ce que je puis vous dire sur ma naissance, “ répondit-il, c’cśt qu’à sept ans j’errais au fond des “ forêts avec mon gouverneur et que ma tête était “ mise à prix. ” Ces paroles me firent frissonner, car
1. La Galette de Bruxelles, mai 1760.
2. Mémoires de Mme de Genlis, t. XV, p. 28.
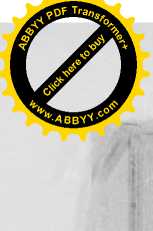
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
je ne mettais pas en doute la sincérité de cette grande confidence. “ La veille de ma fuite, continua M. de “ Saint-Germain, ma mère que je ne devais plus revoir “ attacha son portrait à mon bras.
“Ah! Dieu”, m’écriai-je.
“A cette exclamation il me regarda et parut s’attendrir en voyant que j’avais les yeux pleins de larmes.
“ Je vais vous la montrer ”, reprit-il. A ces mots, il retroussa sa manche et il détacha un bracelet parfaitement peint en émail et représentant une très belle femme. Lorsqu’il fut parti, j’eus le grand chagrin d’entendre ma mère se moquer de sa proscription et de la reine sa mère; car cette tête mise à prix dès l’âge de sept ans, cette fuite dans les forêts avec un gouverneur donnaient à entendre qu’il était le fils d’un souverain détrôné. ”
D’autre part, Saint-Germain aurait gardé, des années passées dans un palais italien, un souvenir enchanté dont témoignent ses paroles et qu’un historien allemand, Gustave Volz a relatées dans un ouvrage récent1. Bien plus, cette hypothèse cadre avec la protection que lui aurait donnée l’illustre descendant de la famille des Médicis, lequel le faisait coucher dans sa chambre.
Enfin, elle explique les attentions dont Louis XV

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
■ l’entoura et le rôle diplomatique important qu’il lui fît jouer à plusieurs reprises.
Le monarque savait qu’il pouvait compter sur le loyalisme d’un jacobite éprouvé, sur l’un de ces hommes qui avaient toujours montré, à l’endroit de leur souverain légitime, le courage le plus chevaleresque et le plus héroïque dévouement. Et l’on trouverait en même temps dans le fait qu’une loge jacobite avait fonctionné à Saint-Gcrmain-en-Laye, résidence de Jacques 11 jusqu’à sa mort et de Jacques III jusqu’à son départ pour Rome, une explication, semble-t-il assez naturelle, du titre de comte de Saint-Germain que notre héros a pris pendant son séjour en France.
Mais ce n’est là qu’une hypothèse que nous soumettons à la sagacité des chercheurs futurs.


Il
SAINT-GERMAIN ET BELLE-ISLE
C’est vers 1740 seulement que Saint-Germain apparaît dans 1’hiśtoire aux côtés du maréchal de Belle-Islc, son protecteur. Ses aventures précédentes nous restent inconnues et cc n’cśt qu’un racontar sans importance qui a permis à G. Volz1 de mentionner un aléatoire voyage à Mexico, où un riche mariage lui aurait permis d’obtenir une haute situation? Tout ce qu’on sait de façon précise, c’est que certaines dispositions naturelles à la chimie, que Lavoisier allait ériger en science, lui firent vendre à diverses petites cours allemandes des secrets de teintures et des produits de beauté, notamment une drogue que nous appellerions maintenant eau de Jouvence. Elle contenait surtout de l’huile de paraffine, extraite du goudron par un procédé encore inhabile.
1. Der Graf von Saint-Germain, Leipzig.
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Des témoins oculaires prétendaient qu’elle luttait efficacement contre les rides et savait donner aux épidermes débilités une élasticité incontestable.
C’eSt en Allemagne, où le maréchal de Belle-Isle
guerroyait alors, que Saint-Germain entra en rapports avec lui.
La fameuse guerre de 'Succession d’Autriche se
déroulait en Bohême. On sait que malgré les pré
cautions prises par l’empereur Charles VI pour assurer le trône à sa fille Marie-Thérèse, les puissances auxquelles il avait concédé certaines satisfactions, s’empressèrent après sa mort d’attaquer son testament et de faire valoir leurs prétentions par les armes. Les hautes sphères françaises avaient été très divisées au sujet de l’attitude à adopter. Deux partis s’y affrontaient : l’un, qui avait à sa tête Chauvin et Belle-Isle, voulait profiter de l’occasion pour écraser définitivement la maison d’Autriche, et ses vues étaient partagées par une grande partie de l’opinion dont la guerre flattait la passion anti-autrichienne; l’autre, que dirigeait le cardinal Fleury, premier ministre, se . rappelait les conseils de Louis XIV qui avait signalé sur son lit de mort la Prusse comme le nouvel ennemi de la France, et n’aurait point voulu affaiblir l’Autriche, où il voyait le contrepoids nécessaire à l’ambition prussienne. Le premier parti l’avait emporté et nous nous trouvâmes ainsi engagés dans une lutte
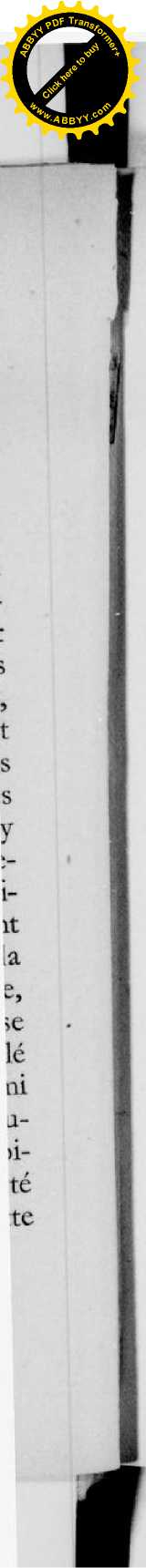

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN qui fut plus glorieuse à nos armes que profitable à nos destins.
Belle-Isle était le petit-fils du surintendant Fou-quet, condamné à la détention à Pignerol; cette parenté l’avait déprécié auprès de Louis XIV qui l’avait constamment tenu à l’écart. Rentré en grâce sous le Régent, il s’était trouvé, sous le ministère du duc de Bourbon, en butte à l’hoâtilité de Mme de Prie et était retombé dans son ancienne inactivité. Mais sa tante, la duchesse de Lévis, obtint du cardinal Fleury, dont elle était l’amie, la nomination de Belle-Isle comme lieutenant général, gouverneur de 1’Eśt, et son élévation au maréchalat.
En 1740, le roi le chargea de représenter la France à la Diète de Francfort qui allait élire le futur empereur d’Autriche. C’cSt à ce moment que le jeune roi Frédéric II se jeta sur la Silésie qu’il devait conquérir. Dès le printemps de 1741, il était à Breslau. Belle-Isle reçut la mission d’aller le trouver et d’obtenir un accord formel. Mais il ne sut obtenir que de bonnes promesses. Le roi de Prusse refusa toute signature. Malgré cet échec, l’entrée en lice d’un nouvel adversaire de l’Autriche flatta le ministre français. On espéra briser rapidement cette courte résistance de Marie-Thérèse et Breteuil, le nouveau secrétaire d’État à la guerre, lança contre elle deux armées : une de 40.000 hommes en Bavière sous les
~ B "
3

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
ordres de Belle-Isle, l’autre de 30.000 hommes en WeStphalie sous la conduite de Maillebois.
Après quelques semaines, Belle-Isle tomba malade et regagna précipitamment Francfort, laissant son commandement entre les mains du maréchal de Broglie, heureux vainqueur de Parme et de GuaStalla.
Le protecteur de Saint-Germain avait à cette époque cinquante-sept ans. 11 était petit, assez malingre. Son profil accusé lui avait valu, dans le courant de son existence, de multiples conquêtes. Son front fuyant permettait de douter de la fermeté de scs rancunes, mais ses yeux bleus, un peu verts, très doux, laissaient soupçonner la rêverie et la sensibilité, qui furent, dans sa carrière, deux travers contre lesquels il s’efforça en vain de lutter. Au moral, il présentait encore de singuliers contrastes, Intelligent, spirituel, et très attaché à la religion, il n’en éprouvait pas moins pour les thaumaturges une bienveillance qui nous étonne. C’était le vice du siècle. Il n’avait point, dans la sorcellerie, la foi naïve d’un homme sans instruction, mais les pratiques merveilleuses auxquelles se livraient les illuminés et les souffleurs du temps avaient développé en lui une admiration profonde. 11 avait incliné à scruter les secrets de l’inconnu. C’était, d’ailleurs, chez lui, un défaut de famille. Son arrière-grand-mère avait

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN publié un volume de recettes mirifiques contre toutes sortes de maladies. Louvois lui-même, qui les avait expérimentées pour sa vue, y découvrit un certain “ casse-lunettes ” dont il se déclara très satisfait. L’ouvrage aurait eu plusieurs éditions, ce dont son auteur devait se féliciter car, déclarait cette dame un jour à Versailles, elle avait reçu ces avis du ciel avec l’ordre de les répandre.
On comprend donc que Belle-Isle ait accueilli avec joie la nouvelle, que lui fit connaître probablement un officier attaché à son service, de l’existence d’un homme extraordinaire dont on relatait les cures surprenantes; il se résolut de faire appel à lui et un matin, il vit entrer dans sa chambre un homme jeune encore, portant avec élégance un pourpoint vert et une épée armoriée sur la garde, et l’on imagine sans peine la scène qui se déroula.
“ On m’a beaucoup parlé de vous ”, dit seulement le maréchal.
L’inconnu s’inclina avec déférence.
“ Pcrmettez-moi de me présenter, je suis le comte de Saint-Germain. ”
La physionomie était au premier regard sympathique; le nez, bien qu’un peu long, ne déparait point l’ovale d’un visage où deux lèvres sensuelles surmontaient un menton énergique. Sous le double arc des sourcils fins et fournis brillaient deux yeux noirs au
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN regard méditatif dont un reflet vert d’eau atténuait par moment l’acuité.
Le front haut se perdait dans un dédale de cheveux noirs légèrement bouclés. Le teint était basané mais, dans l’ensemble, un charme attirant se déga
geait du masque qui n’avait rien de cette hauteur
dédaigneuse dont Gleichen1, quelques années après,
se montrait frappé. Le personnage était de taille
moyenne, plutôt petite, mais l’hermine qui ornait ses manches achevait de lui donner la preśtance distinguée d’un grand seigneur.
Ils causèrent quelque temps.
“ Dormez en paix. Le meilleur repos eSt celui de
l’esprit. Contentez-vous de vous purger avec des
follicule» de séné et de prendre chaque soir, vers dix
heures, une cuiller de ce philtre dans de l’eau sucrée.
Rassurez-vous, nous circonscrirons le danger. ”
Et devant le soldat ébahi qui l’adjurait de lui donner des précisions, AL de Saint-Germain exécuta rapidement du bout de son doigt un signe magique autour de son malade, afin de le protéger contre les influences maléfiques.
Devant cet homme qui recourait à lui comme à un sauveur, devant ce patient amaigri dont il connaissait les appétits de mystères, M. de Saint-Germain
i. Souvenir s
— j6
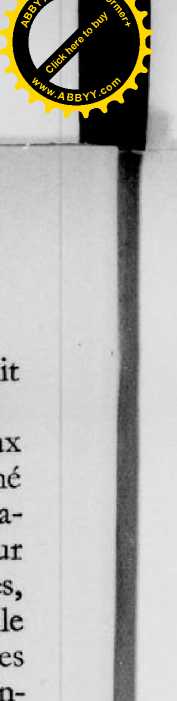
ui ita uc les
: a isdn

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
comprit que l’heure de la fortune avait sonné. Qu’il arrivât à dominer cet esprit malléable, à se rendre indispensable, et les plus vastes espoirs lui seraient ouverts! D’un ton de voix déférent, il s’entretint avec Belle-Isle et revint plusieurs fois par semaine lui tenir compagnie. A chaque demande du maréchal, il répondait par un hochement de tête, par des gestes qui n’avaient d’autre but que de créer une ambiance de doute et d’entière soumission aux volontés éternelles et sous laquelle il dissimulait davantage sa pensée.
“ Que vous importe de connaître ce que j’ai juré de tenir caché? ”
Belle-Isle dut-il à sa constitution dont les apparences étaient assez fragiles ou aux soins dont Saint-Germain l’entoura d’échapper au danger? Nul ne saurait le dire! mais il se remit assez promptement de ce qu’à l’heure aétuelle nous appellerions une tuberculose pulmonaire. Notre héros l’aurait, dit-on, dissuadé de reprendre son commandement. En effet, d’après le témoignage du général Chevert1, le suprême défenseur de Prague, des palpitations nerveuses compromettaient la régularité du cœur. Mais M. de Belle-Isle avait, malgré ses cinquante-sept ans, la désinvolture d’un cadet et il voulut retourner à

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
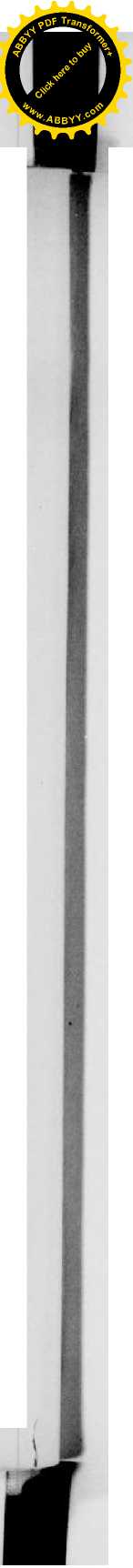
l’armée quelques mois après l’avoir quittée. Il n’y eu plus, à vrai dire, qu’une situation diminuée et dut se contenter du rôle de conseiller. Mais quand le maréchal de Broglie eût reçu l’ordre de remplacer . Maillebois, à son tour disgracié, à la tête de l’armée d’Allemagne, Belle-Isle fut chargé de sauver l’armée française cernée dans Prague et d’évacuer la Bohême. C’e£t alors que, dans des circonstances tragiques, il accomplit cette retraite impeccable qui reśtera l’honneur de sa carrière. L’hiver était d’une rigueur extrême. La neige, le verglas gênaient la marche des soldats et des convois. Néanmoins, par les heureuses dispositions qu’il prit et par son énergie, Belle-Isle, trompant l’ennemi, pur se retirer sur la frontière sans avoir perdu un canon.
En rentrant en France, le maréchal ramenait avec lui M. de Saint-Germain, pour qui il s’était pris d’une vive affection; le souci de sa santé autant que la reconnaissance lui avaient inspiré cette décision. A ses familiers qui s’étonnaient de la grande faveur de cet étranger auprès de leur maître, M. de Belle-Isle déclarait :
“ C’est un grand médecin et un artiste né. Dieu, fasse qu’il ne me quitte jamais! ”
Le vieux soldat habitait, à Versailles, depuis son retour en France, un hôtel de grand style où il consumait ses regrets. Il appelait M. de Saint-Germain “ le
- 38 -
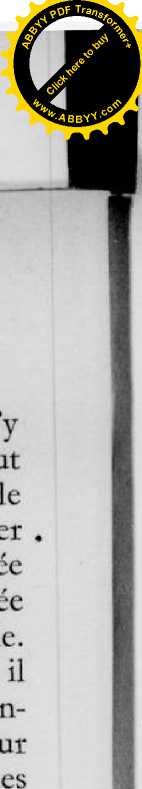

es le, ns
ec ris
ne
•n. de île
u,
un u-ie
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
fils de mes vieux jours ” et lui donna l’hospitalité pendant plusieurs années.
Que fit alors l’aventurier? Si l’on ajoutç foi au témoignage d’un valet de chambre du maréchal, Témerhof, il aurait disposé à Paris, dans la rue Saint-Antoine, d’un laboratoire entretenu parla générosité de son proteéieur. Il s’y rendait deux et trois fois par semaine, se livrant à des travaux de chimie ou retouchant des diamants insuffisamment purs qui lui étaient confies. On l’a accusé d’avoir dérobé des bijoux à Belle-Isle. Mais s’il est vrai qu’on remarqua à son doigt un superbe solitaire qu’avait possédé le maréchal, rien ne prouve que ce ne fut pas une libéralité consentie librement par l’homme qui lui devait tant.
Comme beaucoup de personnes à cette époque, et comme M. de Boulainvilliers notamment, les deux hommes croyaient à l’influence des autres sur la vie humaine. Ainsi que les mages de l’antiquité, ils étudiaient leur marche à travers le ciel. On attribue ainsi à Saint-Germain la decouverte d’un signe annonciateur de jours nćfaśtcs; c’eSt le passage sur la lune des parallèles de Mars et d’Uranus; notre héros inspira en outre la composition de différentes cartes célestes, retrouvées à Versailles, en 1762, après la mort du maréchal.
Enfin Belle-Isle et Saint-Germain pratiquèrent
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
ensemble la nécromancie fort à la mode depuis la Régence.
Dédaignant les anciens procédés des sorcières,
Saint-Germain essaya des expériences catoptriqucs
où il faisait apparaître des esprits dans des miroirs incurvés. Les séances furent d’abord réservées à un petit nombre d’intimes, puis ouvertes à des clients qui, tous, avec conviéfion, s’imaginaient voir évoluer devant eux des âmes chéries, un instant ressuscitées.
A tous ces dons pseudo-scientifiques, Saint-Germain ajoutait encore de réels talents musicaux. C’était un virtuose du violon. 11 touchait aussi fort joliment du clavecin et il avait une manière d’accompagner qui n’appartenait qu’à lui. M. de Gleichen, qui le rencontra chez Mme Lambert, l’ayant félicité à ce sujet, le comte lui dit négligemment :
“ J’adore la musique, mais j’ai dû l’abandonner faute de temps. ”
Deux musiciens, l’un de renom, l’autre illuśtre, sont d’accord sur ce point avec les profanes contemporains. Philidor s’avoua surpris de la poignante mélancolie de son jeu et Rameau, dont la musique passait alors pour très savante et très compliquée, admirait les hardiesses de Saint-Germain dans scs préludes1.
Musicien de grand talent, notre héros montra aussi
i. C’est dans les Mémoires de Mme de Gcnlis que nous avons trouvé ce témoignage de la valeur musicale de M. de Saint-Germain.


a
s S
‘S n s :r
5. r
c.
rt iii
a
ir
it s. ie rs 2S

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
à l’occasion cc qu’il pouvait faire en peinture. Nous nous permettrons à cc sujet de citer ces quelques lignes extraites des mémoires du siècle1.
“ Mon père, déclare celle quides rédigea, était fort en état d’en juger et admirait les connaissances du comte en cc genre. Il peignait à l’huile; non pas de première force, comme on l’a dit, mais très agréablement; il avait trouvé un secret de couleurs véritablement merveilleux, cc qui rendait scs tableaux extraordinaires; il peignait dans le grand genre des sujets historiques et ne manquait jamais d’orner scs figures de femmes d’ajustements, de pierreries ; alors il se sentait de ses couleurs pour faire ces ornements et les émeraudes, les saphirs, les rubis, les opales avaient réellement l’éclat, les reflets et le brillant des pierres qu’ils imitaient. ”
D’après l’auteur, La Tour, Van Loo et d’autres peintres étaient venus pour voir ces tableaux et admiraient extrêmement l’artifice de ces teintes éblouissantes. Liles avaient l’inconvénient d’éteindre les figures, dont elles détruisaient d’ailleurs la vérité, par leurs étonnantes illusions. Mais pour le genre ornemental, on aurait pu tirer un grand parti de ces singulières couleurs dont M. de Saint-Germain n’a jamais voulu donner le secret.
I. Mémoire/ de Mme de Genlij.
— 41 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Ce témoignage cśt d’ailleurs corroboré par celui de Glcichen. Le diplomate danois raconte qu’un soir Saint-Germain l’emmena chez lui et lui montra une admirable collection de bijoux. Négligemment, le comte ajouta :
“ Je ne borne pas mon activité à ces choses; laissez-moi vous montrer quelques tableaux marqués dont vous n’aurez pas vu de pareils de Florence à Naples’. ”
C’était la vérité et, dans le fameux laboratoire de la rue Saint-Antoine, l’artiśte fît voir à l’ambassadeur, qui le raconte, plusieurs tableaux d’une perfection étonnante. L’école de Rembrandt s’affrontait avec celle du Titien; un petit Vinci, probablement authentique, portait tout le poids d’un mysticisme qui symbolisait le maître de céans. Dans le petit bureau où le mystérieux seigneur venait se reposer en toute liberté se dissimulait une Sainte-Famille dc Murillo, protégée par une enveloppe noire contre les regards indiscrets.
La toile tomba brusquement et Gleichen, émerveillé, put discerner pendant quelques minutes qu’elle dépassait en grâce la fameuse “ Gloire de Raphaël ”, l’œuvre magnifique de Versailles?
Nous avons vu ainsi, aux derniers jours de 1936,
1. Gleichen, SûMenirs^

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN un artiste né, contraint, pour se faire apprécier, de faire des fausses toiles de maîtres et nous devons reconnaître que si notre héros pouvait impunément tromper un critique d’art comme le diplomate, c’cśt qu’il était lui-même un maître.
Si l’on ajoute à tous ces avantages que le comte avait un très brillant talent de causeur et révélait dans sa conversation une étonnante connaissance de l’histoire et des pays du monde, on comprendra facilement qu’il lui ait été aisé de séduire non seulement le maréchal de Belle-Isle, mais encore une société aussi éprise dc myśtere qu’assoiffée de spirituel.
Cependant, une carrière aussi heureusement commencée allait s’interrompre brusquement.
Le 4 décembre 1744, Mme de Châteauroux, favorite du roi, fut prise de coliques après l’absorption d’un plat de champignons et contrainte de s’aliter. La cour s’affola devant les conséquences possibles d’une mort que nul remède connu ne parvenait à écarter. Les protégés de la duchesse curent recours à Saint-Germain et lui réclamèrent un contre-poison que le thaumaturge refusa.
“ 11 cśt trop tard, beaucoup trop tard, Mme de Châteauroux va paraître devant son Dieu. ”
Quelques années après, interrogé par Mme d’Adhé-
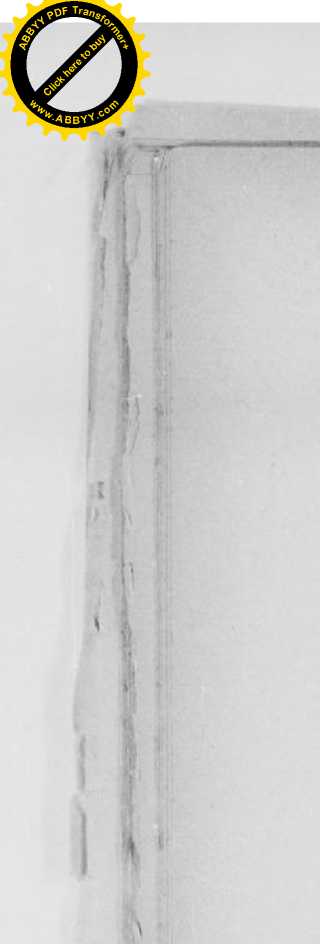
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
mar1 qui le relate dans ses “ Mémoires ”, il livra le myśtere de sa conduite.
“ Si j’avais guéri la duchesse, déclara-t-il, je serais devenu responsable des empoisonnements qui auraient pu survenir dans la suite. Chaque famille m’aurait sommé de faire un miracle, et malheur à moi si j’eusse échoué dans l’entreprise. ” C’était là un raisonnement irréprochable. Mais si la prudence de Saint-Germain put le mettre à l’abri des éventualités qu’il redoutait, elle eut sur le moment l’effet de compromettre sa réputation auprès de la cour et non du roi. Jugeant nécessaire de laisser se calmer l’hostilité qu’on lui manifestait, il décida brusquement de quitter la France, comptant que, chez une nation aussi oublieuse que la nôtre, le temps ferait son œuvre et qu’il recouvrerait sans peine, au moment où il le jugerait opportun, le prestige dont il se sentait dépossédé. Il allait réapparaître, quelques années après à Versailles, dans toute sa
La force de caractère capable de dompter l’impatience demeure sans conteste une des plus grandes qualités de notre héros et la véritable raison de son succès. Nous ne chercherons pas à cacher notre admi-

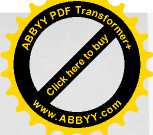
Saint-Germain arriva à Londres au début de l’année 1744. Il y resta jusqu’aux derniers jours de 1745. Son séjour dans cette ville c^t attesté par un témoignage irrécusable; la lettre adressée le 9 décembre 1745 par Horace Walpolc au chevalier Horace Man, envoyé anglais à Florence1.
Dans cette épître, écrite dans un ton familier, Walpolc apprenait à son correspondant que l’on avait récemment enfermé, puis relâché “une sorte de fou, qui vit sous le nom de comte de Saint-Germain, depuis deux ans à Londres. 11 nè veut dire ni qui il cśt, ni d’où il sort. Il se contente d’affirmer deux choses, absolument étonnantes : d’abord qu’il vit

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

sous un nom d’emprunt et ensuite qu’il n’a jamais eu affaire avec aucune femme1.
“ Il chante, joue admirablement du violon, compose, mais ne semble pas très équilibré. Il doit être Italien, Espagnol ou Polonais ajoute le ministre. 11 a vécu à Mexico. Il eśt arrivé à faire fortune on ne sait comment et s’est enfui de là pour Constantinople, avec des bijoux. Le prince de Galles était extrêmement désireux de l’approcher mais il n’y parvint point. Après sa libération, il a prétendu qu’on l’avait emprisonné comme espion. ”
Ce témoignage offre, nous semble-t-il, un certain intérêt. Il nous montre Saint-Germain intriguant Londres comme il avait intrigué Paris, par le mystère de son origine et le séduisant par ses talents artistiques et se donnant aussi, par certaines excentricités, l’apparence d’un être étrange qui ne possède pas tout son bon sens.
Pour nous, Saint-Germain jouait manifestement un rôle. Il voulait, par son attitude énigmatique et par ses bizarreries, détourner l’attention de sa véritable a&ivité*
Ce qui tend à le faire croire, c’cśt cet autre détail
i. Remarquons cette assertion de Walpolc. Saint-Germain était Rose-Croix et les membres de cet ordre évitaient le mariage. Franz Hartmann, historien du XIXe siècle, est précis sur ce point dans sa brochure “ Au seuil du sanétuaire ”, mais il cSt hors de doute que notre héros prit de grandes libertés vis-à-vis de toutes les sociétés auxquelles il fut affilié.
- 48 -

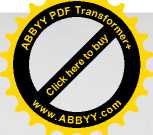
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
que nous relevons dans un article du Daily Chronicie de 1760, époque à laquelle Saint-Germain revint en Grande-Bretagne? Le journaliste anglais, faisant un retour sur le premier séjour du comte dans Pile, rapporte qu’en 1745 il eut maille à partir avec un jaloux, au sujet d’une histoire d’amour. Cet homme, dont on affecte d’ignorer le nom, aurait mis dans une des poches de notre personnage une fausse lettre du prince Charles-Edouard et le fit arrêter comme traître à la couronne. Il ajoute d’ailleurs que l’enquête menée à ce propos prouva l’innocence complète de M. de Saint-Germain et qu’on fut obligé de le relâcher.
Cette anecdote cadre bien avec la lettre de Walpole et l’on s’explique et les protestations misogynes du prisonnier et sa déclaration touchant les motifs de son emprisonnement, mais l’absence de nom du jaloux peut permettre aux imaginations de reprendre leur vol, car rien ne s’oppose à ce que M. de Saint-Germain, certain du résultat de l’enquête, n’ait mis dans sa propre poche une lettre destinée à détourner dans l’avenir les foudres de “ l’Intelligence Service ” du temps.
Si l’on admet, comme nous penchons à le croire, que notre héros appartenait par sa naissance au cercle des Stuart exilés, il aurait bien été envoyé en Angleterre pour préparer l’insurredion jacobite qui allait éclater en 1746.
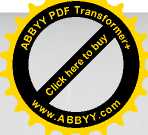
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
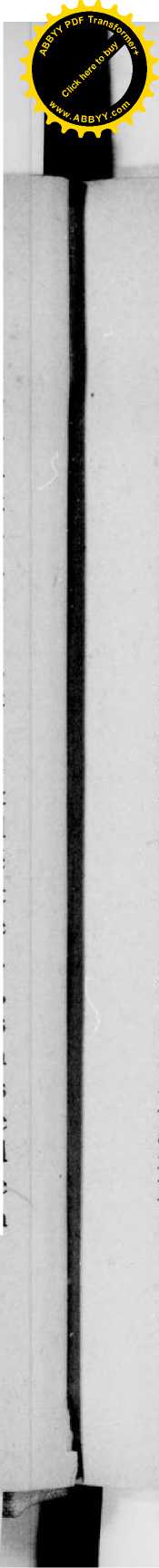
Jacques III, en effet, découragé par son échec de 1716, semblait avoir renoncé à toute entreprise pour regagner son trône, mais son fils aîné, Charles-Edouard, ne se résignait point à l’inaction. Né à Rome en 1720, il avait eu pour précepteur le fameux Ramsay, l’ami de Fénelon, personnage assez inquiétant, que certains historiens vont même jusqu’à accuser d’avoir trahi la cause des Stuart, dont il s’affirmait le champion. Il ne négligea pourtant rien, de manière à donner à Charles-Edouard et à son frère, plus jeune de cinq ans, une éducation parfaitement soignée.
Polyglotte, musicien de talent, le prince avait fait de brillants débuts dans la carrière militaire, pendant la guerre de Succession de Pologne, sous le maréchal de Berwick. Il joignait à un grand courage une bonté de cœur égale. Le président Desbrosscs, qui le vit en 1740, loue son amabilité, sa politesse et trouve seulement à lui reprocher une excessive dévotion. Lorsque s’ouvrit la guerre de Succession d’Autriche, Charles-Edouard brûlait de servir à nouveau dans les armées françaises. 11 se trouvait à Rome, dans son palais de la rue des Saints-Apôtres, lorsque, dans les derniers jours de 1743, Jacques III reçut la visite mystérieuse de son agent confidentiel à Paris, lord Sempill. L’Angleterre venait d’entrer dans la lutte et Georges II en personne avait battu à Dettinghem


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
le comte de Clermont (26 juin 1743). Le cabinet français, pour faire pièce à la Grande-Bretagne, avait naturellement repris les projets traditionnels de la France : susciter des ennemis à la dynastie de Hanovre sur le sol anglais. Pour cette raison, Versailles s’empressa de soutenir activement le prétendant Stuart. La duchesse de Châteauroux, maîtresse de Louis XV, était favorable à la cause jacobite et elle poussa le roi à donner son concours à une expédition que Jacques III tenterait en Angleterre. Celui-ci, déjà vieux et n’espérant sans doute point un meilleur résultat qu’une trentaine d’années plus tôt, laissa son fils courir l’aventure. Charles-Edouard échoua une première fois et refta pendant quelque temps inaétif mais, en 1745, il prépara minutieusement une expédition en Écosse et, au mois d’août, prit terre dans ce pays.
On sait quelles furent les vicissitudes de la campagne et comment, après une succession de victoires qui le menèrent jusqu’à 35 kilomètres de Londres, ses troupes furent battues à Cullodcn en 1746. Bien que sa tête fût mise à prix, Charles-Edouard ne pouvait se résigner à quitter sa patrie, mais enfin, de guerre lasse, abandonné peu à peu par ses partisans, il s’embarqua pour la France, qu’il atteignit à Roscoff, le 10 oétobre.
Le gouvernement anglais exerça de sauvages repré-

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN sailles sur ceux qui avaient soutenu son adversaire.
E$t-il téméraire d’imaginer que le séjour de Saint-Germain en Angleterre, au moment même où se préparait l’expédition du prétendant, n’cśt pas une simple coïncidence et qu’il a pu être mêlé aux traéta-tions qui aboutirent à la révolte?
Grâce à l’alibi moral qu’il s’était ménagé par son attitude étrange, grâce aussi aux précautions qu’il sut prendre, il put se tirer des fâcheuses conséquences de son dévouement. Mais il reśte certain que si les opinions de notre héros n’avaient point été sujettes à caution, la fausse lettre n’aurait pas servi à grand-chose. Dans le cas toujours possible où il l’aurait mise lui-même, elle indique avec autant de sûreté que le comte était bel et bien un agent secret de la cause Stuart iśtc.
Après cette aventure, Saint-Germain disparaît à nouveau.
D’après une lettre qu’il adressa à son ami, le comte de Lemberg, chambellan de l’empereur d’Autriche (1729-1792)!! aurait fait deux voyages aux Indes, line nous a donné aucun détail sur le premier, mais il nous a fourni sur le second certains renseignements qui ne manquent point de piquant. Il l’a entrepris en 1755, avec le colonel Robert Clive, celui-là même qui devait fonder la puissance anglaise dans l’Inde, s’emparer de Calcutta et chasser les Français des rives du Gange.
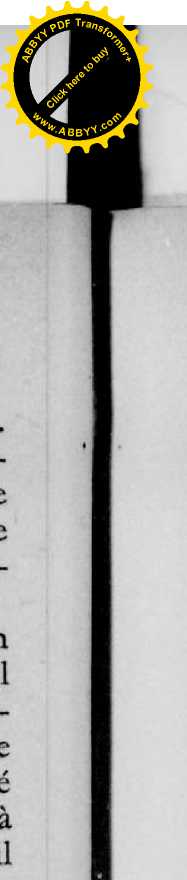
e t
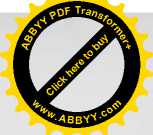
a
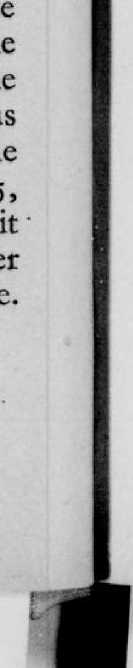
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
“ L’escadre était sous les ordres du vice-amiral Watson. Pour de bonnes raisons, je m’étais donné auprès de mes compagnons pour le comte C. Z. Partout où nous touchions terre, je recevais les mêmes distinctions que l’amiral1. ”
Il se lia intimement avec le nabab de Baba, qui voulut même garder auprès de lui un prétendu fils de l’aventurier2. Le nabab aimait converser avec notre héros et se montrait curieux des choses de l’Angleterre. L’un de ses plus grands plaisirs était d’entendre Saint-Germain lui décrire les courses de chevaux de Newmarkct, et lui raconter les prouesses d’un cheval célèbre, Eclipse, qui, plus rapide que le vent, couvrait un mille anglais en une minute. Le nabab était fortement anglicisé. Tous scs courtisans portaient des noms anglais et, parmi ses enfants, il avait un prince de Galles, un duc de Gloucester, un duc de Cumberland. Quand l’amiral Watson venait ie voir, il s’informait de la santé du roi George. Ayant appris un jour que celui-ci avait perdu son fils aîné il s’écria en soupirant :
“ Moi aussi, j’ai perdu mon prince de Galles. ”
i. Déplacées au xix" siècle du British Muséum, ces lettres doivent être conservées au Ministère des Affaires Étrangères de Calcutta.
2. Aucune archive ne décèle la présence d’un fils de Saint-Germain sans doute né dans l’imagination dc M. C. Volz, Der Graf von Saint-Germain, 1912.
— JJ —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
C’eSt à ce second voyage dans les Indes que Saint-Germain devait, d’après scs propres affirmations, la découverte de l’émail des pierres précieuses. Lors de son premier séjour, il n’aurait acquis sur ce merveilleux secret que de minces connaissances, perfectionnées dans ses recherches à Paris, à Vienne et à Londres. C’cSt enfin vers le même temps qu’il lui aurait été donné de trouver la pierre philosophale.
Il y a, certes, bien des hâbleries dans un pareil récit et Saint-Germain s’amusait de la crédulité de son correspondant. Ne peut-on pas cependant en retenir quelque chose? Notre héros n’y dévoile-t-il pas une partie de son temps, pendant les années où l’on perd sa trace? Il serait allé à Vienne, sans doute apres avoir fait un détour à Paris, après la ruine des espoirs de Charles-Edouard, et serait retourné à Londres, d’où il se serait embarqué pour les Indes. Mais, comme il était connu en Angleterre, sous le nom de Saint-Germain, comment admettre le nouveau titre dont il se para? 11 y a sur ce point quelque chose de très obscur, à moins d’admettre la connivence de Watson et de Clive, qui, séduits, se seraient faits complices de sa supercherie.
Quant à la tolérance que semble lui avoir témoigné le gouvernement anglais, elle ne saurait surprendre, étant donné que Saint-Germain, suivant les alléga-
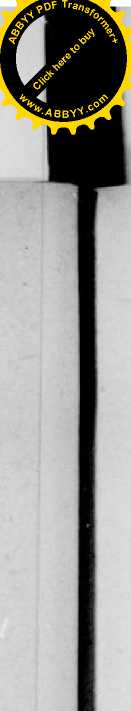
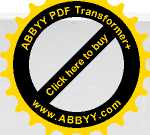
LE COMTE DE SAINT GERMAIN
tions de Gleichcn1, lui aurait livré les pic,ns de bateaux de son invention, destinés au transport de troupes en Angleterre. Le geśte peut ne point paraître élégant, mais Ton sait qu’en matière d’espionnage, il eśt de pratique conśtante de fournir des documents de peu d’importance pour s’assurer la confiance de l’ennemi et pour obtenir des avantages supérieurs. L’invention dc M. de Saint-Germain ne devait avoir qu’une valeur médiocre puisque les bureaux de Maurcpas, ministre de la Marine, qui donnait alors une vigoureuse impulsion à la réorganisation de notre flotte, n’avaient pas cru devoir la réaliser.
Les voyages de notre héros aux Indes présentent encore un autre intérêt. N’aurait-il pas profité de son intimité avec le nabab et n’eśt-ce pas à la libéralité du monarque indou qu’il devait ses bijoux merveilleux dont il allait faire bientôt un si complaisant étalage à la cour de Versailles? N’cst-il pas entré, pour une part, dans les effrayantes rapines auxquelles Robert Clive se livra dans l’Inde et qui lui valurent par la suite d’être mis en accusation par le parlement?
Combien de temps dura le séjour de Saint-Germain aux Indes? il eśt impossible, dans l’état actuel de la question, de le dire d’une façon précise. Nous ne
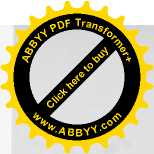
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN sommes pas mieux renseignés sur la date exacte où Saint-Germain réapparut en France pour y jouer cette fois des rôles de premier plan et y mener les années les plus brillantes de son existence.
Ce dut être très probablement en 1757, car dans ses “ Mémoires ” Casanova nous raconte à cette date un dîner qu’il fit chez sa dupe, la marquise d’Urfé, en compagnie de Saint-Germain, qu’avait amené la comtesse de Gorgy. Il nous le dépeint comme possédant déjà la faveur royale et celle de Mme de Pompa-dour, et il ne peut s’empêcher d’en marquer un certain dépit. Il ignorait naturellement les services que le comte avait pu rendre au monarque et il cherchait la raison de cette faveur dans l’avidité de distrayions que Louis XV désirait pour échapper à l’ennui incurable qui le rongeait. Certes, sa psychologie n’était pas en défaut, car si le roi put être guidé, dans la conduite qu’il tint vis-à-vis de Saint-Germain, par un sentiment de reconnaissance, il eSt hors de doute que le motif déterminant fut la curiosité qu’excitèrent en lui la prodigieuse personnalité et les talents multiples de l’aventurier.
Cet homme aux propos surprenants, à l’activité merveilleuse, était bien le meilleur antidote que pouvait rêver le roi contre la tristesse désenchantée dont il souffrait.
Roi à cinq ans, élevé par un gouverneur, le maré-
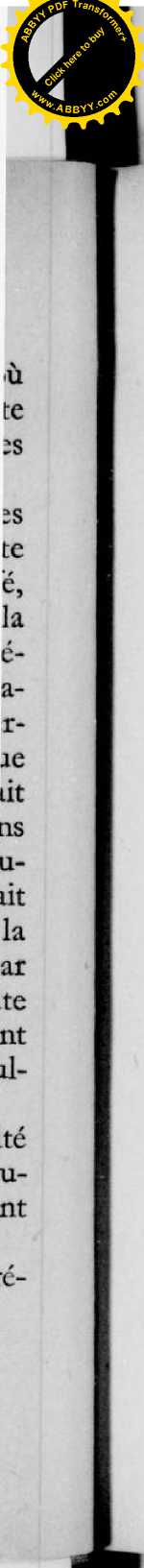

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
chai de Villeroy, qui se pliait à tous ses caprices, adulé par une cour ambitieuse d’accomplir scs moindres désirs, il avait touché le fond de la toutc-puis- • sanee et épuisé toutes les distrayions. Naturellement distant et renfermé, il ne pouvait se défendre d’une méfiance dédaigneuse pour les flatteurs qui l’entouraient.
Le comte tranchait vigoureusement sur la plate banalité de son entourage. Le souverain aimait la franchise déférente avec laquelle notre héros lui parlait et il trouvait dans son commerce un dérivatif puissant aux fades adulations qui, de toutes parts, l’assaillaient. Très probablement au courant de la bonne origine de Saint-Germain, il ne croyait pas déroger en lui manifestant un intérêt qui, à l’occasion, lui était profitable. 11 se créa donc entre le monarque et le coureur d’aventures une sorte de sympathie à base de confiance réciproque. Le crédit de notre héros, qui s’appuyait déjà sur la gratitude de M. de Belle-Isle, trouvait en outre un nouveau promoteur dans la favorite en titre, Mme de Pompadour.
A l’époque où nous sommes, il y avait treize ans qu’elle avait succédé à Mme de Châteauroux dans les faveurs du roi.
Jeanne-Antoinette Poisson était, raconte le président Hénault “ une des plus jolies femmes que j’aie jamais vues ”. Fille non pas d’un trafiquant douteux,

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
comme on l’a écrit trop souvent, mais d’un financier collaborateur des frères Paris, les deux banquiers qui possédaient le privilège de prêter à la Couronne, elle faisait partie d’une grande famille de la bourgeoisie française. Elle avait été mariée très jeune à un gentilhomme normand, M. d’Etioles, que les scrupules ne gênaient guère et elle avait mené une existence provinciale un peu terne, surtout quand la banque Paris dût sacrifier à l’intransigeance des hauts fournisseurs de l’armée un de scs chefs les moins importants, son père, Antoine Poisson. Jalouse de produire ses talents pour la comédie et pour le chant Mme d’Etioles avait brillé d’un vif éclat sur le théâtre privé de son oncle, M. de Tournehem, que fréquentait un public de lettres et d’artistes, prompt à s’émouvoir. Mais son ambition ne se bornait pas là.
Au fond d’elle-même avait germé l’espérance de conquérir la cour du roi de France. Elle avait vu à plusieurs reprises Louis XV chasser près de chez elle, en forêt de Sénart1. A l’aide de multiples complicités, sa liaison avec le monarque qui l’agréa devint effective après une présentation qui eut lieu pendant un bal à l’Hôtel de Ville. Devenue rapidement marquise de Pompadour, la jeune femme n’eut pas d’adversaire plus terrible que cet ennui qui, malgré tous ses efforts,
i. Nous avons pu recueillir la majorité de ces renseignements dans l’œuvre de Piere de Nolhac, Inouïs XV et Mme de Pompadottr.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
s’emparait de jour en jour davantage de l’esprit du souverain.
C’eśt sans doute la raison pour laquelle Mme de Pompadour, jalouse pourtant de tout ce qui pouvait menacer sa faveur, ne vit pas un danger dans la pro-teâion que Louis XV accordait à M. de Saint-Germain. Au contraire, elle découvrit dans notre héros une aide, un secours pour les jours noirs où l’habileté complaisante de son corps bien dressé, la grâce de son esprit et les mille artifices de son imagination féconde demeuraient sans effet sur la neurasthénie royale, lilie la combattait cependant par des fêtes brillantes qui se déroulaient à l’Hôtel de Ville et se renouvelaient quelques jours après à Versailles avec toute leur pompe. M. Pierre de Nolhac nous raconte dans “ Louis XV et Mme de Pompadour ” une de ces grandes réjouissances auxquelles la tradition voulait que le roi de France conviât le plus grand nombre de scs sujets à célébrer avec lui cet heureux événement et nous nous excusons de nous inspirer quelque peu du grand historien de Versailles pour ébaucher un tableau approximatif d’une des fêtes que M. de Saint-Germain aimait illustrer de sa présence.
“ Les jours de réception, le château était illuminé sur les façades du côté des cours. Vers les jardins, il semblait se resserrer autour des candélabres. Les nombreuses compagnies qu’amenaient, par le froid

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
sec de cette nuit d’hiver, tous les carrosses de la capitale, apercevaient de loin, sur la hauteur, le rayonnement des lumières montant dans le ciel, qui semblait dessiner au-dessus du palais un halo irréel de château de fées.
“ Vers le milieu de la nuit, l’affluence redoubla. Le grand appartement et le jeu de la reine commencé à six heures dans la Galerie des Glaces avaient pris fin à neuf heures pour laisser le roi et la reine manger à leur grand couvert. A minuit devait s’ouvrir le bal masqué. Un nouveau public entrait à cette heure dans le château; c’était Paris qui arrivait pour avoir sa part des réjouissances royales.
“ Deux files de carrosses avançaient lentement dans l’avant-cour. Les masques mettaient pied à terre à l’escalier de marbre et à la cour de la Chapelle et pénétraient des deux côtés dans les appartements. Aucun billet n’était exigé; dans chaque compagnie, une personne se démasquait, dont l’huissier prenait le nom avec le nombre de masques qui étaient avec elle. Comme on donnait le nom que l’on voulait, une formalité aussi simple ne pouvait éloigner personne. ”
Cette cohue que décrivent les mémorialistes se transforme, dans la célèbre cStampc de Cochin, en une foule élégante qui circule aisément dans un décor magnifique. La Galerie ruisselle de lumières, luśtres,
— ôo —
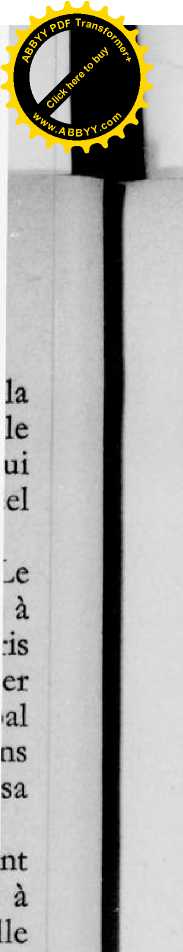
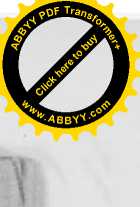
ts. e, ut ec it, er
se ne Dr ‘s,
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
torchères et girandoles se multiplient dans les glaces. Sous les plafonds pompeux de Le Brun s’anime la mascarade : Arlequins et Colombines, Turcs, Arméniens, Chinois, médecins à hautes perruques, sauvages emplumés, pèlerins, bergers, magiciens, diables, folies. Les dames, placées sur des gradins, prennent des rafraîchissements offerts par des pages. Dans un coin, toute une compagnie assise sur le parquet boit et mange; elle eśt là pour rappeler que cinq ou six cents masques, assis par terre dans les salons voisins, s’empiffrent aux frais du roi des viétuailles pillées au buffet.
La princesse de Conti ne trouve pas une place; un masque lui refuse la sienne et quelqu’un qui s’eśt assis fort près de la reine et que personne n’a pu reconnaître se lève pour lui donner un siège. C’est le prince Charles-Édouard lui-même.
Malgré le froid vif, une farandole dont la tête eśt déjà perdue dans l’obscurité descend par derrière le château les escaliers du parc. Une femme petite, dont un long bonnet d’alchimtéte corrige la faible taille, dirige la sarabande; elle est masquée comme les autres mais, malgré le secret qui l’entoure, tous ont reconnu Mme de Pompadour. A l’intérieur du palais une porte de glaces s’est ouverte et la foule s’écarte devant des personnages sans masques, qui s’avancent, entourés de curiosités et d’hommages. La reine,
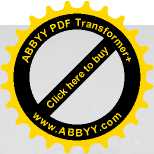
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN posant la main sur le bras de son chevalier servant, précède le dauphin costumé en jardinier, qui tient le bout des doigts de la dauphine, travestie en bouquetière. Derrière eux sont le duc et la duchesse de Chartres qui danseront dans leur quadrille et quelques relations intimes.
Seul, le roi semble manquer à la fête. Mais voici qu’une singulière compagnie vient de sortir de son appartement; ce sont des ifs taillés dans le goût de ceux d’un jardin. Le roi cśt l’un de ces huit masques et M. de Saint-Germain en cśt un autre. D’aimables jeunes femmes, intriguées par le secret à demi connu et par la difficulté de le dévoiler complètement, entourent un de ces arbres que notre personnage appelle “ Sire ” mais elles croient à une supercherie et volent vers un but différent tandis que le monarque, qui avait prévu la chose, rit de bon cœur sous cape de l’erreur des dames, car sous la śtrućłure de fils de fer et de bois qui soutiennent un habile camouflage, nul n’a reconnu le monarque.
Des femmes de la finance, de la magistrature ou de simples bourgeoises de Paris sont venues étaler ce soir à la cour leurs grâces inédites et l’agrément de leurs ajustements. Parmi celles qui se démasquent à l’envi, combien rêvent de rencontrer le roi et de fixer son caprice? Un témoin nous le raconte; toutes les beautés de la ville se sont rassemblées en ce jour-là
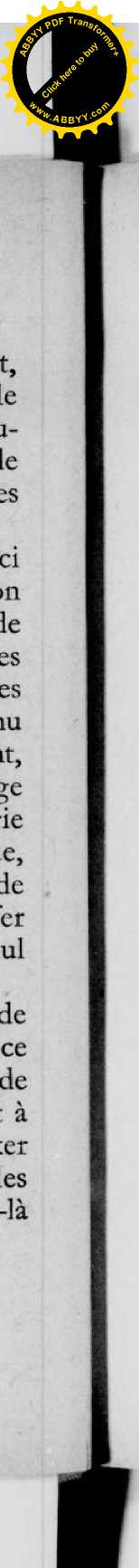

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
pour conquérir le roi couvert de gloire dont le cœur eśt libre et qui eśt le plus bel homme du monde. La foule des prétendantes eśt infinie, dit l’abbé de Bernis qui voit leurs manèges et qui connaît la plupart de celles que le roi agace et provoque. Il mentionne même le succès d’une jeune fille extrêmement belle dont les parents sont de ses amis; un chroniqueur plus indiscret cite une présidente libertine, Mme Portail, qui se laisse emmener dans les petits appartements par un if qu’elle suppose être le roi. Il faut conśtater, en ces fêtes, la presque totale amoralité des femmes de la société bourgeoise. La dernière des sœurs de Nesle, la duchesse de Lauraguais, la princesse de Rohan affirment l’apparente dignité de la noblesse, mais, pour les Vénus et les Junons sous l’habit desquelles se cachent les femmes des classes moyennes, n’cst-ce pas le moment rêvé de solliciter le jugement de Paris?
Par cette cérémonie, comme par celles qui devaient lui succéder, Mme de Pompadour essayait de combattre cette nośtalgie terrible qui pesait sur l’esprit du roi. Elle voulait avant tout pallier ce mal romantique par des déplacements, des distractions et aussi par les plus lâches complaisances. C’eSt sur son impulsion qu’en 1755 Louis XV acheta à Versailles un hôtel de Style où les dames et les jeunes filles de bonne naissance, confiantes en leurs charmes,
— 63 —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN venaient distraire leur maître et tenter de lui faire oublier l’ennui qui le minait. Ce fut au parc aux Cerfs que se déroula, entre autres histoires lamentables, un incident dont Saint-Germain hâta la solution.
Un père dénaturé, M. de Palois, avait mis comme condition au mariage de sa fille Hélène avec le vicomte de Bénavent-Rhodès, le sacrifice complet de la jeune fiancée à son roi. Elle arriva ainsi un matin à Versailles, sous bonne escorte. La détermination de la jeune fille était prise. Elle s’empoisonnerait s’il le fallait, sous les yeux du souverain, mais elle le manda auparavant à Louis XV par le moyen d’un billet qui fut décacheté dans la tribune de la chapelle.
Épouvanté par cette résolution extrême, le monarque dépêcha un officier de sa maison, le marquis de Pontécoulant, pour annoncer à la jeune fille qu’il renonçait à elle. Le secours arriva trop tard et le poison avait commencé son œuvre quand le porteur fut introduit auprès de l’agonisante. Divers médecins essayèrent, sans succès, de la ranimer, mais ils durent avouer l’inutilité de leurs efforts. M. de Saint-Germain fut appelé, on ne sait exactement par qui. Il tenait dans les mains un gobelet de cristal et un flacon plein d’une liqueur verte.
Il s’avança vers le lit de la mourante, dessina dans


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
l’air, suivant sa coutume, un cercle magique autour d’elle, versa dans le verre un peu d’eau dans laquelle apparut rapidement l’émeraude de six ou sept gouttes de son élixir. La chambrière du vieil hôtel tenait la tête de la nouvelle pensionnaire. A travers les dents serrées, le thaumaturge chercha à faire passer le contenu du verre. Hélène de Palois devenait de minute en minute plus pâle. Son corps qui s’abandonnait tout entier retomba sur le lit couvert de dentelles.
— Elle cśt morte, s’écria-t-on.
— Elle cśt sauvée, répondit le comte de Saint-Germain, et dans quelques heures elle se réveillera d’un profond sommeil pour nous remercier de ne pas lui avoir laissé faire une grande folie.
Pouchet précise dans scs “ Archives de Police ” que Mlle de Palois sortit du parc aux Cerfs avec un portefeuille contenant un bon de 500.000 livres pour le Contrôleur des finances. C’était l’amende honorable de Louis XV.
Cette merveilleuse intervention accrut, comme on le pense, le prestige de notre héros. 11 n’avait point fini d’étonner, car ses talents d’astrologue devaient lui permettre bientôt d’augmenter son renom. Mme de Pompadour, qui avait entendu parler de ses travaux avec Belle-Isle, voulut se rendre compte par elle-même de ce que pouvait dans ces matières M. de
— 65 —
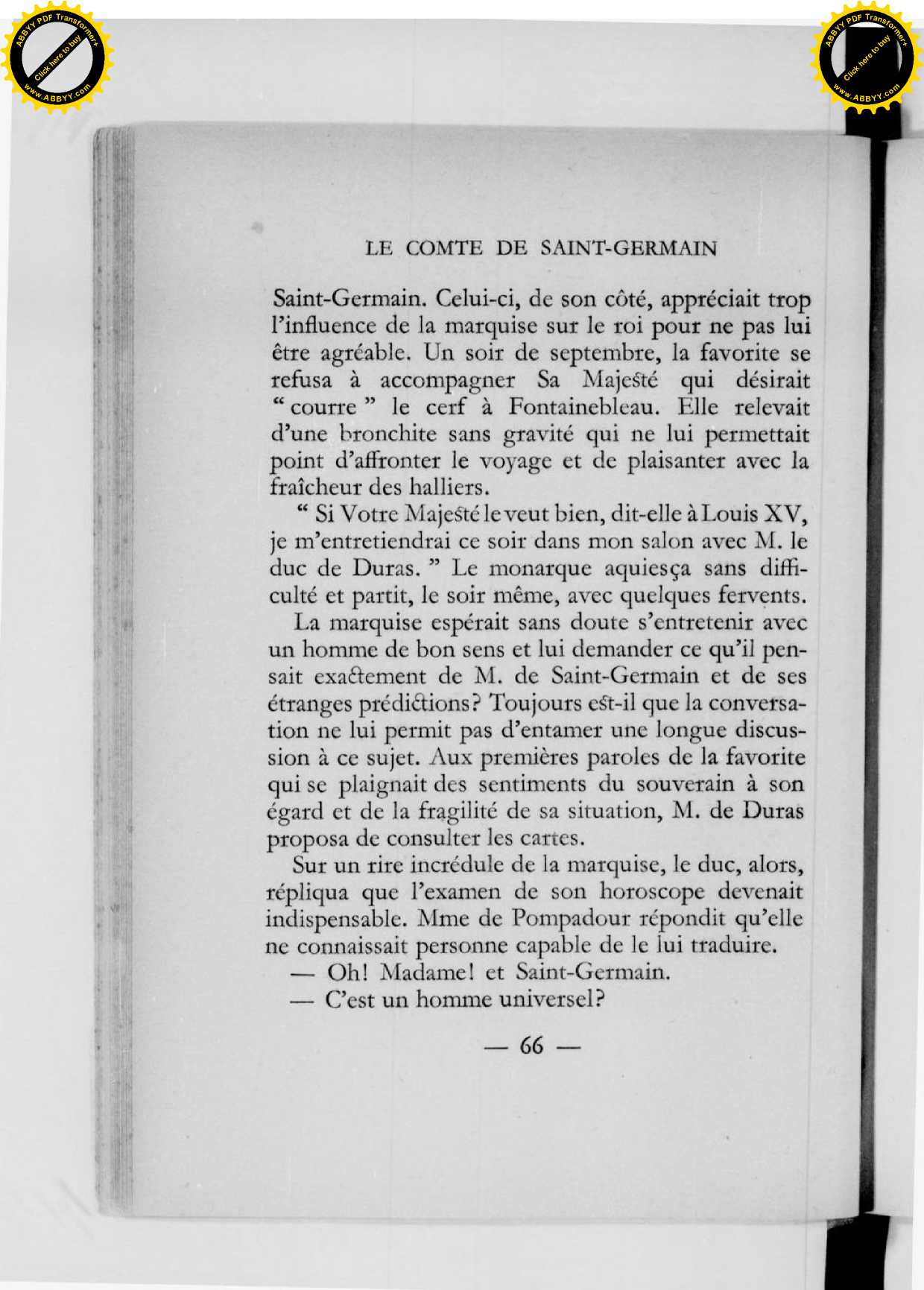
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
monarque aquiesça sans difli
d’une bronchite sans gravité qui ne lui permettait point d’affronter le voyage et de plaisanter avec la fraîcheur des halliers.
“ Si Votre M ajesté le veut bien, dit-elle à Louis XV, je m’entretiendrai ce soir dans mon salon avec M. le
Saint-Germain. Celui-ci, de son côté, appréciait trop l’influence de la marquise sur le roi pour ne pas lui être agréable. Un soir de septembre, la favorite se refusa à accompagner Sa Majcśtć qui désirait “ courre ” le cerf à Fontainebleau. Elle relevait
culte et partit, le soir même, avec quelques fervents.
La marquise espérait sans doute s’entretenir avec un homme de bon sens et lui demander ce qu’il pensait exactement de M. de Saint-Germain et de scs étranges prédictions? Toujours eśt-il que la conversation ne lui permit pas d’entamer une longue discussion à ce sujet. Aux premières paroles de la favorite qui se plaignait des sentiments du souverain à son égard et de la fragilité de sa situation, M. de Duras proposa de consulter les cartes.
Sur un rire incrédule de la marquise, le duc, alors, répliqua que l’examen de son horoscope devenait indispensable. Mme de Pompadour répondit qu’elle ne connaissait personne capable de le lui traduire.
— Oh! Madame! et Saint-Germain.
— C’est un homme universel?


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
— C’eSt un dilettante aimable que je ne crois pas dénué de tout scrupule, quoiqu’on en prétende.
Le comte de Saint-Germain, pressenti, accepta la mission et quelques semaines après, apporta la décision des aStrcs.
Il présenta scs hommages à Mme de Pompadour et lui dit tout le plaisir qu’il avait eu à travailler pour elle.
“ J’ai senti à l’avance, madame, que les aśtres vous seraient favorables. Vous êtes venue au monde après un jour particulièrement nćfaśte, comme si les enfers avouaient devant votre berceau leur impuissance à vous combattre. Je me permets de venir vous offrir le résumé de mes recherches; elles sont étendues autant que le permettent mes faibles connaissances. ”
Cet horoscope fut concluant, si l’on en juge par la conduite ultérieure de la marquise à l’égard de Saint-Germain qu’elle ne cessa de combler de prévenances.
Nous aurions été heureux de joindre à cet ouvrage une copie de l’œuvre de notre héros. Mais après être re§tée longtemps dans les papiers de la favorite, elle fut détruite vraisemblablement pendant la tourmente révolutionnaire et nous sommes obligés, pour en donner une idée, de nous rapporter à l’hiStorien Soulavie1. .
i. Soulavie, Anecdotes de /a cour de France.
— 67 —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Avec infiniment de taft et d’esprit, 1’aśtrologue improvisé racontait le passé de la marquise et, sans faire allusion aux origines bourgeoises de Mme d’Etioles, il évoquait sa naissance, complimentait le roi de son goût et prédisait sans exagération, mais aussi sans ces lieux communs qui suffisent à déprécier les fouilleurs d’avenir populaire, une existence heureuse sur laquelle la mauvaise fortune n’aurait point de prise.
En phrases un peu vagues, que l’on pourrait interpréter de multiples façons, il semblait annoncer une perte d’influence de Mme de Pompadour et la reprise victorieuse de la liaison à peine interrompue.
La période qui suivit la tentative d’assassinat de Damiens, pendant laquelle le roi se détacha de Mme de Pompadour et songea même, dit-on, à se séparer d’elle, montre que la prédiction de notre héros, historique ou non, se réalisa entièrement.
Tout en se livrant ainsi à 1’aśtrologic, Saint-Germain poursuivait, dans des conditions bien meilleures que lors de son premier séjour en France, ses recherches scientifiques.
Casanova1 nous apprend, et M. de Gleichen2 est d’ailleurs entièrement d’accord avec lui sur ce point, que Louis XV donna à Saint-Germain une résidence
i. Casanova, Mémoires.
z. Gleichen, Souvenirs.
ra-ent sis-une
ue et, de ?li-


ter-une : la
DUC. t de e de •arcr i§to-
Ger-:ures :her-
r est oint, lence
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
à Chambord, ainsi qu’une somme de 100.000 livres pour lui permettre de travailler à ses couleurs, grâce auxquelles il se faisait fort d’assurer aux fabriques de toiles françaises la prééminence sur celles de tous les autres pays. Il ajoute même que Saint-Germain avait captivé le roi à un tel point qu’il lui avait ménagé un laboratoire au Trianon. Nous ne savons rien au sujet de cette assertion1.
Quant au séjour de Saint-Germain à Chambord, il ne saurait être mis en doute, bien que le souvenir n’en ait point été conservé, au château même, où l’on affirme encore que jamais notre héros n’a résidé.
Pour que nul ne les ignore, nous transcrirons ici deux lettres qui prouvent de façon péremptoire que le protégé de Belle-Isle vint à Chambord après la mort du maréchal de Saxe.
Voici d’abord la correspondance du marquis de Marigny à l’abbé de la Pagerie. Écrite à Versailles, elle porte la date du 2 septembre 1756.
“ J’ai reçu votre lettre du ier du mois passé. Le roi a assigné au comte de Saint-Germain une habitation à Chambord et vous dites, avec raison, que c’cśt un homme de mérite. J’ai eu l’occasion de me convaincre à ce sujet par plusieurs entretiens avec lui. ”
1. Gustave Volz en parle évasivement dans la ir édition de Graf von Saini-Germain, Leipzig.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Collet, majordome des châteaux de Chambord, écrit deux jours après au comte de Marigny :
“ Le comte de Saint-Germain eśt arrivé ici avec deux messieurs. Il reitera ainsi cinq à six jours et les invitera chez lui à Paris1. ”
Quels furent les résultats des recherches du comte? C’eit ce que nous ignorons, quoique les présomptions semblent être en faveur d’un échec, sans quoi il serait bien étrange que le silence le plus complet se soit fait.
Que faut-il penser aussi des secrets qu’il aurait possédés pour la fabrication des diamants? Un grand nombre de témoignages du temps l’affirment comme une chose indiscutable et le monarque lui-même partagea l’opinion générale, si l’on en croit l’anecdote suivante2.
“ Un jour que Louis XV, la marquise et quelques familiers parlaient à Saint-Germain du pouvoir qu’il avait de faire disparaître les taches des diamants, le roi en fit apporter un de grosseur moyenne, assez légèrement maculé.
“ On le pesa soigneusement.
“ Ce diamant eśt eśtime 6.000 livres, mais il en vaudrait au moins 10.000 sans ce défaut. Voulez-
1. Gustave Volz, Der graf von Saint-Germain.
2. Elle figure au nom de Saint-Germain dans le grand Larousse encyclopédique,

td,
tec les

du réins lus
■ait tnd
me
>ar-ote
ues u’il its, sez
en ez-
/clo-
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
vous nous charger de me faire gagner 4.000 livres?
“ Le comte ne pouvait refuser à Sa Majesté. Il examina la pierre avec soin et répondit que c’était possible et que dans un mois, il le rapporterait. En effet, peu de temps après, il rendait à Louis XV, assez étonné, un diamant enveloppé dans une sorte de toile d’amiante. On le pesa de nouveau et la différence était à peine sensible. M. de Gontaut, envoyé immédiatement chez le joaillier de la couronne, rapporte 9.600 livres; le roi fît demander le diamant et le garda par curiosité. ”
Mais était-il bien le même? En un mois, le comte avaitpu envoyer à Amsterdam Tordre de faire tailler une autre pierre à peu près semblable et sans tache. Grâce à ses ressources, la différence de prix était pour lui peu de chose. Le monarque n’en fut pas moins étonné et s’écria que Saint-Germain avec ce secret devait être riche à millions, surtout s’il savait, comme on l’affirmait, fondre plusieurs petits diamants en un seul. Aune question que Louis XV lui posait dans ce sens, il ne répondit ni oui ni non, mais il affirma qu’il savait grossir les perles et leur donner la plus belle eau. La perle étant causée par une maladie de l’huître, il prétendait savoir aussi provoquer cette maladie.
Là ne sc bornaient point, à l’entendre, scs connaissances car il lui était possible, affirmait-il, de fabriquer des diamants chimiques.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
A Mme de Pompadour qui l’interrogeait un jour sur ce point, le comte fit voir une petite boîte contenant des diamants de très belle eau, des topazes, des rubis, et des émeraudes. “ Il paraît, affirme Mme du Hausset1, qui fut la première femme de chambre de la marquise, qu’il y en avait pour des trésors.
“ Madame m’avait appelée pour voir toutes ces belles choses. Je les regardai avec ébahissement, mais je faisais signe à Madame par derrière que je croyais tout cela faux. Le comte ayant cherché quelque chose dans un portefeuille, grand deux fois comme un étui à lunettes, il en tira deux ou trois petits papiers qu’il déplia. Il fit voir un superbe rubis et jeta de côté sur. la table avec dédain une petite croix de pierres blanches ou vertes. Je la regardai et dit : “ Cela n’est pas tant à dédaigner. ” Je l’essayai et j’eus l’air de la trouver jolie. Le comte me pria aussitôt de l’accepter, je refusai, il insista. Madame refusait aussi pour moi. Enfin il pressa tant et tant que Madame, qui croyait que cela ne pouvait guère valoir plus de quarante louis, me fit signe d’accepter. Je pris la croix, fort contente des belles manières du comte et Madame, quelques jours après, lui fit présent d’une boîte émaillée sur laquelle était un portrait de je ne sais quel sage de la Grèce. Je fis au rcśtc
i. F. Barrière. Bibliothèque des Mémoires relatifs à l’hiStoire de France,
Mme du Hausset, femme de chambre de Mme de Pompadour, Firmin-Didot et C1".
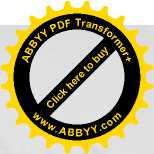
A
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN estimer la croix qui valait quinze cents francs. ” Le comte possédait certaines formules inconnues. Ce fait nous paraît incontestable. ESt-ce de cette connaissance que s’inspira, plusieurs années après, le fils d’un contrôleur des meubles de la Couronne, Pierre de Fontanieu, lorsqu’il publia en 1778 : “ L’art de faire des cristaux et des diamants colorés imitant les pierres précieuses ” dont nous avons retrouvé à Vienne, en Autriche, quelques rares exemplaires?
Ce goût des pierreries était à un tel point poussé chez M. de Saint-Germain qu’à la suite d’un dîner chez Mme Lambert, le baron de Glcichen1, qui était de retour à Versailles, reçut du fameux comte, avec l’hommage de son amitié, l’invitation de venir le voir.
D’après les Mémoires de l’ambassadeur, Saint-Germain s’empressa de complaire à son visiteur et exposa une quantité de diamants de couleur d’une grosseur et d’une perfection surprenantes. Parmi toutes ces pierres précieuses qui s’entassaient sur la table, il y avait une opale d’une grandeur magnifique et un saphir de la taille d’un œuf, dont l’éclat effaçait celui de toutes les pierres de comparaison qu’il mettait à côté de lui. “ Je crus voir toutes les lumières de la lampe merveilleuse ” écrit le baron1 qui se connaissait en bijoux. “ L’œil le plus exercé ne pou-


vait découvrir le plus petit défaut à ces brillants qui, d’ailleurs, n’étaient point montés. ”
Saint-Germain, enfin, était très expert dans l’art des crèmes de beauté, ce qui lui attirait la sympathie curieuse des femmes. Il sacrifiait fréquemment à la convoitise de ses admiratrices des philtres, des crèmes de sa composition, du vinaigre de Maille contre les rides et d’autres onguents bizarres. Il n’en exagérait point cependant l’influence, d’après ce que raconte Casanova de Seingalt dans ses récits, car il avait la modestie d’avouer qu’il lui était impossible de rajeunir. Il cherchait simplement à conserver scs clients dans l’état où il les prenait, au moyen d’une eau qui, disait-il, lui coûtait beaucoup, mais dont il leur faisait présent.

— 74 ~

li,
íes ne il
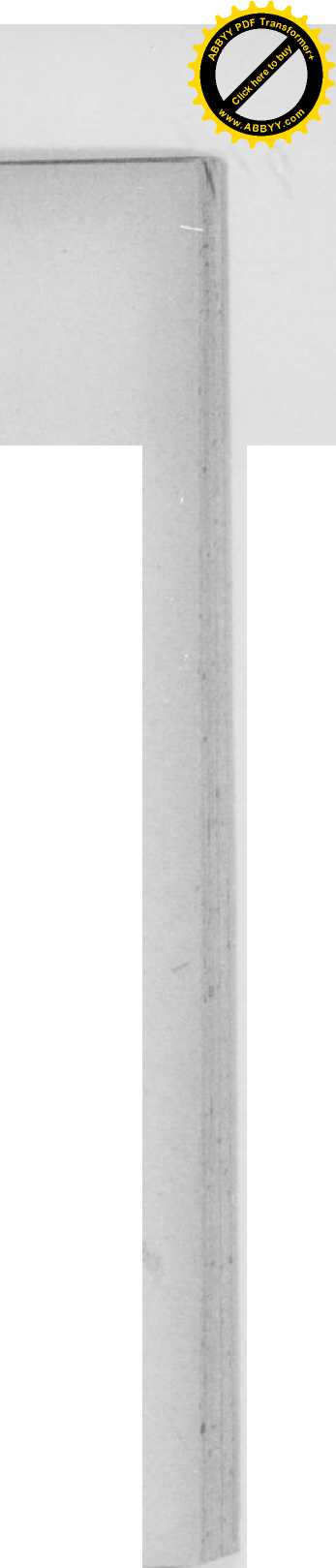
irt de la es Ile en ne
SAINT-GERMAIN CONTEUR
Saint-Germain possédait un brillant talent de conteur. Les aventures curieuses qu’il prétendait avoir traversées renaissaient dans sa conversation, les enjolivant d’une multitude de détails. Quand il entrait dans un salon, les tapis verts des tables se vidaient de leurs joueurs, les dés retombaient et les fauteuils se resserraient autour de lui. Dans les plus importantes réceptions, le cercle ondoyant des gavottes se rompait de lui-même, tandis que les orchestres habituels s’arrêtaient pour le laisser parler près de la maîtresse de maison, sous les regards de ses admiratrices passionnées. Plein de talent, cet artiste profond savait conter l’anecdote à la mode, avec des précisions qui rehaussaient l’intérêt. Sur ce sujet encore, il restait un antidote contre l’ennui. Le comte aimait aussi à montrer sa facilité d’élocution et son érudition en histoire.
“ 75 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Mme de Pompadour se plaisait à aiguiller sa conversation sur cette partie. Elle choisissait l’heure de son lever où une étiquette plus simple que celle du roi lui permettait de s’entretenir avec ses admirateurs. Quand la marquise, les yeux humides de sommeil, livrait son corps encore tiède de la chaleur du lit aux soins de ses chambrières, elle interpellait ses visiteurs. Ceux-ci dissimulaient mal leur tentation devant le dessin parfait de la poitrine gracieuse cachée sous la chemise de satin. La meilleure noblesse se rencontrait dans les deux salons proches de la chambre avec les abbés de cour; ces pièces abondamment remplies laissaient filtrer, dans le brouhaha des jugements téméraires ou des calomnies insidieuses, la conversation courante sur les papotages du jour. Mme du Hausset raconte qu’un matin, à la toilette, la favorite exposa devant Saint-Germain son admiration pour François Ier.
— C’eśt un roi que j’aurais aimé.
— Aussi était-il très aimable, affirma le comte.
Et il se mit à dépeindre la figure et toute la personne du souverain, comme l’on fait d’un homme qu’on a bien considéré.
— C’eśt dommage qu’il ait été trop ardent; je lui aurais donné un bon conseil qui l’aurait garanti de tous ses malheurs, mais il ne l’aurait point suivi, car il semble qu’il y ait une fatalité pour les princes dont
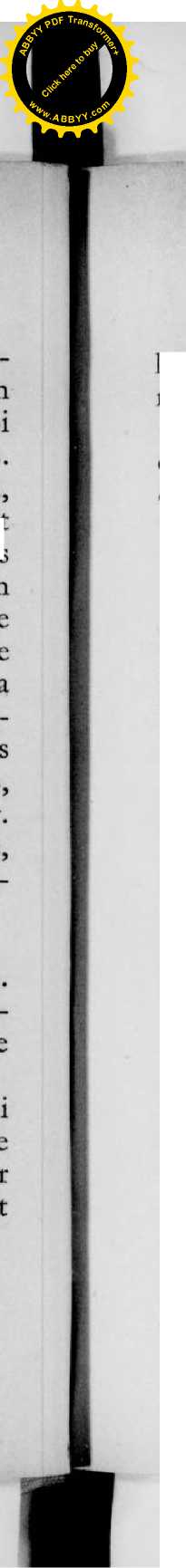
t
s

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
les oreilles, c’est-à-dire l’esprit, sont fermés dans les moments critiques aux meilleurs avis.
— Et le connétable, reprit Mme de Pompadour, qui sans doute voulait parler de M. de Bourbon, qu’en dites-vous?
— Je ne puis en dire trop bien et trop de mal.
— La cour de François Ier était-elle fort belle?
— Très belle, mais celle de ses petits-fils la surpassait infiniment et, du temps de Marie Stuart et de Marguerite de Valois, c’était un pays d’enchantement, le temple des plaisirs où ceux de l’esprit dominaient. Les deux femmes faisaient des vers.
C’était un discret compliment à la marquise qui déclamait à ravir, touchait du clavecin et jouait du violon.
— Il semble que vous avez vu cela?
— J’ai beaucoup de mémoire, dit-il, et j’ai lu bien souvent l’histoire de France. Quelquefois je m’amuse non pas à faire croire, mais à laisser comprendre que j’ai vécu dans les plus anciens temps.
— Mais enfin, vous ne dites pas votre âge et vous vous donnez pour fort vieux. La comtesse de Gorgy qui était, il y a cinquante ans je crois, ambassadrice à Venise, dit vous avoir connu tel que vous êtes
— Il eśt vrai que j’ai connu, il y a longtemps, Mme de Gorgy.


— Mais, suivant ce qu’elle dit, vous auriez plus de cent ans à présent?
— Cela n’est pas impossible, dit-il en riant, mais je conviens qu’il eśt encore plus vraisemblable que cette dame, que je respete fort, radote.
— Vous lui avez donné, dit-elle, un élixir surprenant par scs effets : elle prétend qu’elle n’a longtemps paru que vingt-quatre ans. Pourquoi n’en donneriez-vous pas au roi?
— Ah! madame, dit-il avec une sorte d’effroi, m’aviser de donner au roi une drogue inconnue! il faudrait que je fusse fou!
L’intelligence vraiment surprenante de Saint-Germain ne se bornait pas à ces badinages et certaines anecdotes dont l’authenticité eśt reconnue prouvent le soin qu’il prenait de graduer scs effets.
Parmi les hiśtoircs dont le maréchal de Villeroy avait bercé trop souvent le jeune souverain, se trouvait une énigme historique, celle de la mort du procureur Dumas. Elle avait frappé particulièrement l’esprit du jeune Louis XV. Il eśt vrai que le myStèrc qui l’entourait n’avait jamais été soulevé. Ln jour le roi raconta devant M. de Saint-Germain la disparition du procureur. D’apres le volume de M. Peuchet “ Mémoires tirés des Archives de la police de Paris ”, maître Dumas, ancien procureur au Châtelet, vivait dans une très vieille maison de la rue de l’Hirondelle,
:1e
>i,
c-
DS
Z-
>y i-
it
■e
e
t-
:s n
iis
JC
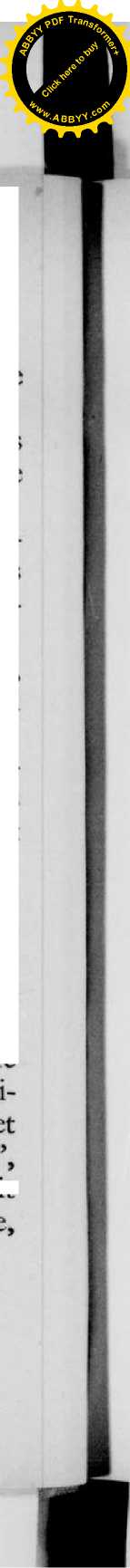
it
où la duchesse de Châteaubriant, maîtresse de François Ier, avait habité deux cents ans auparavant. Le procureur y fut assassiné. Du moins on le supposait, car son corps n’avait jamais pu être retrouvé.
“ Cet homme vivait comme un mécréant. Jamais il n’allait écouter une messe et il ne possédait pas de directeur de conscience. Les commerçants de sa rue supposaient qu’il tenait son or du diable auquel il rendait un culte secret à l’aide de pratiques magiques.
“ Ce qui fortifiait aussi les voisins à accepter cette thèse, c’était la visite hebdomadaire d’un singulier personnage. Tous les vendredis à trois heures précises, maître Dumas montait à sa chambre haute, sorte de petit observatoire d’où il consultait les aśtres. On entendait alors de la rue le trot pesant d’une mule s’arrêter devant le logis.
“ Cette mule eût paru la plus belle du monde si, sur le côté droit de sa croupe, n’avait saigné une horrible blessure.
“ Le cavalier qui la montait pénétrait chez le procureur sans même heurter le marteau d’entrée. Il était grand, avait une belle preśtance, mais possédait un regard si pénétrant que tous les gens se détournaient pour ne pas l’apercevoir.
“ Depuis une trentaine d’années, cet inconnu étonnait le quartier par la régularité de sa visite. La servante de maître Dumas ignorait d’où il venait et

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
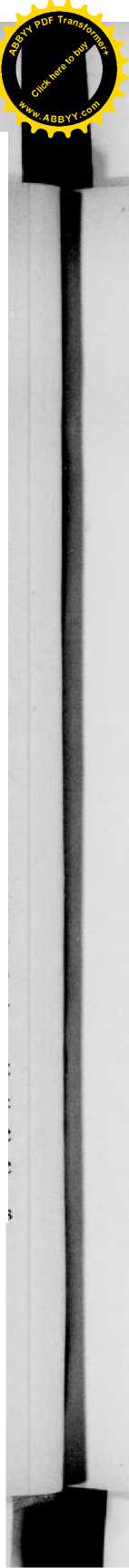
l’endroit où il allait. Bien des personnes s’étaient aventurées à suivre cet homme. Malgré leur bonne volonté, elles avaient perdu ses traces aux environs du cimetière des Innocents qu’il contournait avant de disparaître.
“ Le mercredi 31 décembre 1700, vers dix heures du matin, le pas lourd de la grande mule fit sonner le pavé de la rue. L’inconnu, à son ordinaire, monta au laboratoire de l’ancien procureur qui ne l’attendait pas et qui poussa un cri. Le fils Dumas, Eudes, qui avait cinquante ans, eut peine à reconnaître son père au déjeuner de midi tant il était défait. Aidé de sa sœur, vieille fille de quarante-cinq ans, dévote et intolérante, il ne put arracher un mot à l’ancien magistrat et se contenta de le hisser dans sa chambre où il déclara vouloir sc reposer. Dumas alors embrassa ses enfants et leur demanda de venir à quatre heures le chercher, mais pas avant. Ils sortirent tous les deux, revinrent exactement à l’heure convenue mais ne purent retrouver jamais aucune trace de l’astrologue, ni dans le laboratoire, ni dans les caves1. ”
M. de Saint-Germain, après avoir écouté avec attention cette hiśtoire, offrit au roi de lui faire connaître les particularités demeurées secrètes de l’affaire? Louis XV parut un instant stupéfait de
1 . Ce long récit, dont nous n’extrayons que la substance, eSt relaté dans J. PeüCHET, Mémoires tirés des Archives de ¡a Police de Paris.
-- 80 --

it ic u le
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

2S le
LU it ai re sa et ïn re sa es es is >
re de le
ms
cette proposition. Mais Mme de Pompadour, qui était là, pria notre héros de révéler le myśtere qu’il prétendait connaître. Le cercle des intimes applaudit et le comte fut mis en demeure de tenir sa promesse.
“ A Tintant même, Sire, dit Saint-Germain en s’inclinant, je demande dix minutes et Votre Majesté sera obéie. ” Alors, avec un grand sérieux, il traça des lignes, écrivit des formules d’algèbre et d’aStrologie, les étudia et, avant que le délai fût expiré, revint au roi.
“ Le procureur habitait bien la maison dite de François Ier, rue de l’Hirondelle? ”
Le monarque inclina la tête.
Alors M. de Saint-Germain aligna une série de chiffres. Et se tournant vers Louis XV :
“ Sire, dit-il, les ouvriers et ingénieurs qui ont cherché le procureur Dumas étaient gagnés par des gens intéressés à ce que cette trace demeurât ignorée ou bien ne possédaient que fort médiocrement les connaissances nécessaires à leurs travaux journaliers. Voici ce qui s’eśt passé :
“ Dans un angle de la chambre, près de la porte d’entrée, une feuille de parquet eśt mobile, elle recouvre l’issue d’un escalier qui s’enfonce au travers de tous les planchers et de toutes les murailles.
“ A l’extrémité de cet escalier on rencontre un
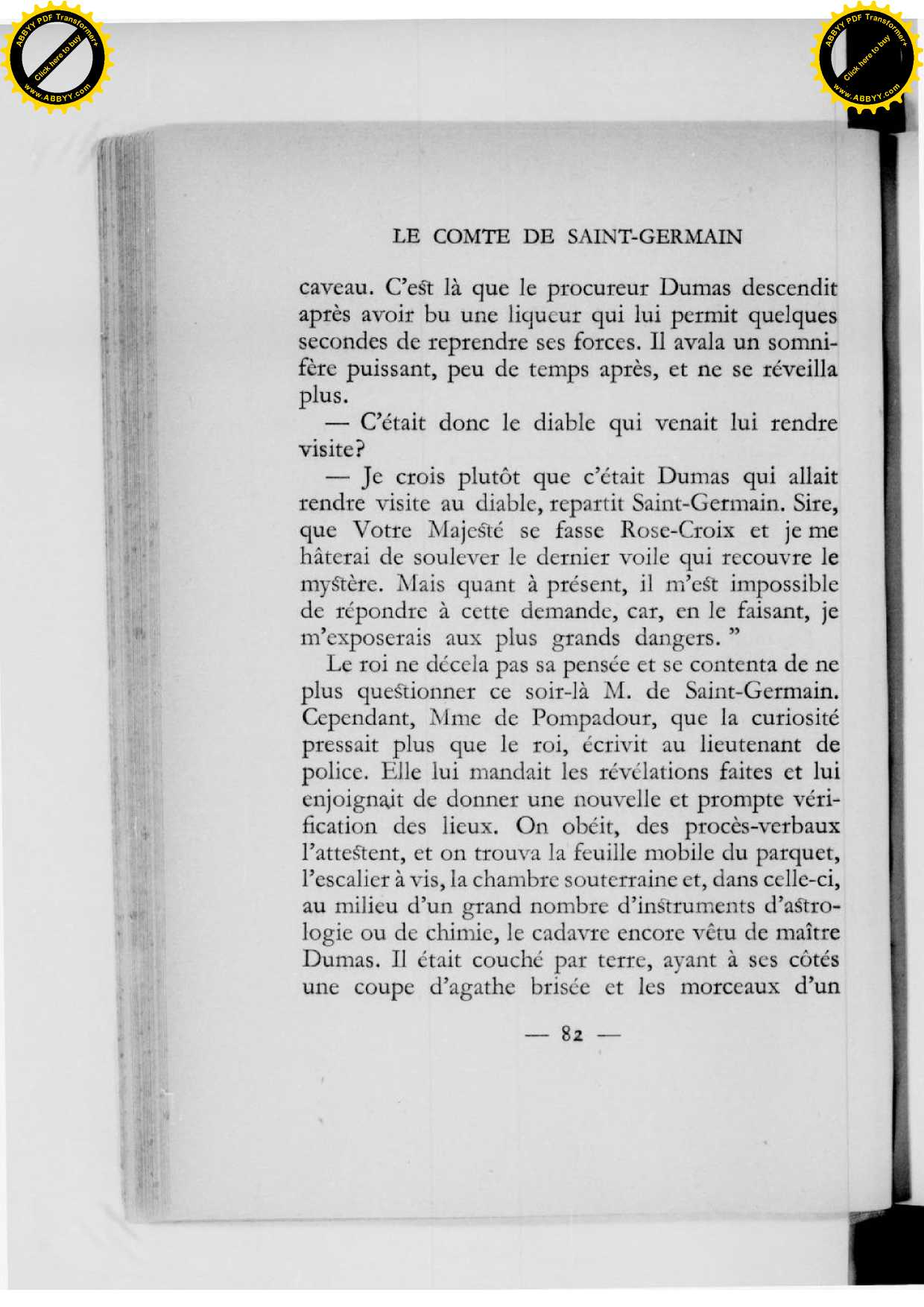
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
caveau. C’est là que le procureur Dumas descendit après avoir bu une liqueur qui lui permit quelques secondes de reprendre ses forces. Il avala un somnifère puissant, peu de temps après, et ne se réveilla
— C’était donc le diable qui venait lui rendre visite?
— Je crois plutôt que c’était Dumas qui allait rendre visite au diable, repartit Saint-Germain. Sire, que Votre Majesté se fasse Rose-Croix et je me hâterai de soulever le dernier voile qui recouvre le
Le roi ne décela pas sa pensée et se contenta de ne plus questionner ce soir-là M. de Saint-Germain. Cependant, Mme de Pompadour, que la curiosité pressait plus que le roi, écrivit au lieutenant de police. Elle lui mandait les révélations faites et lui enjoignait de donner une nouvelle et prompte vérification des lieux. On obéit, des procès-verbaux l’atteStent, et on trouva la feuille mobile du parquet, l’escalier à vis, la chambre souterraine et, dans celle-ci, au milieu d’un grand nombre d’instruments d’aStrologie ou de chimie, le cadavre encore vêtu de maître Dumas. Il était couché par terre, ayant à scs côtés une coupe d’agathe brisée et les morceaux d’un
idit ues mi-:illa
dre
lait ire, me * le ble . je
ne lin. sité
de lui
éri-iux ,ctj -ci, ro-‘tre •tés
un

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN flacon de criśtal. Un des débris contenait encore un sédiment d’opium.
Cette découverte, on le pense bien, ne fit que confirmer l’admiration du roi pour M. de Saint-Germain. Des historiens modernes, MM. Louvet et Moura1, ont voulu expliquer cette découverte par une petite conjuration de Mme de Pompadour et du comte, destinée à composer une mise en scène propre à étonner Louis XV et à le tirer du néant de son ennui? Nous nous permettons d’objecter à cette thèse que la présence d’un troisième personnage, qui aurait découvert, lui, et auparavant, le véritable mystère, serait nécessaire. La maison de Dumas avait été habitée depuis 1700 successivement par le fils et par la fille du mort, qui étaient demeurés célibataires. Ensuite, elle avait été occupée par de vagues cousins. Tout porte à croire qu’une visite de M. de Saint-Germain aurait été considérée comme indésirable. L’affirmation peut-être imprudente qu’il fit, était-elle basée uniquement sur des déductions savantes?
C’cśt peu probable. Le comte n’aurait pas assuré de tels faits, sans avoir de certitudes. Et où les aurait-il prises? Quel était exactement ce procureur Dumas, dont personne ne connaissait la vie? Comme
1. MM. Louvet et Moura, Saint-Germain, le Rose-croix immortel. (Gallimard.)
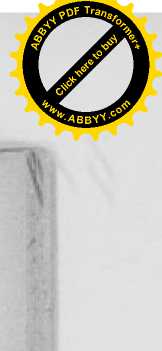
- 83 -

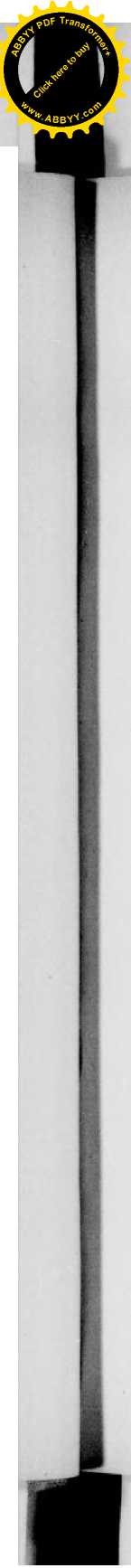
beaucoup d’astrologues, faisait-il partie de la franc-maçonnerie? Là, peut-être, cśt la solution du problème. Surpris par l’arrivée inopinée de son visiteur, le fameux muletier, à une heure où il le croyait bien éloigné de lui, reçut-il, pour des faits restés inconnus, un ordre de suicide immédiat? Ainsi s’expliquerait la pâleur de ses traits au dernier repas qu’il prit avec ses enfants. Saint-Germain, cinquante ans plus tard, aurait pu ainsi connaître la clé de l’énigme, grâce aux archives de la société secrète qu’une initiation assez poussée lui permettait de consulter.
M. de Saint-Germain racontait encore une histoire très particulière qui attirait aussi des cercles d’auditeurs. Nous avons tendance à croire que ce récit eut pour théâtre une ville du Nord, ou plus exaélement du HoLtein, et qu’elle se déroula peu de temps après l’initiation dc Cagliośtro à la franc-maçonnerie. Un jeune homme, seigneur très distingué, mais de mœurs fort débauchées, avait prétendu, nous dit Mme d’Adhémar dans scs “ Mémoires ”, avoir eu tant de maîtresses qu’il ne pouvait plus souffrir les femmes.
“ J’irai, avait-il déclaré, passer cette nuit au cimetière, pour évoquer les trépassés. ”
Malgré tous les appels à la raison que lui prodiguèrent scs amis, le comte R... se rendit vers minuit dans le cimetière de la ville, s’entoura d’un cercle
- 84 -
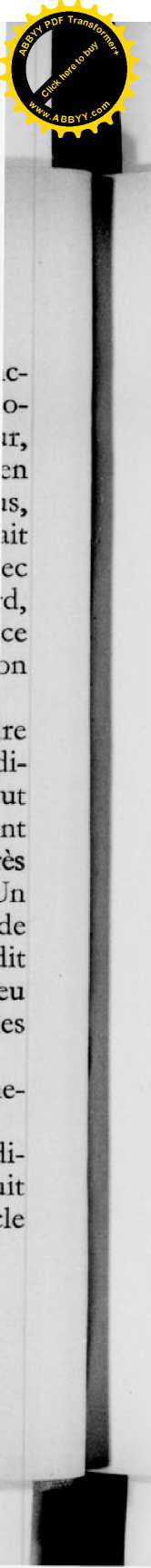
magique et, par d’horribles imprécations, essaya de troubler la paix des tombeaux. Tout reśta silencieux, M. de R... entendit à quelque distance dans la campagne une voix féminine qui chantait une romance du pays. Le timbre en était si pur, si harmonieux, que le jeune homme oubliant le motif de sa présence dans le cimetière le quitta et courut à la recherche de la jeune fille dont la voix avait fait sur lui une telle impression. Il l’accoSta, lui parla et l’emmena insensiblement dans l’enceinte funèbre. Plus audacieux encore, il voulut en obtenir des faveurs qu’elle refusa.
“Je ne peux appartenir qu’à un mari, dit-elle.
— Eh! bien, je t’épouse, voilà ma bague, donne-moi la tienne en échange, nous serons fiancés. ”
La proposition fut acceptée. N’éprouvant plus de résistance, le comte resta jusqu’à une heure du matin en compagnie de la jeune fille. Alors ils se quittèrent et promirent de se revoir le lendemain au même lieu.
Mais le comte, ayant satisfait sa fantaisie, oublia aussitôt sa promesse et celle qui en était l’objet. Donc, le lendemain, au lieu d’aller au rendez-vous, il se coucha fort tranquillement. Il dormait depuis deux heures lorsqu’à minuit la porte de sa chambre s’ouvrit. Réveillé en sursaut, monsieur dc R... entendit la respiration d’une créature humaine, puis le frôlement d’une robe. On approcha lentement de son lit, on souleva la couverture et il sentit se glisser à ses côtés
- 85 -


un corps doux et flexible, mais froid comme le marbre des tombeaux.
Le lendemain au soir, à une réception en son hôtel particulier, on annonça une princesse italienne : elle avait des lettres pour le comte dc R... On se leva, on l’entoura, elle était jolie et magnifiquement parée. Le comte pâlit affreusement, car dans cette prétendue princesse, il avait reconnu la jeune fille mystérieuse du cimetière. Le fantôme s’approcha et attacha sur lui un regard fixe et terne : partout ce regard le poursuivit et il ne put s’y soustraire.
A une heure, la princesse se leva, ses gens l’attendaient; elle dut repartir et le comte respira encore une fois.
Chaque nuit, depuis cette époque, en quelque lieu que le comte se transportât, il était suivi par cette affreuse vision.
M.de Saint-Germain racontait “qu’il allait expirer, lorsque le hasard me conduisit à lui ”.
“ Rendez grâces à Dieu de m’avoir rencontré, lui dis-je. Te reviendrai à minuit. Veillez et priez jusqu’à cette heure.
“ A onze heures trois quarts, je traçai sur le plancher un triangle solaire, je le parfumai, puis je fis placer le comte au milieu en lui défendant de sortir quoi qu’il arrivât.
“ Minuit sonna. La porte s’entr’ouvrit, le
— 86 —
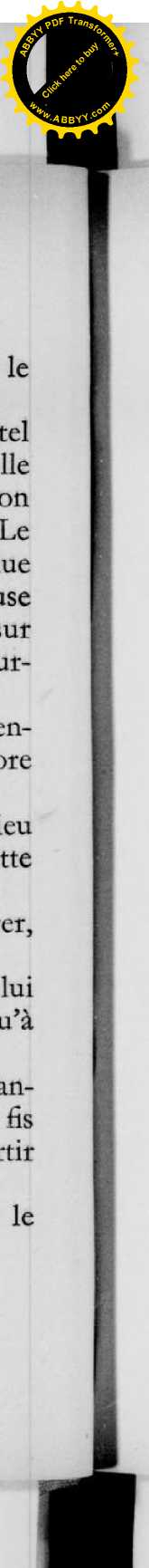
spcârc s’avança jusqu’aux limites du triangle.
“ C’eSt mon époux, dit-il d’une voix creuse.
— Par fraude! car tu n’es pas un habitant de ce monde. Rends la bague, poursuivis-je.
— Non, pas ici, mais où je l’ai reçue.
— Soit! nous allons y aller ensemble. Cependant, il faut que tu nous devances.
“ Je ne raconterai pas la lutte que j’eus à soutenir, terminait Saint-Germain. Néanmoins, j’en sortis victorieux. Le comte jeta la bague sur le tombeau où il s’était assis avec le fantôme. Le spectre rendit celle qu’il avait reçue, puis nous restâmes seuls. Il était tard quand nous retournâmes à la ville. Le lendemain, à mon réveil, on me remit une lettre du comte. En me quittant, au lieu de rentrer chez lui, il avait été frapper à la porte d’un monastère dont ses ancêtres furent les bienfaiteurs. Là il déclara qu’il venait prendre l’habit de novice et il e£t mort, en odeur de sainteté, trente-cinq ans après. ”
Cette histoire que Mme d’Adhémar relate avec ferveur, peut nous sembler tout au moins fort mystérieuse. Elle dépeint cependant avec assez de netteté le caractère de Saint-Germain. Cet aimable conteur, facilement modeste devant des auditeurs possédant quelque culture, devenait vite romanesque devant ceux qu’il appelait, chez Gleichen, “ ces bêtes de Parisiens ”,
— 87 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Cependant, si nous excluons la partialité de Mme d’Adhémar à son égard, nous nous trouvons devant un récit dont l’extravagance fut inspirée sans doute par une aventure authentique dont son imagination avait exagéré les proportions.
Le comte, très fier du magnétisme avec lequel il savait influencer ses admirateurs, aimait à raconter cette autre histoire que nous trouvons encore dans l’œuvre de Mme d’Adhémar1.
Mme d’Espréménil n’avait pas manqué d’admirer à plusieurs reprises les bijoux qui couvraient les boutons du pourpoint de M. de Saint-Germain. Après avoir acheté certaines complicités, elle fit venir un soir le gentilhomme sous le vague prétexte d’une fête de famille et parut s’étonner de son arrivée.
“ Quel bon vent vous amène? lui dit la dame.
— Je viens assister à votre fête.
— Elle aura lieu après-demain.
— Vous m’avez écrit que cc serait aujourd’hui.
— Vous vous trompez. ”
Alors il montra le billet d’invitation à Mme d’Es-préménil,
“ C’eSt une erreur, dit-elle; n’importe, puisque vous voilà, rcStez souper avec moi.
— Serez-vous seule?
i. Les Mémoires de Mme d’Adhémar sont parfois apocryphes.
— 88 —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
— Oui.
— Je ne mange jamais hors de chez moi.
— Mais vous buvez et j’ai d’excellent sirop de groseilles, il faut que vous le goûtiez. ”
M. de Saint-Germain éprouva le pressentiment que la liqueur était empoisonnée et la laissa se répandre sur la table.
“ Quelqu’un m’attend... je vais revenir à l’instant.
— Non, reśtez, je le veux. ”
Puis, par l’effet d’une volonté soudaine et puissante, Saint-Germain l’endormit en posant la main sur son front. Alors il l’interrogea :
“ Vous avez voulu m’empoisonner?
— Oui.
— Où sont vos gens?
— Ils attendent que je tire le cordon de la sonnette.
— Combien sont-ils?
— Cinq.
— Quel cśt votre projet?
— Voler vos diamants.
— Vous êtes une misérable... réveillez-vous. ”
Elle se réveilla en effet, sans garder le souvenir de la révélation qu’elle avait faite dans son somnanbu-lisme.
“ J’ai dormi, dit-elle en souriant.
— Une ou deux minutes.
— Comme il vous plaira. ”


Et pendant qu’elle sonnait, M. de Saint-Germain se hâta par une porte du fond de quitter le repaire.
Le lendemain, lorsque, sur sa dénonciation, la police vint s’emparer des brigands, on les trouva à la même place, lourdement endormis près de leur complice qui n’avait pu les quitter.
Un dernier récit, fait un soir chez Mme de Pompadour, avait particulièrement plu à la maîtresse royale qui avait pendant quelques jours caressé l’idée d’en faire faire une comédie. Le projet avorta. Malgré l’impression plutôt pénible qu’elle éveille chez un lefteur moderne, cette histoire nous paraît digne d’être citée, car elle nous semble avoir comme un accent d’autobiographie et nous inclinons à croire que, sous des noms supposés, Saint-Germain y retrace un incident de sa jeunesse aventureuse.
Il était reâté dans l’après-midi avec Mme de Pompadour pour lui faire voir quelques portraits en émail de Petitot.
Mme du Hausset, quia recueilli tout au long dans scs “ Mémoires ” cette aventure, était le témoin
assistèrent.
“ On parle d’une histoire charmante que vous avez racontée, il y a deux jours, en soupant chez M. le Premier, dit Mme de Pompadour; vous l’avez connue dans votre jeunesse et elle eśt délicieuse. ”
— 9o —
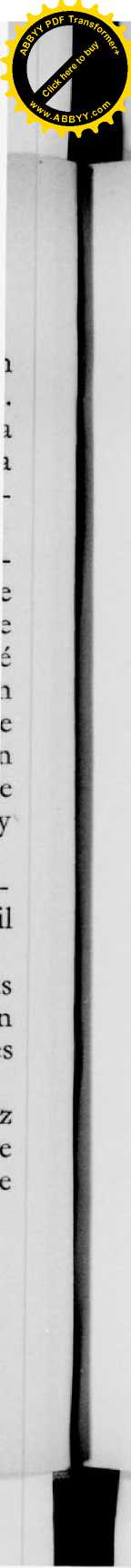
Il sourit et se fit prier.
“ Elle cśt un peu longue.
— Tant mieux, répondit Madame, elle nous distraira plus longtemps. ”
M. de Gontaut et les dames arrivèrent et l’on fit fermer la porte. Notre héros, modeśtement, objefta que tout conteur était inégal, qu’il racontait passablement un jour, mais que le lendemain il pouvait être ennuyeux. Devant 1’insiśtancc de son public, il renouvela ce récit.
“ Le marquis de Saint-Gilles, dit-il, était au commencement de ce siècle ambassadeur d’Espagne à La Haye et il avait connu dans sa jeunesse le comte de Moncade,grand d’Espagne, et l’un des plus riches seigneurs de ce pays. Quelques mois après son arrivée dans la capitale des Pays-Bas, il reçut une lettre du comte, qui, invoquant son amitié, le priait de lui rendre le plus grand des services. “Vous savez, “ lui disait-il, mon cher marquis, le chagrin que “ j’avais de ne pouvoir perpétuer le nom des Mon-“cade; il a plu au ciel, peu de temps après que je “ vous eus quitté, d’exaucer mes vœux et de m’accor-“ der un fils ; il a manifesté de bonne heure des incli-“ nations dignes d’un homme de sa naissance, mais “ le malheur a fait qu’il cśt devenu amoureux à “ Tolède de la plus fameuse aétrice de la troupe de “ comédiens de cette ville. J’ai fermé les yeux sur
— 91 —
■
cc cc U cc « cc «
«
cet égarement d’un jeune homme qui ne m’avait jusque-là donné que satisfaâion. Mais, ayant appris que la passion le transportait au point de vouloir épouser cette fille et qu’il lui en avait fait la promesse par écrit, j’ai sollicité le roi pour la faire enfermer. Mon fils, instruit de mes démarches, en a prévenu l’effet et s’est enfui avec l’objet de sa passion. J’ignore depuis plus de six mois où il a porté ses pas, mais j’ai quelque lieu de croire qu’il est à La Haye? ”
“ Le comte conjurait ensuite le marquis, au nom
de l’amitié, de faire les perquisitions les plus exaétes pour le découvrir et l’engager à revenir auprès de lui. ,
“ Il eśt juste, disait le comte, de faire un sort à la “ fille, si elle consent à rendre le billet de mariage “ qu’elle s’eSt fait donner et je vous laisse le maître “ de Stipuler scs intérêts, ainsi que de fixer la somme “ nécessaire à mon fils pour se rendre dans un état “ convenable à Madrid. Je ne sais si vous êtes père, “ disait le comte en finissant, mais si vous l’êtes, vous “ pouvez vous faire une idée de mes inquiétudes. ”
“ M. de Moncade joignait à cette lettre un signalement exact de son fils et de sa maîtresse. Le marquis n’eût pas plutôt reçu cette lettre qu’il envoya dans toutes les auberges d’Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye, mais ce fut en vain. Il ne put rien découvrir.
— 92 —

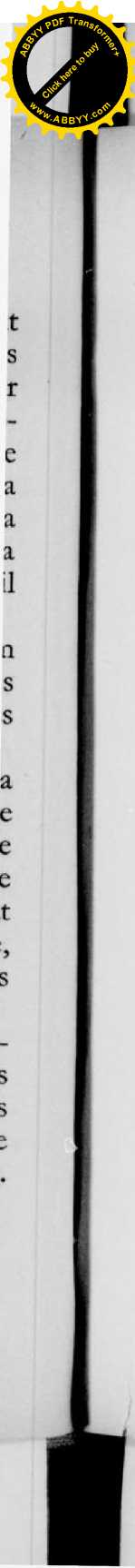
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Il commençait à désespérer deses recherches lorsque l’idée lui vint d’y employer un jeune page français fort éveillé.
“ Il lui promit une récompense s’il réussissait à découvrir la personne qui l’intéressait si vivement et lui donna son signalement. Le page parcourut, plusieurs jours, tous les lieux publics sans succès; enfin, un soir, à la comédie, il aperçut dans une loge un jeune homme et une femme qu’il considéra attentivement, et ayant remarqué que, frappé de sa surveillance, le jeune homme se retirait dans le fond, vers la porte, le page ne douta plus du succès. Il ne perdit pas de vue la loge, considérant attentivement tous les mouvements qui s’y faisaient. Au moment où la pièce s’achevait, il se trouva sur le chemin des places de luxe, et il remarqua que le jeune homme, en passant devant lui, et considérant sans doute l’habit qu’il portait, avait cherché à se cacher en mettant son mouchoir sur sa bouche. Il le suivit sans affectation jusqu’à l’auberge appelée Le vicomte de T «renne où il le vit entrer avec la femme; sûr d’avoir trouvé ce qu’il cherchait, il courut bien vite l’apprendre à l’ambassadeur. Le marquis de Saint-Gilles se rendit aussitôt, couvert d’un manteau et suivi de son page et de deux domestiques, au Vicomte de i «renne. \rrivé à cette auberge, il demanda au maître de la maison où était la chambre d’un jeune homme et

— 93 —

d’une femme qui logeaient depuis quelque temps chez lui. Le maître de l’auberge fit d’abord quelques difficultés de l’en instruire, s’il ne les demandait pas par leur nom. Le page lui dit de faire attention qu’il parlait à l’ambassadeur d’Espagne qui avait des raisons pour parler à ces personnes. L’aubergiste dit qu’elles ne voulaient point être connues et qu’elles avaient défendu qu’on laissât entrer chez elles ceux qui, en les demandant, ne les nommaient pas; mais, par considération pour l’ambassadeur, il indiqua la chambre et le conduisit tout au bout de la maison dans une des plus vilaines chambres. Il frappa à la porte qu’on tarda quelque temps à ouvrir; enfin après avoir frappé assez fort de nouveau, la porte s’ouvrit à moitié et à l’aspeô de l’ambassadeur et de sa suite celui qui avait entr’ouvert la porte voulut la refermer, disant qu’on se trompait. L’ambassadeur poussa fortement la porte, entra et fit signe à scs gens d’attendre en dehors et, reśtć seul dans la chambre, il vit un jeune homme, d’une très jolie figure, dont les traits étaient également semblables à ceux spécifiés dans le signalement. Avec lui était une jeune femme belle, très bien faite et également ressemblante par la couleur de ses cheveux, la taille et le tour du visage à celle qui lui avait été décrite par son ami le comte de Moncade. Le jeune homme parla le premier et se plaignit de la violence qu’on avait employée pour
— 94 ~
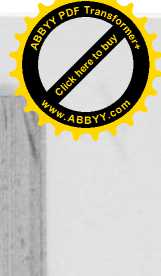
s
a i
a s t e
•»
e a
s e
a e
e e
r
entrer chez un étranger qui eśt dans un pays libre et qui y vivait sous la protedion des lois. L’ambassadeur lui répondit, en s’avançant vers lui pour l’embrasser. “ 11 n’eSt pas question ici de feindre, mon cher “ comte; je vous connais et je ne viens point ici “ pour vous faire de la peine, nia cette jeune dame, “ qui me paraît fort intéressante. ” Le jeune homme répondit qu’on se trompait, qu’il n’était point comte, mais fils d’un négociant de Cadix, que cette dame était son épouse et qu’ils voyageaient pour leur plaisir. L’ambassadeur, jetant les yeux sur la chambre, fort mal meublée, dans laquelle était un seul lit, et sur le bagage très mesquin qui était çà et là. “ Eśt-ce “ ici, mon cher enfant, permettez-moi ce titre qu’au-“ torisc ma tendre amitié pour Monsieur votre père, “ eśt-ce ici que doit demeurer le fils du comte de “ Moncade? ”
“ Le jeune homme sc défendait toujours de rien entendre à ce langage. Enfin vaincu par les insistances de l’ambassadeur, il avoua en pleurant qu’il était le fils de Moncade, mais qu’il ne retournerait jamais auprès de son père s’il fallait abandonner une jeune femme qu’il adorait. La femme, fondant en larmes, sc jeta aux genoux de l’ambassadeur, en lui disant qu’elle ne voulait pas être la cause de la perte du comte de Moncade et que, son amour triomphant de son propre intérêt, elle consentait, pour son
bonheur disait-elle, à se séparer de lui. L’ambassadeur admira un si noble désintéressement. Le jeune
homme s’en désespérait, faisant des reproches à sa maîtresscct faisant tourner contre elle-même, contre
une personne si estimable, la générosité sublime de son cœur. L’ambassadeur lui dit que l’intention du comte de Moncade n’était point de la rendre malheureuse, et il annonça qu’il était chargé de lui donner une somme convenable pour qu’elle puisse retourner en Espagne ou vivre dans un tel endroit qu’elle voudrait. La noblesse des sentiments et la véracité de sa
tendresse lui inspireront, dit-il, le plus grand intérêt et l’engageront à porter aussi haut qu’il soit possible, pour le moment, la somme qu’il était autorisé à lui donner. Devant ces faits, il lui promit 10.000 florins, environ 30.000 francs, qui lui seraient comptés au moment où elle aurait remis l’engagement de mariage qui lui avait été fait et où le comte de Moncade aurait pris un appartement chez l’ambassadeur et promis de retourner en Espagne. La jeune femme eut l’air de ne pas faire attention à la somme, ne songeant qu’à son amant, à la douleur de le quitter, au sacrifice cruel auquel la raison et son propre amour l’obligeaient de souscrire.
“ Tirant ensuite d’un petit portefeuille la promesse de mariage signée du comte, elle lui dit
encore :
e a e Q e
e n i-;a êt e, ai s, LU
lit
le ’à
Qt
la lit
“Je connais trop ton cœur pour avoir besoin de cela. ”
“ Elle baisa cette lettre avec une espèce de transport, plusieurs fois, et la remit à l’ambassadeur qui reśta surpris de tant de grandeur d’âme. U promit à la jeune femme de s’intéresser à jamais à son sort et assura le comte que son père lui pardonnerait.
“ Il recevra à bras ouverts, lui dit-il, l’enfant prodigue revenant au sein de sa famille désolée. Le cœur d’un père eśt une mine inépuisable de tendresse. Quel sera le bonheur de son ami, affligé depuis si longtemps quand il apprendra cette nouvelle et le comte de Saint-Gilles se trouva lui-même heureux d’être l’instrument de sa félicité.
“ Tels furent en partie les discours de l’ambassadeur, dont le jeune homme parut vivement touché. Le représentant de l’Espagne, craignant que l’amour ne reprenne pendant la nuit tout son empire et ne triomphe de la généreuse résolution de la dame, pressa le jeune comte de le suivre en son hôtel. Les pleurs, les cris de douleur que cette cruelle séparation occasionnèrent, sont difficiles à exprimer et touchèrent sensiblement le cœur du témoin, qui de nouveau promit sa protection à la jeune dame. Le petit bagage du comte ne fut pas embarrassant à porter et il se trouva installé, le soir, dans le plus bel appartement de l’ambassadeur, comblé de joie d’avoir rendu à
— 97 —

l’illustre maison des Moncade l’héritier de ses grandeurs et de tant de magnifiques domaines dont elle était propriétaire. Le lendemain de cette heureuse
journée, le comte vit arriver à son lever, tailleurs,
marchands d’étoffes, de dentelles et il n’eut qu’à choisir. Deux valets de chambre et trois laquais pris par l’ambassadeur parmi ce qu’il y a de plus intelligent et de plus honnête dans cette classe, étaient dans son antichambre. Ils se présentèrent pour être à son
es ci
service. L’ambassadeur montra au jeune comte la lettre qu’il venait d’écrire à son père, dans laquelle il le félicitait d’avoir un fils dont les sentiments et les qualités répondaient à la noblesse de son rang. Il lui annonça son prompt retour. La jeune dame n’était point oubliée; il avoua devoir en partie à sa générosité la soumission de son amant et ne douta pas que le comte n’approuvât le don qu’il lui a fait des mille florins.
“ Cette somme fut remise le même jour à cette noble dame et intéressante personne, qui ne tarda pas à partir. Les préparatifs pour le voyage du comte étaient faits, une garde-robe magnifique, une excellente voiture furent embarquées à Rotterdam sur un vaisseau faisant voile pour la France et sur lequel fut arrêté le passage du comte qui, de ce pays, devait se rendre en Espagne. On remit au jeune homme une assez grosse somme d’argent à son départ et

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
des lettres de change considérables sur Paris, et les adieux de l’ambassadeur et de ce jeune seigneur furent des plus touchants. Le représentant de l’Espagne à La Haye attendait avec impatience la réponse du comte de Moncade et, se mettant à sa place, jouissait du plaisir de son ami. Au bout de quatre mois il reçut cette réponse si vivement attendue et l’on essayerait vainement de peindre la surprise du négociateur en lisant ces lignes :
“ Le ciel ne m’a jamais, mon cher marquis, accordé “ la satisfaction d’être père, et, comblé de biens et “ d’honneur, le chagrin de n’avoir point d’héritiers “ et de voir finir en moi une race illuśtre a répandu la “ plus grande amertume sur ma vie. Je vois avec une “ peine extrême que vous avez été trompé par un “ jeune aventurier qui a abusé de la connaissance de “ notre ancienne amitié. Mais Votre Excellence n’en “ doit pas être la dupe. C’e§t bien véritablement le “ comte de Moncadc que vous avez voulu obliger, “ il doit acquitter ce que votre généreuse amitié s’est “ empressée d’avancer pour lui procurer un bonheur “ qu’il aurait senti bien vivement. J’espère donc, “ monsieur le marquis, que Votre Excellence ne fera “ nulle difficulté d’accepter la remise, convenue dans “ cette lettre, de trois mille louis de France dont elle “ m’a envoyé la note. ”
La manière dont le comte de Saint-Germain faisait
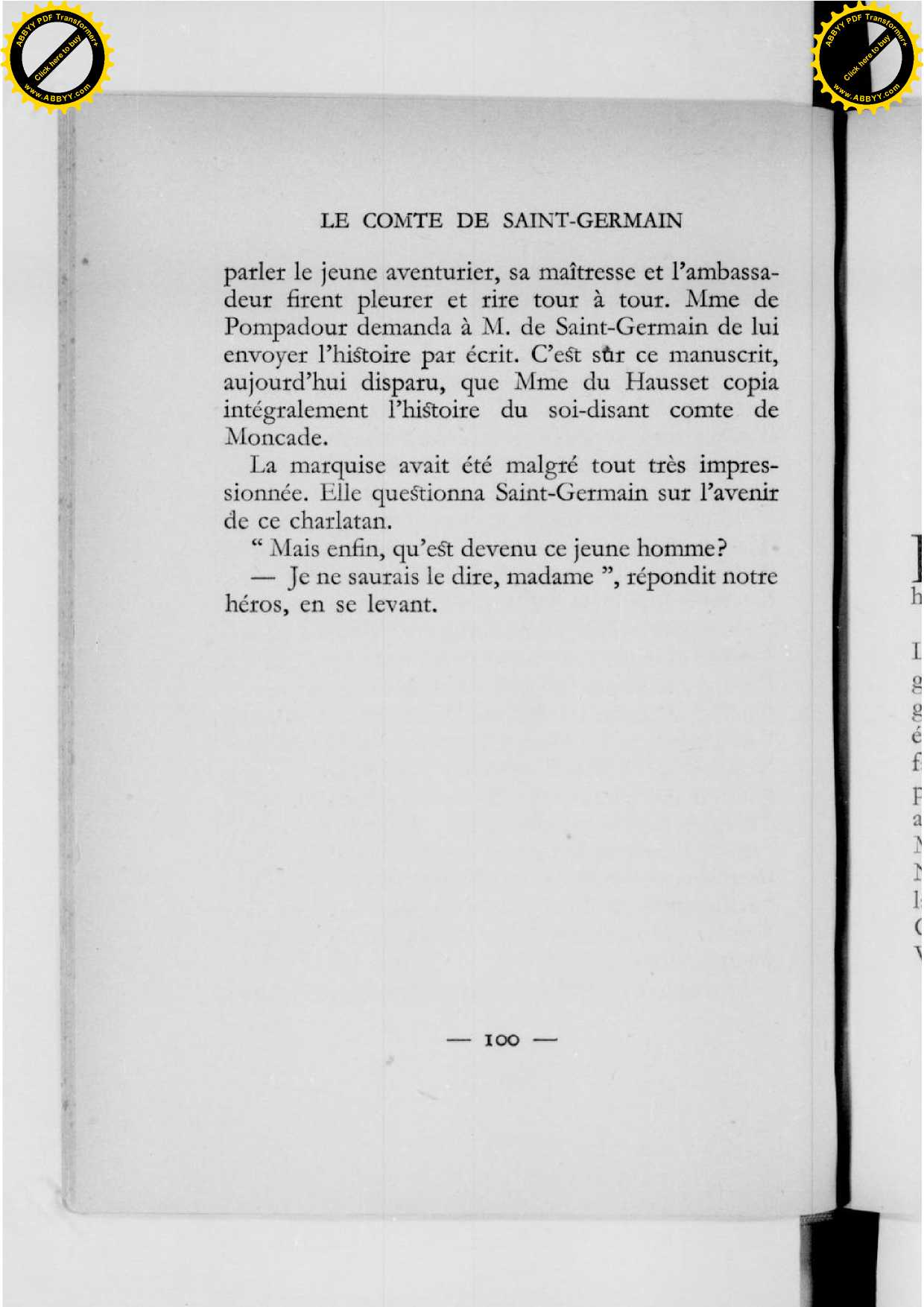


LE MYSTIFICATEUR GAUVE
La situation du comte de Saint-Germain paraissait solidement assise lorsqu’il se heurta à la haine du premier miniśtre, M. de Choiscul.
“ Fils d’un grand chambellan du dernier duc de Lorraine, M. de Stainville gardait un vernis d’étranger et on lui trouvait, dit Lavissc1, des airs de seigneur allemand. ” Il était petit et laid. Son front était dégarni, ce qui en augmentait la hauteur. 11 se faisait des ennemis par son ton de persiflage et d’impertinence polie, mais il avait un très grand succès auprès des femmes. Il s’était assuré la faveur de Mme de Pompadour par son inlassable complaisance. Ne s’était-il pas fait à Rome le commissionnaire de la maîtresse royale pour l’achat d’objets d’art? Grâce à elle, il avait été nommé ambassadeur à Vienne, puis, lors de la démission de l’abbé de
i. Histoire de France, VIII.
-- IOI --
Bcrnis, il avait obtenu le portefeuille des Affaires Étrangères. Son prédécesseur à ce pośte l’avait d’ailleurs chaleureusement recommandé à Louis XV comme le seul homme capable de revenir, sans aliéner l’utile amitié de l’Autriche, du second traité de Versailles, qui engageait à fond la France dans l’alliance autrichienne, au premier, dont les clauses étaient bien moins astreignantes.
Il fut un peu surpris de retrouver à Versailles, très en cour, le comte de Saint-Germain dont il avait entendu vanter à Vienne les extraordinaires capacités.
Mais son avenir dépendait trop de la protection de la favorite royale pour que M. de Choiseul ne cachât sa susceptibilité dépitée, et ne consentît à faire provisoirement bonne mine à notre héros. Une sympathie, tout au moins apparente, régna même entre eux au début. Flic parut sincère aux yeux des mémorialistes qui ont dirigé l’opinion de certains historiens modernes, si sincère meme qu’on écrit encore couramment, en notre siècle, que Saint-Germain fut “ l’âme damnée de Choiseul ”.
Rien n’eSt plus contraire à la vérité que cette assertion. Aucun contaét ne pouvait rapprocher ces deux hommes, car tous deux, autoritaires au dernier degré, étaient ambitieux de parvenir, et chacun sait que, sur ce terrain, grand d’Espagne ou laquais ne s’allient point mais s’opposent.
— 102 —

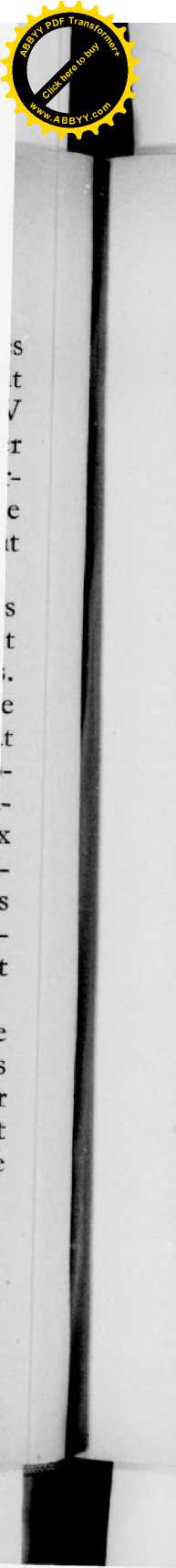
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Quoiqu’il en ait été, cette période d’intimité entre les deux personnages fut brève. L’agacement qu’éprouvait le ministre à entendre les louanges de celui qui vivait en intimité avec le roi, l’incita à rechercher des documents capables de perdre son rival. Mais, soit que l’enquête eût été trop délicate, soit que la police fût rcśtće au-dessous de sa tâche, le duc n’apprit que bien peu de choses sur notre héros. Saint-Germain ne laissait pas de traces sur ses routes. C’eśt à ce moment que se produisit l’incident raconté par Gleichen et où, dans un dîner chez Mme de Choiseul, se révéla l'énervement du premier miniśtrc qui alla, comme nous l’avons rapporté, jusqu’à déclarer que le célèbre aventurier était le fils d’un Israélite de Strasbourg, Daniel Wolfi. Cette affirmation ne trouva aucun crédit à la cour, où l’on considérait généralement qu’elle n’était que la preuve du ressentiment que nourrissait contre 1’ariśtocratie de vieille souche le noble lorrain de fraîche date.
Saint-Germain, peut-être prévenu par Gleichen, se contenta, dit-on, de sourire à cette anecdote et de se frapper le front, avec un geSte gamin signifiant que, dans scs colères, le duc ne possédait certainement pas le contrôle de toutes ses facultés.
Les recherches successives de la police sur notre homme avaient lamentablement échoué. Malgré tout, certains renseignements, assez sujets à caution il eśt

— 103 —

vrai, avaient permis la création d’un dossier dont M. de Choiseul tournait les pages avec une compréhensible satisfaction. Ces quelques feuilles, sans preuves écrasantes, faisaient allusion à des folies de jeunesse, à de menues escroqueries déjà anciennes, commises, du moins tout porte à le croire, à Dantzig ou en Italie. Trois fois le ministre pria le roi d’en prendre connaissance et trois fois il se heurta à un refus. La volonté du monarque d’ignorer ces faits n’avait rien que de très naturel. Louis XV aimait Saint-Germain pour sa gaieté, pour ses excentricités, pour scs récits invraisemblables d’où le vrai n’était pas toujours exclu. lin outre, il savait à quoi s’en tenir sur les origines du comte, et 1’insiśtance du ministre, loin de l’intéresser à des faiblesses qu’il excusait, le blessait sans le convaincre.
Une sorte de divination permettait à Louis XV de distinguer ceux qui l’aimaient sincèrement pour lui-même, des courtisans qui agissaient pour leur propre ambition. Cette force, que souligne Mme de Créquy dans ses “ Souvenirs ”, l’empêcha à plusieurs reprises de se laisser prendre à de basses flatteries. M. de Choiseul était trop intelligent pour ne pas saisir cette nuance, il s’étonna quelque temps des procédés du roi à l’égard de son protégé, mais il dut reconnaître qu’abattre M. de Saint-Germain avec la complicité du roi était impossible.
— 104 —
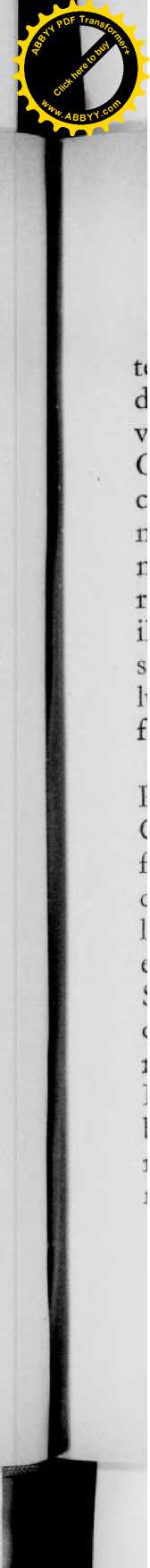

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Le don que fit Louis XV à l’aventurier d’un appartement au château de Chambord, peu après la mort du maréchal de Saxe, déchaîna chez le ministre une violente irritation dont il ne laissa rien paraître. Comprenant qu’il se briserait à lutter de front contre une telle faveur, il résolut de louvoyer et de mener une guerre d’usure farouche, diplomatiquement, avec un visage souriant. Il ne rompit pas les relations mondaines qui l’unissaient au comte, mais il s’employa à le déconsidérer devant la ville, en lui suscitant un grotesque sosie qui se donnerait pour lui et le couvrirait de ridicule par ses exagérations forcées.
En outre, tout permet de croire que “ Monsieur le Premier ”, comme dit Mme du Hausset, circonvint le Grand dauphin et s’en fit un allié en l’occurrence. Le fils de Louis XV possédait une énergie qui faisait défaut à son père. Très dissemblable aussi de lui dans la vie privée, il menait à Versailles une existence exempte de tout reproche. Son antipathie contre Saint-Germain était bien connue à la cour. On l’expliquait par ce fait que, fervent catholique, il avait horreur des jongleries du comte, évocateur d’esprits. Mais le dauphin n’aurait jamais traduit cette réprobation en aâes tant était grand son résped pour le roi, si la piété de sa femme ne l’avait influencé de manière décisive. Cet héritier du trône, qui devait


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
mourir en 1765 sans avoir régné, était, à l’arrivée de Choiseul aux affaires, le chef et l’espoir du parti dévot. Moins pour punir le comte que pour infliger un échec au maréchal de Belle-Isle, qui avait été en 1742 le chef reconnu du parti et que l’on considérait plutôt comme un renégat, il fit siennes les propositions de Choiseul.
1 t
<
1
C’eSt à ce moment que, fort de l’appui du dauphin, le ministre fit surgir un personnage extraordinaire qui, par sa suffisance, son autorité affectée, sa sûreté de lui-même, s’efforça de ruiner la véritable physionomie du fameux comte, en se faisant valoir dans certains salons de la capitale et notamment du Marais.
Ruhlière parle dans son poème “ Jeux de mains ” de ce merveilleux illusionniste, le Français Gauve :
“ On aura Coquelet, Musson, Préville et Gauve... ”
Enfant de Paris, cet homme avait été utilement employé par la cour comme indicateur dans l’armée ennemie pendant la guerre qui se poursuivait. Il possédait admirablement l’anglais et le parlait sans accent : vers sa quinzième année, il avait travaillé en effet chez un ébéniste de Londres. Psychologue né, il s’amusait à contrefaire avec beaucoup d’humour les principaux personnages de la société anglaise, que leur morgue guindée et leur orgueil presbytérien rendaient insupportables à l’Europe entière. Gauve
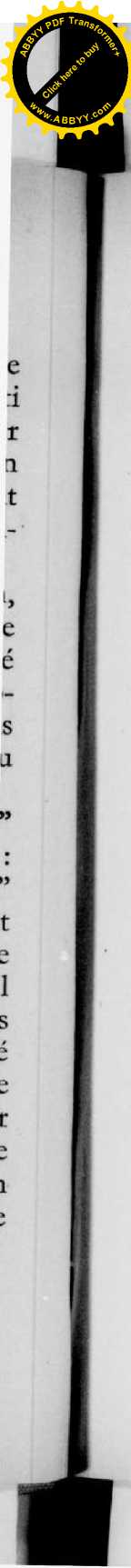

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
présentait ainsi des pères autoritaires, prêchant sans succès à leurs fils une morale sévère. Avec une verve
toute parisienne, il mimait de vieilles misses anglicanes qui, leur livre de prières à la main, s’éprenaient du premier homme venu.
Il créait, sous des clichés étudiés sommairement, les premiers types grotesques de l’aristocratie londonienne. C’eSt peut-être de là que sont nées les figurines britanniques de Saxe, que le Consulat et l’Empire surent faire revivre dans leurs pièces comiques. Sa position d’indicateur lui avait fait fréquenter certains milieux bourgeois de la Cité, et d’aimables plaisantins, tel le duc de Richelieu, se servaient parfois de son talent d’imitation pour mystifier les bonnes
gens. , , .
M. Gauve, devenu mylord Gower pour les besoins de la cause, se revêtit d’un costume de notre héros qu’on avait pu se procurer par l’entremise d’un valet de chambre. Présenté dans diverses sociétés du Marais sous le nom de comte de Saint-Germain, il joua son rôle médiocrement d’abord, car cet espion était, qui l’aurait pu croire? d’une timidité fébrile dans les réunions mondaines. Voyant que ses auditeurs l’écoutaient avec un intérêt amusé ou passionné, suivant leur caractère, Gower prit de l’assurance, débita les sornettes les plus folles. On a vu que, dans une réponse ambiguë à la Pompadour, Saint-Germain

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
avait laissé entendre qu’il avait vécu à la cour des Valois. Plaisanterie, sans aucun doute, qui tomba dans les oreilles crédules mais qui était calculée pour accroître le halo de mystère dont il entourait sa vie. Il confia à Gleichen, un soir d’expansion : “ Ces Parisiens se figurent que j’ai plus de cinq cents ans et je les confirme dans cette idée, puisque je vois que cela leur fait tant de plaisir. ”
Gower, lui, ne se contentait pas de ces relations royales et il affirmait froidement qu’il avait été en relations avec Jésus-Christ lui-même.
“ Je l’ai connu intimement. C’était le meilleur homme du monde, mais romanesque et inconsidéré, je lui ai souvent dit qu’il finirait mal1. ”
Il s’étendait aussi sur les services qu’il avait cherché à lui rendre par l’intermédiaire de Mme Pilate, dont il fréquentait la maison journellement.
Un soir Gower ajouta meme :
“ Je me rappelle fort bien la Sainte Vierge, sainte Élisabeth et sainte Anne, sa vieille mère. Pour celle-ci, je lui ai rendu un grand service après sa mort. Sans moi, elle n’aurait jamais été canonisée. Pour son bonheur, je me suis trouvé au concile de Nicée et comme je connaissais beaucoup les évêques qui le
i. M. de Gleichen qui a connu Saint-Germain et qui ne vit peut-être jamais Gower, note dans scs : Souvenirs. “ H en parlait avec une familiarité très grande, comme s’il avait été son ami. ”

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
composaient, je les ai tant priés, leur ai tant répété que c’était une si bonne femme, que cela leur coûterait si peu d’en faire une sainte, que son brevet lui fut expédié. ”
Et Glcichen, à qui nous empruntons cette “ anecdote ”, s’étonne quelque peu de la crédulité des salons cultivés où se répandaient ces facéties, puis il ajoute :
“ C’eśt cette plaisanterie si absurde et répétée à Paris très sérieusement qui a valu à Al. de Saint-Germain le renom de posséder une médecine qui rajeunissait et rendait immortel. ”
A ce sujet, voici un autre conte bouffon, tiré, cette fois, des “ Souvenirs ” de Mme de Créquy.
Une vieille femme de chambre de Aime de San-ncéterrc, à qui sa maîtresse avait caché le merveilleux élixir comme un trésor, finit, pendant une absence de cette dernière, par mettre la main sur la liqueur enviée et en but tant qu’elle redevint petite enfant. Sa maîtresse, en rentrant, ne la put reconnaître.
Une autre jonglerie, que Aime du Hausset nous a transmise, nous montre aussi Saint-Germain, que l’on interrogeait un jour dans un salon du Alatais, sur un fait très ancien, se retournant vers son valet de chambre et le prenant à témoin :
“ Que Monsieur me pardonne, aurait répondu le domestique, je n’ai point connaissance de ces faits.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Sans doute monsieur le comte oublie-t-il que je ne suis à son service que depuis cinq cents ans! ”
M. André de Méricourt raconte dans son dernier volume1 que AL de Saint-Germain avait convenu avec Mme d’Angiviller qu’il l’autorisait à croire qu’il était âgé de deux ou trois mille ans.
“ Je n’y songeais plus, racontait-elle au déclin de sa vie, lorsque je l’entendis un jour jouer sur mon piano un air de musique des plus agréable. Je demandai le nom de l’auteur.
— Je l’ignore, répondit M. de Saint-Germain le plus sérieusement du monde. Tout ce que je puis vous dire, c’eSt que j’ai entendu jouer cette marche lors de l’entrée d’Alexandre le Grand à Babylone.... ”
Toutes ces fantastiques assertions doivent être, semble-t-il, mises à l’actif du faux Saint-Germain qui déformait ainsi la véritable physionomie de notre héros. Une brève attention permet aisément d’affirmer avec le plus de chance possible que les comédies, ou plutôt les bouffonneries de Gowcr, eurent pour résultat de créer, à l’instigation de Choiseul, une quantité de versions inexactes sur la vie de Saint-Germain. Elles impressionnèrent les mémorialistes et jetèrent sur l’aventurier, bien assez mystérieux sans cela, un voile épais que les historiens n’ont pu encore à l’heure actuelle entièrement lever.
i. André de Méricourt, Mme de Sou^a et sa famille.
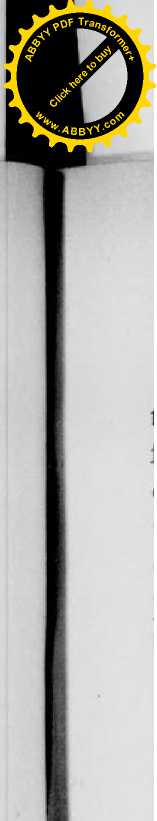
- IIO —
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Mais la tentative du miniśtre du parti dévot manqua totalement son but; les inventeurs de cette parade furent joués comme des enfants. Le comte bénéficia d’un renouveau de curiosité. L’intérêt des récits de Gauvc grandit son sosie. L’ancien espion, plus âgé que Saint-Germain, ouvrit ainsi les horizons les plus larges aux imaginations crédules et accrédita, sans le vouloir, la croyance à l’immortalité de notre personnage.
Quant à Louis XV, sa fine intelligence avait rapidement percé à jour les menées du ministre. Sans s’émouvoir, il continua à Saint-Germain une inaltérable confiance dont il allait bientôt lui donner une preuve éclatante.
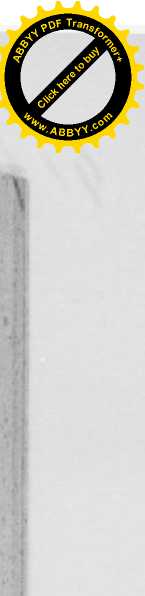
— ni —

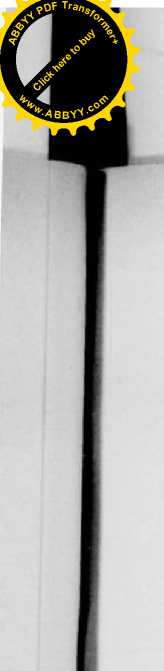

SAINT-GERMAIN EN HOLLANDE
Tandis que Saint-Germain s’assurait, par ses prévenances, la faveur royale et intriguait l’opinion par ses propos et ses façons d’agir, la situation de la Erance devenait grave, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. En 1756, Louis XV avait réalisé une opération restée célèbre dans l’hiStoire diplomatique du xvnie siècle, sous le nom de renversement des alliances.
Dans la guerre de Succession d’Autriche, la France s’était alliée à Frédéric II pour combattre l’impératrice Marie-Thérèse. Louis XV ne s’y était pas résigné sans peine, mais le rapprochement que le roi de Prusse avait opéré, en 1756, avec l’Angleterre, depuis peu en guerre contre la France, rendait cette mesure nécessaire. La claire vision de l’intérêt national qui dirigea le roi de France pendant son règne exigeait l’abaissement de Frédéric, dont l’am-
bition devenait menaçante pour notre sécurité. En quelques semaines le bien du royaume eut raison des hésitations de la cour et Louis XV prêta à l’impéra
trice une aide utile destinée, avant tout, à combattre
les visées de la Prusse.
L’Autriche devait recevoir, apres la vi&oirc, cette Silésie qu’elle ne se consolait pas d’avoir perdue; de plus, en échange des duchés italiens que possédait legendrede Louis XV, l’infant don Philippe,elledevait consentir à céder les Pays-Bas autrichiens à ce dernier.
La France s’était engagée à fournir des armées et des subsides, mais elle n’avait pu obtenir la collaboration de Marie-Thérèse à la guerre contre l’Angleterre et avait été contrainte d’accepter sur ce point la neutralité du cabinet de Vienne.
Frédéric avait été rapidement informé de l’entente réalisée entre les deux cours. Il avait appris aussi que l’impératrice avait décidé Elisabeth de Russie à se
joindre à elle. La situation était critique pour lui,
mais,- faisant confiance à son génie, certain de scs généraux et de ses soldats qui l’idolâtraient, il résolut d’employer la tactique audacieuse qui lui avait si bien réussi dans la guerre précédente. Sans déclaration d’hostilités il se lança sur la Saxe, contre laquelle il prétendait avoir des griefs, et battit les troupes de l’Éleéteur dont il incorpora les forces dans sa propre armée, sans autre forme de procès.
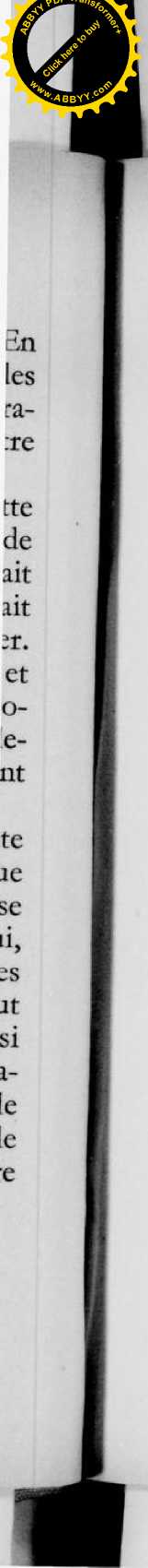

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
La lutte aux côtés de Marie-Thérèse, contre les milices prussiennes, avait été fort peu populaire en France. L’ancien parti hośtile à l’Autriche conservait sa rancune ancestrale contre ce pays, bien déchu de son ancienne splendeur. Les philosophes étaient favorables à Frédéric en qui leur haine pour tout ce qui était catholique les portait à voir un monarque libéral, mais ils ne se consacraient point seulement à la victoire de l’athéisme, ils se rendaient bien compte de la difficulté à faire admettre leurs théories en France sans un revirement complet des esprits, une véritable révolution, et ils en préparaient l’avènement.
Le symbole même de la monarchie de droit divin était Louis XIV. Pendant ses dernières années, le Roi Soleil avait suggéré que la nouvelle ennemie de la France pourrait être la Prusse. Le premier mouvement des philosophes devait être le rapprochement avec Frédéric, monarque d’un pays dont le défenseur de l’unité française avait déjà percé le masque.
Cependant, après le coup de force prussien en Saxe, l’Encyclopédie se rallia nettement aux projets de combattre la Prusse.
La campagne débuta heureusement pour nos armes. Richelieu s’empara de la seconde île des Baléares, Minorque, en août 1756 et, passant de là en Allemagne, battit et força à capituler le ducdcCum-
— 115 —
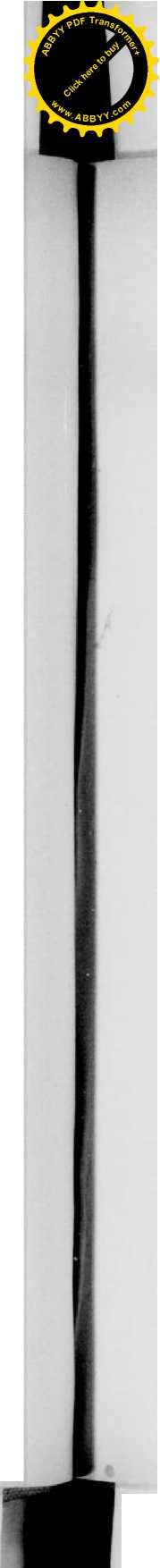
Borland, fils de George II, à CloSterscvcn, le 8 septembre 1757.
De son côté, Frédéric, après un succès en Bohême, avait perdu la bataille de Kollin, le 18 juin. 11 se trouvait dans une situation très difficile. Les Russes occupaient la Prusse, les Suédois la Poméranie. Il parlait de mourir les armes à la main, quand la victoire de Rosbach sur l’armée de Soubise le sauva et lui permit d’écraser les soldats autrichiens à Leuthen.
La coalition franco-autrichienne lui faisait face, mais elle ne montrait aucune cohésion. Les états-majors différents n’avaient pas confié leur plan à ceux qui les soutenaient. Les généraux français étaient incapables et se jalousaient. A la fin de 1758, la situation était devenue favorable à Frédéric. C’eSt alors que l’abbé de Bernis, négociateur de l’alliance autrichienne, offrit sa démission de secrétaire d’Etat aux Affaires Étrangères, mais Louis XV, qui avait de l’eStime pour lui, ne voulut l’accepter qu’après l’avoir fait nommer cardinal.
En quittant le ministère, Bernis avait proposé Choiseul pour le remplacer. Dévoué à l’alliance autri-cliiennc, il se rendait compte cependant que la France était trop engagée vis-à-vis de Marie-Thérèse et il obtint quelques concessions à cet égard. Son plan était de porter tous les efforts de la France contre l’Angleterre. Les opérations n’en continuèrent pas
— 116 —

;ep-
me, Gueulait de mit
ICC, its-:ux ent la ’cśt nce itat de oir
osé tri-la
esc ion itre pas

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
moins en Allemagne, mais les querelles entre Contades et de Breuil, les deux généraux français, en compromirent le succès et, à la fin de 1759, l’armée française fut à nouveau réduite à l’immobilité.
A ces préoccupations extérieures, d’autres non moins graves venaient se joindre. Idles concernaient la situation du Trésor royal. Deux contrôleurs des finances s’étaient déjà usés à la tâche de procurer l’argent nécessaire au financement de la guerre. Les mesures qu’ils avaient proposées n’avaient pu être rat ifiées que par des coups de torce contre les parlements, toujours hostiles aux réformes. Lin 1759, un troisième contrôleur général s’attacha à ce travail ingrat. Ce fut M. de Silhouette, honnête homme, riche en idées, décidé à réprimer certains abus par une répartition plus équitable des impôts. 11 s’attaqua aux fermiers généraux. Cette tâche le rendit populaire mais n’assura point, loin de là, sa position à la cour. Son projet de recettes, destiné à contrebalancer les dépenses prévues pour 1760, souleva un “ toile ” unanime et quand Silhouette fut contraint par la nécessité, en odobre 1759, de supprimer certains versements que devait faire le T résor, il encourut un discrédit qui entraîna sa disgrâce. Lapresse anglaise dénonça le roi de France comme banqueroutier. A Paris, plaisanteries et brocards s’abattirent sur l’infortuné contrôleur. On fabriqua des culottes sans
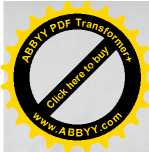
LF, COMTE DE SAINT-GERMAIN

poches et des pourpoints sans gousset appelés “ à la Silhouette ” et c’c§t le nom du financier que l’on a donné à ce dessin de profil, produit sur un mur par l’ombre du visage, pour faire allusion à la rapidité avec laquelle le novateur passa sur la scène politique.
La disgrâce de Silhouette était arrivée à la fin de novembre 1759. Elle concordait avec l’arrêt des opérations. Aussi conçoit-on que le découragement se soit emparé des esprits à la cour de France.
Choiseul, dans sa correspondance de cette époque, traçait de la situation un tableau particulièrement sombre. 11 reconnaissait la grandeur de nos malheurs militaires et confessait l’épuisement du royaume. Notre crédit était anéanti. On n’avait même plus l’argent nécessaire pour payer les troupes et l’on avait parlé, pour se le procurer, d’envoyer à la Monnaie la vaisselle du roi et des particuliers. Le ministre avait chargé son cousin, le duc de Choiscul-Praslin, ambassadeur à Vienne, d’avertir Marie-Thérèse que certes la France ne l’abandonnerait pas, mais qu’elle devrait chercher à conclure un traité avec l’Angleterre.
Louis XV ne se faisait point non plus d’illusions sur le présent ni sur le proche avenir. 11 se rendait compte qu’une paix séparée ne serait pas suffisante et que l’on devait mettre fin délibérément à toutes les hostilités. S’il n’avait pas été victime de cette

i la n a par lité uc.
dc des ent
uc, ent urs ne. lus ’on □n-;tre lin, ]ue die Je-
ms ait
ate tes ttc

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN timidité héréditaire qui paralysait ses très réelles qualités d’intelligence, il eut pu imposer sa volonté à son miniśtrc en monarque absolu qu’il se prétendait être.
11 appréhendait les discussions et les conflits. Aussi résolut-il de recourir à sa diplomatie secrète et de charger un agent officieux de préparer les voies d’un accord général.
L’homme était tout trouvé. C’était celui qui avait déjà été son instrument lors de la dernière guerre au moment où la France suscitait des difficultés à l’Angleterre sur son propre territoire en soutenant les efforts du prétendant Stuart, c’était le comte de Saint-Germain.
Notre héros avait alors à la cour une position presque inexpugnable. Sans doute, Choiscul ne voyait pas d’un œil favorable cet aventurier s’enfermer avec Mme de Pompadour et le roi pour évoquer les esprits ou tenter la transmutation des métaux, mais il affectait à son endroit un dédain persistant. Des rumeurs confuses lui apprirent cependant que le personnage usait de son influence pour donner des conseils politiques au roi. A partir de ce jour, le chef du gouvernement se crut lésé et commença contre son ennemi une campagne incertaine. 11 n’osa protester auprès de Mme de Pompadour, à laquelle il devait tant, et faire des réflexions à Louis XV dont

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
120
Cf. Kauderbach, envoyé saxon à La Haye. Mémoires. Gustave Volz, Der Graf ron Saint-Germain.
le caractère pointilleux aurait su lui rappeler que si le roi ne gouvernait point, il régnait.
Aussi l’appréhension de perdre la faveur royale obligea le duc de Choiseul à dissimuler son désir de diriger exclusivement les Affaires Étrangères. Avec une curiosité peut-être indiscrète, il ne se borna pas à attendre, mais il fit surveiller l’entourage de Saint-Germain, de la marquise, de Belle-Isle et du roi.
Notre héros, lui, se souciait peu de l’hostilité du ministre. Il se croyait assuré de la proteétion royale. Il avait l’appui de la maîtresse en titre et son pro-tcélcur, le maréchal, venait d’être appelé à la direction du ministère de 1a Guerre. D’autre part, il entretenait les relations les plus amicales avec le comte de Clermont, prince du sang.
Certains ambassadeurs étrangers prétendent que des ministres le fréquentaient et venaient prendre conseil de lui1. 11 intervenait dans la marche des
affaires et c’eSt ainsi que dans une lettre qu’il adressait à un de scs amis, Saint-Germain se vantait d’avoir contribué à la chute du contrôleur Silhouette2.
Après la chute du financier, Saint-Germain se trouvait particulièrement désigné pour remplir la mission dont le roi voulait le charger. Ses voyages à travers le monde l’avaient mis en relation dans'tous
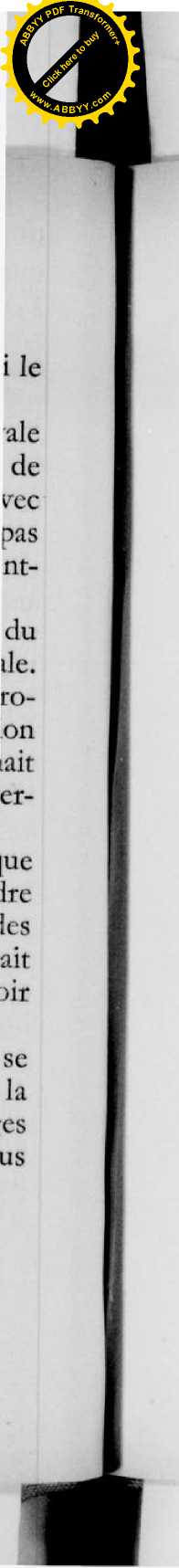

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
les pays avec les personnes les plus élevées par la naissance ou par leurs fondions.
C’eSt sur ces entrefaites que Louis XV lui exposa un soir ce qu’il attendait de son dévouement. Le monarque désirait obtenir cette annéc-là, en Hollande, un emprunt de 30 millions de florins.
Ce n’était pas la première fois que le gouvernement avait recours à des agents secrets, en matière de finances.
Par exemple, en 1757, sur les conseils du banquier Corneman et le consentement de AL de Boulogne, contrôleur général, l’abbé de Bernis avait donné l’ordre à Casanova de Seingalt, chevalier d’industrie bien connu, de négocier en Hollande, au nom du roi de France, un emprunt de 20 millions, soit à peu près 2 millions de florins. Aucun moyen n’avait été imposé. Il s’agissait de proposer aux États Généraux ou à une compagnie privée de la Cité d’AmSterdam, dont la prospérité passait pour fabuleuse, des effets royaux. L’habilité consistait à acquérir les papiers de quelque autre puissance dont le crédit serait moins ébranlé que celui de la France et de les réaliser au plus tôt1.
M. Armand Baschet a voulu démontrer dans une étude2 l’authenticité absolue des opérations de
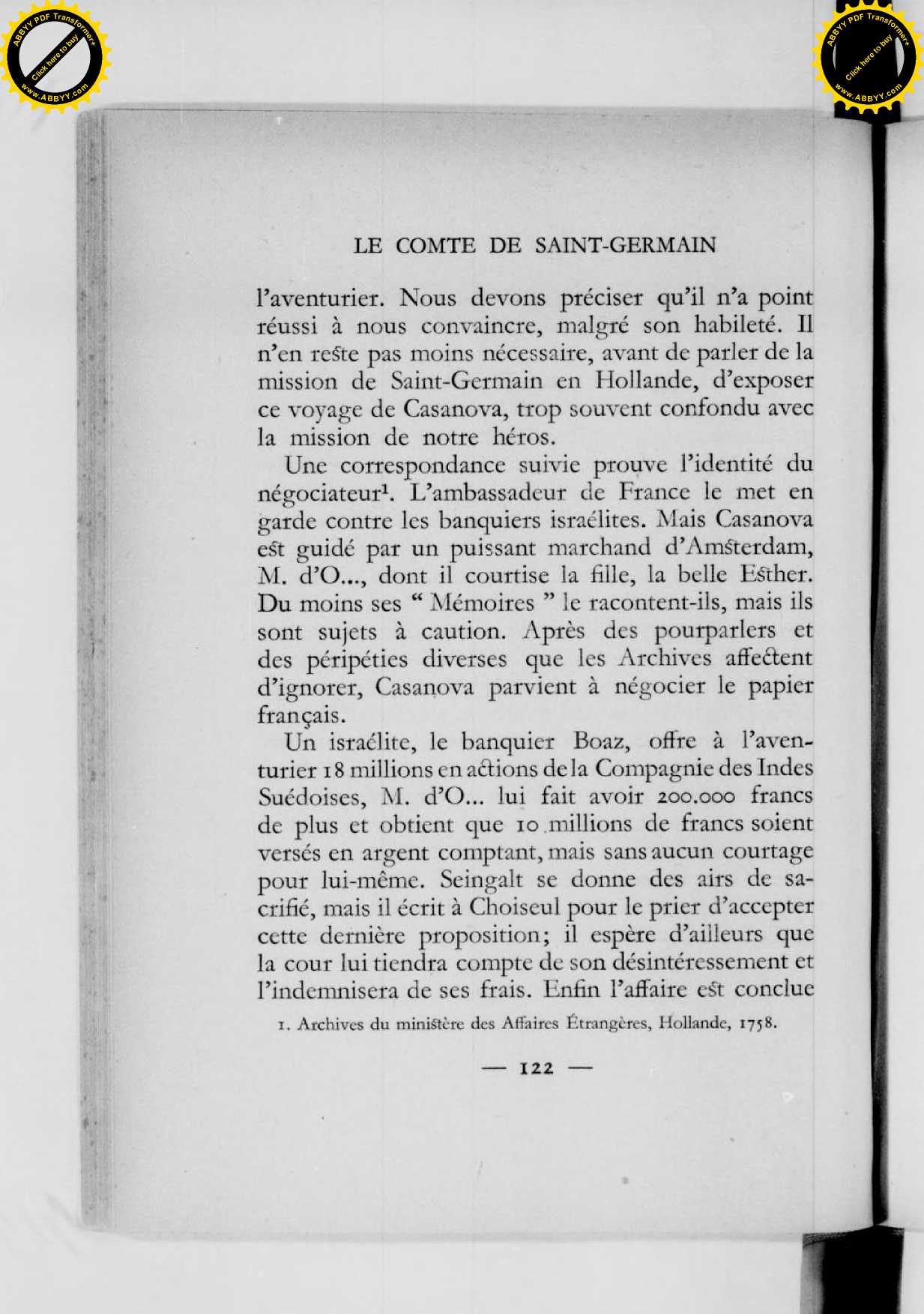
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Un Israélite, le banquier Boaz, offre à l’aventurier 18 millions en actions delà Compagnie des Indes Suédoises, Al. d’O... lui fait avoir 200.000 francs de plus et obtient que 10 millions de francs soient versés en argent comptant, mais sans aucun courtage pour lui-même. Seingalt se donne des airs de sacrifié, mais il écrit à Choiseul pour le prier d’accepter cette dernière proposition; il espère d’ailleurs que la cour lui tiendra compte de son désintéressement et l’indemnisera de ses frais. Enfin l’affaire eSt conclue
I. Archives du ministère des Affaires Étrangères, Hollande, 1758.
l’aventurier. Nous devons préciser qu’il n’a point réussi à nous convaincre, malgré son habileté. Il n’en rcśte pas moins nécessaire, avant de parler de la mission de Saint-Germain en Hollande, d’exposer ce voyage de Casanova, trop souvent confondu avec la mission de notre héros.
Une correspondance suivie prouve l’identité du négociateur1. L’ambassadeur de France le met en garde contre les banquiers Israélites. Mais Casanova est guidé par un puissant marchand d’Amsterdam, AL d’O..., dont il courtise la fille, la belle ESthcr. Du moins ses “ Alémoires ” le racontent-ils, mais ils sont sujets à caution. Après des pourparlers et des péripéties diverses que les Archives affectent d’ignorer, Casanova parvient à négocier le papier français.
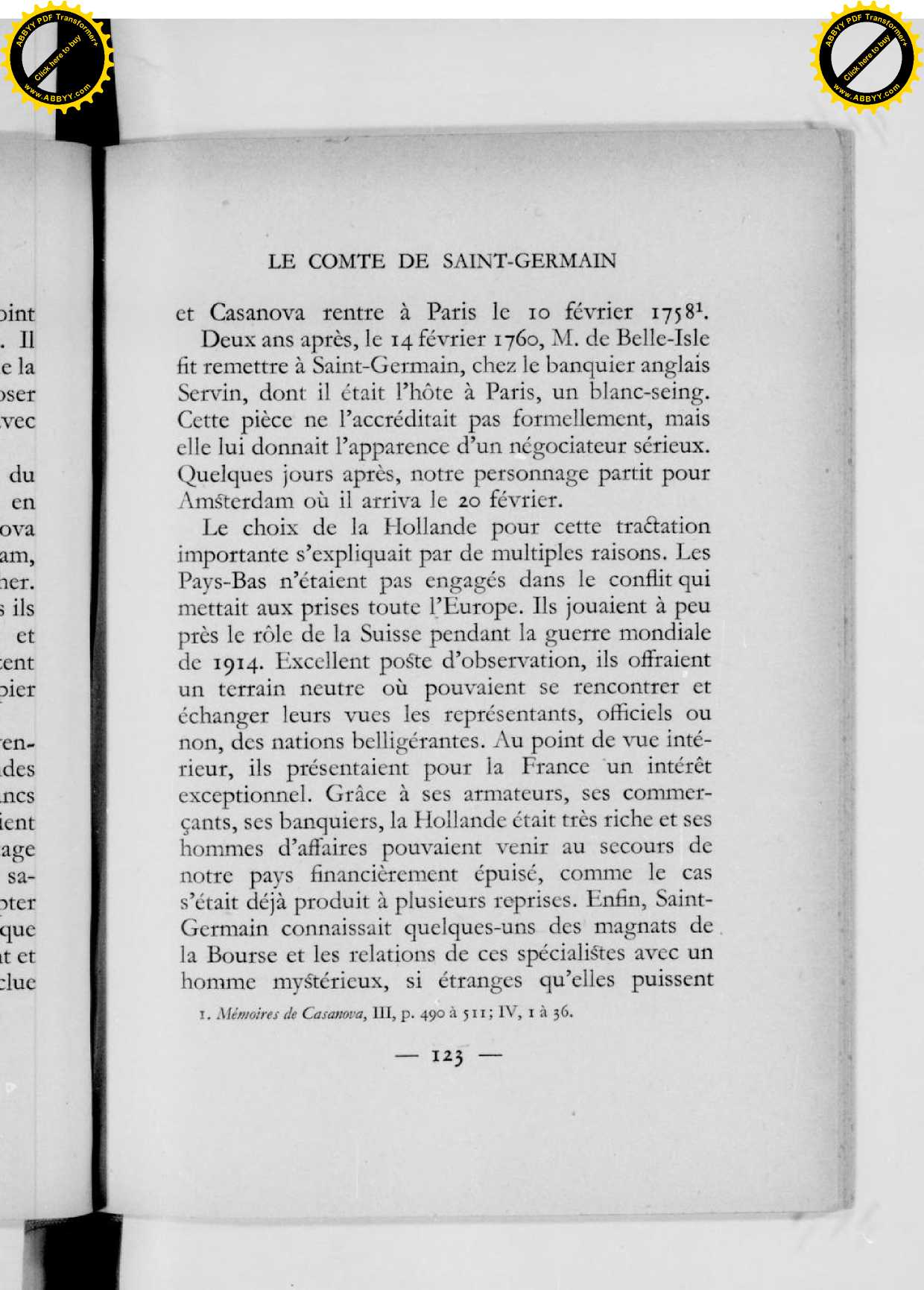


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN paraître au premier abord, ne surprennent plus lorsque l’on sait la faveur avec laquelle Casanova, escroc reconnu, avait été accueilli par eux deux ans plus tôt.
Le comte, “ personna grata ” auprès de la bourgeoisie opulente d’AmSterdam, était mieux placé qu’un autre pour mener à bien les négociations de Louis XV.
Saint-Germain descendit à Amsterdam, chez le banquier Adrien Hope. Ce dernier avait déjà conclu maints arrangements financiers avec la France et se faisait fort de recommander notre héros à plusieurs Israélites portugais dont la colonie, assez nombreuse, avait une situation de premier ordre dans les Province s-Unie s.
Le comte s’était dit chargé de contraéter un emprunt de 30 millions de florins pour la France. Mais il eut le tort de jouer, en parlant affaires, le même personnage qu’en Angleterre et qu’à Paris. U employa son prestige coutumier dont il avait éprouvé la valeur. Il recourut au merveilleux, donna à croire qu’il avait dépassé la centaine et qu’il détenait le secret de la pierre philosophale. Il affeéta le meme dédain de l’argent, comme s’il connaissait le moyen de n’en jamais manquer. Il mena un train fastueux, nourrit un nombreux personnel domestique, dépensa sans compter, étala les plus somptueux bijoux, charma

lilis
ne

Va ir. lit la dc ;n it
is la
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
et intrigua par d’alertes récits, des confidences réticentes et montra au grand jour sa virtuosité de vio-loniśte et de chanteur. Bientôt tout Amsterdam raffola de lui. La plus haute société lui ouvrit ses portes. Il fréquenta journellement chez le bourgmestre. C’eSt à qui aurait le personnage prodigieux à scs réceptions. Mais ccs succès flatteurs ne lui firent point perdre la tête, qu’il avait solide. D’ailleurs, n’était-il point habitué? Il ne négligea pas non plus ses intérêts et signa avec un noble de Franche-Comté, M. de Lignièrcs, un contrat d’association pour la réparation des machines hydrauliques destinées au nettoyage des ports, des canaux et des fleuves1.
Cependant, à la cour de France, on brûlait de connaître ce qu’il faisait et, dès le 26 février, Belle-Isle lui envoyait une lettre où il lui disait son impatience d’avoir des nouvelles de lui et ne tarissait pas d’éloges sur son zèle, son habileté et les espoirs qu’il plaçait sur le but de sa mission. Saint-Germain quitta alors Amsterdam et, mettant à profit un heureux concours de circonstances, il partit pour La Haye. C’eSt le moment où se déroulaient les noces de la princesse Caroline et du prince Charles de Nassau. Les réjouissances publiques, pensa-t-il, serviront de prétexte suffisant à ses déplacements et il pourra,


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN sans éveiller de soupçons, interroger les bonnes volontés.
L’accueil de La Haye n’est pas moins chaleureux que celui d’Amsterdam. Adrien Hope, qui accompagnait notre héros, le mit en relations avec quelques membres de la plus haute société. Ce dernier possédait, en outre, des lettres d’introduétion auprès de certaines personnalités. Il comptait renouer connaissance avec le chargé d’Affaires anglais, Yorke, qu’il avait jadis fréquenté en Angleterre. La situation se dessinerait donc très favorablement si, à Versailles, M. de Choiseul n’avait point été averti du départ et de l’activité de Saint-Germain.
Au début, le ministre avait cru à la mission de ce dernier. Il n’ignorait point le ressentiment qu’éprouvait le roi pour les frères Paris. La banque dirigée par eux possédait le privilège exclusif de prêter à la Couronne. Il savait combien cette prérogative exaspérait le souverain. Tenter auprès des argentiers d’Amsterdam un emprunt nouveau pour empêcher les frères Paris d’empiéter sur le terrain politique, comme ils tendaient à le faire, était de bonne guerre. Mais le duc n’ignorait pas que Saint-Germain ne passait pas toutes ses nuits à pratiquer la magic. Certains bruits affirmaient que le comte était plus souvent employé au Secret du Roi. Enfin, après quelques jours, le secrétaire d’Etat apprit par un
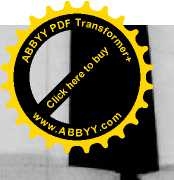

ICS
□X II-:cs sede is-i’il on es, irt ce >u-;ée la as-:rs icr ie, rc. ne ic. ■ us rès un
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
rapport de l’ambassadeur à La Haye, l’exiStence du blanc-seing remis à l’aventurier par le maréchal de Belle-Isle. Point n’était besoin d’une pièce officielle pour négocier un emprunt, du moins si notre héros était aussi connu à la Bourse de Hollande qu’il le prétendait. Malgré lui, Choiscul fit des rapprochements. Les physionomies du roi et de Mme de Pompadour ne s’étaient-elles point éclaircies dès le départ de l’agent secret? Un événement duquel dépend la tranquillité de leur esprit n’allait-il pas surgir?
Mais le duc de Choiscul soutirait de ne point comprendre. 11 chercha à éloigner de son esprit le vain mirage et brusquement l’illumination tardive l’éclaira. Maintenant, il savait. La négociation financière du comte était un subterfuge derrière lequel se cachait une véritable mission que nul ne connaissait. Saint-Germain avait travaillé au Secret du Roi, tout naturellement il avait été chargé de commencer les pourparlers avec l’Angleterre, en vue de la paix que chacun désirait.
Mais cette entente serait la négation même de la politique de Choiscul et le traité possible provoquerait dans un bref délai sa chute. Un soir, chez Mme de Tonnerre, il tenta de confesser le maréchal de Belle-Isle. A des questions insidieuses, le vieux soldat répondit nettement, trop nettement même. M. le duc éprouva dès la première phrase l’impression que

11
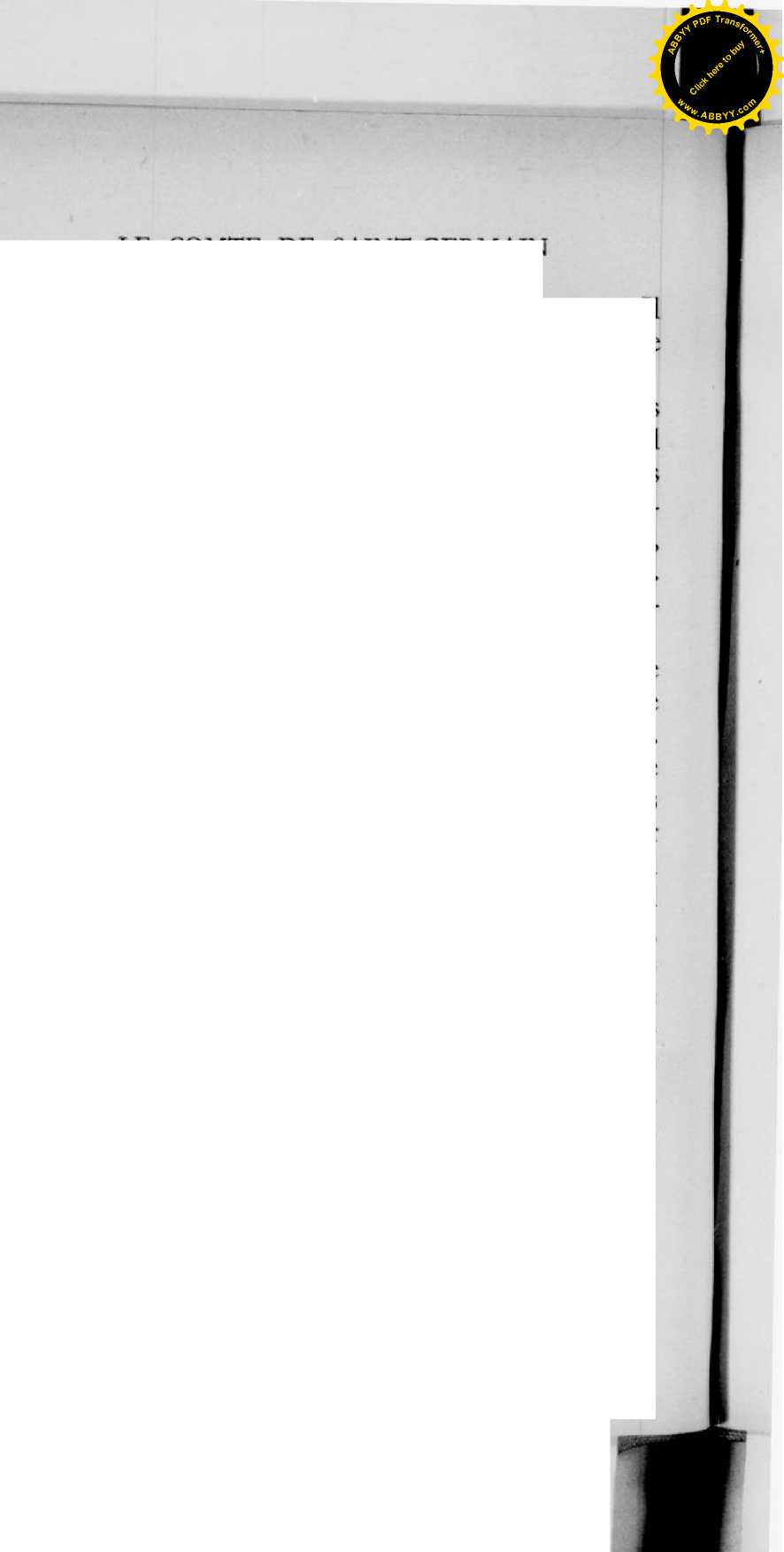
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
— 128 —
la réplique était apprise depuis longtemps, sembla se laisser convaincre et joua devant miniśtre de la Guerre la comédie de l’amabilité.
Maintenant, la preuve était faite. Ce n’était pas une preuve matérielle, mais une conviétion dont il ne sc séparerait point. 11 avait l’expérience des faits et son intuition affirme qu’il marchait vers la solution. Certes, il ne pouvait attaquer, sans preuve, M. de Saint-Germain pour crime de haute trahison. Qu’à cela ne tienne! Sur le terrain financier commencera l’offensive.
Notre ambassadeur à La Haye était à cette époque le comte d’Affry. Issu d’une famille du canton de Fribourg, il avait alors une cinquantaine d’années. Venu en France vers 1713, il avait pris du service dans les armées et s’était distingué, par la suite, dans les guerres de Pologne et d’Autriche. Brigadier général en 1744, puis maréchal lieutenant général en 1748, il s’était tourné vers la diplomatie. D’abord ambassadeur à Londres, il avait été envoyé à La Haye, pośtc dont nous avons dit l’importance dans ces temps de conflagration européenne. La venue de Saint-Germain le plongea dans une perplexité profonde. 11 se douta des buts secrets de notre personnage et soupçonna le roi de France de jouer un jeu personnel. Obligé par sa situation de ménager à la fois le souverain et le miniśtre, il se trouva dès le

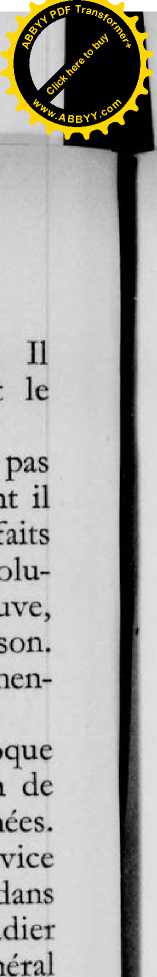
jord

aye,
CCS : de proson-i jeu à la ùs le
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
début dans une situation très délicate. Il éprouva, de plus, un froissement d’amour-propre bien compréhensible à voir un profane détenteur d’un secret d’État qu’on lui tenait soigneusement caché. Dans son hésitation, il se résolut à louvoyer jusqu’à l’éclaircissement de la situation. Il fit part à Choiseul de l’arrivée dans la capitale hollandaise du comte fantôme et demanda au ministre des instructions à ce sujet1.
Mais la fête du mariage princier détourna pendant quelques jours l’ambassadeur de ses préoccupations. Dans La Haye, ivre de joie, des plats appétissants et des chopes de bière étaient servis, au coin des principales artères, sur des tables dressées sur des tréteaux. Une foule hollandaise truculente, dont on connaît la vivacité et la gourmandise par les peintres de son école, fraternisait dans les rues de la capitale en braillant à tue-tête des refrains égrillards.
Lorsqu’une trop grande licence régnait dans les bals, la police forçait, sans méchanceté, la foule des ivrognes à aller chanter ailleurs. Mais, avec un ensemble touchant, les paysans et les ouvriers tapageurs finissaient en hâte leurs chopes avant de laisser les places libres aux gendarmes. 11 en résultait mainte mêlées épiques après lesquelles ouvriers et agents
i. Lettre classée dans les archives du ministère des Affaires Étrangères de 1 toi Linde, 1760.
buvaient dans les mêmes pots d’étain la belle liqueur blonde que prodiguaient d’immenses fûts. Les ouvriers s’en tiraient pour quelques coups et s’en retournaient le soir près de leurs femmes, perdues
dans les bagarres diverses, avec la satisfaction d’avoir
bien bu et pris part honnêtement à l’allégresse du pays.
A la fin des réjouissances données par la ville, courses, loteries, déguisements, il fallut songer de nouveau aux problèmes de l’heure et M. de Saint-Germain eut une entrevue avec M. d’Affry. Il lui montra le blanc-seing, preuve de la confiance du roi. Le représentant français n’avait reçu aucun ordre de Choiseul. 11 s’inclina et exprima son désir de connaître les raisons du séjour de l’agent en Hollande. Le comte, avec cette loquacité indiscrète, trait essentiel de son caractère, se répandit d’abord en propos pessimistes sur la situation financière de la France.
“Les coffres sont délestés de leur encaisse; le nouveau contrôleur des finances, M. Bertin, cśt disposé à suivre une orientation différente de celle adoptée par M. de Silhouette. 11 cśt animé d’excellentes intentions, consulte fréquemment sa conscience, ne cherche pas à faire une révolution aux frais des fermiers généraux pour acquérir une popularité, mais malheureusement il n’cśt pas un financier de race et n’aboutira à rien.
— Mais enfin, MM. de Montmartel et Duvernet,
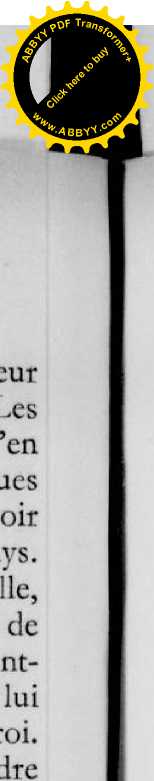
an
de.
m-)0S ce.
le cśt die :cl-Ce’ criais
et

LE COMTE DE SAINT GERMAIN banquiers de la cour, ont proposé une solution au désarroi bancaire?
— Nous sommes d’accord, mais ces messieurs les gouvernent. Je ne veux point juger mais la modeste compétence que je possède sur ces questions me font considérer ces derniers comme néfastes au pays. J’ai établi pour ma part un plan sûr, deśtine à l’amélioration des finances françaises et je ne doute point de sa réussite1. ”
Sous ce flot de paroles, d’Affry ne perdit point contenance. Il demanda à son interlocuteur de bien vouloir lui exposer les grandes lignes de son plan. Saint-Germain commença par esquiver cette courtoise mise en demeure et détourna la conversation sur ses relations amicales avec le maréchal de Bclle-Isle. 11 montra à d’Affry deux lettres du vainqueur de Prague, reçues depuis son arrivée aux Pays-Bas. Nous avons expliqué précédemment qu’elles étaient parties de Versailles le 26 février 1760. Elles contenaient d’ailleurs des éloges sur le zèle de notre personnage.
D’Affry ramena Saint-Germain à l’objet de la réforme envisagée pour remettre le 'Trésor royal en meilleur état.
“ Je ne sais rien de précis et je m’en occuperai
iet,

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
dès mon retour à Versailles. Si vous désirez lire mon projet je vous l’apporterai dès demain, mais à titre purement amical. ”
L’ambassadeur voulut alors savoir le rapport existant entre ce fameux plan et le voyage de son auteur en Hollande. Le comte répondit d’une voix embarrassée :
“ Les grandes lignes de la mission que je poursuis consistent à assurer à la France le crédit des plus grands banquiers hollandais. ”
Le même jour, après avoir pris congé de l’ambassadeur, Saint-Germain engageait des pourparlers politiques avec le comte de Bentinck, un des personnages les plus importants des Pays-Bas. En 1747, ce dernier avait joué un rôle de premier plan dans le rétablissement du stathoudérat dans les Provinces-Unies. Très bien vu de l’Angleterre, où il avait séjourné quelque temps, il passait pour être attaché à la cause des Hanovre.
La conversation entre les deux hommes débuta sur les possibilités de la paix entre la France et son ennemie.
“ La Grande-Bretagne, affirma M. de Bentinck, n’entraverait point les négociations. Si des résistances doivent surgir, elles viendront de Versailles, non de Londres1. ”
1. Kauderbach, Lettres traduites et expliquées par von Weber, 1856.
- I32 —


Comme bon nombre des membres de la haute société néerlandaise, l’homme d’Etat s’était laissé séduire par le brio de l’aventurier. Il ne tarda point à lui offrir dans sa propre maison un appartement que Saint-Germain accepta. Cette nouvelle, communiquée à Choiseul par le représentant de la France, fit un effet désastreux sur l’esprit du ministre1.
A Versailles, le roi, Mme de Pompadour, la cour, le pays tout entier désiraient une prompte cessation des hostilités, mais leurs dispositions pacifiques se heurtaient à l’intransigeance de M. le duc.
Que l’Angleterre fût prête à engager des pourparlers, nul n’en doutait. Une lettre de lord Granville, président du Conseil Privé, au duc de Newcastle, premier lord du Trésor, dont Mme de Pompadour avait reçu communication et qu’elle avait fait présenter par le récipiendaire au Premier en était la plus récente preuve.
Malgré ce que l’on sait sur les rivalités des dirigeants français à cette époque, on s’étonne de voir la marquise user de tels détours pour faire parvenir à Choiseul des renseignements de première importance. Peut-être aussi avaient-ils été communiqués par des services affiliés à la diplomatie personnelle du monarque et était-il obligatoire de camoufler leurs origines?
i. Rapports diplomatiques. Archives du ministère. Hollande, 1760.
— 133 —

Pendant ce temps, à La Haye, Saint-Germain était devenu un ami de Bentinck.
“ Je refusai d’abord cette mission, mais, à la réflexion, j’accédai au désir de Mme de Pompadour, avait-il confié à ce dernier.
— Vous avez redouté de ne point réussir?
— Non pas, mais j’ai réfléchi plusieurs jours. ”
Ainsi qu’il l’avait promis à d’Afffy, l’aventurier apporta à l’ambassadeur son projet de réorganisation financière. Il assurait que ce plan était connu de Bénin, le contrôleur général des finances, et recevait son adhésion1 mais il faut voir dans cette affirmation une fanfaronnade destinée à assurer sa position de négociateur.
D’Aflry demanda quelques jours pour l’examiner et Saint-Germain rentra dans sa chambre écrire une lettre conservée aux archives du quai d’Orsay. Apres avoir assuré la maîtresse en titre de scs respe&s et de ses meilleurs sentiments ainsi que de son désir d’être utile à la France, il lui parlait dans les termes les plus chaleureux du comte Bentinck, seigneur de Rhôone.
“ Ceśt le plus sûr et le plus dévoué ami de notre pays et Votre Grâce ne doit pas ajouter foi à tout ce qu’on pourrait dire contre lui. Bentinck a autant
I. Lettre de d’Affry à Choiseul. Archives des Affaires Étrangères, Hollande, 1760.
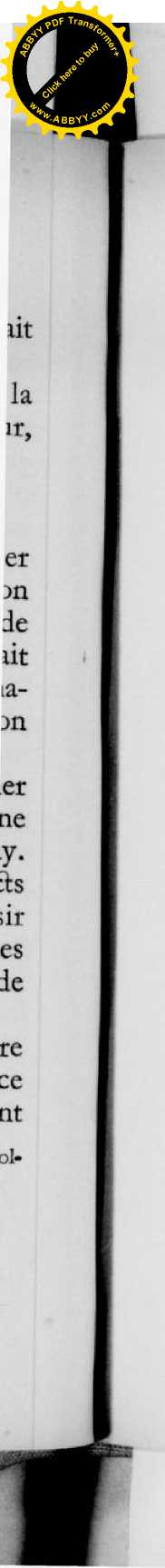
d’influence en Angleterre qu’en Hollande. C’eśt un grand homme d’Etat, un parfait gentilhomme. J’en réponds comme de moi-même. J’ai des raisons de supposer que le roi doit attendre de Bentinck les plus grands services. Ce dernier cśt prêt, si cela plaît à Sa Majesté, à mettre à profit ses relations personnelles pour obtenir un heureux résultat. On pourrait avoir la paix, sans les inconvénients d’un Congrès général1. ”
Le comte termine sa lettre en priant la marquise de lui faire tenir les instructions royales, soit à La Haye, chez le comte de Rhôone, soit à Amsterdam chez Adrien Hope. Au cas où elle n’aurait point le temps de répondre elle-même, il la supplie de le faire par l’entremise d’une personne sûre et de confiance,
“ Ne perdez pas à me répondre, je vous en conjure, un des moments que vous offrez à l’attachement, à l’amour que vous avez pour le plus aimable des rois. ”
Dans un post-scriptum, Saint-Germain abandonne le terrain des intérêts généraux pour traiter d’une affaire qui lui est personnelle.
Un vaisseau de commerce Vylchrmann avait été pris par les Anglais. Notre héros, intéressé pour
i. Lettre de Saint-Germain à Mme de Pompadour, thid Hollande, 1760.
— us —
50.000 écus dans ce bâtiment, demande à la marquise d’intercéder en sa faveur près de M. Emery, chargé dans le port du Havre de le faire restituer. L’incident cSt intéressant à relater, puisqu’il nous montre à la fois la variété des affaires auxquelles était mêlé Saint-Germain et l’une des sources de son apparente richesse.
Bentinck reçu communication de cette missive à la favorite,
“ Le ministre connaît-il votre adivité? ”
Saint-Germain haussa les épaules en riant et dit avec une flamme d’orgueilleuse assurance dans le regard :
“ Il y aura bientôt du nouveau à Versailles. Choi-scul n’aura point toujours le pouvoir de faire échouer la paix1. ”
De son côté, le comte d’Affry s’était empressé de prendre communication du fameux plan. Il le renvoya après quelques jours à son auteur, sans y ajouter aucune observation. Cependant, une rencontre fortuite chez une relation commune, M. de Kauder-bach, résident saxon, leur permit, après une partie de dés, un échange de vues sinon cordial, du moins plus libre. L’ambassadeur fit part à Saint-Germain de son étonnement :
“ Ces sortes d’affaires n’ont rien de relatif au
vcc rd : IOÍ-uer
au

lise rgé tici-itre lêlé nte
de enter br-er-■tie ins de
ministère dont je suis honoré. Vous comprenez qu’il n’eSt interdit de m’en mêler sans avoir reçu l’ordre de trouver du crédit pour les fonds de Sa Majesté à Amsterdam ou dans les autres villes de Hollande. ”
Notre personnage ne fut pas autrement déçu de la conduite de l’ambassadeur. Ce dernier, fin diplomate, poursuivit la conversation et se mit à parler du projet d’édit royal esquissé par le gouvernement français au sujet de la constitution d’une caisse d’escompte.
“ — Voilà, dit-il, qui peut devenir un trésor immense pour les gens qui la géreront....
— Et qui en profiteront, ajouta Saint-Germain. Si on laisse MM. Paris s’en rendre maîtres, ils le deviendront bientôt de toute la finance du royaume.
— Je ne défends pas particulièrement ces derniers....
— Peut-être, et vous ne tentez rien contre ces corrupteurs de consciences. Mais moi je suis là et mon voyage en Hollande achèvera de former une compagnie suffisante pour s’opposer à ces beaux desseins. ”
D’Affry ne releva point la réplique, mais il comprit sans peine pour quelle raison M. de Saint-Germain nourrissait une telle antipathie à l’endroit des frères Paris. La conversation se détourna sur un autre sujet et Saint-Germain tenta, comme il l’avait fait pour Mme de Pompadour, de faire revenir le repré -
— j37 —

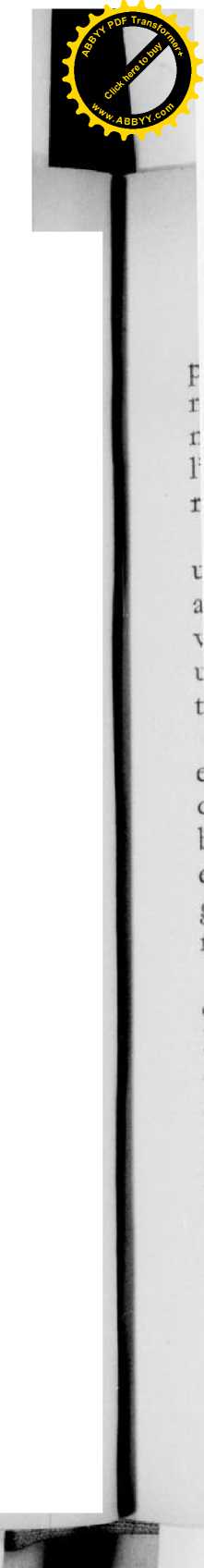
sentant sur scs préventions à l’égard de M. de Ben-tinck, dont on connaissait à Amsterdam et à La Haye l’anglophilie notoire.
“ — Il s’cSt plaint à moi de ce que vous ne lui aviez jamais parlé affaires.
— Vous comprenez que mon titre de diplomate me force à une certaine réserve!
— Mais pourquoi cette attitude qui le peine? Il affirme que nul n’eśt moins Anglais que lui. Il cśt vraiment patriote et plus Français que vous ne le croyez1. ”
Devant ce coup droit, d’Affry, choqué de l’indiscrétion de notre homme, usa d’un procédé très en honneur chez les diplomates. 11 noya sous les généralités les plus communes un refus de s’expliquer, dont la netteté aurait été blessante. 11 fit ensuite sentir à son interlocuteur combien il trouvait singulière son attitude.
Mais cet échec auprès de l’ambassadeur de France ne découragea point notre homme. Il redoubla encore de zèle pour hâter la conclusion de la paix.
Quelques années auparavant, M. de Saint-Germain était entré en relations, à Londres même, avec le major général Yorke, depuis envoyé plénipotentiaire à La Haye. Bien que celui-ci n’eût mis aucune hâte
i. Rapport de d’Alfry à Choiseul. Archives des Affaires Étrangères, 1760,
— 138 —
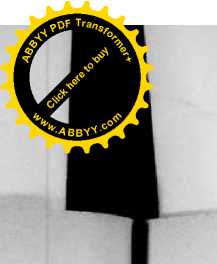

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Ben-^ye
e lui
mate
5? Il
1 eSt le le
idis-
s en léra-dont tir à
son
anee core
nain

pour renouer connaissance avec lui, notre héros résolut de lui faire une visite. Une première tentative n’eût aucun succès et Yorkc fit la sourde oreille. Mais l’aventurier renouvela sa demande d’audience et fut reçu le 14 mars.
Le comte commença comme toujours par tracer un tableau très sombre de l’état de la France qui avait besoin de la paix et désirait la conclure au plus vite. Il exprima sa propre ambition de contribuer à un but désiré de toute l’humanité et affirma, en termes très nets, son amour pour l’Angleterre et la Prusse.
Poliment, Yorke s’excusa d’abord de ne pouvoir examiner une question aussi grave avec un homme qui n’était pas accrédité pour cela. Saint-Germain bondit et présenta à l’Anglais le blanc-seing du roi et les lettres du maréchal de Belle-Isle. L’ancien major général en prit connaissance, lui adressa les compliments d’usage et le pria de s’expliquer.
“ Le roi, le dauphin, toute la cour, tout le peuple désirent la paix avec l’Angleterre. Seuls, Choiseul et Berryer, ministre de la Marine et des Colonies, s’y opposent, surtout parce que l’initiative ne vient point d’eux, mais leur résistance sera de courte durée. La situation intérieure exige impérieusement la fin des hostilités. La France ne connaît point les vrais sentiments de l’Angleterre à cet égard, mais toute son ambition cSt de se tirer d’affaire avec honneur. C’est
— 139 —

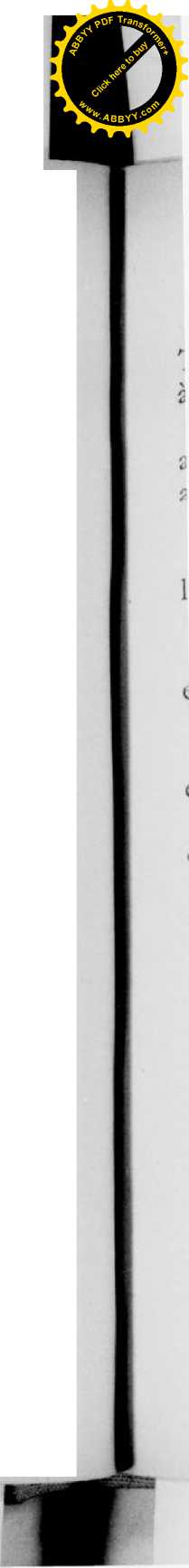
pour apprendre les intentions de la Grande-Bretagne que le maréchal de Bclle-Isle m’a choisi avec l’agrément du roi de France. Ni M. d’Affry, ni le duc de Choiseul ne sont au courant de ma mission et on eśt résolu à les laisser en dehors des traéfations. Mme de Pompadour n’est pas favorable à la cour de Vienne, mais ne sachant sur qui compter, elle flotte dans l’incertitude. Dès qu’elle sera sûre de la paix, elle montrera la plus grande décision. Sans doute, l’Espagne a bien offert sa médiation pour la paix franco-anglaise, et le duc s’efforce de faire croire que les bons offices de cette puissance seront couronnés de succès. Mais à Versailles, on reśte bien sceptique à cet égard1. ”
A ces franches déclarations Yorkc hésita. Il craignait de traiter la question à fond et répliqua par des considérations et des assurances générales. Georges II, affirma-t-il, eśt très désireux de la paix. On en pourrait donc traiter en détail si l’Angleterre était pleinement assurée que ses adversaires éprouvaient les mêmes sentiments qu’elle. Mais comment la France pourrait-elle se dégager de la dépendance où elle se trouvait par rapport aux deux impératrices? Se rendait-elle compte des désagréments qui lui apporterait le traité, meme si le roi de Prusse avait des malheurs?
ren
drait airs?
eine-t les
crai-.r des ;esll, Dour-
-ance le sc
‘tagne ’agré-uc de
3ii eśt ne de

ennc, dans :, elle FEs-
anco-1e les és de ^ue à
Tant que l’on n’aurait point à Londres des certitudes à ce sujet, on reśterait dans l’expectative.
La conversation s’anima alors et le représentant anglais demanda à notre personnage quelle perte avait été la plus sensible à la France.
“ — Eśt-ce le Canada?
— Non, car nous savons qu’il nous a coûté 36 millions sans rien nous rapporter.
— La Guadeloupe?
— Ce n’cśt point à cause de cela que la paix peut échouer, car nous avons assez de sucre sans cette île.
— Les Indes Orientales?
— Voilà le point sensible, car l’état de nos finances en dépend. ”
Poursuivant son questionnaire, Yorke demanda ce qu’on pensait en France sur Dunkerque.
“ — Nous nous déciderons à le désarmer. Mais, de votre côté, que pensez-vous de Minorque?
— Bah! nous l’avons oublié et personne n’en parle plus.
— Je leur ai dit cent et mille fois ”, s’écria Saint-Germain triomphant.
Et d’un air songeur il ajouta : “ La question des dépenses pour la guerre nous met dans de sérieuses difficultés1
T. G. Volz, Der Graf eo» Saini-Germain.
■-- I4I --
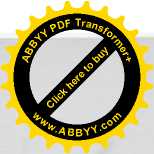

LE COMTE DE SAINT GERMAIN
La conversation n’avait pas duré moins de trois heures. Yorkc promit à son interlocuteur d’en référer à son gouvernement, mais notre homme le quitta en lui demandant le secret sur son nom.
“ Je pars bientôt pour Amsterdam. Prévenez-moi dès que vous aurez une réponse. Je m’empresserai de revenir. ”
Il prit congé de Yorke sur des paroles évasives. Ce dernier ne pouvait prévoir si la cour de Londres tiendrait compte de ces révélations et les jugerait dignes d’une réponse. Le soir, l’attaché anglais dit à l’oreille du chargé d’affaires prussien, Hellen, son entretien avec le comte de Saint-Germain. Peu de jours après, il relatait l’aventure dans tous ses détails.
Ce fut bientôt chose connue dans les légations et l’envoyé de l’Autriche notre alliée, Reichach, en informait le 18 mars son gouvernement1.
Il ajoutait que le comte devait être chargé par la cour de France de parler de la paix. La présence de ce dernier alarmait d’Affry, dont le ressentiment augmentait. Bien plus, le prince Louis de Brunswick, régent des Pays-Bas et parent d’un des meilleurs généraux de Frédéric II, témoignait quelque inquiétude à cet égard. Il avait fait venir notre ambassadeur et lui avait demandé des renseignements sur la mission en
i. Archives de la Hoffburg à Vienne. Rapports diplomatiques.
— I42 —

! trois
tta en
z-moi
sscrai
si ves. ndres gérait is dit
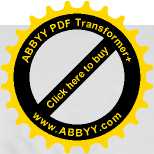
i, son :u de étails. ms et ni in-
lar la ce de ; aug-wick, géné-ade à et lui
>n en
LE COMTE DE SAINT GERMAIN
Hollande du mystérieux personnage. D’Affry, on le conçoit, éprouva quelque gêne; il prétendit tout ignorer, puis, rompant l’entretien, déclara dédaigneusement :
“ Il n’y a pas à s’en préoccuper autrement. De tout temps cet homme a passé pour un aventurier1. ”
Cependant, le lendemain de son entretien avec Yorke, Saint-Germain en avait avisé la cour de France, puis avait regagné Amsterdam.
L’ancienne cité de la banque et du diamant était construite au xviiT siècle sur des pilotis maçonnés et, plus qu’en notre siècle, elle gardait son cachet de cité lacuśtre. Les remparts étaient défendus extérieurement par un large canal demi-circulaire, le Singel. Une petite rivière, l’AmStel, lui donna, à l’origine, son nom. AmSteldam signifie le pont sur l’AmStel. File divisait la ville en deux parties, celle située à l’Orient, fut appelée Oudezyde ou Ancien Côté, sans doute parce qu’elle fut préférée par les premiers colons. L’autre Nicuwezyde, ou Côté Neuf, était pratiquement habitée depuis la fin du xvie siècle. Près de l’hôtel de Rondeel, l’AmStel passait sous le pont Doelenburg, dont la construction avait été achevée en 1685 et prenait jusqu’à la Bourse le nom de Rokin. Depuis ce palais, le petit fleuve sc diri-
geait vers le pont Neuf, pour traverser une immense
écluse dont le trop-plein se déversait dans le Zui-derzée, sous le nom de Danrak.
■ Une multitude de canaux divisaient alors la ville en quatre-vingt-dix petites îles. Trois cent trente-quatre ponts, le chiffre en eSt relaté dans un livre de voyage de 1860, étaient destinés à relier les divers quartiers sur les quatre grands canaux parallèles au Singel-Buitcn et concentriques comme lui, parmi lesquels le Herren-gracht où se présentait la maison d’Adrien Hope. Leurs rives étaient plantées d’arbres. Des bateaux les sillonnaient et les gens de qualité étendus sur des coussins brodés, protégés des variations de température par un dais magnifique, pouvaient apercevoir en été, sur les hôtels particuliers qui leur faisaient escorte, les minces rayons d’un soleil dont l’épaisseur des feuillages ne leur permettait pas de soupçonner l’existence. L’AmStel possédait, lui aussi, des rives variées décorées de géraniums et de tulipes très lumineuses. Derrière elles se prolongeait une file de maisonnettes, de pavillons, de jardins adossés à des prairies immenses, vertes en toutes
saisons.
En 1760, le Forum hollandais se trouvait sur le Dam. Le Palais Royal était d’un Style Renaissance un peu bigarré. L’Eglise Neuve ogivale dont la forme s’eâtompait derrière lui datait déjà de 1400. Tout près
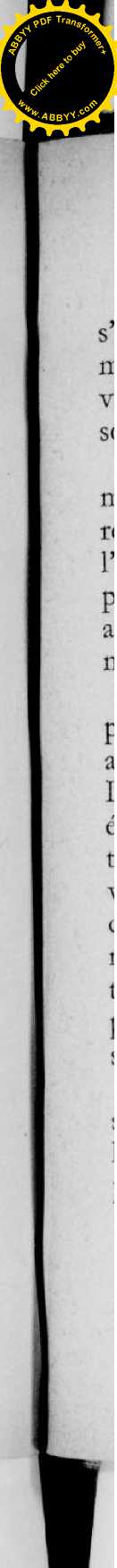


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN s’élevait la Bourse, inspirée de l’antiquité grecque, mais dont la pureté approximative devait donner aux visiteurs l’impression de ne pas “ être à sa place ” sous le cieil orageux et pluvieux de la Hollande.
Vers l’OueSt, s’élevait le fameux Botermarkt, le marché au beurre, construit en 1593; c’était le rendez-vous des marchands et des ouvriers pendant l’époque de la kermesse et, sans nous tromper, nous pouvons affirmer que M. de Saint-Germain, grand amateur de réjouissances populaires, vint avec joie y manger et y boire.
Sur le même côté de l’AmStel se trouvait la perspective du Kalversratt, la rue du Calvaire. Parallèle au canal de Roskin, elle joignait d’un seul trait le Dam et la Grande Tour à la Place de la Monnaie. Elle était reliée avec le Grand Canal par une série de voies terrestres, étroites et mal fréquentées, où l’on retrouvait parfois le corps d’une fille publique éventrée d’un coup de couteau. Des balustrades en fer formaient des obstacles destinés à empêcher la circulation, mais la constante sympathie des gens du monde pour ces milieux borgnes était une mode que notre siècle comprendra.
Saint-Germain goûtait beaucoup Amsterdam. L’air salin de la mer convenait à son tempérament et la société hollandaise qu’il avait beaucoup fréquentée, plusieurs années auparavant, lui avait toujours été
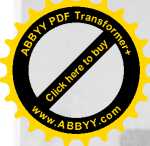

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
favorable. Tl aimait causer aux gens du peuple, s’enquérir de leurs travaux, encourager leurs espoirs. De menues pièces distribuées à bon escient lui avaient ainsi procuré la réputation d’un seigneur généreux.
11 repritavec fièvre les traftations au sujet de l’emprunt et il essaya, mais d’ailleurs en pure perte, de revoir une de ses anciennes relations, le prince régent de Brunswick. Sur un bruit fallacieux il crut nécessaire de revenir quelques jours à La Haye. 11 pensait revoir dans la capitale l’attaché anglais, mais il éprouva, en rentrant chez M. de Bentinck, la désagréable surprise de trouver une missive d’Affry le convoquant à l’ambassade de France.
Choiseul, en effet, avait pris connaissance de la lettre si confiante adressée par notre héros à Mme de Pompadour. A ce sujet il se pose un problème dont il nous paraît difficile de trouver une solution satisfaisante. Comment la fameuse lettre tomba-t-elle des mains de la favorite dans le bureau du ministre?
Le vol était un pis aller, sans doute réalisable, mais trop délicat, et le duc n’aurait point voulu s’exposer à pareille aventure. D’autre part, la copie par une tierce personne nous paraît difficile à imaginer. Le document était long et la porte de la marquise bien gardée.
La troisième solution, la plus vraisemblable, reśte
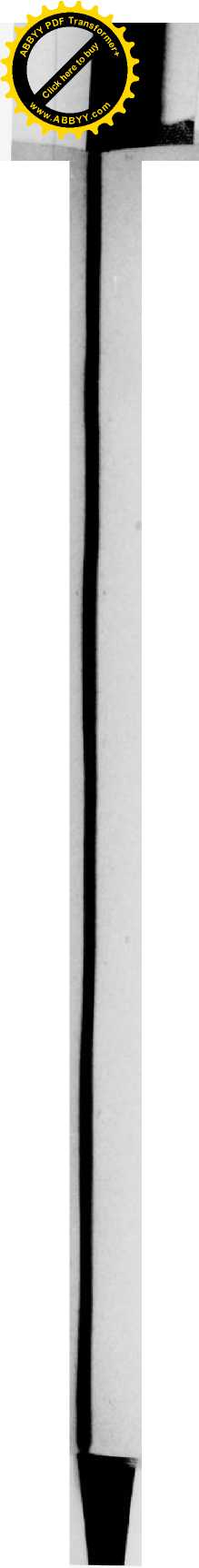
te
la de nt ai-.es
le, lu »ie
a
LT-
le, rs. ui ur
ride ce ut
II ais jale
Je don librement consenti par la favorite à M. de Choiseul de la missive de Saint-Germain.
En effet, le ministre redoutait plus les offres faites à l’Angleterre que la paix elle-même. Il avait peur d’affaiblir le preśtige de son cabinet, opposé depuis longtemps à une entente avec la Grande-Bretagne, en prenant l’initiative des pourparlers.
Mais entre le départ de Saint-Germain le 20 février, et le 25 mars date du retour à La Haye de notre héros, il y eut entre la marquise et Choiseul un changement total de relations. La raison du revirement fut vraisemblablement la promesse solennelle du secrétaire d’Etat d’envisager la paix. Cette supposition ne peut, bien entendu, être prouvée par une pièce d’archives. Elle est seulement la déduction logique tirée des faits qui allaient se dérouler.
Comme nous l’avons mentionné, lord Granville avait écrit au duc de Newcaśtle. Cette confidence
La maîtresse royale n’espérait pas un succès absolu de la mission de Saint-Germain. Elle dut recevoir sa lettre peu de temps après le départ de ce dernier pour Amsterdam. Elle en prit connaissance et la retourna à son destinataire avec prière de l’adresser dircéfemcnt à M. le duc, sans doute récemment converti à ses façons de voir.
La favorite craignait toujours de mêler sa signature
— i47 —
à des intrigues, mais elle n’en influençait pas moins le ministère des Affaires Étrangères.
Il eSt à remarquer que les instructions de Choiseul à d’Aflfy1 prennent aux environs du 10 mars une sévérité que n’auraient pas eu les ordres d’un homme d’État indécis sur l’esprit de son monarque.
En second lieu, aux environs de cette date, Saint-Germain ne reçoit plus de correspondance du maréchal de Belle-Isle, du comte de Clermont ni, bien entendu, de Mme de Pompadour.
En troisième lieu, vers cette époque, M. le duc fait en Conseil des ministres des allusions au sujet des pourparlers illicites avec l’Angleterre. Pendant cette séance, que nous raconterons en son temps, le roi ne relève aucune des libertés de Choiseul et garde le silence. Si nous n’avons pas une certitude absolue, nous avons plusieurs raisons de supposer qu’en mars 1760 le cabinet avait retrouvé à la cour sa popularité d’antan.
M. de Saint-Germain n’augura rien de bon en lisant la convocation de l’ambassadeur de France. Il se rendit cependant à la légation accompagnée de MM. de Brühl et de Kauderbach, résidents saxons dans la capitale. Notre héros alla la main
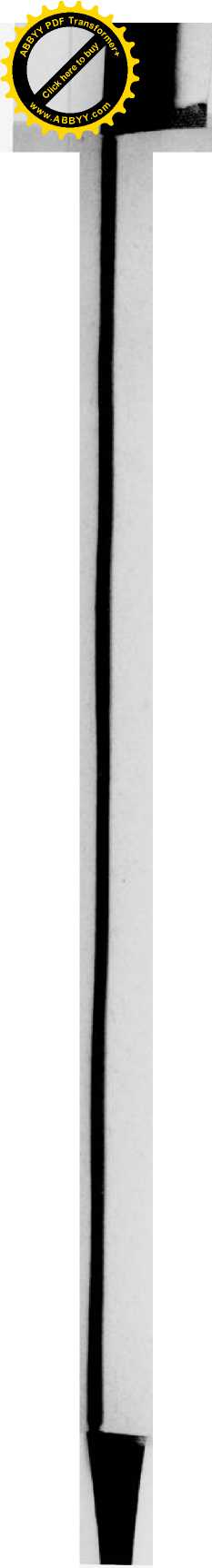
ins
fait
du
:tte roi
eul me me
nt-ré-icn
ue, ’en
3U-
en ce. léc ats un

tendue vers d’Affry et, après les premiers compliments de politesse, se tourna vers scs compagnons :
“ — Ces messieurs ont fait le pari de m’emmener chez le comte de Golovkin à Ryswik, où vous devez aussi souper, m’a-t-on dit.
— En effet, répondit simplement d’Affry. Cependant, monsieur de Saint-Germain, si ces messieurs veulent bien me le permettre, je serais très désireux de vous parler avant votre départ.
— A vos ordres, monsieur. ”
Et, laissant de Brühl et Kauderbach, le comte suivit l’ambassadeur dans son cabinet.
Là, fort courtoisement, mais avec fermeté, d’Affry 7 J /
“ — Vous vous êtes, monsieur, attiré à Versailles de graves désagréments par une lettre à la marquise. J’ai même reçu un courrier avec l’ordre du roi de ne plus vous permettre d’entrer en ces lieux.
— Du roi, dit ironiquement Saint-Germain. Vous plairait-il, monsieur, de me permettre de voir cet ordre qui, je l’avoue, me surprend étrangement.
— A vrai dire, monsieur, l’ordre n’émane pas de Sa Majesté, mais bien de M. le duc de Choiseul.
— Alors cela ne me fait pas grand-chose, répondit l’aventurier en prenant congé. ”
Devant cette assurance, d’Affry se demanda s’il n’avait pas fait un pas de clerc. 11 fallait que Saint-
— 149 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Germain se crût bien certain de l’appui royal pour prendre avec tant de dédain les menaces du ministre. Aussi se répandit-il en affirmation de haute estime et en protestations sur la peine qu’il éprouvait à agir ainsi.
“ — Venez me voir demain, nous causerons à nouveau.
— Pcrmcttez-moi, monsieur l’ambassadeur, de n’en rien faire. Je serais au regret de vous faire transgresser vos ordres. ”
Telle cśt la version que Saint-Germain fit courir de son entretien avec l’ambassadeur1.
Le rapport que celui-ci envoya à Choiseul à ce sujet présente naturellement la chose d’une manière assez différente. A l’entendre, le comte averti brutalement des ordres du duc en aurait été accablé et M. de Kauderbach aurait refusé de conduire son compagnon à Ryswick. D’après Volz, Saint-Germain ne s’e^t point vanté et d’Affry a bien dépêché quelqu’un, deux jours après, pour s’informer de la santé de notre héros dont il devait attendre vainement la visite le lendemain.
Quoi qu’il en soir, d’Affry, pour le reśte, accomplit ponctuellement les ordres de son chef. Il en fit part aux principaux attachés étrangers et avertit M. Astier,
i. Mémoires de Hellen, attaché prussien.
— ISO —

> à
de .ire
irir
»ur re.
et ^
ce ère ilc-de
Pane
un, •tre : le
DÜt
art
et,
consul de France à Amsterdam, de mettre en garde les banquiers contre les propositions dc M. de Saint-Germain. Quelques jours après, l’agent commercial français faisait savoir qu’Adricn Hope, entre autres, était très fâché et très embarrassé d’avoir logé chez lui l’aventurier.
Saint-Germain fut si peu déconcerté par cette intervention du ministre que, le 27 mars, à l’heure même où d’Affry l’attendait à l’ambassade, il se rendait chez Yorke qui désirait le voir. L’envoyé anglais venait, en effet, de recevoir la réponse du cabinet de Londres aux ouvertures précédentes. Les instructions britanniques étaient précises; Yorke ne devait négocier avec des personnes différentes, qui tantôt avaient pleins pouvoirs, tantôt non. Le roi Georges II avait échangé tout récemment avec d’Affry des vues et il était inutile de s’avancer davantage tant que des dispositions pacifiques ne seraient point précisées par le gouvernement français. Cependant, pour faire avancer une œuvre aussi salutaire, Yorke était prié de faire part des intentions du roi de se réconcilier avec la cour de France, sous la condition que les alliés de l’Angleterre seraient compris dans l’arrange-menf.
Saint-Germain demanda alors la permission de prendre copie de la fin de la lettre officielle, c’est-à-dire du passage où il était question d’une paix géné-
— ip —
raie. Yorke y aquiesça volontiers, se fît raconter l’incident entre le comte et d’Affry et, curieux de savoir comment l’émissaire terminerait son entreprise, lui posa quelques questions à ce sujet.
“ — J’avoue ignorer ce que je dois faire immédiatement. L’apathie du roi et la décision de la Pom-padour sont telles qu’il me faut réfléchir quelque temps. Peut-être y a-t-il un moyen : essayer de gagner le duc de Choiseul.
— Oh! Ohî... s’exclama Yorke, pour le moins cette chose gênera vos protecteurs ! En tout cas, comment ferez-vous usage de mes ouvertures? Pensez-vous aller en personne à Versailles1?
— Cela ne servirait à rien. 11 me faudrait revenir et cela exciterait encore des soupçons ; non, j’enverrai un de mes domestiques avec trois lettres pour la marquise, le maréchal de Belle-Isle et le comte de Clermont. Ce dernier cśt mon ami intime. Il a la confiance du roi, n’a partie liée avec aucun des ministres et reśte partisan d’une paix avec vous. ”
Pour dissiper l’incrédulité de Yorke il lui montra une lettre déjà ancienne du comte de Clermont rédigée dans les termes les plus cordiaux; le prince déplorait l’absence de son correspondant et souhaitait son prompt retour.
i. La substance de ce récit cśt adaptée de G. Volz, Der Graf ron Saint-Germain.
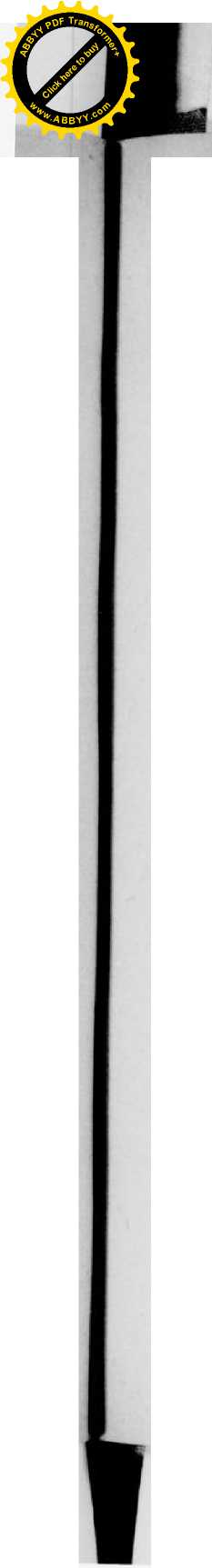
aint-
fins >m-sez-
iter de
tre-
né->m-que ner
mir rrai r la de
1 la des s. ” itra ont nce aai-
“ Je suis sûr, affirma Saint-Germain, que le maréchal et mon ami me répondront. Quant à la favorite ce serait folie de s’y attendre, car elle a pour principe de ne jamais écrire sur des affaires d’État. Il n’en reśtc pas moins nécessaire de l’informer pour la faire agir de son côté. ”
De retour chez lui, Saint-Germain écrivit en triple exemplaire un rapport sur les événements passés. Il affichait la même imperturbable confiance. A ses amis, il faisait valoir son crédit auprès de la maîtresse en titre, de Belle-Isle lui affirmait que l’ordre reçu venait de Choiseul et non du roi. 11 était résolu à faire en sorte que tout fût réparé sans délai et que sa réputation atteinte fût rétablie le plus tôt et le plus complètement. D’ici peu, il y aurait du nouveau à Versailles.
Sa confiance semblait justifiée. On paraissait attacher encore à la cour un certain prix aux communications et aux rapports signés de son nom et le maréchal de Belle-Isle, qui rcśtait dans le cabinet un des ministres les plus effacés, avait écrit à d’Affry l’ordre de prêter son concours à Saint-Germain.
L’ambassadeur français eut alors une nouvelle conversation avec le comte et lui demanda des précisions sur ces termes un peu généraux. La conviétion du diplomate était faite. Le vieux maréchal avait été laissé en dehors des décisions nouvelles du roi.
— 153

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Aux pressantes questions posées, notre héros répondit que sa mission n’avait pour objet aucune opération militaire, maritime ni financière.
C’était un premier aveu, car en arrivant à La Haye Saint-Germain avait déclaré venir pour négocier un emprunt.
“ Alors ce ne peut être que de la politique ”, conclut d’Affry impatienté.
Sans attendre la réponse de son interlocuteur il lui rappela les menaces de Choiseul et lui affirma son intention de les mettre à exécution.
“ — Je n’ai pas peur de cela et M. de Choiseul ne m’empêchera pas de revenir en France.
— C’eSt ce que l’on verra. En tout cas vous avez le plus grand tort de vous commettre ainsi avec M. de Bentinck, car jamais notre pays ne pourra avoir confiance en lui. ”
Saint-Germain laissa entendre qu’il était libre de faire ce que bon lui semblait et que les menaces de Choiseul ne lui causaient aucune émotion.
Devant cette attitude, d’Affry, outré, écrivit à Choiseul de faire pression sur Belle-Isle pour qu’il cessât de correspondre avec l’aventurier et il se mit en mesure d’exécuter les instructions reçues. Il donna la publicité la plus grande au désaveu ministériel et le crédit de Saint-Germain commença à baisser à La Haye. Yorkc ne voulut pas le recevoir, le prince de
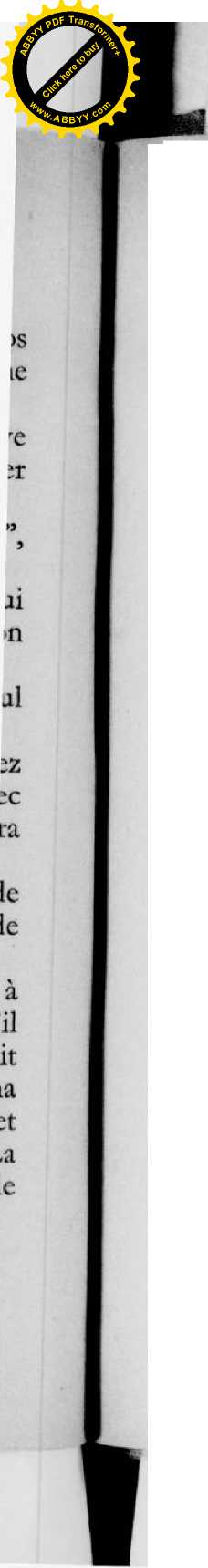
Brunswick lui signifia de cesser ses demandes d’audience et joignit ses efforts à ceux d’Afffy pour ruiner la confiance que les Hollandais mettaient en lui. Seul, Bentinck lui rcSta fidèle. Encore crût-il prudent de ne pas l’héberger plus longtemps et notre homme s’en alla loger à l’hôtel.
Comptant toujours sur le roi de France, dont il connaissait pourtant le caraétèrc versatile, le comte tenait tête arrogamment à la mauvaise fortune et ne cessait de se moquer de ses ennemis.
“ Le pauvre d’Affry, disait-il, n’a pu s’empêcher d’exécuter les ordres de son supérieur1. Je sais bien que M. de Choiseul ne m’aime pas, mais, s’il a une place dans le Conseil du roi, j’en ai une autre. ”
Informé de ces propos, Choiseul, exaspéré par la résistance de ce “ fils de juif ” comme il disait, décida de frapper un grand coup. Vers la mi-avril, dans un Conseil des ministres que présidait Je roi, il résolut de mettre un terme à une situation qu’il estimait humiliante pour lui. Le débat eut lieu à Versailles, au début du printemps. Une des baies de la grande salle avait été ouverte pour permettre aux effluves nouvelles des parcs d’entrer librement. Tous les ministres étaient présents : on remarquait Choiseul,
i. La substance de ce récit sc trouve dans la correspondance de d’Affry et de Choiseul, aux archives des Affaires Étrangères et G. Volz s’en eśt inspiré. Hollande, 1760.
— 155 —
Bcrryer et le secrétaire de l’Intérieur. Le maréchal arriva le dernier et se plaça à un bout de la table où le roi vint s’asseoir un instant à ses côtés. Juśte devant eux le chef du gouvernement, après avoir reçu de Louis XV l’ordre d’ouverture, expédia les affaires courantes assez brièvement et fixa ostensiblement le monarque et le vieux soldat. Le bruit avait couru depuis la veille que les déclarations de M. le duc seraient, ce jour-là, capitales et l’attention des assistants était particulièrement alertée.
Le ministre se dressait dans l’immense salle sur ses talons fins; sa petite taille faisait souvent l’objet de plaisanteries, mais, à cette heure, chacun était tenu en haleine par la gravité de sa physionomie.
“ J’ai cru devoir, dit-il, ordonner à notre représentant à La I lave de mettre fin aux agissements du comte de Saint-Germain et de le faire arrêter pour lui apprendre à s’immiscer dans des affaires qui ne le regardent pas. Si je n’ai pas pris le temps de demander les ordres de Sa Majesté, c’e£t que j’ai la conviction absolue que personne ici n’aurait osé négocier une paix sans que le miniśtre des Affaires Étrangères, c’eSt-à-dire moi-même, ne le sût à l’avance1. ”
Et il réclama du Conseil l’approbation de sa
i. Le récit de cette scène a été fait par le baron de Gleichen dans scs Souvenirs. La version de Fr. Bulau dans Gebcime Gcschicbten ne parait qu’une adaptation.
— 156 —
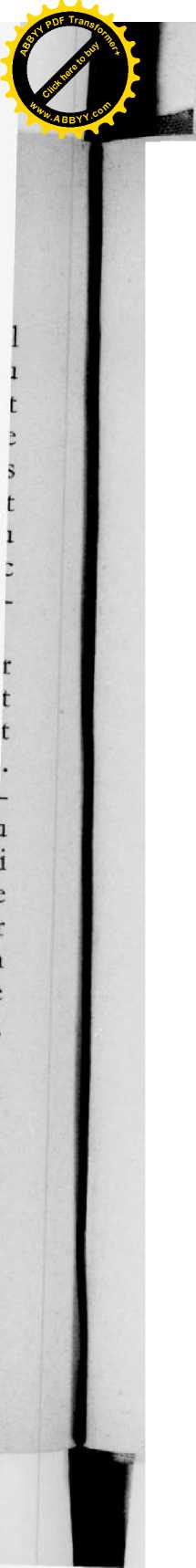
conduite. Tous les regards se tournèrent vers le roi; on attendait la réaction qu’une telle diatribe allait déterminer en lui, mais le monarque, baissant les yeux comme un coupable, ne souffla mot et Bellc-Isle imita son silence. Choiseul triomphait et Saint-Germain était condamné.
Dès le u avril, le ministre s’empressa de faire part à d’Affry de ce qui venait de se passer et, brodant un peu sur la réalité, il lui manda :
“ Le roi m’a ordonné de faire décrier immédiatement avec les termes les plus humiliants et les plus précis ce prétendu comte de Saint-Germain auprès de ceux que vous pouvez soupçonner de connaître ce fripon. Vous ferez savoir ainsi votre opinion sur l’étendue des Provinces-Unies. Sa Majesté désirerait de plus que vous puissiez obtenir de l’amitié des Etats Généraux pour Elle, qu’ils fissent arrêter cet homme pour qu’il pût être transporté en France et puni suivant la gravité de sa faute1. ”
Cette fois d’Affry n’eut plus d’hésitation. La balance penchait du côté du ministre. Son intérêt, comme son devoir, lui faisaient une obligation d’obéir. Il décria donc tant qu’il put Saint-Germain et rédigea un mémoire pour obtenir des Etats Généraux de Hollande 1’arrcśtation et l’extradition du comte.
i. Archives des Affaires Étrangères, Hollande, 1760.
— 157 —
Ceux-ci, à vrai dire, montrèrent moins d’empressement à accepter le rôle qu’on voulait leur faire jouer. On donna de bonnes raisons à l’ambassadeur, mais comme on ne voulait ni heurter par un refus un aussi puissant seigneur que le roi de France, ni violer les traditions d’hospitalité de la nation, on s’efforça de trouver un subterfuge.
Bentinck fut prévenu du péril qui menaçait son ami. Sans doute les États ne se seraient jamais résolus à faire arrêter l’agent secret, mais cette situation aurait mis les plus hauts personnages du pays dans une situation délicate, si Saint-Germain s’obstinait, après le désaveu royal, à rcStcr à La Haye.
Naturellement, Bentinck s’empressa de tenir son ami au courant de la menace qui pesait sur lui. Le 15 avril au matin il se rendit dans la chambre d’hôtel de ce dernier et lui conseilla, dans son propre intérêt, de s’en aller le plus tôt possible. Le récit que nous a laissé de cet entretien l’homme d’État, dans ses Mémoires, cśt assez émouvant pour que nous le reproduisions tel quel :
“ Je lui dis que j’étais informé d’un troisième côté que d’AHry avait reçu l’ordre d’obtenir son arrestation, après quoi il devait être emmené à la frontière, sous escorte, et incarcéré pour le restant de ses jours. 11 fut extraordinairement surpris, moins de l’ordre de Choiseul, que de ce que d’AHry pensait à exécuter,
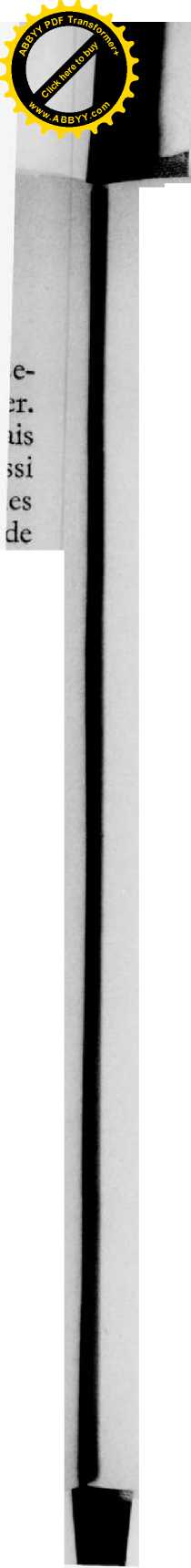
un us on ns
Lit,
>té :a-æ» rs. te
on Le tel êt, s a ies le
dans un pays où le droit et la loi avaient encore quelque valeur. Il me posa une masse de questions, plus graves les unes que les autres, et cela avec la plus grande tranquillité du monde. Je refusai toute discussion et, jugeant trop d'Hîcilc de répondre, je lui dis que ce n’était pas le moment, mais qu’il devait beaucoup plus songer à un départ immédiat si sa sûreté lui était chère. Il aurait jusqu’au lendemain matin pour faire des préparatifs, car d’Affry ne pouvait entreprendre ses démarches que le lendemain à dix heures. Il fallait qu’à ce moment Saint-Germain eût établi et réalisé ses plans. Nous discutâmes alors sur les moyens et les buts du voyage. Pour les premiers je me mis à sa disposition et pour les derniers je lui conseillai l’Angleterre. Nous tombâmes d’accord sur ce point et je m’offris, par M. Yorke, de le pourvoir du passeport dont il pourrait avoir besoin pour s’embarquer sur un vaisseau. Comme le voilier devait partir le lendemain matin je le pressai de se rendre aussi vite que possible à Hellevoetsluis. Ainsi toutes les démarches de d’Affry viendraient trop tard1. ”
Bentinck avisa immédiatement aux movens d’assurer la fuite de son protégé. Le mardi 15 avril il se rendit chez Yorke et, espérant peut-être encore ne
1. Mémoires de Bentinck, Amsterdam, 1775- Il en existe au British Muséum une traduéiion anglaise anonyme.
__ iJ9 „
pas être réduit à se séparer d’un homme pour lequel il avait une certaine affection, il commença par lui demander de prendre le comte sous sa protection. Mais Yorke, toujours aussi flegmatique, lui répondit qu’il serait enchanté de voir Saint-Germain aux mains de la police. Un moment atterré, M. de Bentinck tenta d’apitoyer l’envoyé anglais en lui rappelant les anciennes relations qu’il avait eues avec son protégé. Mais Yorke, froidement, lui répondit qu’il se lavait les mains de tout ce qui arriverait.
Alors Bentinck le supplia de l’aider à mettre Saint-Germain à l’abri du sort terrible qui l’attendait. Il ne fallait pas grand-chose, un simple passeport pour l’Angleterre et le comte était sauf.
Yorke tergiversa encore puis, finalement, de guerre lasse :
“ C’eśt bien pour vous faire plaisir. ” lit il lui remit un passeport en blanc.
Le soir meme, entre sept et huit heures, Bentinck apporta le laisser-passer à Saint-Germain. Celui-ci recommença ses questions, mais son interlocuteur les éluda de nouveau et le supplia de pourvoir à sa sécurité. Le comte se résolut alors à partir, mais comme aucun de scs serviteurs ne connaissait la langue, les routes et les coutumes du pays, il pria son ami de lui en prêter un des siens. L’homme d’État accepta. Bien plus, il commanda un carrosse de
rrc
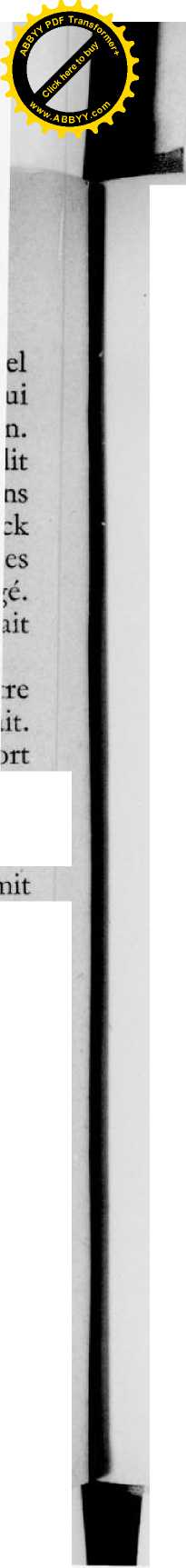
ck
-ci :ur sa ais la
on tat de

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN louage à quatre chevaux, d’aucuns disent le sien personnel, pour le lendemain matin à quatre heures devant sa porte. 11 chargea aussi un valet de mettre Saint-Germain sur la bonne voie et de rester auprès de lui jusqu’au quai d’embarquement.
Le 16 avril, à trois heures, Saint-Germain se leva, prit son thé comme d’habitude, régla son hôte et partit. Quand l’aubergiste entra dans sa chambre il ne trouva qu’une rapière rouillée et son ceinturon, des copeaux d’argent ou d’étain et deux bouteilles de liqueur inconnue. D’AHry fut informé de ces faits par M. de Kauderbach, l’envoyé saxon à La 1 lave. On imagine sans peine sa Stupeur indignée. 11 se posséda quand même assez pour cacher à son interlocuteur son ressentiment. Kauderbach prétendit avoir ces renseignements de la bouche de l’hôtelier saxon lui-même et proposa de faire venir ce dernier chez l’ambassadeur; celui-ci acquiesça et devant eux le logeur renouvela son récit.
Sans perdre de temps d’Affry demanda audience au Pensionnaire, mais celui-ci ne put le recevoir que le lendemain matin. Notre représentant n’obtint point la réponse souhaitée. On arrêterait notre héros, si c’était possible, mais on ne pourrait l’extrader qu’avec l’approbation des Etats Généraux, à leur prochaine assemblée. D’Affry établit aussitôt un mémoire dans cette intention et l’adressa à toutes les
— i6i —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
gazettes de Hollande. L’Assemblée se réunit le 30 avril et conclut à la remise pour plus large examen d’une commission extérieure. Comme le dit l’envoyé de la Prusse, Hellen, dans une lettre à Frédéric, c’était l’enterrement.
Il était d’ailleurs trop tard, car depuis dix jours Saint-Germain était à Londres. D’autres tribulations l’attendaient sur la terre anglaise. A peine débarqué il était arrêté ou plutôt mis sous la surveillance de la police. On lui fit subir un interrogatoire serré qui ne révéla rien d’important. L’Angleterre craignait deux choses : la présence de l’aventurier sur son territoire et ses machinations en faveur des Stuart. Pour ménager la France, disposée à négocier, et pour éviter toute surprise, le miniśtrc Pitt pressa son départ.
L’agent secret fut alors réellement angoissé. Où pouvait-il se rendre. La France lui était interdite ainsi que la Hollande. Dans ce pressant dilemme il s’adressa au représentant de Frédéric, Knyphausen, et lui demanda d’intercéder auprès du roi de Prusse, pour que celui-ci acceptât de le recevoir dans ses États.
Frédéric y consentit. Saint-Germain reprit le bateau, arriva le 11 mai dans le port où il s’était embarqué, et sans doute avec la complicité de fonctionnaires, traversa les Pays-Bas pour arriver à
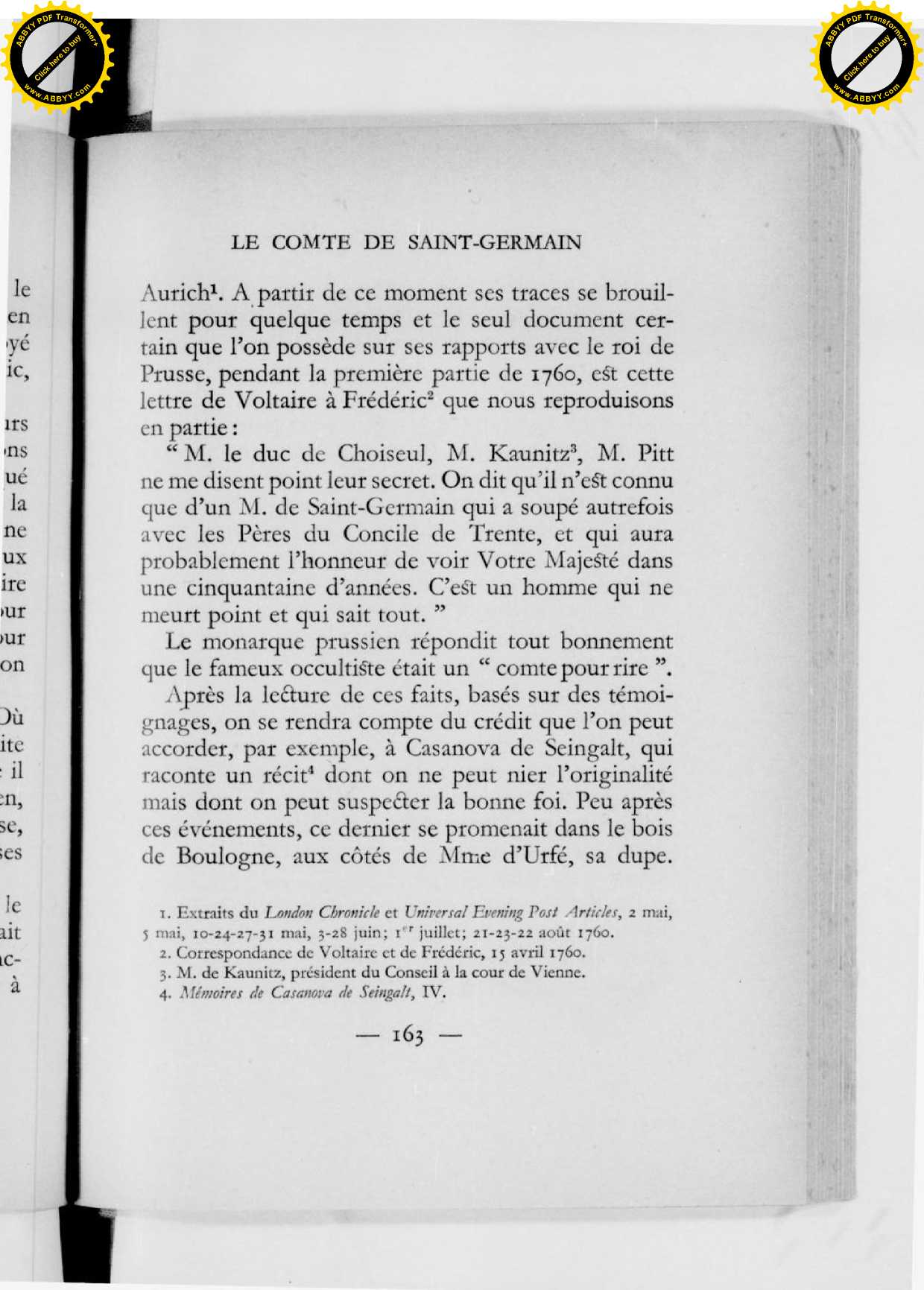
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
en
tain
ux
Aurich1. A partir de ce moment scs traces se brouil lent pour quelque temps et le seul document cer
i. Extraits du London Chronicie et Universal Lvening Post Articles, 2 mai 5 mat, 10-24-27-31 mai, 5-28 juin; rr juillet; 21-23-22 août 1760.
2. Correspondance de Voltaire et de Frédéric, 15 avril 1760.
3. Al. de Kaunitz, président du Conseil à la cour de Vienne.
4. Mémoires de Casañera de Seingait, IV.
>ur »ur on
Prusse, pendant la première partie de 1760, cśt cette lettre de Voltaire à Frédéric2 que nous reproduisons en partie :
“M. le duc de Choiscul, M. Kaunitz3, M. Pitt ne me disent point leur secret. On dit qu’il n’eSt connu que d’un M. de Saint-Germain qui a soupe autrefois avec les Pères du Concile de Trente, et qui aura probablement l’honneur de voir Votre Majesté dans une cinquantaine d’années. C’eSt un homme qui ne meurt point et qui sait tout. ”
Le monarque prussien répondit tout bonnement que le fameux occultiste était un “ comte pour rire ”.
Après la lecture de ces faits, basés sur des témoignages, on sc rendra compte du crédit que l’on peut accorder, par exemple, à Casanova de Seingalt, qui raconte un récit* dont on ne peut nier l’originalité mais dont on peut suspeder la bonne foi. Peu après ces événements, ce dernier se promenait dans le bois de Boulogne, aux côtés de Mme d’Urfé, sa dupe.
Soudain, ils aperçurent M. de Saint-Germain qui, à leur approche, s’esquiva dans une allée transversale.
Mme d’Urfé avait coutume de donner des conseils à certaines administrations. Sans lui être hostiles, ces dernières n’approuvaient guère son zèle indiscret. Elle décida cette fois de faire part de sa rencontre à M. de Choiseul. Celui-ci la reçut fort aimablement et ne se montra point surpris de la nouvelle.
“ Vous avez vu M. de Saint-Germain. J’en suis bien heureux. 11 lui était nécessaire de prendre l’air, après avoir passé la nuit à m’attendre dans mon cabinet1. ”
Le premier voulait-il signifier à sa partenaire un congé rapide ou parlait-il sérieusement? A notre avis la question ne peut meme point se poser : le duc se moquait, sans égards, de sa visiteuse pour l’empêcher de revenir trop souvent lui faire perdre son temps.
Mais cette anecdote, comme tant d’autres qui circulaient à ce moment à Paris, montre bien l’intérêt particulier que la France un peu cultivée prenait aux aventures de notre héros.
Enigme vivante, il avait passé entre les doigts des policiers réunis contre lui. Qui le protégeait d’une façon si persistante? Sur cet homme, les
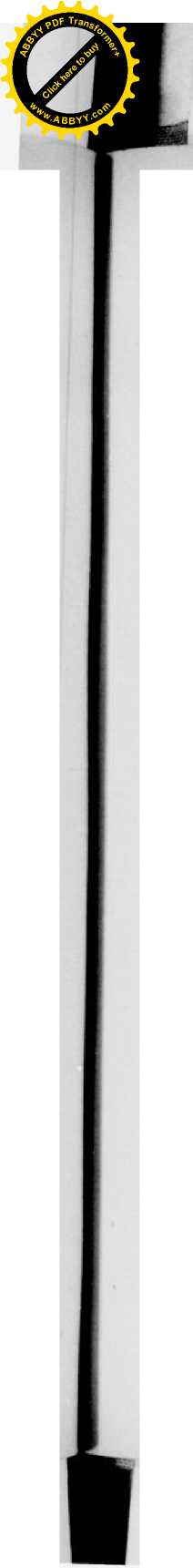
;ts üt
es
ns ir, 311
ir-
-êt
JX
on .Te le ur Ire
a e. ils es :t. : à nt
espoirs les plus fous s’accumulaient. S’il avait accompli tant de choses fantastiques c’cSt qu’un pouvoir quelconque, divin ou occulte, le soutenait.
Sa fuite des Pays-Bas, sa fuite d’Angleterre étaient présentes à tous les esprits. Chez les libraires de Paris et particulièrement chez ceux de la rue du Bac, on vendait une gravure de Nicolas Thomas, dédiée au comte de Milly, qui représentait “Le comte d^ Saint-Germain, célèbre alchimiste ”. Quatre vers attribués à Voltaire, mais croyons-nous, à tort, exprimaient l’admiration de la population parisienne :
Ainsi que Prométhée il déroba le feu
Par qui le Monde existe et par qui tout respire;
La nature à sa voix obéit et se meurt.
S’il n’est pas Dieu lui-même, un Dieu puissant l’inspire.
Casanova, peu suspect d’admiration pour notre homme, cherchait dans scs “ Mémoires ”, sinon à l’excuser, du moins à l’expliquer. “ Le duc de Choiseul a fait semblant de disgracier Saint-Germain pour l’avoir à Londres en qualité d’espion. ”
Si fantaisistes que puissent paraître ces explications, elles doivent, chez un écrivain aussi personnel et aussi hautain que Seingalt, être interprétées comme une admiration.
Mais, malgré toutes les apparences, la décadence de notre personnage commençait. Après avoir été
l’intime du roi de France, après avoir été adulé par la cour la plus brillante et la plus spirituelle du temps, après avoir rêvé de procurer à l’Europe la paix qu’elle désirait, il était réduit à reprendre sa vie d’aventures et dans des conditions particulièrement pénibles, puisqu’il pouvait craindre de voir disparaître ses moyens d’existence.
Cependant, la destinée lui réservait encore une dernière occasion de déployer ses talents dans la révolution tragique de Russie, en 1762.
ar 'S, le
es s, es
SAINT-GERMAIN EN RUSSIE
La façon au moins cavalière avec laquelle
Louis XV avait abandonné notre héros ne provoqua chez ce dernier aucune réaction visible et l’examen des récits de tous les mémorialistes du temps ne nous a point permis de trouver l’écho de sa légitime rancœur. Saint-Germain savait être reconnaissant au roi de son accueil à Versailles. Malgré son nom usurpé, il avait vraiment une âme de gentilhomme. En effet, nous avons pu remarquer, au cours des chapitres précédents, que le comte n’avait pas d’intérêt absolu à tenir près du souverain et de Mme de Pompadour le rôle d’un courtisan zélé. Qui pourrait affirmer que notre homme ne poursuivait point un idéal plus élevé et que pour lui le monarque, objet de son attachement désintéressé, ne représentait point cette patrie d’adoption vers laquelle l’attirèrent tant d’éléments d’apparence

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
contradictoire? La continuité de son aółion coordonnée et précise permettrait d’envisager son désir de soutenir la cause royale et, malgré la disgrâce gouvernementale imposée par Choiseul, nous allons le retrouver, en 1761, intriguant à la cour de Russie en faveur des intérêts français. ,
L’espoir de rénover à Saint-Pétersbourg l’influence de nos compatriotes devait tout naturellement opposer Saint-Germain à Pierre de Holstein admirateur extasié de Frédéric II, roi de Prusse, que l’imprudence de la Grande Élisabeth avait fait proclamer grand-duc héritier de toutes les Russies.
Quelques écrivains ont voulu nier l’influence de notre héros en cette cour étrangère. Le plus connu d’entre eux, Kauderbach1, a convenu qu’un individu inconnu, répondant au nom d’Odart, eut une part aCtive dans la révolution de 1762, mais il affirme, sans preuve convaincantes, que ce meneur étranger ne peut être assimilé à Saint-Germain. Dans l’œuvre de l’historien saxon, Odart paraît un touche-à-tout, maître Jacques, dilettante et chevalier d’induStrie. Un ressentiment divisait notre héros et Kauderbach, et leur brouille à La Haye, dans l’antichambre du chargé d’affaires français, suffirait à expliquer l’attitude ultérieure du mémorialiste. En effet, ne point

or-isir âcc ms ¡sic
ICC ent ram-ner
de tnu idu art ne, ?er /re ut, ie. A, du tint
révéler la personnalité d’Odart c’cSt soustraire, en cas de succès, la reconnaissance française à un rival. Plus franchement, M. de Breteuil, attaché militaire de notre pays, relate ses rapports journaliers avec Odart en des appréciations personnelles sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, mais il ne fait aucune allusion à son identité qu’il affecte d’ignorer1.
Mais la méthode de cacher son identité à tout prix eśt une nécessité trop habituelle à Saint-Germain pour que nous ne songions point à rapprocher sa personnalité de celle d’Odart.
A ce point de vue, le témoignage du baron de Glei-chen8 qui nous expose la rencontre de Grégor Orloff3 avec Saint-Germain à Nuremberg, en 1774, est convaincant. Le ministre de Catherine n’avait pas coutume de témoigner du respeâ à qui ne le méritait pas et cependant il aurait profité d’une absence du comte pour se pencher vers le margrave
r. Cf. la correspondance de M. de Breteuil, 1761-1762.
2. Souvenirs.
5. Les Orloff étaient cinq frères :
Gregor, officier de la garde, amant de Catherine. D’abord évincé par Potcmkine, il reprit victorieusement sa revanche.
Alexis, amant de l’impératrice. Nommé amiral en 1770 après la victoire de Tschesmé sur les Turcs.
Iran, officier de la garde.
F ¿dar, officier de la garde.
Le balafré, dont le nom est contcśtć (Pierre, Nicolas?) soldat en 1762.
-- 169 --
d’Anspach, ami et protećłeur de ce dernier, en lui disant : “ Voici un homme qui a eu un rôle important dans notre histoire. ”
A notre avis, cette phrase ne peut être révoquée en doute. Un écrivain pondéré et réfléchi comme l’était l’ancien ambassadeur du Danemark, n’a pas, lui, l’imagination fantaisiste d’un Casanova.
Quoi qu’il en puisse être, M. de Saint-Germain était polyglotte et parlait précisément les langues familières à Odart : l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le russe et le français, avec un léger accent piémontais. Comme Odart, Saint-Germain quitta la tsarine peu de temps après la révolution et, toujours comme lui, il avait le goût du mystique jusqu’à prendre l’initiative de faire jurer les conspirateurs sur un crucifix. Comme Odart, Saint-Germain était de taille moyenne. L’historien Sudhoff1 le croit très vulgaire dans ses expressions. Certes, ce n’eSt pas ainsi qu’on aime à se représenter un grand seigneur. Mais pourquoi ne pas voir dans cette contradiction se révéler la faculté extraordinaire du comte à se dédoubler pour s’adapter aux circonstances?
Il fallait, en effet, parler aux soldats russes sur un ton et dans une langue très differente de ceux qui étaient de mise à Versailles ou dans les brillants salons
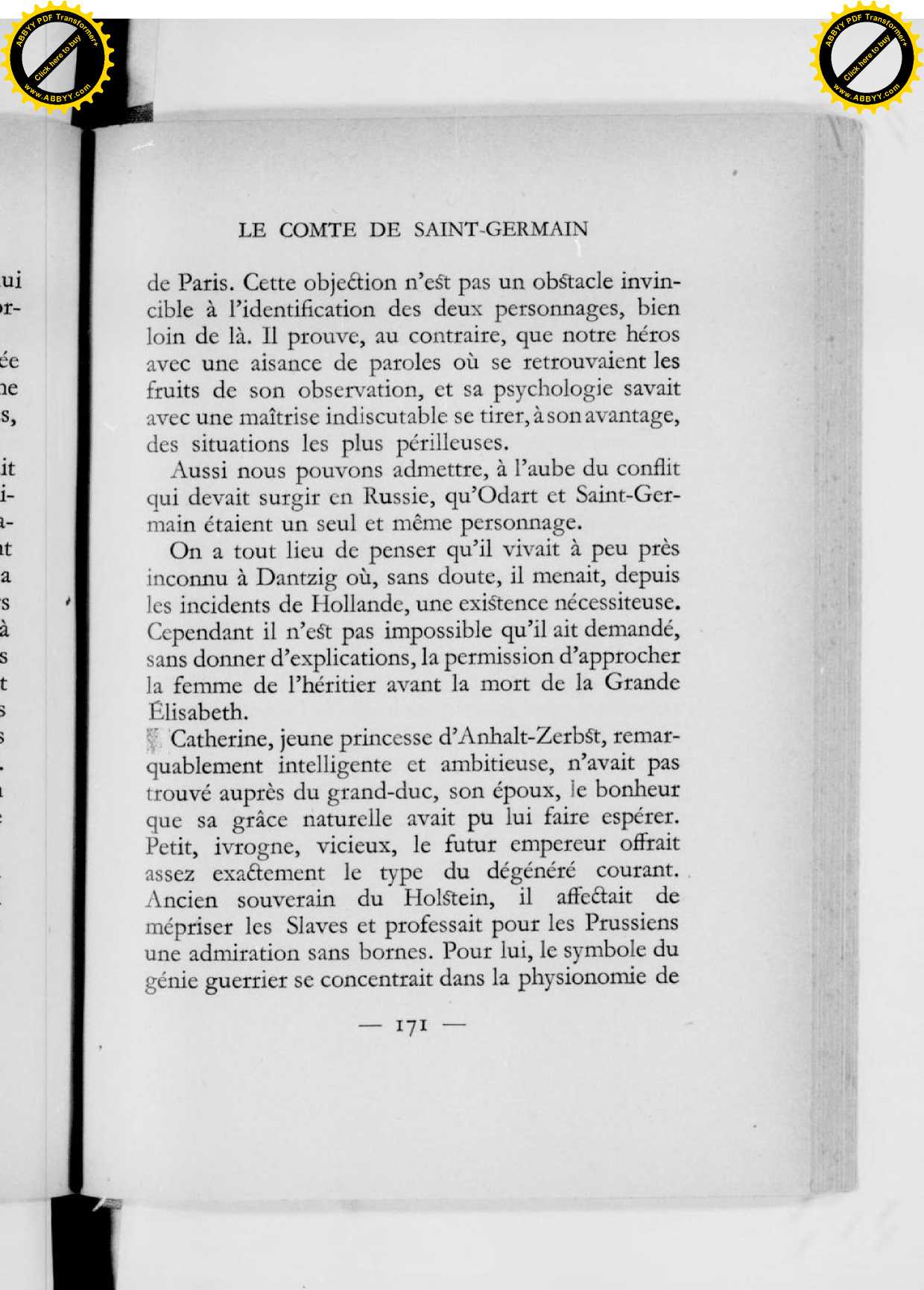
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Petit, assez
énere courant, il affrétait de
mépriser les Slaves et professait pour les Prussiens une admiration sans bornes. Pour lui, le symbole du génie guerrier se concentrait dans la physionomie de
i grâce naturelle avait pu lui faire espérer, ivrogne, vicieux, le futur empereur offrait
de Paris. Cette objcćtion n’eśt pas un obstacle invincible à l’identification des deux personnages, bien loin de là. 11 prouve, au contraire, que notre héros avec une aisance de paroles où se retrouvaient les fruits de son observation, et sa psychologie savait avec une maîtrise indiscutable se tirer, à son avantage, des situations les plus périlleuses.
Aussi nous pouvons admettre, à l’aube du conflit qui devait surgir en Russie, qu’Odart et Saint-Germain étaient un seul et meme personnage.
On a tout lieu de penser qu’il vivait à peu près inconnu à Dantzig où, sans doute, il menait, depuis les incidents de Hollande, une existence nécessiteuse. Cependant il n’eSt pas impossible qu’il ait demandé, sans donner d’explications, la permission d’approcher la femme de l’héritier avant la mort de la Grande Elisabeth.
Catherine, jeune princesse d’Anhalt-ZerbSt, remarquablement intelligente et ambitieuse, n’avait pas trouvé auprès du grand-duc, son époux, ie bonheur
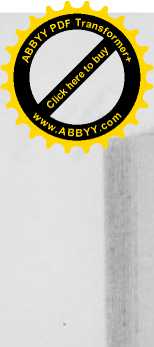
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Frédéric II qui, d’ailleurs, se moquait de lui1.
Possédé de toquades ingénues auxquelles il se défendait pourtant d’obéir, le grand-duc avait voulu créer à Saint-Pétersbourg des bataillons d’élite, exercés et équipés suivant les dernières méthodes de Berlin. Ce que la précaution de Frédéric avait créé en Allemagne, dans un but de défense nationale, Pierre de Holśtein avait voulu le faire en Russie et ces troupes, qui ne correspondaient pas à la taftique habituelle dans ce pays, n’avaient que mécontenté les officiers de carrière et rendu le futur tsar impopulaire aux Moscovites. L’armée tout entière avait haussé les épaules devant les défilés inutiles de ces bataillons étrangers, et le prestige de l’héritier en avait été fortement ébranlé.
Catherine s’était heurtée bien souvent à l’autoritarisme de son époux, mais elle avait un caractère trop personnel et trop volontaire pour ne pas se défendre énergiquement. Les courtisans aux aguets la voyaient marcher avec décision lorsqu’elle se rendait dans le cabinet de travail du grand-duc. Son œil brillant, son nez arqué laissaient deviner une femme sensuelle dont le désir du pouvoir exaltait l’ambition. Certes les lèvres de son mari proféraient
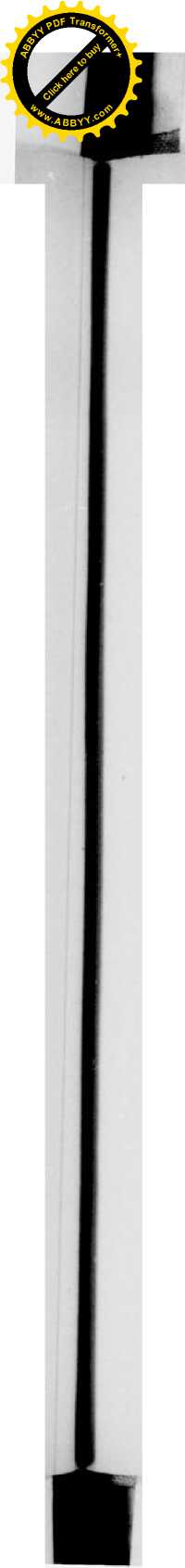
et
0-
rire se ts n->n le it it
i1. se lu te, de éé le, et uc ité o-ait es en
à son égard plus d’injures que de compliments, mais elle ne craignait pas, parfois, d’abaisser son poing sur le bureau du grand-duc et de refuser, devant témoins, d’adopter des suggestions impraticables.
Après que le chancelier Beśtoujoff, attiré par sa jeunesse gracieuse, fût devenu son amant, elle prit l’initiative de faire exclure Pierre des salles de conseil, car l’héritier n’hésitait pas à communiquer à Frédéric le plan des entreprises décidées contre lui par l’état-major d’Élisabeth. Ce divorce moral, accru par une mésentente constante, fut certainement à l’origine du coup d’État de 1762.
Pour les personnes qui la fréquentaient, la grande-duchesse était irrésistible lorsqu’elle était aimable. Ainsi avait-elle fait une impression très sensible sur une de scs amies, la princesse d’Aschkova, qui ratio-lait d’elle et voyait dans sa tournure d’esprit le symbole de la philosophie encyclopédiste du progrès.
A peine la princesse était-elle arrivée à Pétcrsbourg en 1761, que Catherine, après avoir conversé deux fois avec elle, avait cherché à l’attirer dans son orbe. On disait, mais rien ne vint confirmer ce bruit scandaleux, que cette jeune femme était une demi-sœur adultérine de la grande-duchesse. Il y eut peut-être un myStère dans sa naissance, mais il fut tout autre. Panine, qui devait être plus tard le précepteur du tsarévitch Paul, fils de Pierre, fréquenta longtemps la
mère de la princesse d’Aschkova. Si l’amie de la grande-duchesse ne voulut jamais céder à ses instances, ce fut plutôt par crainte de commettre avec lui le crime d’Œdipe, car la légèreté des mœurs de cette dame pouvait prêter à toutes les suspicions.
Rapidement, la cour et ses relations déplurent à la jeune femme, car elle ne pouvait se plier aux manières rudes et militaires que le grand-duc, ennemi né des philosophes français, cherchait à y introduire. Dans ce domaine spirituel, Catherine formait un contraśtc frappant avec son époux. Autant Pierre méprisait les choses de l’esprit, “ des billevesées ”, disait-il publiquement, autant elle les aimait. En 1761, l’héritière du trône n’avait pas de cercle et vivait dans l’isolement. Chaque dimanche elle allait voir ses enfants à Péterhoff et, sur le chemin du retour, faisait arrêter sa voiture devant la résidence campagnarde des d’Aschkova et emmenait la jeune femme pour le restant de la journée à Oranienbaum. Dans sa chambre personnelle, loin du bruissement chantonnant des jets d’eau, ces deux femmes, dont l’une n’avait guère dépassé la trentaine et dont l’autre n’avait pas encore dix-neuf ans, s’entretenaient des heures entières sur l’application de la philosophie, sur les droits de l’homme, sur l’humanité et sur des problèmes politiques et sociaux.

La princesse se vantait, non sans fierté, qu’on aurait difficilement trouvé dans toute la Russie une troisième femme susceptible de prendre part à leurs conversations1.
La réaction était sans doute bien violente pour ces deux idéalistes quand, rentrées respectivement chez elles, elles abandonnaient leurs rêveries pour se plonger à nouveau dans la réalité. Elles voyaient l’Empire où régnait, par la volonté du grand-duc, une perpétuelle tyrannie.’ Le bourreau prussien était venu s’ajouter depuis quelque temps au knout russe. L’idéal de Montesquieu, la monarchie constitutionnelle, que la volonté d’une impératrice pleine de sagesse et de bonté dirigeait pour l’intérêt de ses sujets, n’était donc qu’une utopie!
La princesse d’Aschkova, pénétrée d’un noble feu, passait maintenant des nuits sans sommeil. Son imagination en ébullition lui inspirait les plus folles idées. La Providence l’avait-elle destinée à sauver la malheureuse Russie? Il y avait déjà eu de nombreux coups d’Etat dans l’Empire, mais toutefois aucun n’avait été aussi désirable que celui qui arracherait le pouvoir au demi-fou qui allait régner pour le remettre à Catherine. Depuis longtemps des aspirants dictateurs, pour la plupart des généraux privés
i. Gina Kaus, Catherine ¡a Grande, p. 194. Bernard Grasset, éd.
— I75 —
de leur commandement, avaient cherché à renverser le régime et souvent en pure perte.
ir n ci
r(
Tant que la grande-duchesse ne régna point, le rêve de la princesse d’Aschkova ne put se réaliser.
Catherine était trop méfiante pour faire des confi- Ip
dences inconsidérées à la jeune femme. Cette dernière|
aimait jouer la jeune tille précocement blasée (quel B
rôle aurait mieux convenu à scs dix-neuf ans?) et nul I
ne se douta jamais que cette adolescente aux allures B
presque ingénues pouvait être dangereuse. Sans qu’on B
y prêtât garde, elle apprit dans divers salons les senti- B
ments de tel membre du Parlement, les opinions de B
tel général, rassembla dans son esprit ses allies pos- B
sibles et disgracia de son salon tous les partisans B
du grand-duc.
La femme de Pierre n’avait jamais eu de véritable I
amie. Ses relations avec la troublante princesse l’atti-I
'raient mais ne constituaient pas une sincère atkétion B
de femme. Elle considérait sa compagne avec cette|
condescendance qu’afleétent certaines dames envers B\
un lycéen amoureux dont on accepte la passion B
sans la prendre au sérieux mais, enfin, clic ignorait B
complètement son activité de souris. L’amour enthou- B
siaste de cette enfant la flattait agréablement et elleÍ
fut la première surprise d’apprendre par la bouche B
de cette dernière un assez grand nombre de faits qu’il8
lui importait fort de connaître. Mais ces raisons|
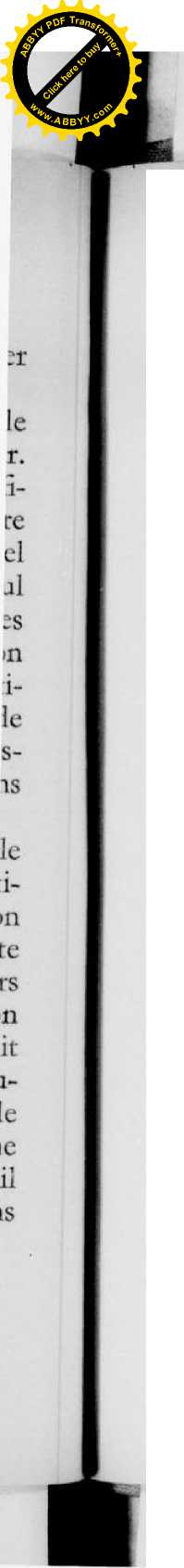
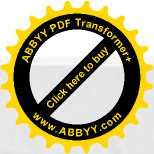
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN influencèrent peut-être moins la future tsarine qu’elles ne l’eussent fait en un autre temps, car en 1761 un ensemble de circonstances tragiques l’obligèrent à rompre avec son amant Poniatowski qu’elle remplaça par un lieutenant de la garde, Grêgor Orloff.
Cet officier n’appartenait pas à une grande famille de la noblesse. Son grand-père avait servi comme simple soldat dans les śtrelitz et, après l’insurrection avortée de ce régiment, il avait été condamné à mort avec de nombreux camarades. Un historien allemand, Mme Gina Kaus, relate dans un livre récent1 comment Pierre le Grand l’avait vu monter à l’échafaud placé sur la Place Rouge et s’était étonné du coup de botte qu’il avait porté à la tête d’un homme décapité avant lui sur le même billot. Le tsar avait interrogé le soldat.
“ 11 faut bien que je me fasse une place ”, avait répondu l’homme.
Un pareil sang-froid en présence de la mort inévitable avait soulevé l’admiration du Rénovateur. Il lit grâce à Orlotf et le fit entrer dans un régiment de ligne où, après de longues années, il acquit le rang d’oflicier et par là le titre de gentilhomme.
Au moment où nous nous trouvons, cinq descendants de ce soldat qui n’avait pas, il faut en convenir,
i . Gina Kaus, La Grande Catherine.
— 177 —

froid aux yeux, étaient en vie, cinq frères d’une beauté mâle et robuśte servant dans la garde impériale, tous aimés de leurs camarades, adorés de leurs subordonnés aussi bien pour leurs vertus que pour leurs vices dont l’ensemble réalisait le type de l’officier russe. Hardis jusqu’à la témérité, gais de caractère, excessifs dans leurs passions, joueurs et pas mal ivrognes, ardents dans leurs amours jusqu’à l’érotisme, profondément fatalistes, ils étaient, en bien et en mal, les dignes rejetons du fameux ^trclitz de Pierre le Grand.
Comme leur ancêtre, ils savaient mener une vie ardente et attendre froidement la mort; ils vivaient dans une griserie perpétuelle, étaient avides sans cupidité, possédaient un tempérament effréné, mais restaient dépourvus de toute culture. Les membres de cette catégorie recueillent généralement beaucoup de suffrages féminins, mais la fascination qu’ils étaient capables d’exercer ne se bornait pas à attirer vers eux les dames d’une cour dissolue; certains hommes, assez bornés il faut en convenir, les adoraient pour l’apparente brutalité que décelait leur regard et leurs manières.
Grégor était le second des OrloH et le plus beau de tous. On le désignait généralement par cette expression “ une tête d’ange sur un corps d’athlète ”.
11 s’était distingué par un sang-froid admirable
— 178 —
beau pres-
rable

l’une mpé-leurs pour l’offi-ftère, mal
l’éro-ien et tz de
c vie aient sans mais abres coup qu’ils ttircr tains ado-leur
dans la terrible bataille de Zorndorff contre la Prusse en 1758. Quatre fois blessé, il n’avait pas abandonné son pośte d’un pas et, en récompense de cette adion d’éclat, il avait été nommé aide de camp du général Sebo uvalo il.
A y regarder de près, son courage n’avait riertkle commun avec le fameux héroïsme du devoir, car Grégor éprouvait plutôt le mépris de la mort, traditionnel dans sa famille, et qui n’a point besoin d’un but déterminé pour braver avec insouciance le danger et le deśtin en général. Orloff l’avait prouvé peu de temps après en enlevant à Kœnigsberg la femme de son premier chef, la belle princesse Kouranine. Il ne se demandait pas si cette aventure était périlleuse pour son avenir! Il avait sans doute des raisons de croire à sa bonne étoile et quand Schouvaloff, son chef, eût succombé brusquement à une maladie de cœur, le jeune officier devint un des hommes les plus en vue de la Russie.
On commença par lui confier la tâche d’escorter un héros ennemi, fait prisonnier pendant la guerre en Brandebourg, le comte Schewerein, avec l’ordre de le conduire à Pétcrsbourg. C’était une simple formalité, l.e général fut traité avec le plus grand respect. On prétend même que le prisonnier fut reçu à la cour où le grand-duc osa lui dire :
“ Si j’étais empereur vous ne seriez point captif! ”
— 179 —

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Catherine fit la connaissance d’Orloff au cours de cette mission. Schewercin, se trouvant un jour à Oranienbaum, en visite, la grande-duchesse aurait jeté par la fenêtre un regard d’ennui dans la cour d’où les yeux de flammes de Gregor Orlofl l’auraient subjuguée. La vigoureuse beauté du jeune lieutenant fit une vive impression sur elle. La future tsarine possédait, malgré scs goûts intellectuels, un tempérament chaleureux. A ses heures de réflexion, elle avouait ses regrets :
“ Ce qu’il y a de terrible en moi, disait-elle souvent, c’eât que mon cœur ne peut se passer d’amour, fût-ce pour une heure. ”
Quoi qu’il en ait été, cette faiblesse de la souveraine fit la fortune de ce “ condottiere ”.
Le véritable caraCtère d’une femme ne se révèle pas, à notre avis, dans le choix de son amant, mais dans la nature de son amour. Orlofl n’était qu’un bretteur à l’esprit ordinaire, mais Catherine voyait en cet homme un héros des beaux jours de la République romaine*
11 conquit la jeune femme soigneusement et sut, non sans habileté, la persuader de sa protection en cas de coup d’Etat. La grande-duchesse savait ce que peuvent les gardes en Russie. Eux seuls avaient frayé le chemin du trône à la veuve du Grand Pierre, la première Catherine, et plus tard à Elisabeth.
— ï8o —

5OU-our,
ave-
vèle nais j’un >yait Tu~
aurs ur à irait i’où jub-aant ri ne apé-elle
sut, i en que ient :rre, eth.
Quand Orloft n’était point chez elle il se rendait auprès des officiers ou parmi les soldats de la garde et s’enivrait en leur compagnie, tout en jouant aux dés ou aux cartes de fantastiques sommes d’argent. Entre deux bouteilles, il ne manquait jamais de faire l’éloge de la future impératrice.
“ C’eSt une ardente patriote russe qui combat contre les sentiments prussophiles de son époux ”, disait-il.
Les quatre autres frères de Grégor menaient auprès de leurs camarades une agitation aussi violente et les gardes, séduits par une persuasion continuelle, montraient vis-à-vis du suppôt de Frédéric une méfiance justifiée. Le grand-duc les méprisait et les traitait de janissaires, ils ne craignaient pas l’arrivée de Pierre à l’Empire! Ils avaient une force et ils la tenaient d’eux-mêmes.
Tout ce qui était russe, tous les soldats, tous les gardes étaient sympathiques à Catherine. Ces derniers plaçaient en elle, et elle ne l’ignorait pas, tous leurs espoirs anxieux.
Grégor, par son caractère et son éducation sommaire, ne pouvait être un amant discret. Tous les lieux de réunion où l’on boit fort l’avaient entendu crier la raison de sa fortune. Ses camarades ne le jalousaient pas trop et ne se choquaient pas de scs déclarations. La grande-duchesse leur paraissait


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
moins distante. Préférer à tant d’autres l’amour d’un officier eśt, pour un régiment, un discret hommage que le simple soldat ressent comme le général.
Certes, Orloff ne pouvait plaire à la princesse d’Askhova et au comte Panine, mais les intimes de Catherine s’ignoraient souvent et chacun avait scs relations particulières la plupart du temps.
L’impératrice Élisabeth, dont l’horreur pour son neveu était bien connue, aurait voulu, sans trop se l’avouer à elle-même, “ que les gardes acclament le petit prince Paul pour héritier. Elle ne sortait plus guère de sa chambre où l’assaillaient des hémorragies et des attaques épileptiques fréquentes. Elle savait parfaitement que Pierre attendait son décès avec impatience pour porter scs mains sacrilèges sur tout ce qu’elle avait aimé : sa religion, ses alliances, scs amis. Elle ne se faisait aucune illusion sur le sort de scs bijoux qui étaient destinés à être envoyés à Frédéric II pour remonter quelques mois le niveau financier de l’état prussien; mais clic avait fait son testament en faveur de Pierre et elle était trop pieuse pour violer son propre serment. Elle aurait voulu y être forcée, y être engagée par une manifestation de volonté populaire assez violente1 ”
Pour cette seule raison clic essaya de provoquer, un
SC
VÍ
P] P1
C( d le
O
n
q s’ le d
ai le
e, É b
P s
c
S
r
I
1
I

;sse . dc scs
, un
son p se t le □lus gies vait tvcc :out
scs t de rrc-eau son ■use •ulu ion
soir, un soubresaut dans l’opinion. En un court intervalle de santé relative, peut-être le dernier dont elle put profiter, elle accepta d’assiâter au théâtre de la cour, placé près de scs appartements, à la première d’une comédie nationale russe. Les spectateurs se réjouirent d’apercevoir, après de longs mois, des lueurs dans la loge impériale. Élisabeth fit prier les gardes et leurs officiers de sc rendre direétement dans la salle où il n’y avait point grand monde.
Quand ils curent pris place devant elle, les rideaux qui protégeaient l’impératrice des regards indiscrets s’entr’ouvrirent et la souveraine, tenant par la main le petit prince Paul Pétrovitch, reçut les acclamations de scs sujets. Elle n’avait pas oublié que vingt ans auparavant ce corps d’élite l’avait aidée à conquérir le pouvoir. Espérait-elle qu’en ce jour il se prononcerait contre l’héritier qu’elle abhorrait? De son fauteuil elle reconnaissait en quelques officiers à barbe grise certains de ces héros qui l’avaient accompagnée sur le chemin du Palais d’Hiver. Elle plaçait sur ces dos maintenant voûtés, un nom fugitif qu’elle croyait sc rappeler. L’un avait abattu d’un coup de sabre tel partisan d’Ivan, l’autre était arrivé le premier aux grilles de telle caserne. Son souvenir encore précis évoquait cette marche triomphale à travers la capitale. Maintenant l’impératrice avait pris le petit prince sur ses genoux et montrait ośtensible-
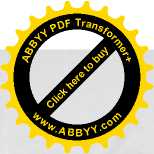

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
ment à la foule le futur tsarévitch dont elle caressait les boucles dorées. Elle l’embrassa de nouveau et sourit avec triśtesse. Les acclamations montaient vibrantes vers la loge, mais aucune voix impérative ne domina le murmure confus des ovations. Elle frémissait, malgré elle, dans l’attente anxieuse d’une phrase magique qui lui assurerait, avant de mourir, la certitude de la continuité de son œuvre. Elle regardait tous les officiers, les anciens, les nouveaux, avec une sorte de supplication, mais aucun d’eux n’osa crier “ Vive le tsar Paul ”. Et déçue, pénétrée d’une morne lassitude, Elisabeth déposa à côté d’elle son petit neveu pour rentrer plus accablée et plus aigrie que jamais par l’escalier qui menait à ses appartements particuliers.
“ Si j’avais pu vivre encore quelques mois.... ” Mais elle avait déjà senti, en s’asseyant sur le canapé de sa chambre, le commencement de sa trop longue agonie. Cette dernière bataille, elle l’avait perdue! son rêve allait s’éparpiller, son corps allait se dissocier.
Certes, en Europe, les intéressés tentaient d’arracher à la souveraine mourante une modification de son testament. Louis XV (faut-il voir en cela la preuve de la mission secrète de Saint-Germain?) avait écrit de sa propre main une longue lettre à Breteuil, son chargé d’ariaires à Pétersbourg, en le priant d’inter
lapé gue lue!
sso-

ssait u et tient itive Elle ’une arir, gar-avcc ’osa ’une
son græ irte-
rra-. de uve crit son ter-
venir personnellement1. Mais la cour de Russie n’avait donné aucune assurance. Marie-Thérèse avait agi dans le même sens, également en vain. A l’intérieur du pays les Schouvaloff, dans une ultime intrigue, avaient tenté de réaliser, malgré l’opposition de Pierre, leur ambition : être nommes gouverneurs des provinces conquises en Prusse Orientale. Ces faits à l’extérieur et à l’intérieur sont trop significatifs pour ne pas être retenus. Us prouvent, en effet, le désarroi dans lequel l’arrivée du grand-duc au treme impérial jetait scs ennemis et peut-être ses partisans. Tous arrivaient trop tard. L’impératrice n’était pas encore disparue, mais déjà son esprit subtil l’avait abandonnée. Elle n’était plus qu’un grand corps qui n’avait pas achevé de rendre le dernier soupir.
Pendant ce temps, Pierre ne parlait plus seulement de paix immédiate avec la Prusse, mais d’alliance avec Frédéric et de conflit contre ses alliés actuels, entre autres le Danemark, sous prétexte de lui enlever une parcelle de terre holśteinoise. Plus le jour du pouvoir s’approchait, plus ouvertement il exprimait sa haine, son mépris pour les Russes. Catherine, plus que d’autres peut-être, avait toutes les raisons d’appréhender la fin d’Élisabeth, car les intentions de son époux se manifestaient sans ambages. Les provo-
i. Archives du ministère des Affaires Étrangères et Correspondance de lireteuil.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
cations de ce dernier, à son égard, étaient tellement
évidentes que la grande-duchesse savait ce qu’il lui restait à faire : périr avec son mari quand la ; indi&e publique éclaterait contre lui ou se dresser contre le futur tsar. Dilemme tragique! Les plus fâcheuses conditions l’empêchaient d’entamer une lutte adive, car sa liaison avec Orloff avait déposé dans son sein
une trace ineffaçable. Depuis quelques jours elle était enceinte de l’officier.
Le 25 décembre 1761 Elisabeth s’éteignit à deux heures de l’après-midi. Elle fut aussitôt mise en bière et exposée dans un salon de réception du Palais. Pendant les heures qui suivirent, tous les membres de la noblesse, de l’armée, les grands dignitaires, les ambassadeurs vinrent s’incliner devant la souveraine défunte.
Le pope qui avait reçu la dernière confession d’Elisabeth et qui n’ignorait rien de l’antipathie éprouvée par Pierre contre le clergé orthodoxe intronisa le jeune empereur. Les rites s’opposaient, en effet, à ce que le tsar fût sacré avant l’enterrement de son prédécesseur. La prestation du serment fut exécutée et le nom de Catherine et du prince Paul ne furent point prononcés. C’était une nouvelle entorse aux usages traditionnels. .
A Paris, à Vienne, on s’attendait à voir la révolte

Ite
ses
ve, ein .ait
.‘UX ère ais. res •es, ve-
ili-¿ée le
ce ré-
et int ;es
renverser Pierre. L’aristocratie comptait sur la haine de la garde contre l’ennemi des traditions russes, mais comme si rien ne s’était passé, les gardes dédièrent devant le palais aux cris de “ Vive l’empereur ”.
Le pouvoir est vraiment une chose étrange. Lorsqu’il n’était encore que grand-duc et qu’un mot d’Elisabeth aurait suffi à l’exclure de la succession, Pierre n’avait paru à tout le monde qu’un polichinelle taré, mais sur le piédestal de son trône il devint inséparable de ses attributs royaux. Tous l’avaient repoussé, mais en cc jour d’exaltation, tous s’efforcèrent de reconnaître en lui des qualités incontestables.
Le nouveau tsar était un névrosé et toutes scs décisions devaient porter la marque de cet état maladif : irréflexion, précipitation, méconnaissance et mépris absolu de la réalité. Son premier acte fut la conclusion de la paix avec Frédéric vers lequel il dépêcha, trois heures après la mort de la souveraine, un aide de camp revêtu de pouvoirs étendus. Des courriers partirent de Pétersbourg pour faire arrêter immédiatement toutes les hostilités contre la Prusse. Sa politique ou plutôt scs projets de politique n’étaient pas même étudiés. Il était, avant tout, opposé aux innovations d’Elisabeth, sans raison, par besoin de manifester sa personnalité.
Catherine, malgré sa philosophie, était effrayée.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Elle savait que Pierre se vengerait au pouvoir de ses dédains passés et la ferait monter à l’échafaud. Malgré son espoir, l’armée avait suivi l’empereur. Sa vie et l’avenir de la Russie étaient en jeu. Elle s’en ouvrit à Grégor Orloff dans lequel elle avait mis toute sa confiance, surtout depuis sa grossesse. L’officier niait la volonté du nouveau maître de faire assassiner sa femme, mais celle-ci doutait peut-être un peu de la garde et désirait une conspiration.
Orloff était brave. 11 ne craignait pas pour sa vie, mais sa race le portait naturellement à la superstition.
“ —Que Dieu me damne! J’ai connu à Dantzig, par Gagliośtro, la présence du fameux sorcier qui fréquentait Louis XV et Mme de Pompadour.
— Quel homme? ”
Grégor n’avait pu retenir son nom. Il se rappelait la haine que cet homme vouait à Choiseul et la facilité prodigieuse avec laquelle il avait passé au travers des mailles de M. Pitt et du Pensionnaire de Hollande.
“ Qu’il vienne ici! ce sera le succès assuré. ”
Catherine n’avait point répondu, et l’entretien ne pouvait avoir d’autre suite.
Cependant, Orloff, très exubérant, allait tenter, on ne sait par quels moyens, de faire prévenir notre héros. Et M. de Saint-Germain accepta de rallier des conjurés contre un tsar prussien.
L’aventurier se présenta à Pétersbourg sous le
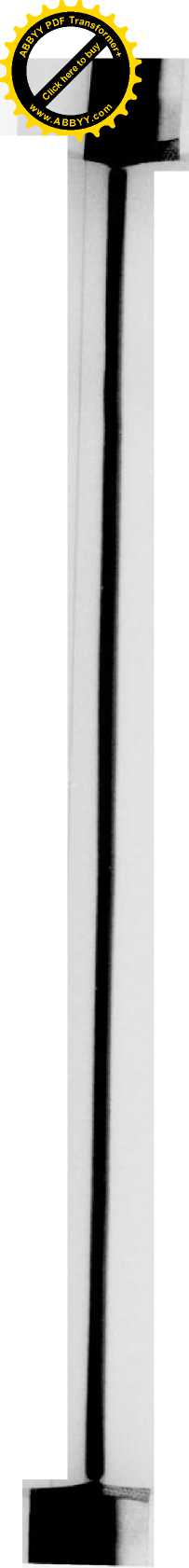
ses grc 2 et •it à : sa cicr ner . de
vie, on. zig, qui )ur.
lait aci-'crs de.
ne
er, tre Jes
le
nom d’Odart. Il fut reçu sans difficulté à la cour, mais ne sembla point décidé à prendre sur-le-champ des décisions trop rapides. A plusieurs reprises il eut des entretiens avec la nouvelle impératrice, accompagnée de la princesse d’Aschkova. Il tempéra l’ardeur révolutionnaire des frères Orloff et conseilla à la souveraine, crédule comme tous les grands personnages de son siècle, d’évoquer l’ombre de Pierre le Grand.
“ Cela fait souffrir les morts ”, disait-elle parfois.
Devant l’insistance de M. de Saint-Germain, influencée par la fixité de son fameux regard, elle consentit un soir à l’expérience.
La séance se poursuivit tard dans la soirée et le rénovateur de la Russie apparut deux fois dans le miroir incurvé et donna des signes évidents d’approbation1.
L’impératrice devait déclarer plus tard qu’elle commença à écouter les ennemis du monarque à partir de ce soir-là. Nous croyons plus vraisemblable qu’elle attendit, hésita et tergiversa longtemps; mais la haute autorité du tsar rouge exerça, par la suggestion des témoins, une grande impression sur la décision de la jeune femme.
Elle prit, en tout cas, pendant les premiers mois
i. G. Kaus, Catherine /a Grande.
ki

de 1762, le parti de lutter désespérément contre la tyrannie de son mari et nul ne pourra lui en vouloir d’avoir suivi sans faiblesse la voie tracée.
Les conversations avec les Orloff prirent donc à partir de février une forme plus précise. Il ne s’agissait plus de fuir devant un danger, il fallait le vaincre. Le premier plan des conjurés ou plutôt du noyau de partisans fut d’emprisonner Pierre à i’improviśte dans sa chambre comme Elisabeth l’avait fait d’Ivan. Mais la souveraine disparue était la fille de Pierre le Grand et Catherine, par sa naissance, était Allemande, donc étrangère.
Or, ce fut le tsar lui-même qui, d’une manière inattendue, accéléra la marche de son deStin. Il avait commencé par bannir sa femme de sa présence. Il habitait généralement avec sa maîtresse, la comtesse Vorontzoff, le palais d’Oranienbaum. Un soir, trop ivre, il déclara sans vergogne “ qu’il se débarrasserait le plus vite possible de sa trop gênante épouse1 ”. Par quels truchements ces bruits furent-ils répétés à Catherine? Il ne peut être question de le savoir. Toujours eSt-il que ces menaces curent comme résultat précis de resserrer autour de la jeune femme l’union des cinq frères Orloff, de la princesse d’Aschkova, du comte Panine, précepteur du prince Paul, de Bibi-
i. G. Kaus, Catherine /a Grande.
- ï^q —

e la loir
ic à gis-crc. yau iSte
/an. rele idc,
ièrc vait
Il
2SSC rop sse-.1 » * • is à ou-Itat ion va, bi-
koff, un officier de la garde et de notre prestigieux héros, M. de Saint-Germain.
Le 2i juin une grande fête eut lieu à Oranienbaum. On obligea Catherine à y paraître. L’affiont préparé ce jour-là par Pierre consistait à remettre officiellement à Mme Vorontzoff l’ordre de Sainte-Catherine, fondé, dans le passé, par l’empereur pour honorer son épouse.
Le calme absolu, la froide dignité de la tsarine provoqua chez Pierre III une explosion de fureur. Saint-Germain assistait à cette cérémonie. 11 savait se contenir pour réaliser ses desseins, mais il fut tellement écœuré par cette scène qu’il descendit dans le parc demander à l’air de la nuit de dissiper sa fièvre1.
Dans la soirée, Pierre, ivre suivant sa coutume, donna l’ordre à son aide de camp, Baratinsky, de faire arrêter Catherine. Ce dernier n’osa ni obéir, ni résister et, dans son émoi, il s’adressa à l’oncle du monarque, Georges de HolStcin, pour le prier de s’entremettre. C’eSt à grand-peine que le vieillard réussit à détourner son neveu de ce projet Stupide. L’empereur, presque inconscient, restait furieux. Sa première décision, mise sur le compte d’une table trop bien arrosée, était plutôt une variété de la manie de persécution. Elle donna à la tsarine de nombreux
i. G. Volz, Der Graf ion Saini-Germain.
--191 --
partisans et Pierre n’eut point l’excuse d’avoir été provoqué par sa femme. Cependant, sans être inquiétée, Catherine put reprendre le chemin de la capitale.
Le 50 juin, à la tète de scs troupes, le souverain devait partir en guerre contre le Danemark. Par précaution le lieutenant Passek, soupçonné, à juste titre d’ailleurs, de faire partie des conjurés ralliés à la cause de l’impératrice, fut arrêté. Le complot n’avait plus que de faibles chances d’aboutir, car la torture de l’officier, pensaient les amis de Catherine, ferait
r< u
découvrir la trame et inculper les principaux meneurs. I n En effet, cette conspiration révolutionnaire, dirigée I p contre le pouvoir civil et contre le monarque lui- |
même, s’était étrangement développée depuis quelques semaines. Dix mille personnes en avaient main
tenant connaissance. Saint-Germain trépignait. 11 I d prit l’initiative de proposer aux conjurés une réunion | secrète et, à huis clos, interrogea les frères Orloff sur |
leurs intentions.
Grégor et Alexis, les deux têtes du mouvement, étaient disposés à marcher envers et contre tous.
Certes, l’arrestation de Passek avait été un coup terrible pour eux, mais Saint-Germain les persuada que dans une entreprise sincère, profondément ancrée dans la volonté d’un peuple, les fautes de l’adversaire viennent toujours aider les hommes de bonne volonté. Avant tout il fallait profiter des
c
î
r
1
1
Y
été lié-ale. ain >ré-itrc
use •lus
de rait
1rs» gée lui-lel-lin-
U ion
sur
mi, us.
>up ida
eut de de
des
quelques heures disponibles pour tenter de sauver Catherine. Grégor, désigné pour aller chercher l’im
pératrice à Péterhoff, envoya son frère Alexis et se rendit lui-même auprès de l’hetman Razounovsky, un des piliers ele la conjuration, afin de l’informer de l’arrestation du lieutenant.
Le général le reçut le Ier juillet au matin et écouta l’officier sans dire un mot. Mais, à peine Grégor s’était-il retiré, qu’il ordonna de faire imprimer, dans un caveau souterrain, les manifestes deśtinćs, non pas à la foule qui ne savait pas lire, mais à scs principaux dirigeants.
Alexis pénétra seul à Péterhoff qui, par chance, n’était pas gardé. 11 se fit reconnaître de la chambrière qui n’ignorait pas son profil défiguré au cours d’un duel. Il s’approcha du lit où Catherine reposait.
“ Il est l’heure de vous lever. ”
Elle interrogea brusquement cette ombre qui avait l’air de ressusciter d’un cauchemar confus.
“ Pas se k a été arrêté. ”
En peu de minutes elle était prête. Elle prit sans trop de craintes la calèche qui l’attendait aux alentours du château et, à quelques kilomètres de Pétcrsbourg, retrouva Grégor venu au-devant d’elle. Catherine monta dans son carrosse attelé de chevaux plus fringants. Vers huit heures du matin, elle retrouva Aime d’Aschkova, Panine et Saint-Germain venus

également à sa rencontre. Les voitures, arrivées à l’enceinte de la ville, s’arrêtèrent sur l’avenue de la Foutaka, devant la caserne dTsmaïlovsky. Des soldats
h
d
a
r
v
apparaissaient au corps de garde. Orlofl se fit connaître sans tarder et la jeune femme s’avança au milieu de la troupe en désordre.
“ Je suis venue chercher protection auprès de vous. L’empereur a donné l’ordre de m’arrêter. Il veut me faire tuer ainsi que mon fils. ”
Jusqu’ici les gardes n’avaient jamais vu Catherine
que de loin. Ils s’étaient fait de sa personnalité une B
image créée par la naïve conception des Orlofl', pour B
de ces hommes, appelés à un rôle politique, qui B
l’emporta et leurs sentiments chevaleresques les B
poussèrent à combattre pour l’opprimée. B
Odart-Saint-Gcrmain savait battre le fer pendant I qu’il était chaud. 11 avait profité de ces minutes I d’attente pour s’introduire avec les Orlofl parmi les H v soldats et il avait commencé à exalter leur ardeur par B \
cette persuasion remarquable que lui avait donné sa B¿
lité au nouveau régime sur une effigie du Chriśt.|
'es à de la Idats nnaî-lilieu
,’OUS. t me
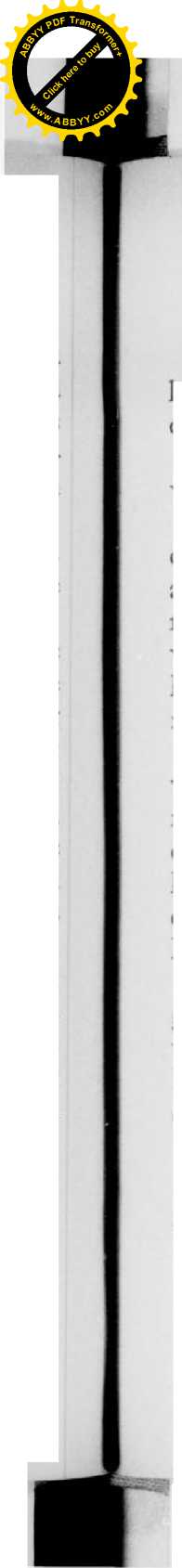
erine
■ une pour lent : ene ! tîner, leusc , qui s les
idant lûtes ii les r par né sa nion. fidé-hriśt.
La garde, enthousiasmée, vint prêter serment sur la croix et le fameux cri qui n’avait pas éclaté au bas de la loge d’Elisabeth monta dans l’azur matinal :
“ Vive notre petite mère Catherine! Vive le tsarévitch Paul! ”
De l’autre côté de l’avenue se trouvait la caserne du régiment Somjouvsky. Quelques amis d’Orloff avaient pris les devants et annoncé l’arrivée de l’impératrice. Si imprévu que fut le dénouement, les soldats voisins avaient embrassé avec la même sympathie la cause de Catherine et avaient acclamé son nom.
Près de là, à quelques centaines de mètres, s’élevait la caserne Préobrajensky. Pierre avait toujours manifesté une certaine prédilection pour ces grenadiers, commandés par le frère de la maîtresse royale, le comte Vorontzoff. Ce dernier les avait toujours exhortés, en cas de coup d’Etat, à marcher contre les insurgés.
Arriva l’instant décisif. La bataille allait-elle s’engager? Les adversaires s’affrontaient en silence à travers les grilles, mais sans un coup de feu; le général Mcnchikof, chef en fait du régiment, s’était déjà écrié :
“ Vive notre petite mère, l’impératrice de Russie! ” A cette parole les hésitants furent entraînés. Le général Villobois, dircétcur technique, n’avait pas

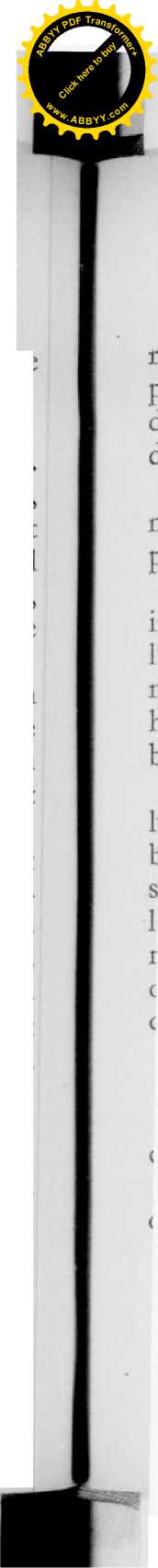
encore été prévenu par Orloff. Il vint de lui-même et déclara à la tsarine :
“ Je désire me ranger à vos certes. ”
Puis il prêta serment et livra les clefs des arsenaux.
Le cortège, renforcé par plusieurs régiments, pénétra dans Notre-Dame de Kazan. Là se trouvait le comte Panine avec son élève, le petit Paul, qu’il avait été chercher. Dans une bousculade homérique, Catherine se fit proclamer impératrice autocrate de toutes les Russics.
La foule grandissait maintenant de minute en minute. La marche triomphale commença vers le Palais d’Hiver. Saint-Germain fit en la langue du pays plusieurs allocutions que les troupes saluèrent d’acclamations enthousiastes.
Cependant notre héros était trop fin pour ne point se rendre compte qu’une grande popularité lui vaudrait rapidement la jalousie des cinq frères. Aussi dès l’aurore de la victoire, scs actes semblent du moins le prouver, prit-il la résolution de ne jamais agir sans le conseil des conjurés, et cette méthode lui permit de s’assurer l’amitié des nouveaux maîtres de la Russie.
On peut facilement s’imaginer avec quel émoi le tsar avait appris la trahison de ses meilleurs régiments. Chez ce nerveux, cette sédition avait pris la physionomie d’une catastrophe. Il avait naturellement
— 196 —
aême
loi le icnts. ysio-ment
e en rs le e du crent

uux. icnts, uvait qu’il ique, te de
point vau-
ù dès moins
• sans ermit le la
remis son voyage et s’était réfugié à Oranienbaum, pour n’être point cerné dans la capitale. Son aide de camp, le général Munnich, l’adjurait sans cesser de retourner l’esprit public en sa faveur.
“ Montrez-vous aux gardes, en personne. Souvenez-vous que Pierre le Grand, dans une situation pareille, a sauvé sa couronne par son entrée en scène ! ”
Mais Pierre III n’est pas Pierre le Grand. La crainte intime éprouvée devant ce peuple qui lui eśt étranger l’angoisse. 11 ne fait que répéter : “ Je me méfie de ma femme. Si on l’avait arrêtée, comme je le voulais, hier soir, tout cela ne serait pas arrivé. Elle eśt capable de tolérer ma mort. ”
Son entourage sent bien qu’il faut renoncer à la lutte. Les plus souples cherchent des prétextes valables pour abandonner sa cause. Pierre se décide à s’enfuir à Cronśtadt pour tenter ce qu’il pourra. C’eśt la seule ville armée fidèle. 11 arrive à une heure du matin le surlendemain. La sentinelle pousse son traditionnel “ Qui vive? ”; mais le monarque ignore que la révolution a triomphé dans le port.
“ — C’eśt moi, l’empereur, répond-il.
— Il n’y a plus d’empereur. Arrière où je tire. ”
Au même instant on sonne l’alarme dans la citadelle.
Les matelots fidèles rament à bras tendus et tandis que se casse la chaîne de l’ancre, un cri répété par des

milliers de voix retentit dans la ceinture des forts.
“ Vive Catherine II! ”
Le bateau se dirige à nouveau sur les côtes d’Oria-nenbaum. A son tour le tsar craint pour sa vie. Il a donné l’ordre de n’opposer aucune résistance armée. Il envoie le général Izmaïloff avec une lettre dans laquelle il renonce à ses droits au trône et demande la permission de retourner en Holśtein avec sa maîtresse, son chien et son nègre.
Catherine serait disposée à accepter. Mais Saint-Germain et Orloff exposent à la souveraine leurs craintes sur les possibilités d’intrigues dont le souverain déchu pourrait être l’enjeu, et ils réussissent à convaincre l’impératrice de la nécessité de tenir son mari à l’intérieur du pays. Ce fut à Ropcha, dans un château proche de la forteresse de Schlusselbourg, où fut emprisonné Ivan, que l’ex-monarque fut déporté-
La nouvelle tsarine, il faut lui rendre cette justice, n’avait jamais voulu assassiner son mari. Saint-Germain n’en était point davantage partisan, mais une exécution politique ne pouvait que lui être indifférente. '
Ce fut donc le 10 juillet 1762 que se termina le drame. Catherine ignorait encore l’intensité de la haine d’Orloff, mais celle-ci représentait assez bien le désir secret du peuple russe. L’impératrice avait
ftice, aint-
> une liffé-
ta le le la bien ivait
b rts.

Dria-. Il a mée. dans ande maî-
>aint-leurs
sou-ssent tenir dans ^rg, fut
envoyé le Balafré communiquer au prisonnier ses exigences. Invité par Pierre, ainsi que ses quatre frères, à partager son repas, il tenta, avec l’aide de ses aînés, Grégor et Alexis et d’un tout jeune lieutenant Potemkine, de lui faire boire un poison mortel. Affolé, l’homme appela au secours. Deux amis d’Orloff, parmi lesquels se trouvaient le prince Barabinsky, lui passèrent un lacet que Grégor maintint quelques minutes entre scs doigts d’acier. Saint-Germain n’assiśta vraisemblablement pas à cette horrible exécution, mais il la connut sans nul doute.
De nombreux historiens ont souvent prétendu que ce drame, tin naturelle d’une révolution de palais, s’était déroulé dans les souterrains de Peters bourg. Bornons-nous à faire remarquer la présence de la victime à Ropcha. C\śt à l’ombre de son parc de mélèzes et de pins que Pierre III fut étranglé.
Les archives de Moscou ne connaissent qu’une lettre collective, signée des Orloff et de Potemkine à P impératrice.
“ Petite mère! Il n’eśt plus de ce monde. Nous sommes perdus si tu ne fais pas grâce. Comment avons-nous eu l’idée de lever la main sur ton époux. Pourtant le malheur cśt arrivé. Il eut à table une querelle avec Fédor. Nous ne pûmes les séparer et déjà il n’était plus. Aie pitié de nous, ne fût-ce que pour l’amour de notre frère. Nous avons fait notre
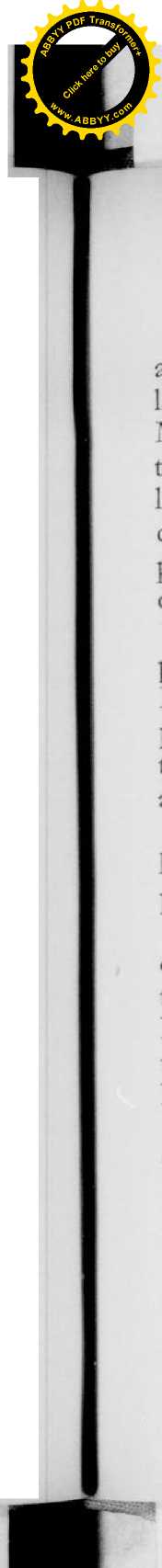
aveu. Toute enquête cśt superflue. Pardonne ou commande d’en finir vite! ”
Le lendemain, la capitale apprenait, sans intérêt, que l’empereur avait succombé dans la nuit à des coliques hémorroïdales.
La crainte de la colère de Catherine, manifestée par Alexis Orlofi — c’eSt probablement lui à qui revient l’initiative de cette supplique — n’eSt pas entièrement feinte. La tsarine pardonna pour conserver à Pétersbourg les principaux soutiens de son nouveau trône.
Le désir de combattre l’influence prussienne en Russie était tellement ancré dans l’esprit de Saint-Germain qu’il tenta d’emprunter, par l’entremise de M. de Breteuil, chargé d’affaires français à Pétersbourg, une somme correspondant à 60.000 roubles d’or afin de faire la révolution. Nous trouvons dans une lettre du 21 juillet 1762 au roi Louis XV les basses excuses du diplomate dans lesquelles se montrent ses regrets de n’avoir point aidé plus cflcctivc-ment M. Odart dans ses pourparlers1.
D’après lui, notre héros avait déclaré au cours d’une visite personnelle que l’impératrice, incertaine du moment où elle pourrait réaliser son dessein,
OU
:rét, des
§téc qui pas ser-
son
urs :cr-dn,
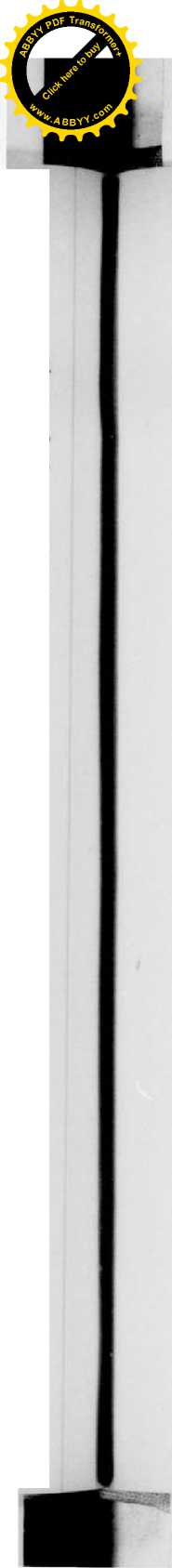
en int: de
ers-jles
ans les
on-vc-
avait fait demander à Versailles si la France pourrait l’aider de ses deniers. Sans répondre exactement, \I. de Bretcuil avait expliqué à son visiteur que la tsarine se devait de remettre à son émissaire une lettre conçue en ces termes : “ J’ai chargé le porteur du présent billet de vous faire mes adieux et de vous prier d’exécuter quelques commissions que je vous demande de m’envoyer le plus tôt possible1. ”
Par un dcśtin malencontreux M. de Bretcuil devait partir le lendemain pour Varsovie. Il avait laissé à M. Béranger, secrétaire d’ambassade, la copie du projet de billet et avait convenu avec lui, dès la réception de la demande autographe de l’impératrice, d’en avertir Louis XV.
M. Odart, en contant les difficultés traversées par la tsarine, avait laissé entendre que le détail n’était pas arrivé à un point de maturité suffisante.
D’après scs dires, l’ambassadeur avait cru comprendre que les faits étaient encore loin de leur réalisation. Très évasivement d’ailleurs, M. Odart et M. de Bretcuil avaient convenu de verser la somme empruntée en ducats de Venise pour empêcher la place de Pétersbourg de songer à la complicité de la France.
Le matin du départ de l’agent diplomatique, Odart revint encore pour s’assurer de la sympathie
i. Correspondance de M. de Bretcuil.
-- 201 --
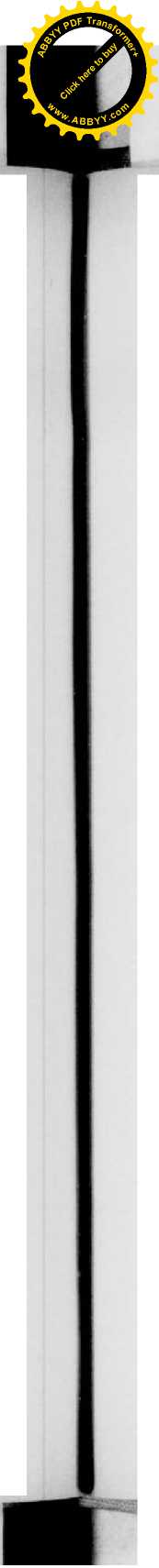
S
du roi de France à ce prêt. De Bretcuil, un peu gêné — il ne croyait pas à la suite de cette demande — répondit par un faux-fuyant et prouva que la cour de France n’avait pas l’habitude de se mêler d’affaires domestiques. Il se ravisa, puis demanda une signature formelle de l’impératrice, mais ne jugea pas à propos de différer son départ. Au moment d’une crise si importante pour notre cause, un suppléant remplissait à la cour de Russie les fonctions d’ambassadeur en titre. Après son couronnement, la tsarine ne cacha point son ressentiment pour M. de Bretcuil et réclama de Versailles une mesure contre le diplomate français. A son retour de Varsovie cc dernier avait trouvé un message de Saint-Germain : “ L’emplette que nous devions faire se réalisera, mais à bien meilleur marché et nous n’aurons plus besoin d’autres comptes1. ”
Choiseul averti s’émut de ces faits et, sous l’impulsion du roi, fit des excuses à l’impératrice. De sévères remontrances furent adressées à M. de Brctrcuil qui fut déplacé, en septembre, à Vienne.
C’était sur tous les points la revanche de Saint-Germain. “ Il n’eśt pas douteux, écrivait M. Béranger au duc de Choiseul, qu’il va devenir un homme considérable par l’influence qu’il a mise dans tout ceci et je crois que Sa Majesté ne saurait lui faire pas-
i. Tous ccs renseignements recueillis dans la correspondance de Bretcuil.
;êné
qui
eres qui
rine Bre-c le der-in :
cra, dus

r de ires ^nais à rise em-ssa-
int-gcr une out vas-;euil.
scr trop tôt des marques essentielles de ses bontés1. ” Que devait penser de son ministère des Affaires Etrangères le Premier lorsqu’il apprit la réussite morale de la France contre l’influence prussienne à Pétersbourg?
Un autre conflit, un peu spécial celui-là, devait opposer M. de Saint-Germain au comte Panine. Ce dernier était épris de la princesse d’Aschkova et poursuivait la jeune femme de scs assiduités. Après avoir obtenu le renvoi de son mari, qu’elle détectait, dans un pośte de Crimée, la princesse semble avoir cédé, un certain temps, aux propositions de notre héros.
Il en résulta entre les deux hommes une rivalité qui se termina à la fin de 1762 par un duel à la Pierre-Tondue, un champ bien connu des bretteurs de la garde.
Notre héros fut probablement blessé au bras. Il se guérit facilement mais ne se réconcilia jamais avec son adversaire. Le respect dont Catherine l’entourait ne paraît pas lui avoir convenu. 11 aurait eu avec la tsarine plusieurs conversations, dans lesquelles il aurait déclaré que les Encyclopédistes étaient des niais, et leurs relations en auraient été affrétées.
Cependant Saint-Germain savait beaucoup de choses sur la révolution russe, et les frères Orloff
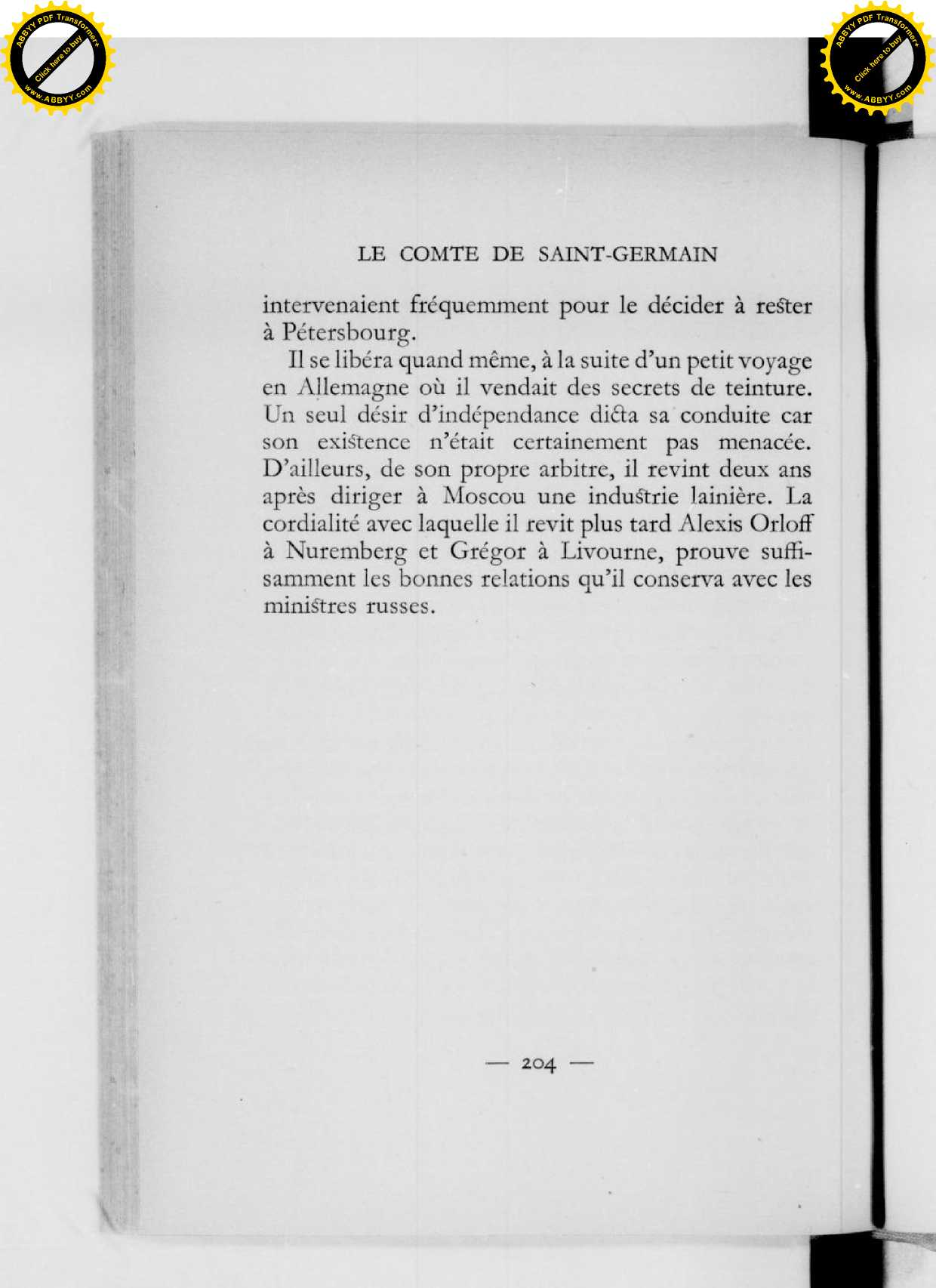
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
D’ailleurs, de son propre arbitre, il revint deux ans apres diriger à Moscou une industrie lainière. La cordialité avec laquelle il revit plus tard Alexis Orloff à Nuremberg et Grégor à Livourne, prouve suffisamment les bonnes relations qu’il conserva avec les ministres russes.
intervenaient fréquemment pour le décider à rester à Pétcrsbourg.
Il se libéra quand même, à la suite d’un petit voyage en Allemagne où il vendait des secrets de teinture. Un seul désir d’indépendance diéta sa conduite car son existence n’était certainement pas menacée.



LE COMTE DE SAINT-GERMAIN DANS LES PAYS-BAS AUTRICHIENS
Après avoir quitté Saint-Pétersbourg, M. de Saint-Germain traversa l’Allemagne de l’cśt à l’ouest pour aller se fixer à Bruxelles, la capitale des Pays-Bas autrichiens, comme on disait à cette époque. Sa situation pécuniaire se trouvait-elle obérée? Nous pouvons en douter, car les cadeaux somptueux de Catherine devaient lui permettre de vivre à l’aise. Mais il était d’un siècle prodigue, et nous avons déjà pu nous rendre compte que l’esprit d’économie n’était certainement pas la vertu dominante de notre héros. Il décida alors, dans cette possession lointaine de l’Autriche, d’utiliser sa fortune à la restauration de procédés de teinture dont il prétendait être l’inventeur.
L’Empire n’avait pas à Bruxelles de représentant, mais une sorte d’envoyé qui jouissait, sur les autorités

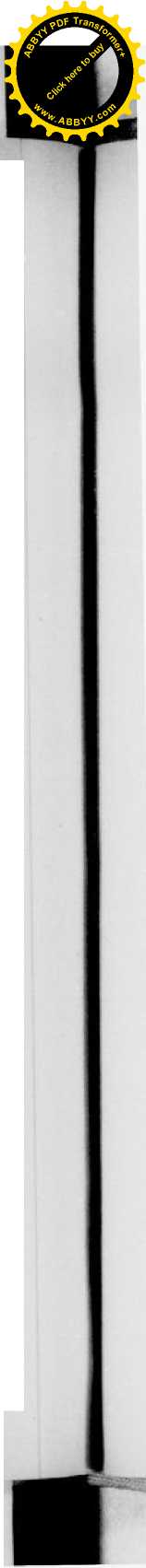
gouvernementales ou municipales, d’une autorité presque didatoriale. En 1763, date où se présenta Saint-Germain, le comte Kobenzl était chargé de ce poStc difficile. M. de Surmont, nouveau nom d’emprunt de notre homme, exécuta devant le gouverneur, sur de simples échantillons, de savantes expériences. Le grave diplomate, agréablement surpris des résultats obtenus, perdit en quelques jours sa méfiance naturelle et devint bientôt un enthousiaste disciple de l’inventeur.
Dans une lettre personnelle du 8 avril 16731 adressée à Kaunitz, ministre d’Etat de Marie-Thérèse, le résident aux Pays-Bas ne peut cacher le trouble qu’il avait ressenti devant la simplicité des démonstrations du chimiste. Preuve capitale de la persuasion exercée par Surmont, le gouverneur laissa entendre que la prépondérance industrielle de l’Empire était en jeu dans cette affaire. Le moyen le plus pratique de la garantir et de l’affirmer, ajoutait-il, était de fournir, par l’entremise du Trésor de la cour, des capitaux à Surmont.
Le ministre, méfiant par métier, conseilla au Résident une très grande prudence2 et il fit comprendre très discrètement à Kobenzl que sa position de gouverneur civil l’empêchait, sur un territoire annexé, de
1. Correspondance de Kobenzl à Kaunitz. Archives de la Hoffburg.
2. Wien Hoffburg, 19 avril 1763.
-- 2OÓ --

:orité senta Je ce l’em-iver-;xpé-s des anee cipie
Ć731 róse, uble śtra-sion ndre était ique our-:api-
Lési-idre ;ou-■, de
prendre parti pour un homme ni autrichien ni flamand.
“ Je vois les choses de loin, précisa le Premier de Vienne, et sans subir l’ensorcellement des décors. Les savants les plus habiles et les chimistes les plus distingués ont souvent trébuché avant d’avoir obtenu des résultats probants. Agissez, monsieur le Résident, auprès des autorités de Bruxelles avec beaucoup de circonspection et rappelez-vous le passé extravagant de M. de Surmont. Ccci doit vous suffire à contraindre à la patience et à l’observation tous les admirateurs de ce dernier avant de lui donner une aide financière. A l’heure actuelle, en cśt-il digne? ”
Certes, le comte Kobenzl fut désagréablement impressionné par la mauvaise volonté du ministre. 11 eśt même probable que les ordres déguisés sous des conseils de ses supérieurs auraient triomphé de son indécision qui pouvait l’entraîner dans une lâcheuse affaire, si une de scs relations autrichiennes, Mme Net-tinc, femme du monde, poète d’un certain talent, rcśtće dans l’obscurité jusqu’alors et habituée à vivre seule, tant à Paris qu’à Bruxelles, n’avait insisté pour assister à une des expériences de M. de Surmont.
Elle ne résista pas à sa suggestion, à son parler insidieux, à l’impression de franchise révélée par toute sa personnalité. Exaspérée par l’attitude trop prudente de la cour imperiale, elle crut impossible de
— 207 —


voir se développer l’avenir industriel de Vienne sans la collaboration de savants semblables à M. de Surmont. Une nouvelle manœuvre de Marie-Thérèse auprès de Kobenzl lui donna prétexte à se lancer dans cette croisade et, sans réflexions, cette femme généreuse se résolut à engager des capitaux personnels et à faire construire une manufacture dont elle confia la direction à M. de Surmont. Les dépenses, tous ses proches le pensaient, devaient être largement compensées par de très gros bénéfices.
C’est à Tournai que fut installée l’usine de teinture. C’était au xvine siècle une ville industrielle et florissante de plus de 40.000 habitants, agriffée sur les deux coteaux qui bordent l’Escaut. Deux cents ans auparavant, la victoire des troupes de Charles-Quint avait décidé de son rattachement aux Pays-Bas; à la fin du siècle, elle avait subi très malencontreusement l’hérésie des iconoclastes, laquelle, très excusable en principe, la priva, en fait, de certaines œuvres du Moyen Age, arrachées à ses églises et à ses maisons. Son trésor artistique diminué d’autant en restait affecté. Louis XIV s’en empara en 1667 et confia à Vauban le soin de la fortifier, mais Louis XV, après Fontenoy, fit procéder à son démantellement immédiat. Sage précaution d’ailleurs, car Tournai, qui devait retomber sous la domination autrichienne trois ans après, n’était plus qu’une ville ouverte dont les
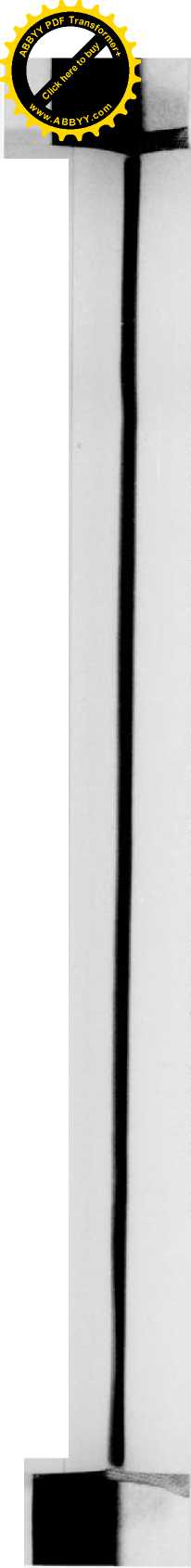
: sans Sur-lérèse dans ^éné-nnels onfia ts scs ipen-
turc. oris-r les 5 ans )uint
à la lient e en s du ons. ^tait fia à près imé-
qui rois : les
bastions d’antan ne pouvaient plus menacer nos frontières. En notre temps, de grandes promenades plantées d’arbres entourent la ville très riante, mais en 1765, date dc 1’inśtallation de notre héros, les autorités n’avaient pas comblé les fossés de l’ancienne citadelle. Une population, plus dense que celle d’aujourd’hui, s’empressait peut-être sur d’anciens chantiers délabrés et une marmaille bruyante, issue de ces ouvriers, teinturiers et filatcurs dont l’œuvre était déjà célèbre dans l’Europe entière, devait s’amuser sur ces espaces en friche.
Sur la place de l’Archevêché se dressait la façade de l’église Notre-Dame, déjà altérée par des remaniements nombreux. La partie intérieure, la plus ancienne, était de śtyle roman, mais un plafond de bois que dut voir M. de Saint-Germain précédait, en ce temps, la voûte qui recouvre la grande nef.
Cinq tours carrées, les “ Chong elotiers ” comme on disait en patois, s’élevaient au-dessus du transept et cinq flèches pyramidales les surmontaient dans l’azur clair.
En suivant le Vieux marché aux Poteries, dont une rue évoque le souvenir, on pouvait arriver au Beffroi, le plus ancien de la Belgique, mais totalement inspiré par le goût flamand.
Dans cette place se coudoyaient les ouvriers chômeurs; les jours de foire, ils s’asseyaient tranquille-
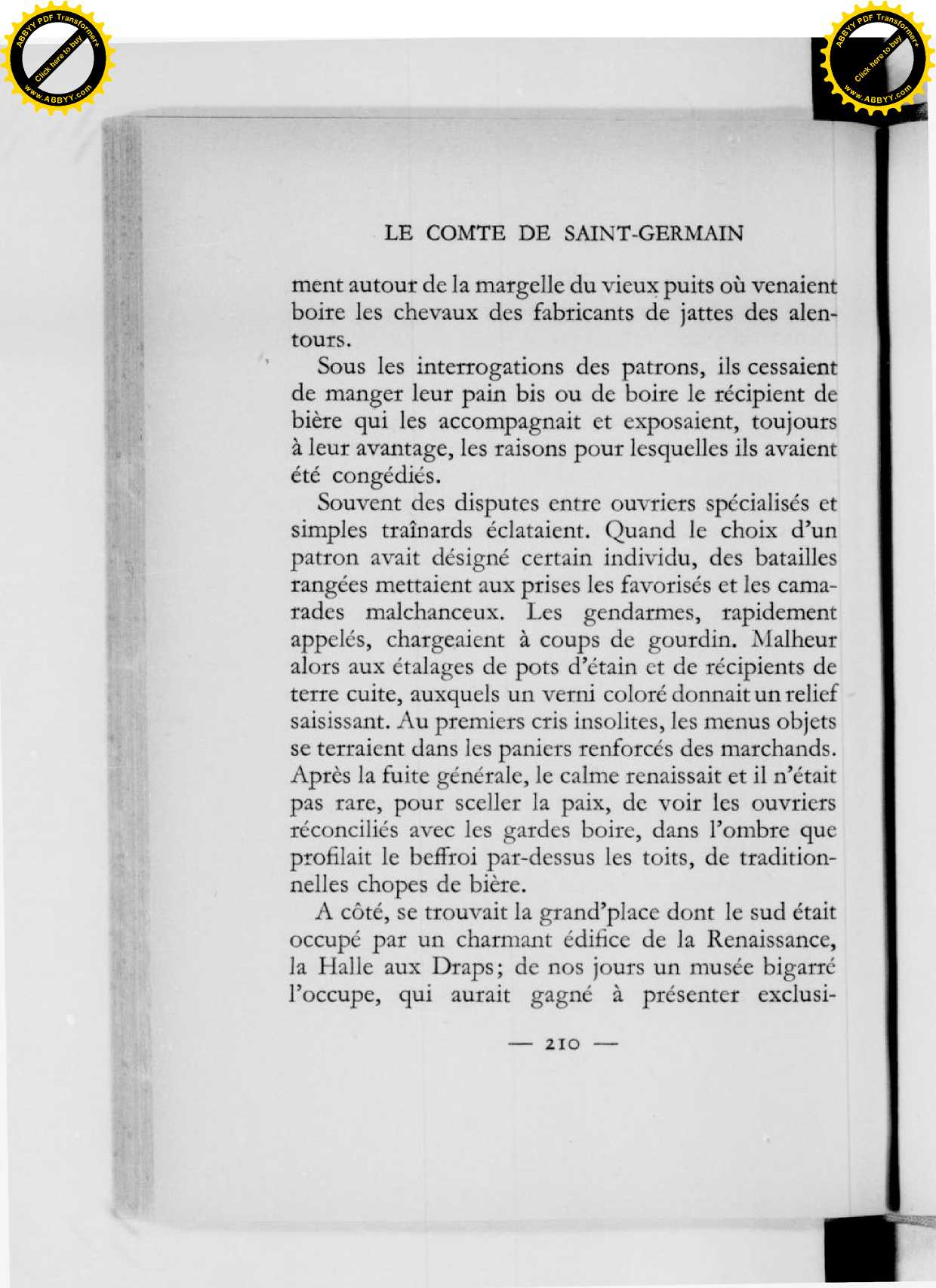
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
boire les chevaux des fabricants de jattes des alentours.
Sous les interrogations des patrons, ils cessaient de manger leur pain bis ou de boire le récipient de bière qui les accompagnait et exposaient, toujours à leur avantage, les raisons pour lesquelles ils avaient été congédiés.
Souvent des disputes entre ouvriers spécialisés et simples traînards éclataient. Quand le choix d’un patron avait désigné certain individu, des batailles rangées mettaient aux prises les favorisés et les camarades malchanceux. Les gendarmes, rapidement appelés, chargeaient à coups de gourdin. Malheur alors aux étalages de pots d’étain et de récipients de terre cuite, auxquels un verni coloré donnait un relief saisissant. Au premiers cris insolites, les menus objets se terraient dans les paniers renforcés des marchands. Après la fuite générale, le calme renaissait et il n’était pas rare, pour sceller la paix, de voir les ouvriers réconciliés avec les gardes boire, dans l’ombre que profilait le beffroi par-dessus les toits, de traditionnelles chopes de bière.
A côté, se trouvait la grand’placc dont le sud était occupé par un charmant édifice de la Renaissance, la Halle aux Draps; de nos jours un musée bigarré l’occupe, qui aurait gagné à présenter exclusi-

ricrs

“ que tion-
était ince, jarre :lusi-
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
vement de la céramique et de la poterie flamandes.
Toute la vie de notre héros aux Pays-Bas autrichiens dut se dérouler dans cette ambiance, entre une riche bourgeoisie assez fermée et un monde de travailleurs ivrognes, souvent paresseux, jamais satisfaits, mais toujours profondément sympathiques dans leur rondeur rabelaisienne.
11 s’agissait pour Surmont d’opérer en grande quantité la teinture de la soie et de la laine avec une perfection inconnue jusqu’alors. Une partie de l’usine devait être consacrée à la teinture du bois, sans indigo ni cochenille, ce qui était une révélation, aux dires des techniciens. On devait ainsi obtenir des couleurs très vives et avec des ingrédients très simples, par conséquent avec le moins de frais possible. Une autre partie était affectée à la teinture superficielle du métal, exécutée sans doute avec des vernis, et une annexe était prévue pour raffermir et teindre le cuir industriel et le cuir repoussé.
La cour de Vienne, prise d’un scrupule méritoire, Ht avertir Mme Nettine que les miracles promis par de Surmont étaient sujets à caution. Elle plaida en outre la perplexité du gouvernement. Rien n’y ht. Kaunitz crut alors nécessaire de s’entremettre et écrivit personnellement à la prêteuse. “ Je vous mets en garde, madame, contre tous les procédés chimiques démontrés ou même prouvés dans des expé-
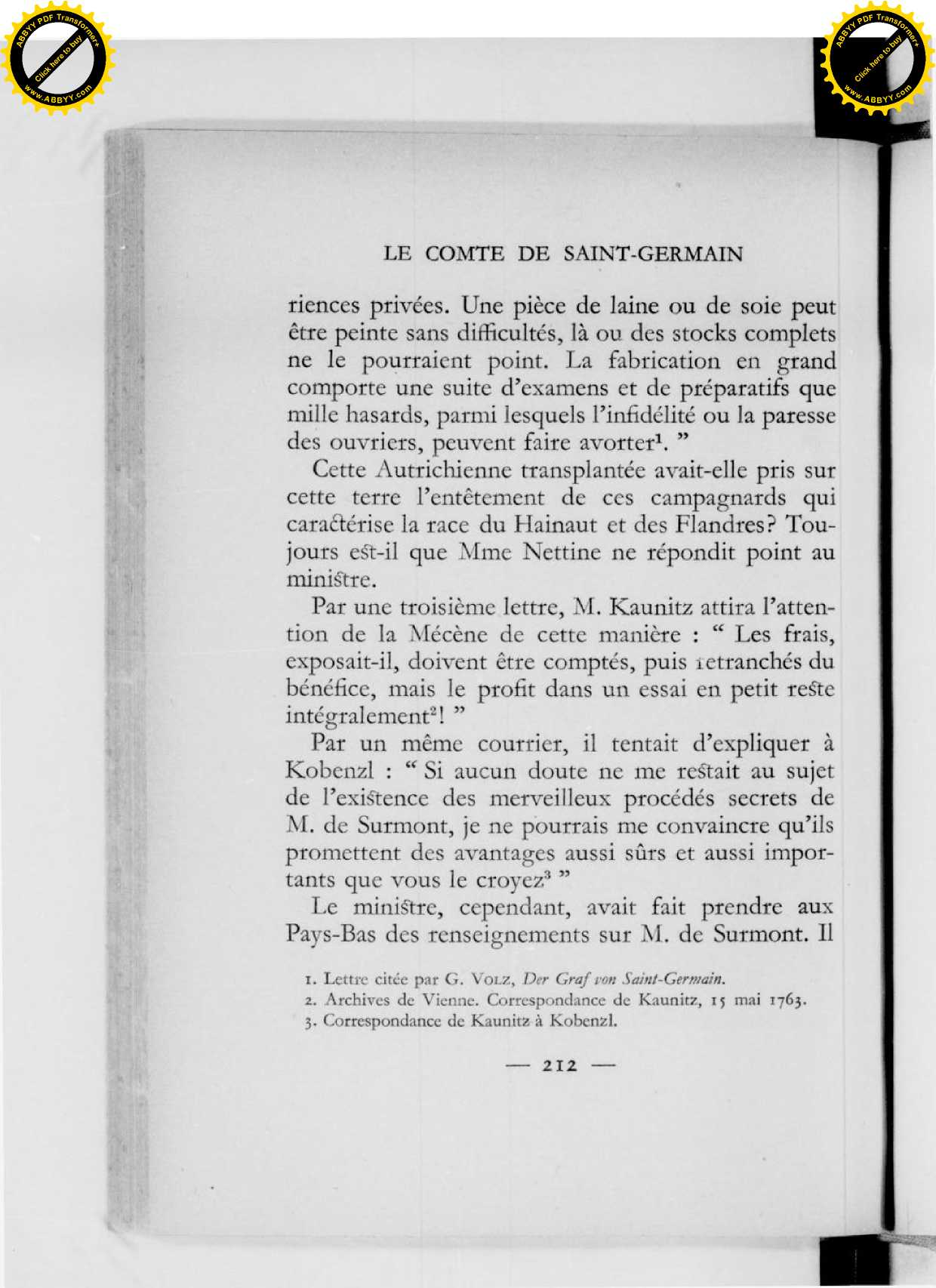
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Le ministre
ou la paresse
rienccs privées. Une pièce de laine ou de soie peut être peinte sans difficultés, là ou des stocks complets ne le pourraient point. La fabrication en grand comporte une suite d’examens et de préparatifs que
i. Lettre citée par CL Volz, Der Graf ron Saint-Germain.
2. Archives de Vienne. Correspondance de Kaunitz, 15 mai 1
3. Correspondance de Kaunitz à Kobcnzl.
des ouvriers, peuvent faire avorter1. ”
Cette Autrichienne transplantée avait-elle pris sur cette terre l’entêtement de ces campagnards qui caractérise la race du Hainaut et des Flandres? Toujours est-il que Mme Nettine ne répondit point au ministre.
Par une troisième lettre, AL Kaunitz attira l’attention de la Mécène de cette manière : “ Les frais, exposait-il, doivent être comptés, puis letranchés du bénéfice, mais le profit dans un essai en petit reśte intégralement2! ”
Par un même courrier, il tentait d’expliquer à Kobcnzl : u Si aucun doute ne me restait au sujet de l’existence des merveilleux procédés secrets de M. de Surmont, je ne pourrais me convaincre qu’ils promettent des avantages aussi sûrs et aussi importants que vous le croyez3 ”


peut iplets granel s que tresse
is sur ; qui Tou-ut au
ttten-frais, es du reStc
ter à sujet s de ju’ils ipor-
aux it. Il
63.
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Ht alors une quatrième pression sur la dame trop confiante, mais cette démarche échoua comme les précédentes, à cause de l’avis favorable que donna Haaselar, bourgmestre d’AmSterdam, un ancien ami de notre héros pendant son séjour en Hollande.
Le résultat d’une enquête, esquissée par le comte Kobcnzl, aboutit à des conclusions très peu convaincantes. On apprit ainsi l’achat fait par M. de Surmont d’une propriété en Zélande. Pouvait-on reprocher à l’inventeur de ne pas l’avoir payée comptant au comte de Saint-Florentin, l’ancien propriétaire?
Une chose surtout inquiétait la cour de Vienne : l’établissement à Tournai; pourquoi de Surmont s’était-il installé en cette ville? La proximité de la frontière pouvait offrir à un aventurier sans scrupules un refuge certain en cas de mauvaises affaires. Le Résident, indigné de la suspicion que le gouvernement jetait sur son protégé, eut à cœur de préciser à AL Kaunitz que Mme Nettine, seule, avait choisi cette ville et l’avait imposée, en espérant une installation moins coûteuse et une meilleure entente avec les corporations.
Comme elle faisait chaque année, la protectrice dc M. de Surmont passa un long séjour à Paris et revint en Flandre. Elle n’avait rien entendu de défavorable à la cour de France sur notre homme.
11 faut faire remarquer que ce moment correspon-

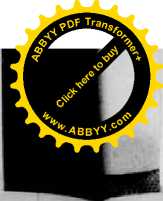
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
dait avec le revirement de l’opinion, causé après les aventures de Russie : le mystérieux personnage restait pour les Français l’homme qui avait précipité la révolution russe à l’avantage de leur pays? Mais Kaunitz ne se tint pas pour battu. Les lettres de Vienne au comte Kobenzl relatent ses efforts désespérés. Cette phrase d’ailleurs n’en eSt-elle pas la preuve?
“ Je ne comprends pas, monsieur le Gouverneur, votre enthousiasme pour un homme si trouble1.... ”
Ému de l’indulgence du diplomate à son égard, M. de Surmont fit comprendre à Kobenzl qu’une trop grande indulgence compromettrait à Vienne son avenir brillant, mais ce dernier refusa de plier.
Nous nous sommes souvent demandé quel intérêt poussait en effet le comte Kaunitz à empêcher notre héros de gagner son existence aux Pays-Bas. Les courriers secrets adressés à Kobenzl et à Mme Net-tine indiquent une volonté très ferme d’interdire le territoire tributaire de l’Empire à M. de Surmont. Nous nous rendons compte que la sollicitude extraordinaire du ministre et de Marie-Thérèse, elle-même, envers la prêteuse de fonds n’eSt qu’un moyen de parvenir. Nous avons songé au prestige. En quoi la réussite ou la faillite de Saint-Germain-Surmont pouvaient-elles nuire au prestige autrichien? On ne

2s les citait révo-unitz te au Cette
ncur, 1 ”
• • • • ^ard, l’une en ne ob'er. térêt rotre
Les Net-re le lont, xtra-ême, a de quoi nont u ne
pouvait craindre, par une mauvaise affaire, de voir diminuer l’influence de Vienne, car l’inventeur n’était ni Viennois ni Flamand, mais étranger. En second lieu, quelle importance pouvait avoir pour Marie-Thérèse les capitaux de cette petite bourgeoise? Si le Trésor n’était pas riche, il pouvait supporter une fuite de plusieurs centaines de mille francs sans envisager une catastrophe immédiate. Doit-on voir dans ces interventions indiscrètes le but d’une politique destinée à rendre l’Europe inaccessible à Surmont? Rien ne peut être écarté; mais quel était le but du gouvernement impérial en cela? Désirait-on, sur le Danube, la présence de Surmont à Versailles? Mais pourquoi l’opposer à Choiseul?Ce serait enfantin! On bien le véritable désir de Kaunitz nous échappe, ou bien il ne peut être expliqué que par un sectarisme contre les aventuriers et les illuminés. Et depuis un temps immémorial, l’impératrice avait fait bon accueil tant à Koibnitz, dont les théories étaient discutées, qu’à Cagliośtro. Sous le règne précédent, Swedeborg était venu passer de longs jours à la cour, et le type de l’aventurier international du xvme siècle, Casanova, y avait eu certaines conquêtes piquantes. A notre humble avis, la peur de recevoir Surmont sur un territoire de l’Empire prouve qu’on ne craignait en lui ni l’illuminé ni le flibuśtier, mais l’agent secret.
— 215 -

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

Voyant que tous scs efforts étaient à peu près restés vains, l’impératrice prit l’initiative d’une rencontre entre Kaunitz et Kobcnzl.
Elle eut lieu au premier voyage que fit le gouverneur dans la capitale*
Le ministre reçut avec amabilité le gouverneur, et l’impératrice, qui assistait à cet entretien, reconnut que la France exerçait une supériorité incontestable sur l’industrie teinturière, avant l’Angleterre qui n’exploitait aux Indes que les découvertes de nos ressortissants. Certaines manufactures autrichiennes donnaient aux étoffes des couleurs assez belles, mais leur peu de durée les faisait considérer comme de qualité inférieure.
Quelle fut donc l’humiliation du comte Kobcnzl d’apprendre de la bouche d’un technicien, M. Thys, que la teinture sans cochenille ni indigo n’était pas un tour de force. D’après lui, deux chimistes, Kurik et ] .émery, et bien d’autres fabricants, avaient donné le secret de cette fabrication, rare encore, mais appelée à devenir courante.
M. Thys se chargea de questionner le gouverneur sur les conditions purement techniques de l’affaire. Un rapport, signé par lui et qui a disparu, permettait de conclure que l’État autrichien n’avait que peu d’intérêt à subventionner l’affaire Surmont.
— 216 —•

restés ?ntre
iver-
ir, et nnut table i’ex-
>sor-don-leur alité
cnzl
Lys»
pas urik
>nné elée
verde
iru, vait
>ur-
G. Volz1 raconte que M. Thys, dans son rôle d’expert intègre, put établir que la plupart des couleurs de la manufacture ne possédaient pas les qualités indispensables. Cependant, il tint à reconnaître que le jaune d’or de Tournai était très éclatant et que, pour un prix minime, on pouvait obtenir une teinture supérieure au jaune autrichien, susceptible de concurrencer la produétion anglo-française.
“ Cc n’eSt pas suffisant pour acheter leur secret ”, déclara M. Thys on rédigeant le rapport définitif.
Après un entretien de cinq heures, le ministre fit signe que sa décision était irrévocable.
Les paupières baissées sur son regard vif révélaient chez Kobenzl un doute étrange. Son front hautain, assez puissant, restait calme. Malgré les preuves qu’il avait devant les yeux, il chercha à se défendre et à sauver la cause de son protégé :
“ Cet homme m’a rendu visite, pour ainsi dire en passant. Bien que l’histoire de sa vie et son origine soient entourées d’une obscurité mystérieuse, je lui ai trouve des dons éminents pour toutes les sciences et tous les arts. 11 eSt poète, musicien, écrivain, médecin, physicien, chimiste, mécanicien au besoin, et connaisseur averti de la peinture. Bref, il a une culture universelle, comme rarement il ne s’en


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
eśt trouvé dans un même homme; il parle toutes les langues, 1’indouśtani comme l’italien, le yiddisch comme le français. Il a voyagé à travers le monde et, comme il eśt très prodigue de ses connaissances, j’ai passé des heures de loisir fort agréables en sa compagnie. Je ne peux que lui reprocher de fréquentes vantardises au sujet de ses talents et de scs origines. Interrogé par moi sur scs parents, ne m’a-t-il pas répondu : “ Seule la maison de Bourbon eśt égale à la mienne par la naissance! ”
— Ce n’est pas la question, intervint Kaunitz. Nous jugeons de Surmont comme inventeur, non comme artiśtc. Ne vous inquiétez pas, mon cher Gouverneur, les secrets de M. de Surmont, dit seulement Kaunitz en se levant, reviendront cher et, pourtant, leur exploitation devrait être fort bon marché? Nous pouvons ainsi savoir quelle sera la solution de cette aventure. ”
Cette conversation1 scrupuleusement exacte a été reproduite quelques semaines après le retour de Kobenzl à Bruxelles dans sa correspondance. Comme l’avait laissé entendre le ministre à Kobenzl, notre héros d’une carrière industrielle : sa fierté, ses capacités naturelles toujours dirigées vers les sciences occultes. M. de Surmont, à ce tournant de son exis-
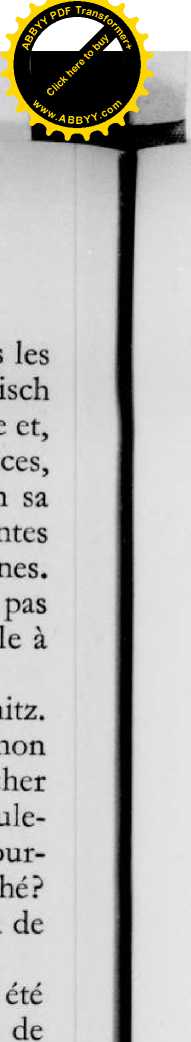

tmc
>tre paces OS
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN tence, rcśtait un illuminé, si grandes aient pu être ses facultés d’adaptation, mais loin d’adopter les accusations dc M. Kaunitz, nous nous refusons à voir dans l’affaire de Tournai une escroquerie délibérée.
Que les promesses de l’inventeur n’aient point été réalisées ne prouve nullement que le chimiste Surmont ne fut pas lui-même victime de son imagination débordante.
On l’a vu, la mise en vente du château domanial de Zélande put correspondre à deux besoins : d’abord payer le propriétaire, ensuite consacrer le reSte du capital à rembourser l’usine que Mme Nettinc subventionnait tant bien que mal.
Le bénéfice réalisé par M. de Surmont en liquidant le manoir fut de 30.000 florins. Il put, croit-on, indemniser dans une grande proportion l’admirable femme qui avait eu confiance en lui. En outre, Tournai, après avoir cessé la teinture des étoffes et des bois vernis, fructifia singulièrement dans la fabrication des cuirs et, quand le fils et le gendre de la prêteuse curent pris la direction de l’entreprise payée par les deniers de leur mère, l’usine commença une progression qui ne se démentit point. Un rapport signé par le comte Kobenzl1 prouve dans quelle estime le bourgmestre d’AmStcrdam tenait M. de Surmont:

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
“ J’ai entendu M. Haasclar dire beaucoup de bien de notre homme. D’après lui, il n’a pas été question entre eux de l’établissement d’une manufacture1. ”
Enfin voici une dernière lettre de Kobenzl qui viendra enlever les soupçons que l’on peut avoir sur M, de Surmont :
“ Je n’ai aucune nouvelle de Surmont. Il a confié à ses amis les fameux secrets des cuirs repoussés, a renoncé à la fabrique et a gardé ses formules pour teindre la laine et la soie. Si j’en crois la rumeur publique, il cherche à les vendre en France ou en Allemagne. Tournai s’eSt développé sensiblement dans la production des cuirs; je crois, pour ma part, que Mme Nettine regagnera ce qu’elle a dépensé. ”
De quoi vécut à cette époque M. de Surmont. On l’ignore. Les mémoires de Casanova sont tellement fantaisistes qu’on ne peut leur accorder aucun poids historique. Notons, à titre d’indication, que les prêteurs avancèrent de grosses sommes à notre héros. L’opulence dans laquelle ce conteur a vu Saint-Germain à Douai, vers la fin de 1763, semble imaginaire.
“ J’arrivai, nous dit-il, à Douai, venant de Dunkerque. Voyant quelques palefreniers qui montaient de beaux chevaux, je demandai par curiosité à qui ils
1. Le dernier fait nous parait dcśtinć à calmer les inquiétudes de la cour d’Autriche.

appartenaient : “ Au comte de Saint-Germain, qui est ici depuis un mois et qui ne sort jamais. ” Cette réponse m’incita à lui rendre visite. Je m’y rendis à neuf heures et je le trouvai avec une barbe noire, longue de deux pouces! ”
Si l’on se rappelle le portrait de M. de Saint-Germain, c’était une innovation récente.
La chambre du comte contenait un grand nombre de récipients, tous remplis de liquides variés. M. de Saint-Germain s’empressa de préciser qu’il travaillait à la fabrication de couleurs, ce qui correspond point par point à son intention de vendre des teintures perfeétionnées. La conversation se porta tout naturellement sur leurs relations communes. Les deux hommes parlèrent de Mme d’Urfé.
“ Elle s’est empoisonnée avec une trop forte dose d’un remède universel. Son testament prouve qu’elle sc croyait enceinte. ”
Comme d’habitude, Saint-Germain voulut se faire admirer par son rival et lui demanda une petite pièce de monnaie. 11 sc leva, mit un charbon ardent sur une plaque de métal, puis un grain noir sur la monnaie. La pièce fut rouge en deux minutes.
“ Attendez qu’elle soit refroidie. Prenez-la, maintenant, elle vous appartient. ” L’effigie de la pièce de douze sols se retrouvait marquée sur la pièce d’oi.
“ Celui qui doute de ma science eśt indigne de me
- 221 —

parler, dit sentencieusement M. de Saint-Germain1. ”|
Ce récit, sans doute inventé, montrerait par sa
tendance la continuité avec laquelle notre héros soi-S
gnait sa propagande parmi les personnages les plusI
divers. Si ces faits sont exaâs, Casanova dut passer
pendant une heure difficile où notre homme n’avaitj
Mais si la volonté déterminée de cet homme éton- 1.
- 222 —
ton-par-ncr-
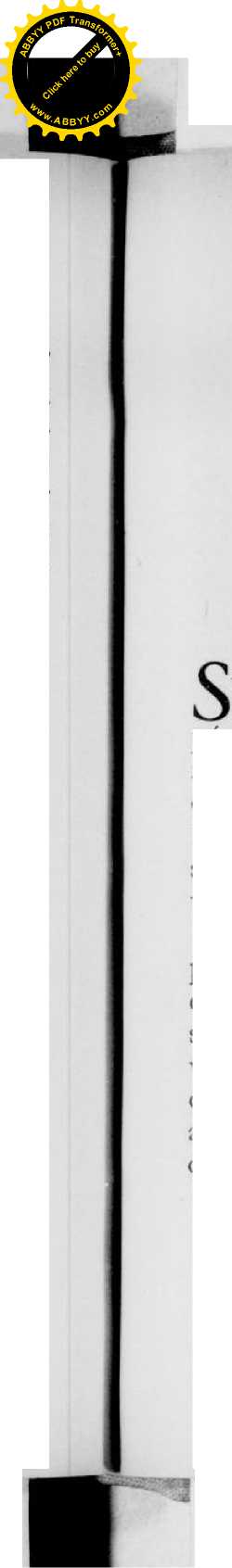
A. ” r sa soi-plus sser .vait 1 de jou
SAINT-GERMAIN A ANSPACH
aint-Germain ne resta pas longtemps à Douai.
Dès lors, commença pour lui une nouvelle période de dix années de mystère. Il paraît absolument impossible de savoir d’une manière précise ce qu’il a fait. Des documents consultés par nous. Souvenirs, Mémoires, Journaux particuliers, laissent supposer qu’il se serait rendu de nouveau en Russie, vers 1764-1765, à Moscou exadement1.
De là, il aurait gagné l’Italie où il établit son séjour
et à Livourne, puis en Allemagne. Mais les preuves sont rares et sujettes à caution. La vraisemblance d’un voyage exotique aux Indes ou en Egypte pourrait se détendre, mais nous restons persuadés que ce silence absolu n’eSt qu’une habile machination faite au profit de la propagande.
1. G. Volz l’affirme dans Der Graf von Saint-Germain.
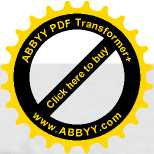

C’eSt seulement en 1774, qu’il attire de nouveau l’attention sur lui. Il eśt alors l’hôte du margrave Alexandre d’Anspach à qui il aurait été présenté par la maîtresse de celui-ci, la célèbre artiste française, la Clairon. Il était déjà depuis quelque temps dans la principauté, quand les bons offices de la comédienne lui permirent de pénétrer dans l’intimité du margrave. Fixé à Swabach, une petite ville proche de la capitale, il se donnait pour un officier riche, menait une vie très retirée et posait au bienfaiteur de l’humanité en semant les bonnes œuvres autour de lui.
Comme la guerre entre la Russie et la Porte durait encore et que la flotte de la mer Noire se trouvait dans l’Archipel, on supposa que le gouvernement russe avait envoyé un homme de confiance en Franconie, pour s’occuper discrètement de la correspondance passant par l’Italie. Averti de ces bruits, le prince, dont l’indulgente bonté n’avait pas de limites, avait donné l’ordre d’autoriser l’étranger à séjourner aussi longtemps qu’il ne donnerait à la police aucun sujet d’inquiétude. Saint-Germain, encouragé par tant de cordialité et fatigué de l’obscurité dans laquelle il vivait depuis dix ans, dressa ses batteries pour sortir de la médiocrité et tenta de jouer un rôle plus conforme à son ambition. Sans doute, la cour d’Anspach était un bien petit théâtre pour son activité, alors qu’il avait


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
ivcau *rave senté çaise, dans
órnete du ■oche riche, titcur Jtour
brillé, et de quel éclat! à Versailles et plus tard à Saint-
Pétersbourg, mais cela valait sans doute mieux que la solitude et l’abandon dans lesquels il craignait de
s’enliser pour le restant de sa vie. 11 simula donc un vif plaisir en remerciant le margrave de sa protection. Ce fut chez la Clairon qu’il eut, pour la première fois, l’honneur d’être accueilli par le souverain.
Le baron von Geimmingen1, ministre de la principauté allemande, nous a laissé sur cette entrevue et le séjour ultérieur de Saint-Germain de savoureux renseignements. Notre homme semblait à cette exc
lurait dans
russe onie, lance ■ince, avait aussi sujet nt de die il iortir
orme était
que âgé de soixante-dix ans. 11 était de taille moyenne, plutôt maigre que fort et cachait sous une perruque scs cheveux gris.
Dès la première rencontre, le comte remercia le margrave de l’autoriser à séjourner sur ses terres. Il ajouta à son compliment des félicitations chaleureuses et spontanées sur le gouvernement de cet lltat heureux, fit allusion à de grands voyages qu’il axait faits et termina en affirmant son intention de confier au petit souverain des secrets propres à augmenter le bonheur et le bien-être de scs sujets. Les qualités inicUcétucllcs d’Alexandre n’étaient pas à la hauteur de scs qualités morales. 11 était fort crédule, il avait l’esprit prévenu, en bon illuminé qu’il était,
avait

en faveur de tout ce qui fleurait le mystère. L’affirmation de Saint-Germain lui fit immédiatement dresser l’oreille et sa curiosité fut portée au plus haut point quand notre héros lui montra négligemment un grand nombre de belles pierreries qui paraissaient être des diamants et qui devaient avoir une immense valeur.
Pris au piège, le souverain allemand invita le comte Tzarogy (le dernier nom de Saint-Germain) à venir le retrouver dès le début de l’année à Triesdorf, sa résidence d’été.
Notre personnage fit bien des difficultés, mais finit par accepter l’invitation à la condition expresse qu’on le laisserait vivre à sa guise, inaperçu, et dans le calme. Trop heureux de le voir acquiescer, le margrave souscrivit avec empressement au désir de son hôte.
A Triesdorf, Tzarogy fut logé dans les chambres du château dont Mlle Clairon habitait l’étage supérieur. Quant au margrave et à sa femme, ils habitaient La Fauconnerie. Contrairement à ses habitudes, l’aventurier ne fit étalage d’aucun faśte, et sembla avoir conclu un pacte avec la modestie et la simplicité. Ce revirement, s’il avait duré longtemps, aurait pu faire croire à une période de dépression. En effet, l’alchimiste refusa des domestiques affairés à le servir, prit tous ses repas dans sa chambre et quitta rarement
Ci
n
r
P c I P c d s: q 'i h h d n ti a n s r c c c
comte venir
mais presse Çu, et escer, désir
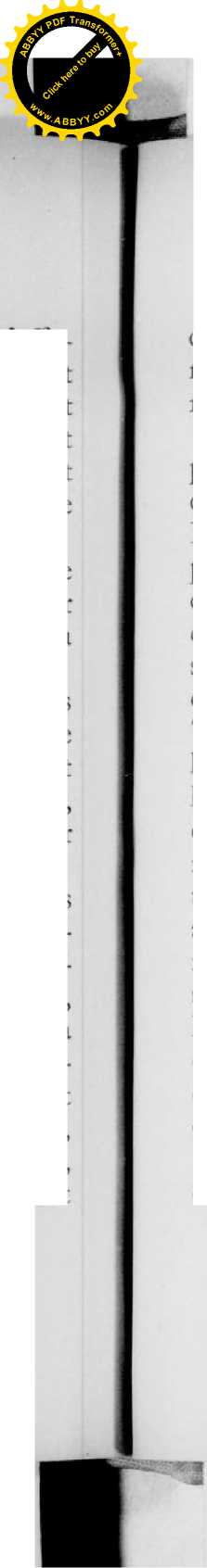
?affir-cment s haut liment saient mense
mbres supé-habitudes, embla impii-aurait l effet, :ervir, ement

cette retraite. Contairement à l’exiâtence qu’il avait menée en Russie, sa cuisine reśta simple et végétarienne.
11 renchérit encore sur la sévérité du régime qu’il pratiquait en Hollande. 11 ne buvait plus de vin, considéré maintenant comme un véritable poison. 11 ne prenait que de l’eau. Eśt-ce l’âge qui le minait précocement? Non, sans doute, car il évitait toute compagnie et ne consentit qu’une fois à présenter ses devoirs à la margravine, curieuse de faire connaissance avec cet homme étrange. 11 se refusa énergiquement à paraître autour de la table du prince, foutes ses soirées, il les passait avec Mlle Clairon, le margrave et ceux que ce dernier aimait voir près de lui. En revanche, il se montra le brillant causeur d’autrefois, prit un invincible plaisir à étaler sa connaissance du monde et des hommes, et sembla accentuer avec satisfaâion le côté mystérieux de sa vie. 11 aimait à parler de son enfance et de sa mère, qu’il ne nommait jamais sans une émotion apparente ou même sans larmes dans les yeux. 11 n’en dévoila jamais l’identité. 11 rappela volontiers son éducation prin-cière, sans jamais risquer une précision, mais au contraire avec des paroles sybillines qui piquent la curiosité par leur obscurité.
Parfois aussi, il versait, nous ne pouvons pas dire dans l’imposture mais dans l’invraisemblance. Il se

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

donnait comme âgé de deux mille ans. A l’entendre, il s’était souvent entretenu avec César sur les moyens d’infuser, par l’institution de la monarchie, un sang frais à la République romaine, tombant en ruines. D’ailleurs, César avait sur ce point des idées très personnelles que purent confirmer des druides témoins de ses expéditions de Grande-Bretagne1.
Dans ces conversations, Tzarogy montrait une assurance tranchante, mais sans se laisser aller à une impolitesse ni à un heurt d’idées avec un contradicteur. Croire sans contrôle a été le propre des salons du xvine siècle, tant le culte du merveilleux y était poussé à un point extrême. Le scepticisme professionnel des philosophes provoqua dans l’Europe entière une réadion étrange qui poussa les esprits vers une-crédulité presque enfantine. Puisque Dieu avait succombé devant la philosophie, les esprits tournaient leurs vues vers ce qui est immortel : l’essence même de Dieu.
La modération avec laquelle Saint-Germain-Tza-rogy parlait, le respe ¿t qu’il montrait au margrave, pouvait faire douter quelque peu d’un témoignage du baron de Gleichen2généralement sincère dans ses récits.

LF. COMTE DE SAINT-GERMAIN

itendre, moyens un sang ruines.
:rès per-témoins
*ait une er à une •ntradic-alons du t poussé ssionnel
entière
/ers une •u avait u ruaient :c même
iin-Tza-ve, pou-tage du zs récits.
c par pure acnt digne

“ Un jour, précise ce dernier, Saint-Germain montra au prince une lettre cachetée de Frédéric.
— Vous savez quel est ce signe?
— Parfaitement! C’eśt le petit cachet du roi.
— Eh bien! Vous ne saurez tout de même point ce que cette enveloppe contient! ”
D’abord, une pareille insolence jure avec tout ce que nous savons de la courtoisie de l’aventurier; ensuite, il eśt bien certain que le margrave, malgré toute son indulgence et son amabilité, n’aurait jamais souffert d’un inconnu un tel manque au respect dû à son hospitalité, à son rang et à scs qualités morales.
Tzarogy, en dehors de la cour, occupait ses journées d’une façon difficile à déterminer. Il n’avait aucun livre avec lui, sauf un exemplaire sali du pasteur Fidoguarini, occultiśte.
C’était une rare faveur, même pour le prince, d’être admis à pénétrer chez notre héros. On le trouvait presque toujours la tête entourée d’un linge noir. Il semble qu’il eût consacré son activité à préparer toutes sortes de couleurs et surtout à améliorer scs découvertes. Il revenait aussi à son idée de traiter le cuir de mouton pour le transformer en maroquin, en cuir de Russie ou de Cordoue. 11 se faisait fort, en outre, de préparer le plus beau hl de Turquie. La candeur du margrave donna naturellement dans ces promesses de bénéfices mirifiques. Il fit rcligicuse-
— 229 —

ment inscrire les recettes par le baron von Gem-mingen, installa un laboratoire pour procéder aux expériences. Le prince et son conseiller se transformèrent pour les besoins de la cause en tanneurs et en teinturiers. Les premiers résultats semblèrent encourager tous les espoirs. On parvint à fabriquer, sans grand’peine, et à peu de frais, le plus beau Cordoue. Malheureusement, Gemmingen eut l’idée de s’en faire faire des souliers de soirée. Vingt-quatre heures après, ils n’étaient plus que loques et charpie. Le fil turc se révéla tout aussi peu solide. D’autres essais aboutirent aux mêmes déconvenues.
Tzarogy rejetait la faute sur les manipulateurs qui, eux, s’en prenaient aux ingrédients. Bref, on dut abandonner l’entreprise.
Le bon margrave n’en continua pas moins à traiter son protégé de la façon la plus amicale.
Un jour de 1774, ce dernier annonça qu’il avait reçu un courrier du comte Alexis Orloff, qui revenait précisément d’Italie. Le miniśtre russe invitait d’une manière pressante son ancien collaborateur à lui rendre visite à Nuremberg, lors de son passage qui ne saurait tarder.
Tzarogy s’empressa de profiter de cette circonstance pour présenter le margrave au vainqueur de Tschesmé. Première victoire navale de la Russie sur la Turquie, elle avait eu dans tout l’Empire un
— 230 —
-irs qui, on dur
l traiter
il avait evenait t d’une à lui ge qui
ircons-eur de sie sur ire un
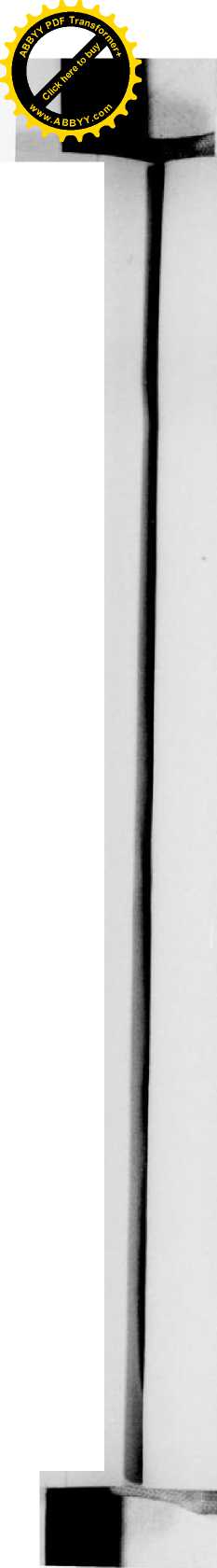
Gem-ler aux ansfor-rs et en encou-:r, sans )rdouc. le s’en heures
Le fil s essais
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN énorme retentissement. L’Europe ne voulait pas croire à la rénovation de la flotte russe avant cet événement et elle avait appris, avec un peu de Stupéfaction, la défaite imposée au sultan par cet ancien officier des Gardes.
Alexandre-Charles s’empressa d’accepter cette occasion et gagna la fameuse cité avec Tzarogy et l’inévitable Gemmingen.
Orloff s’avança les bras ouverts vers son ancien compagnon d’armes, qui était revêtu pour la première fois d’un uniforme de général moscovite; il l’appela “ caro padre ” “ caro amico ” très tendrement devant le margrave extasié et rendit seulement ses devoirs au souverain après avoir embrassé longuement Sai nt-Germain.
Alexis Orloff fut très cordial pour le hobereau allemand, mais il le remercia pour la proteéfion accordée à son ami, comme si cette chose et seulement celle-là, pouvait trouver grâce devant lui1.
Le prestige d’Orloff était à cette époque presque mondial. Tout souverain qu’il était, le margrave ne pouvait être comparé à cet homme, aîné de cinq frères, qui avaient travaillé, suivant leurs capacités, au redressement de l’Empire de Catherine.
Saint-Germain et le margrave furent retenus à
i. Ces quelques détails de l’entrevue ont été recueillis dans les Souvenirs du baron Glcichen.
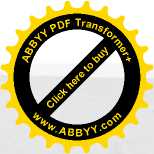
<
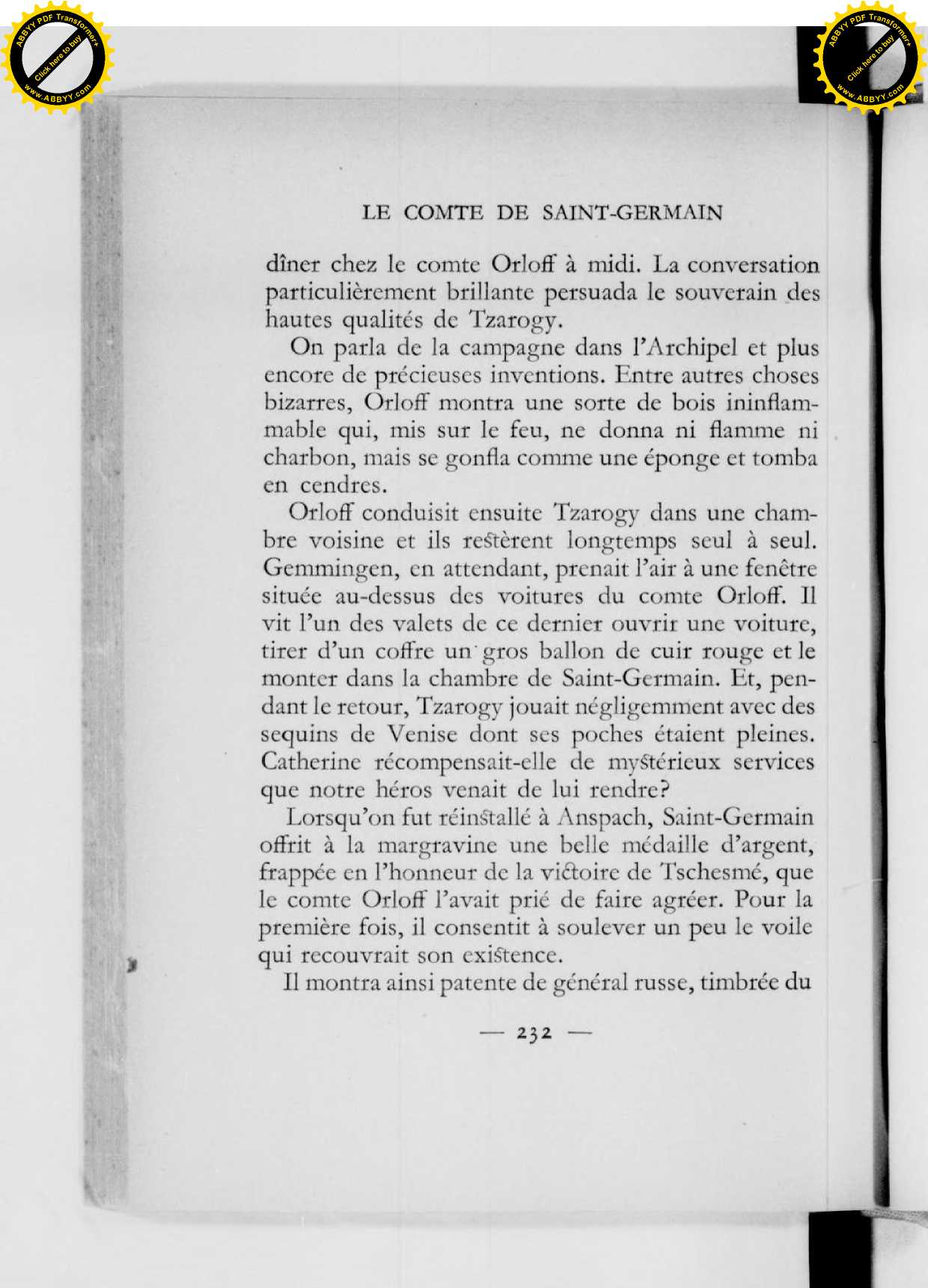
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
niable
dîner chez le comte Orloff à midi. La conversation particulièrement brillante persuada le souverain des hautes qualités de Tzarogy.
On parla de la campagne dans l’Archipel et plus encore de précieuses inventions. Entre autres choses bizarres, Orloff montra une sorte de bois ininflam-
charbon, mais se gonfla comme une éponge et tomba en cendres.
frappée en l’honneur de la victoire de Tschesmé, que le comte Orloff l’avait prié de faire agréer. Pour la première fois, il consentit à soulever un peu le voile qui recouvrait son existence.
bre voisine et ils restèrent longtemps seul à seul. Gemmingen, en attendant, prenait l’air à une fenêtre située au-dessus des voitures du comte Orloff. Il vit l’un des valets de ce dernier ouvrir une voiture, tirer d’un coffre un gros ballon de cuir rouge et le monter dans la chambre de Saint-Germain. Et, pendant le retour, Tzarogy jouait négligemment avec des sequins de Venise dont scs poches étaient pleines. Catherine récompensait-elle de mystérieux services que notre héros venait de lui rendre?
Lorsqu’on fut réinstallé à Anspach, Saint-Germain
sation in des
t plus dioses illa inne ni omba
•main gent, , que ur la voile
ée du

:ham-seul.
mètre >ff. Il ¿turc, ? et le , pen-:c des eines. /vices
grand sceau impérial. Il confia même au margrave que son nom de Tzarogy était un nom d’emprunt, tiré de Rakoczy et qu’il était le dernier descendant des princes de Transylvanie, bannis sous l’empereur • Léopold.
Son crédit grandit encore auprès du margrave et notre personnage pouvait caresser l’espoir de terminer dans la petite principauté son existence passablement agitée. Mais son apparente franchise sc retourna contre lui au retour d’un voyage en Italie, tenté par le margrave en 1775. Les déconvenues s’étaient, en effet, succédé pour ce dernier. A Naples, il apprit que le dernier Rakoczy était mort depuis longtemps; à Livourne, le consul anglais, sir John Dick, le renseigna sur son hôte étranger.
“ Cet homme n’eSt autre que le comte de Saint-Germain, de triśte réputation. Il a fait, en Italie, la connaissance des frères Grégor et Alexis Orloff et a su gagner leur confiance, je ne sais comment. ”
Un autre informateur fut davantage affirmatif.
“ Il eSt né en Savoie, à San-Germano; son père était un certain Rotondo, percepteur des Droits. ”
A ces révélations, aussi dénaturées les unes que les autres, le margrave perdit sa mansuétude ordinaire. Il avait quelque peu la tête faible et la dernière personne qui lui avait parlé avait presque toujours raison, f urieux d’avoir été myStifié, il décida, dès son retour à
— 235 —
Anspach, d’envoyer le fidèle Gemmingen à Swabach où se trouvait Saint-Germain et de lui faire part des renseignements qui lui étaient parvenus sur lui. En outre, il avait prié son émissaire de réclamer les lettres anciennes adressées à son hôte du temps de leur amitié.
Toutefois, il lui octrovait contre le reçu de cette correspondance la permission de rester à Swabach, tant qu’il le voudrait, à condition de se tenir tranquille. Quand Gemmingen arriva, il trouva Saint-Germain alité et observa ironiquement, dans le récit qu’il a laissé de l’entrevue, l’impuissance de l’aventurier à juguler une crise de goutte, par son thé, véritable panacée universelle. Gemmingen s’acquitta, en conscience, de la mission confiée et dont il sentait l’importance, mais il confessa avoir été désemparé en voyant le calme avec lequel Saint-Germain écouta sa diatribe1.
“ Ce que vous dites eśt vrai, dit tranquillement l’homme. J’ai pris de temps à autre certains noms d’emprunt, auxquels vous pouvez ajouter celui de Soltikov, mais sachez-le, monsieur, sous toutes ces étiquettes je n’ai jamais cessé d’être tenu pour un homme d’honneur. Si l’on me calomnie, je suis prêt à me laver de tous les reproches. Je ne crains aucune

ibach t des : lui. :r les □s de
cette bach, tran-jaint-is le :e de i thé, uitta, mtait iparé :outa
ment roms ii de
s ces r un prêt
cune
poursuite. Ce que j’ai dit au margrave touchant mon nom et ma famille eśt vrai. Mais, hélas! — une ombre
de mélancolie passa sur son visage, — la preuve de mes origines se trouve entre les mains d’une personne dont je dépends.... Ah! cette dépendance! que d’ennuis elle m’a causés au cours de mon existence!
Poursuites, attentats, j’ai tout subi et c’est pour cela que je m’étais retiré dans un endroit où je comptais vivre inconnu et solitaire. Le moment va bientôt venir ou je pourrai faire ce que j’ai promis, si je n’en suis pas empêché. ”
Cette éloquente tirade et ces promesses n’eurent pas d’effet sur l’envoyé du margrave qui répliqua :
“ — Pourquoi donc n’avez-vous pas prévenu Son Altesse des différents noms sous lesquels vous avez vécu dans tant de villes et d’États?
— Parce que je ne l’ai pas jugé nécessaire. Je n’ai jamais abusé de la confiance du margrave. J’éprouve un sensible déplaisir de l’opinion défavorable qu’on lui a inspirée. Je me verrai contraint de quitter le pays et le prince sera bien forcé de me rendre son estime. ”
L’entretien se poursuivit encore quelque temps, mais Saint - Germain rappela la confiance dont Louis XV l’avait honoré, les négociations secrètes dont il avait été chargé, sa haine de Choiseul, sa fuite en Angleterre et toutes ses aventures.

Les paroles de notre homme sont curieuses à plus d’un titre. On y retrouve la hauteur arrogante dont Saint-Germain s’armait dans les moments difficiles. On y voit aussi cette sorte de mythomanie dont il était viétime et qui le poussait à imaginer des volontés supérieures au-dessus de sa volonté.
Qui était cet inconnu qui lui imposait un perpétuel incognito? N’était-ce pas un moyen d’épaissir le voile qui couvrait sa personnalité?
Gemmingen sembla satisfait des explications de notre héros, d’autant que celui-ci lui rendit, avec une émotion apparente, les lettres du margrave.
Les deux hommes ne devaient plus se revoir. Profitant de l’autorisation du margrave, Saint-Germain reśta encore quelque temps à Swabach, y menant une vie tranquille, uniquement consacrée à l’étude et à la bienfaisance.
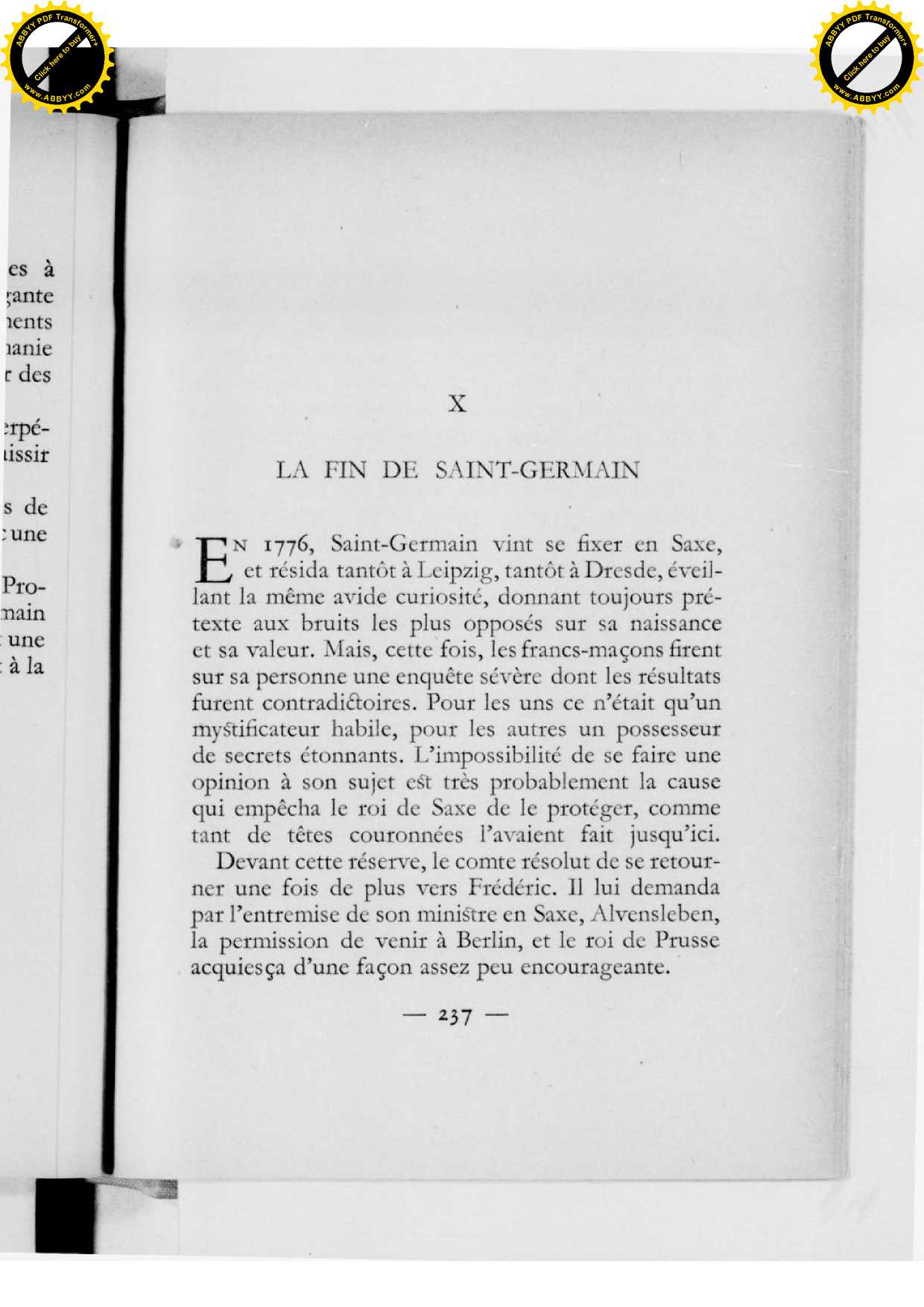
ussir
nain une
jante lents unie r des
lant la même avide curiosité, donnant toujours prétexte aux bruits les plus opposés sur sa naissance et sa valeur. Mais, cette fois, les francs-maçons firent sur sa personne une enquête sévère dont les résultats furent contradi&oires. Pour les uns ce n’était qu’un myśtificatcur habile, pour les autres un possesseur de secrets étonnants. L’impossibilité de se faire une opinion à son sujet cśt très probablement la cause qui empêcha le roi de Saxe de le protéger, comme tant de têtes couronnées l’avaient fait jusqu’ici.
Devant cette réserve, le comte résolut de se retourner une fois de plus vers Frédéric. 11 lui demanda par l’entremise de son ministre en Saxe, Alvenslcbcn, la permission de venir à Berlin, et le roi de Prusse


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
“ Je vous prie de lui faire remarquer que l’on cśt ici très incrédule et, qu’en général, personne ne croit aux choses qu’on ne peut prouver de manière évidente. M. de Saint-Germain ferait donc bien de se demander s’il est disposé à montrer sa science et ses secrets. Sinon, il perdrait ici certainement son temps, tandis qu’il pourrait s’adresser ailleurs plus utilement1!
C’était un congé en bonne et duc forme. Saint-Germain le comprit et, sans insister, repartit pour Moscou, où il fonda, en 1778, une troisième manu- # facture de teintures.
Grâce aux subsides de la cour impériale, grâce aussi à l’expérience acquise, l’affaire atteignit une prospérité assez grande. Mais notre héros souffrait de rhumatismes et le climat ne lui était pas favorable. Aussi, dès 1779, il abandonna la direction de cette fabrique.
11 revint alors à Berlin et prit plusieurs pièces dans un hôtel avantageusement connu, la maison Sion. Il vivait très retiré, avec deux serviteurs. Sa situation pécuniaire semblait s’être améliorée sensiblement, car une voiture de location l’attendait toute la journée devant sa porte. 11 la payait bien,
aint-pour anu- •
;râce une
Hrait able. cette
rc pas .es de
icccs ison . Sa
sen-idait rien,

ii eśt croit évi-le se t scs mps, itilc-
mais ne s’en servait jamais. Un jour, le baron de Knyfausen, l’ancien ambassadeur de la Prusse à Londres, qu’il avait retrouvé en Russie, l’ayant invité d’une manière pressante à venir dîner avec lui, s’attira cette réponse.
“ Volontiers, mais si vous m’envoyez votre calèche. Je ne peux me servir d’une voiture de louage, car les meilleures sont trop mal suspendues1! ”
Le baron s’empressa de complaire à ce désir. Il avait été un temps où il était intervenu personnellement auprès de Frédéric pour faire interdire les États prussiens à Saint-Germain, particulièrement après l’assassinat de Pierre 111. Comme on le voit, les dispositions du diplomate avaient bien changé et leurs relations semblent même avoir connu une période de franche intimité. Jamais le comte ne s’adressait au baron qu’en ces termes :
“ Mon fils, je vous salue! Vous avez bien fair, mon fils! ”
Mais un revirement beaucoup plus éclatant et vraiment inattendu fut celui du roi de Prusse lui-même. Il semble avoir été déterminé par la guérison presque miraculeuse d’une dame de la cour, Française d’origine, Mme du Trousscl. La malheureuse souffrait d’accès épileptiques très fréquents. Confiante
i. “ Souvenirs ” de Knyfausen. La citation faite par G. \ olz a été traduite de Der Graf ron Saint-Germain.
dans la réputation du guérisseur, elle se confia aux mains de notre héros. Le roi Frédéric, sujet à des crises semblables, fut averti du fait et crut de son devoir
de la mettre en garde contre un personnage, à ses
yeux, inquiétant :
“ Sire, répliqua-t-elle, je n’ai personne derrière moi, laissez-moi agir, vous jugerez ensuite. ”
Saint-Germain, deux jours après, arriva en cachette
chez la malade. 11 se rendit compte, aux morsures de la langue, que la dame était atteinte du haut mal. Beaucoup de gens le considéraient, au xvnie siècle, comme un mal astral, presque toujours causé par le dégoût de l’âme à s’incarner dans un corps. De nos jours encore, cette thèse a été reprise fréquemment par certaines sectes, entre autres celle des Anthrbpo-sophes. D’après eux, la déception de l’esprit, vivant dans un bonheur éternel, à réintégrer la matérialité
du corps, se traduit par un choc spasmodique, réflexe de l’âme contre la volonté des esprits supérieurs qui
nous dirigent? Notre homme posa la main sur la tête de la malade, souleva le pouce et fit sur le pôle opposé de la boîte crânienne ùn semblable attouchement avec l’autre main.
11 prétendait à ce moment inje&er, par un effort de volonté, le fluide vivifiant d’un côté et, de l’autre, recueillir le fluide maléfique. Après cela, il recommença la même opération sur le ventre et sur le dos.
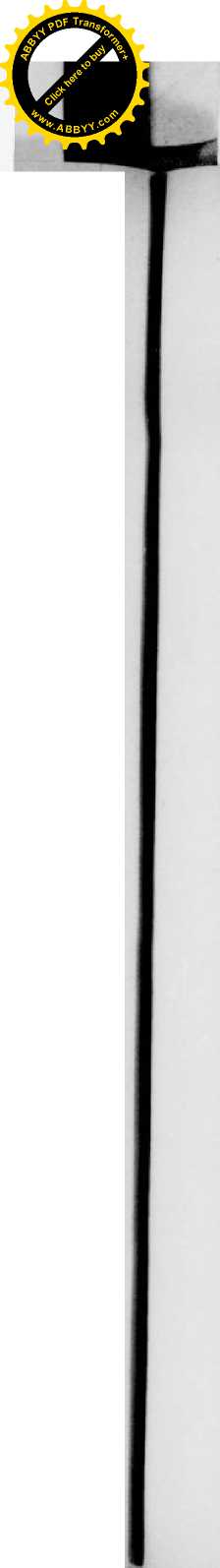
•riere
ffort Jtrc, órnelos.
i aux :rises evoir à ses
het te sures mal. iècle, >ar le : nos ment bpo-ivant ¡alité flexe J qui ir la pôle che-
Mme du Troussel s’étonna le lendemain de voir Saint-Germain couvert de blessures sanguinolentes.
“ Je suis rentré chez moi, madame, mais pas assez vite, car l’esprit du mal m’a traîné dans tous les coins de ma maison, où je me suis blessé contre les meubles. Je n’ai pu m’en débarrasser que ce matin en crachant dans une bouteille le venin que je vous avais pris. Je l’ai couvert de cendres et j’ai bouché avec de la cire l’extrémité du flacon. J’ai été ensuite l’enterrer dans un champ très profondément, pour que le soc de la charrue d’un honnête paysan ne puisse transmettre à un innocent l’effroyable maladie dont vous voici débarrassée1. ”
Mme du Troussel n’eut jamais plus, à partir de ce jour, aucune rechute, comme en témoigne 1’hiśtorien Zimmermann2.
Cette cure sensationnelle triompha du scepticisme de Frédéric et notre homme reçut ainsi, dans son courrier, une invitation à Pośtdam, contresignée par le roi.
Bien loin de l’accepter avec l’empressement que l’on pourrait croire, notre héros hésita un moment à y répondre. Mais, consultant son intérêt, et d’ailleurs orgueilleux de voir qu’un monarque comme celui-là
venait en quelque sorte à résipiscence, il se rendit au palais. L’entretien satisfit sans doute pleinement le roi de Prusse, car Saint-Germain ne fut plus considéré comme un aventurier, mais comme un thaumaturge de grande envergure. Frédéric eut-il recours à sa science? Rien ne peut nous permettre de le supposer. Les termes dans lesquels le souverain parla du comte à M. de Saint-Maurice, l’ambassadeur de France, prouvent, après cette reprise de contact, un abandon des préventions du roi à l’égard de l’alchi-miśte.
Frédéric II chercha dans le récit suivant un moyen de l’expliquer et de l’excuser et, pour un caractère aussi altier, excuser c’eSt défendre.
“ Je suppose, disait-il, qu’un homme vraiment particulier prenne la décision de se faire un deśtin extraordinaire et veuille jouer dans le monde un rôle capable d’étonner et de provoquer l’attention. Je suppose que cet homme, possédé uniquement de cette idée, a dû avoir de l’esprit, acquérir des connaissances, tenir présents à ses yeux tous les événements qu’il a traversés et montrer une grande persévérance dans la continuité de son plan. Je suppose qu’il ait su cacher ses intentions sous le voile d’un silence profond. Manquera-t-il, à l’occasion, d’esprit d’à-propos et de talent pour flatter? Admettons qu’il a ou hérité ou gagné une fortune importante, mettons
— 242 —

dit au ent le consi-luma-)urs à : sup-
ur de zt, un alchi-
noyen aétère
iment deśtin n rôle
nt de mais-Tients rance ’il ait s proropos a ou :ttons
20.000 francs de revenu. Comment se comportera un homme pareil? Il ne parlera ouvertement ni de son âge, ni de sa patrie, ni de sa famille, ni de sa propre personne; il s’enveloppera d’un nuage de secrets, mettra de côté ses revenus de quelques années, formant ainsi un capital qu’il confiera à des banques sûres et bien connues. S’il vit à Paris, il aura, par exemple, son argent à Leipzig. Une banque de Berlin recevra l’ordre de lui payer 20.000 francs ou plus. Il les retirera et les enverra alors à une banque de Hambourg qui lui fera un nouvel envoi. Il fera le même jeu avec quelques banques de Francfort et d’autres cités. Ce sera toujours le même capital sur lequel il aura perdu quelques pourcentages, mais l’homme atteindra son but. On apprend, chaque semaine, qu’il reçoit des sommes considérables de partout. Il dépense peu et ne s’occupe d’aucun commerce. Toutes les merveilles que l’on raconte sur les individus énigmatiques peuvent être expliquées ainsi. Mais cela ne m’empêche pas d’avoir pour ce psychologue de la nature humaine un restant de faiblesse que je ne saurais lui dire, mais qui me pousse à l’admirer1. ”
Quelle vi&oire pour Saint-Germain sur celui qui avait, vingt-cinq ans plus tôt, écrit à Voltaire :
i. Mémoires du comte de Saint-Maurice, ambassadeur de France.
“ 245

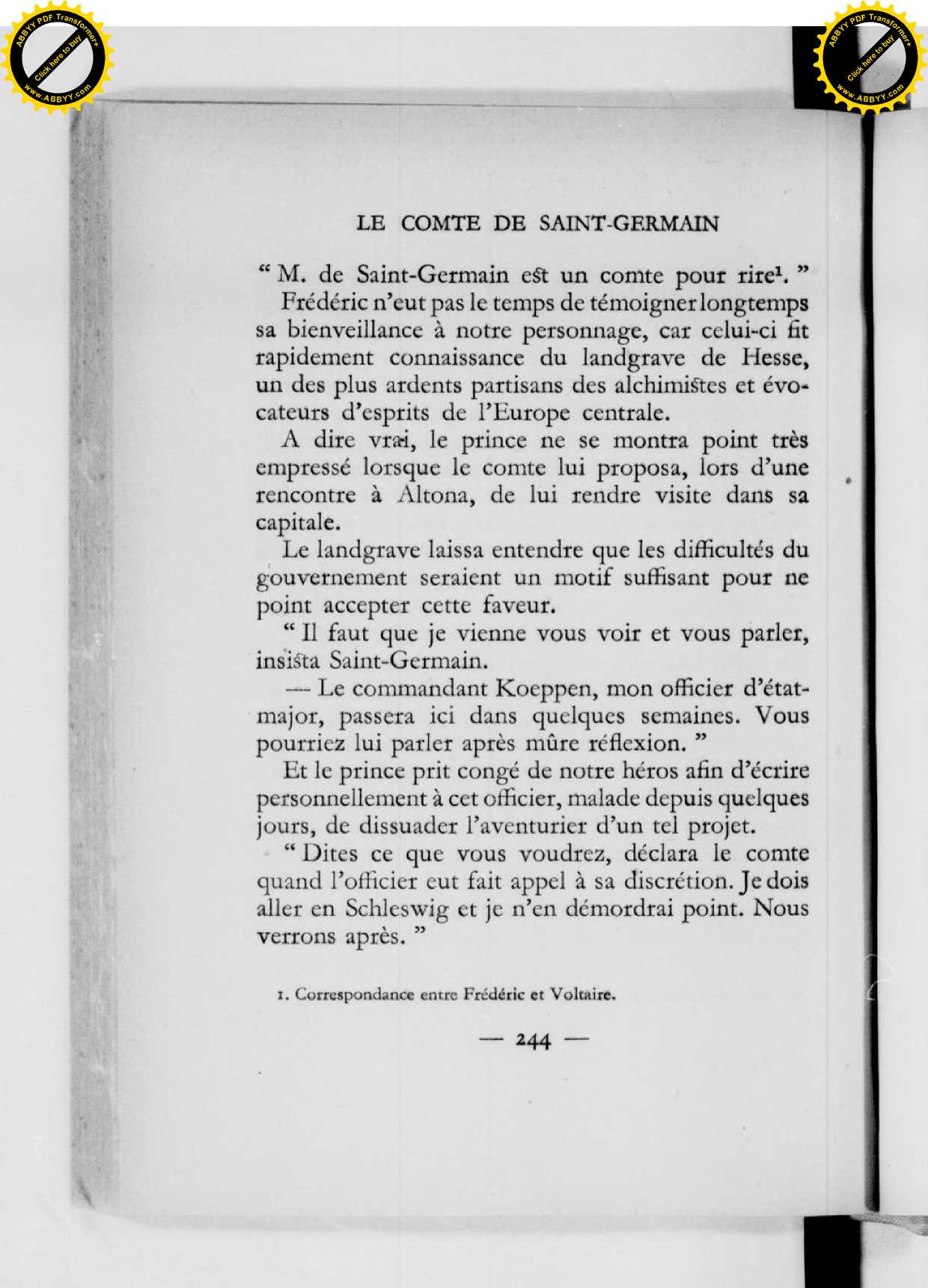
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
“ M. de Saint-Germain eśt un comte pour rire1. ” Frédéric n’eut pas le temps de témoigner longtemps sa bienveillance à notre personnage, car celui-ci fit rapidement connaissance du landgrave de liesse, un des plus ardents partisans des alchimistes et évocateurs d’esprits de l’Europe centrale.
A dire vrai, le prince ne se montra point très empressé lorsque le comte lui proposa, lors d’une rencontre à Altona, de lui rendre visite dans sa
Le landgrave laissa entendre que les difficultés du gouvernement seraient un motif suffisant pour ne point accepter cette faveur.
“ Il faut que je vienne vous voir et vous parler, insista Saint-Germain.
— Le commandant Koeppen, mon officier d’état-major, passera ici dans quelques semaines. Vous
Et le prince prit congé de notre héros afin d’écrire personnellement à cet officier, malade depuis quelques jours, de dissuader l’aventurier d’un tel projet.
“ Dites ce que vous voudrez, déclara le comte quand l’officier eut fait appel à sa discrétion. Je dois aller en Schleswig et je n’en démordrai point. Nous verrons après. ”
ce1, ”
emps ci fît
esse, évo*
très
l’une ♦
is sa
fs du
ir ne
irlcr,
’état-
Vous
crire
ques
□mte
dois
<ous

Le landgrave, colonel dans l’armée prussienne, avait pris auprès de ses collègues de nombreux renseignements sur cet homme peu ordinaire, et il s’en était longuement entretenu avec son ami d’enfance, le commandant Frankenberg.
“ Vous pouvez être convaincu, lui avait dit ce dernier, qu’il n’eśt pas un imposteur et qu’il a beaucoup de valeur. Nous fîmes connaissance à Dresde, lorsque j’y étais avec ma femme. La commandante voulait vendre une paire de boucles d’oreilles; un bijoutier lui en offrit une bagatelle : “ Voulez-vous me les confier?, qucśtionna-t-il. — Nous les lui confiâmes pour plusieurs jours et il nous les rendit après les avoir embellies. Le joaillier auquel ma femme les avait offertes, s’exclama en les voyant. “Voilà de belles pierres, clics sont différentes de celles que vous m’aviez montrées. C’eSt entendu, nous triplerons le prix, mais ce sera mon dernier mot1. ”
Convaincu, le landgrave ne fit plus d’opposition.
C’eSt vers la fin de 1779 que Saint-Germain arriva du Schleswig. Il parla au langrave de grands projets qu’il voulait réaliser pour le bien de l’humanité. Ces choses ne tentaient guère celui-ci, mais il se faisait scrupule de repousser par prétendue sagesse ou par avarice des promesses qui pouvaient être intércs-
santés à tous les égards. Bref, par curiosité, par faiblesse, par admiration sincère, on ne sait exadement, Charles de Hesse devint le disciple de notre héros.
Saint-Germain parlait encore de l’amélioration des couleurs, mais il ne semble pas avoir progressé dans cette voie les dernières années de son existence. Par contre, il ajoutait que le besoin social ne doit pas permettre de faire de l’or, même si l’on en possédait le moyen. N’avait-il pas pensé autrement, peu d’années auparavant? Il prétendait qu’un embellissement rationnel pouvait décupler la valeur des pierres précieuses.
En effet, “ il n’exiśte rien dans la nature qu’il ne soit possible d’améliorer ou de rendre utile1 ’” proclamait-il souvent. Un soir, notre homme se décida à entretenir son protecteur “ des premiers principes à l’aide desquels on aboutit à la révélation de la nature des choses ”. Cette définition est de Fr. Bulau et il le laissa chercher lui-même les moyens d’application par des expériences compliquées. On prétend que, loin d’être jaloux, 1’alchimiśte éprouvait une vive joie des progrès du prince, mais ce sentiment, si désintéressé soit-il, cadre trop peu avec le caractère du personnage pour être vraisemblable.
Le landgrave s’étonnait du savoir du thaumaturge
x. Mémoires de Charles de Hesse.

fai-ent, ros. des lans Par □er-t le lées lent très
l ne oronda ipes : la ilau
end une t, si tère
rge
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
au sujet des plantes médicinales, dont il se servait constamment et qui prolongeaient sa vie et sa santé.
Un médecin de Hesse, ancien apothicaire, auquel le duc donnait douze cents thalers par an pour préparer les médecines, prétendit que le thé curatif était une merveille. Les descriptions qu’en font les mémorialistes du temps nous font penser à une certaine variété commune du maté brésilien, utilisée souvent par les Indiens de l’Amazone. Nous ne citons ces faits que pour la documentation, mais nous ne pouvons nous empêcher de songer que le séjour de Saint-Germain à Mexico, relaté avec toutes les réserves d’usage dans un chapitre précédent, ne fut peut-être pas entièrement un mythe. Les riches recevaient cette infusion contre payement, mais les pauvres pouvaient s’en procurer sans bourse délier.
Le préparateur semble avoir considéré cette potion comme dangereuse pour les cardiaques.
“ C’eśt bien possible, répondit le landgrave, mais personne ne s’en plaint, permettez-moi de douter de votre conclusion. ”
L’activité du protégé de Charles ne se borna point à cela. Au bout de quelques mois de séjour, M. de Saint-Germain fut hanté du désir de fonder à Ecken-fórde une teinturerie. Cette cinquième édition de l’usine de Tournai fut mise en chantier pour donner cette fois, et dès le début, d’excellents résultats. Elle

survécut plus de trente ans à son fondateur. Le landgrave, qui n’habitait point l’hiver Eckcnforde, prétend n’avoir jamais visité cette fabrique, sans avoir appris quelque chose d’intéressant.
“ J’écrivais souvent les questions que je désirais poser. Saint-Germain les prenait une à une, lentement, et me répondait calmement : une fois, je le trouvai très malade et, à ce qu’il croyait, près de mourir. Il dépérissait à vue d’œil depuis une année et sa voix, devenue sourde, cherchait à s’exprimer sans bien y réussir. ”
Une recrudescence de sensibilité mouillait parfois son regard. Il élevait souvent vers le landgrave des yeux suppliants comme pour l’adjurer d’accepter des confidences et quand ce dernier s’approchait de lui, sa physionomie avait déjà repris le calme et la narquoise expression qu’on lui connaissait. Enfin, un jour, son visage perdit son impénétrabilité habituelle et il parut pour la première fois disposé à tout dire. 11 le fit d’ailleurs avec son éloquence coutumière, mais avec un élan auquel sa voix grave donnait une apparence de franchise extrême. Ce témoignage du Dr Kelemann correspond sur beaucoup de points avec le témoignage du landgrave.
“ 11 y a sur moi des siècles amoncelés. Je mourrai comme un autre, du moins en apparence, mais mon
nd-end pris
rais ent, ivai :. Il oix, ny
fois des des lui,
lar-un
ibi-out itu-ave
Ce sur nd-
rrai ion
esprit se résorbera dans le sein du Grand-Tout qui m’inspire. ”
Le landgrave chercha, par de bonnes paroles, à le soutenir et à lui faire abandonner ce déisme dans lequel se complaisait notre comte.
“ J’ai éludé les formes de la Nature par la puissance de mon zèle. Tout eśt Dieu et Dieu eśt tout. Je parle comme un homme qui va bientôt quitter cette terre. 11 ne faut pas plaindre ceux qui s’en vont, même si leur âme n’cśt pas pure. Tout la clarifiera par sa vue. La vie n’eśt qu’une antichambre d’attente. Les dernières minutes d’un homme sont parfois pénibles, mais cette pénitence ne dure point. Les âmes des morts s’envolent et Tout, seul, possède le pouvoir de les réincarner, car il eśt grand et fort; moi qui vous parle, mon cher ami, je rends grâce à ce Dieu. Demain, ce soir peut-être, je serai réincarné dans le corps d’un enfant. L’éternité, c’est un renouvellement de vies successives. Qu’un homme conserve de ses vies antérieures et il devient immortel. Je suis âgé en ce jour, je serai un enfant demain. Mais si vous tentez d’élever votre âme au-dessus des préoccupations matérielles, vous pouvez obtenir en une lueur des points de contaél avec des esprits aimés. Voilà le secret de l’occultisme; il eśt simple, aussi simple qu’il eśt vrai. Élever votre pensée au-dessus des malices terrestres, des intérêts trop vifs et vous toucherez l’éternité.


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Je vais quitter la Terre prochainement, car je sais que Dieu va me rappeler. Si vous le pouvez, parlez-moi, je vous répondrai. Il ne dépend point de moi de vous parler. Dieu permet parfois à l’esprit de quitter une seconde son enveloppe corporelle. C’eśt le sommeil ou la léthargie. N’en abusez jamais, car l’effort eśt considérable. ”
Le comte semblait suivre les désirs de son protecteur et y répondait sans que celui-ci eût articulé le moindre mot.
“ Vous doutez de l’existence de Satan. Il existe et il eśt puissant. Mais il eśt l’esprit du mal et il succombera. C’cSt à l’influence maléfique de Satan que l’homme doit d’exister comme il eśt. 11 a fallu ces deux courants, l’un bon, l’autre mauvais, pour faire votre ancêtre. Tout n’avait pas désiré l’homme. C’cśt la révolte de Satan qui a décidé de la création d’Adam. Ne le dites pas, car beaucoup d’hommes ne peuvent concevoir cette vérité. Ce secret, s’il était divulgué, ne pourrait être admis par l’orgueil humain. ”
Le landgrave s’approchait de plus en plus du visage de Saint-Germain.
“ Vous êtes fou, que dites-vous? ” s’exclamait Charles de Hesse.
Mais le souverain, en se penchant plus près du visage du malade, s’aperçut que notre héros était plongé dans un sommeil profond.

IJ le secoua sans rudesse.
“ Ainsi, repartit le comte, la vie jaillit par l’union des sexes. L’un cśt d’ordre diabolique, l’autre d’ordre divin. ”
Saint-Germain maintenant se réveillait complètement.
“ Je crois avoir rêvé quelque peu.
— Vous me faites beaucoup de peine. Pourquoi ne croyez-vous pas en Notre Seigneur Jćsus-Chriśt? Ces maudites loges vous perdront entièrement! ”
Mais déjà le témoin de cette scène, le Dr Kelemann, médecin de Hambourg en visite à Hesse, avait quitté la chambre du malade sans se faire remarquer. C’eSt grâce à lui et à scs descendants que nous avons pu reconstituer cette petite scène curieuse1.
D’heure en heure, Saint-Germain s’éteignait. Une vigoureuse santé lui avait permis d’éviter toutes les maladies, mais à cet instant elle s’affaiblissait visiblement. Dans sa chambre, placée au rez-de-chaussée, des rhumatismes douloureux, accrus par l’humidité du palais, l’enserraient comme dans un étau. Le lang-grave, à plusieurs reprises, lui avait dépêché son médecin personnel, mais en vain.
Un jour, Charles de Hesse dut quitter quelques mois Eckenfôrdc pour la cour de Naples. Saint-
i. Correspondance du Dr Kelemann, Leipzig.
— 2}I —
Germain déclara à son bienfaiteur son intention de faire remettre après sa mort un billet cacheté qui lui serait destiné. Ce testament dut tomber dans des mains infidèles, car il ne fut pas possible d’en trouver aucune trace. Il dit adieu au prince, le remercia de son accueil et conclut en scs termes :
“ Combien je serais malheureux, si j’osais parler avant d’être mort! ”
Malgré toute l’affe&ion qui unissait les deux hommes, le prince allemand quitta Hesse pour l’Italie. Il n’était plus inquiet de la dépression de son protégé, car une période de neurasthénie succédait généralement aux crises rhumatismales. Mais notre héros se jugeait maintenant avec perspicacité. Il avait senti l’aile d’une ombre frôler son front et, en voyant de sa fenêtre s’éloigner sur la route reétiligne la voiture de son dernier ami, il avait su qu’il ne le reverrait jamais plus sur cette terre.
Pendant quelques jours il agonisa doucement, sans douleur apparente, entre les bras des dames d’Eckenforde qui se relayaient à son chevet et lui apportaient des gâteries. Il les acceptait avec un hochement de tête gamin. Sa gorge semblait s’agiter pour murmurer un remerciement gouailleur qui ne dépassait pas ses lèvres. Lorsque les tressaillements de la fin le secouèrent, on appela le médecin.
Déjà, il ne pouvait plus parler.
— 252 —
:on
de lui des
ver

>m-lic.
roneros mti de
ure rait
^nt, nés lui
un iter
ne mts
“Mais par Dieu, dit celui-ci qui êtes-vous? ” Saint-Germain parut sourire.
“ Êtes-vous le fils de Rakoczy, le roi de Transylvanie? ”
Le visage demeurait immobile :
“ Dites-moi, qui êtes-vous? ”
Il eut un hoquet, dans lequel une dame de la cour crut entendre le mot supposé de Louis XV à Mme de Pompadour : “ Ceci doit partir avec nous. ”
Et il s’endormit pour toujours.
C’était le 27 février 1784. Le 2 mars, on transporta sa dépouille à l’église abbatiale d’Eckenforde, où elle repose dans la chapelle de Saint-Roch. Sur le registre de l’état civil de la bourgade, on peut déchiffrer en allemand quelques lignes émouvantes dans leur simplicité :
“ Celui qui se faisait passer pour le comte de Saint-Germain et de Welldone, et sur lequel on n’a point d’autre renseignements, a été enterré dans cette église1. ”
A son retour d’Italie, le landgrave manifesta un chagrin très violent de la disparition de son protégé. Comme nous l’avons dit, le secret de Saint-Germain que le comte avait promis de transmettre au prince
I. Der siebt te neuneu de Graf ion Saint~Gtrmain w:d Welldone weitere na-
chtrichten sind niebt beekaunt a orden in hiesiger Kirche stiH bergeset^.
— »H —

ne put être retrouvé. Le prince hérita de tous ses papiers, brouillons ébauchés et notamment d’un manuscrit relié de forme triangulaire, écrit sur du parchemin en caractères particuliers. Il avait pour titre “ La Magie sainte révélée ” et portait cette indication sybilline “ Mosé retrouvé dans un monument égyptien et conservé pieusement en Asie, sous la devise d’un dragon ailé ”. On a pu établir qu’il appartint quelques années à un M. Peltier. Sur une page de garde, ces mots étaient écrits à la plume, d’une main qui n’était pas celle de notre personnage : “ Ex dono sapientissimi comitis Saint-Germain qui orbem ternurum percurrit. ”
Nous aurions été heureux d’en donner un résumé succinct, mais l’historien GuStave Bord1, à qui nous empruntons le renseignement, ajoute qu’on a toujours ignoré le deśtin réservé à cette pièce par les descendants de M. Peltier,
Charles de Hesse crut bien faire en brûlant les papiers du comte, pour éviter qu’ils ne fussent mal interprétés. Cette initiative, didée par un sentiment de délicat attachement, eśt très regrettable pour l’histoire. D’autre part, l’incendie de l’Hôtel de Ville, en 1871, a consumé, comme on le sait, les quelques
T. Gustave Bord, Profils maçonniques. Hifloire Je la franc-maçonnerie au XV IH" siècle.
ur :te u-us
documents d’une commission réunie par Napoléon III, peu de temps avant la guerre, au sujet de notre héros. Il semble ainsi qu’un fatal deśtin s’eśt toujours opposé à ce qu’un peu de lumière fût faite sur cette physionomie attachante.
ne
ne
lui
me
)US ars cn-
les nal ent
Ile,
ues
■te au
‘ — 2J5

CONSIDERATIONS
SUR M. DE SAINT-GERMAIN
Une légende s’cśt constituée autour du mystère Saint-Germain. Elle s’eSt embellie après sa mort, ce qui eśt simplement normal, mais elle s’eSt encore développée de nos jours sous l’influence de l’éloignement. L’imagination populaire lui prête une prodigieuse longévité, réservée depuis la plus haute antiquité aux héros et aux prophètes. Son corps gisait depuis longtemps sous la dalle funéraire d’Eckenforde, que la croyance s’implantait dans de nombreuses âmes qu’il était toujours bien vivant et continuait, sous les formes les plus diverses, à mani-feśter sa bienfaisante aétivité. Adeptes et illuminés s’employaient de tout leur enthousiasme mystique à entretenir et à propager cette illusion, qui, au surplus, cadrait si bien avec leurs théories. Mais de tous les témoignages que nous avons étudiés, il n’en est peut-
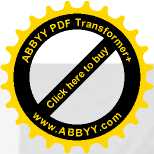
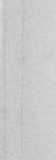

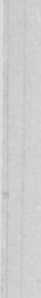
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
être pas de plus suggestif que celui de la comtesse d’Adhémar1. Son authenticité, souvent conSteStée au point de vue historique, n’en rcśte pas moins, comme les “ Souvenirs ” de Mme de Créquy, un indice très sûr de l’admiration religieuse que les contemporains vouèrent à Saint-Germain et constituent de ce fait un indice de la mentalité du xviii® siècle à son égard. Après la Révolution, tout ce qui touchait à la survivance du prestigieux surhomme trouvait un intérêt certain et, au xxe siècle, Claude Farrère a su nous raconter, d’après ces documents, une passionnante histoire où la vénération pour notre héros troublait la raison d’un homme jusqu’à le conduire au crime2.
La comtesse d’Adhémar, qui mourut en 1821, était une intime amie de la reine Marie-Antoinette. Elle avait tenu, suivant une mode séculaire, un journal des événements marquants de son existence, et, plus tard, elle aurait rédigé ses “ Mémoires ”, en y intercalant à l’occasion des remarques explicatives. Ces notes s’étendent de 1760 à 1821. On y trouve sur Saint-Germain des renseignements fort curieux, mêlés à des anachronismes fâcheux.


>m-'ent eśte de
eli~ int
: la
5 la
m ce
CCr-
LOUS ante tou-■ au
¿tait Elle I des ard, liant totes aint-es a
En 17881 une soubrette avertit un jour la comtesse de la présence de M. de Saint-Germain.
La surprise de la dame fut grande. Il y avait plus de vingt-huit ans qu’il avait quitté la France, et, dans notre pays, où l’on oublie vite, personne ne s’était inquiété, après la Révolution russe de 1762, de ce qu’il était devenu. N’écoutant que sa curiosité, elle ordonna à sa femme de chambre de le faire entrer.
Il s’appelait maintenant M. de Saint-Noël, et son visage s’était éloigné de son souvenir, mais elle déclara qu’elle le reconnaîtrait entre mille.
Le comte entra. 11 était encore jeune, avait bonne mine et paraissait rajeuni. Aux compliments de Mme d’Adhémar sur sa belle apparence, il répondit par une politesse de meme nature. “ Laquelle, ajoute avec mélancolie la dame, était très probablement moins sincère que la mienne. ”
La conversation s’engagea sur le défunt roi, mort depuis 1774.
“ — Vous avez perdu, dit Mme d’Adhémar, un ami et un protecteur dans le dernier monarque.
— Je regrette doublement cette perte, à la fois pour moi et pour la France.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
— La nation n’est pas de votre avis. Elle compte sur le nouveau règne pour assurer son bonheur.
— C’eSt une lourde erreur, car ce règne sera fatal au pays. ”
La comtesse se leva de son siège.
“ — Que dites-vous?
— La vérité.... Une gigantesque conjuration cśt formée. Elle n’a pas de chef avéré, mais ce dernier apparaîtra bientôt. Le but n’est rien autre que de renverser ce qui existe pour le rétablir sur un nouveau plan. Il y a de la mauvaise volonté de la part de la famille royale, du clergé, de la noblesse, de la magistrature. Il eśt encore temps d’étouffer le complot. Plus tard, ce sera impossible.
— Qui vous a dit cela?
— Je l’ai su en partie par mes deux oreilles et par le moyen de mes révélations. J’ai acquis cette conviction. Le roi de France, je le répète, n’a pas de temps à perdre. ”
La comtesse pria M. de Saint-Germain d’avertir le chancelier, M. de Maurepas1.
“ Il peut faire tout, mais ne sauvera point la France. Bien plus, c’eśt lui qui hâtera la ruine de ce beau pays. ”
M. de Saint-Noël proposa à Mme d’Adhémar de
i. Maurepas était mort en 1781. On peut supposer qu’il s’agissait de Lomé nie de Btieiint,

eśt nier
ren-reau e la “gis-)lot.
: par 1VÍC-
mpS
ertir
it la
le ce
ar de
sait dc
LE COMTE DE SAINT-GERMALv
parler à la reine des services qu’il avait rendus au gouvernement dans les missions politiques dont celui-ci l’avait chargé à plusieurs reprises. 11 déclara ainsi qu’il était prêt à révéler à la reine ce qu’il savait.
“ Ainsi votre gracieuse souveraine jugera s’il eśt bon de me faire entrer en présence du roi. Cependant, et cela eśt une condition essentielle, M. de Maurepas sera absent de tous nos entretiens. ”
La comtesse, subjuguée, écoutait maintenant AL de Saint-Noël avec attention. Il était, soit par la franc-maçonnerie, soit par les visites faites, très au courant de ce qui se tramait contre la France et contre la monarchie.
“ Réfléchissez à ma proposition, ajouta-t-il sans s’émouvoir. Je suis à Paris incognito. Ne parlez de moi à personne. Je vous serais très reconnaissant de venir remettre demain, à onze heures précises, la réponse de la reine dans l’église des Jacobins de la rue Saint-Honoré, ou je vous attendrai! ”
Mme d’Adhémar réfléchit tout l’après-midi à l’apparition étrange qui s’était révélée à ses yeux. Elle finit par se décider à présenter le comte de Saint-Germain, non sans éprouver la secrète terreur d’avoir été le jouet de son imagination et de ne trouver personne à l’église indiquée.
Aussi, quand elle arriva le jour suivant, éprouva

t-elle une vive joie à constater que l’homme était bien au rendez-vous. Il manifesta même une grande satisfaction quand il apprit sa présentation prochaine à la reine.
La comtesse lui demanda s’il allait se fixer à Paris; il répondit par la négative en faisant remarquer que ses projets ne lui permettaient pas de vivre plus longtemps en France.
“ Un siècle se passera, avant que je réapparaisse. ” L’aimable femme se rendit dans la soirée à Versailles pour parler à son amie. T .a reine, assise en face d’un charmant bureau de porcelaine, récent cadeau du roi, la reçut sans difficultés.
C’était le moment de s’expliquer.
La reine écouta le récit en souriant. Un tressaillement imperceptible l’agitait derrière scs mains qu’elle tenait jointes sur son front.
“ C’eśt étrange! j’ai reçu il y a deux jours un avertissement d’un mystérieux correspondant, dont je ne soupçonne même pas le nom; il m’a averti qu’une importante communication me serait faite et que je devrais la prendre en considération, sous peine des plus grands malheurs.
“ Quelque chose me dit qu’on doit avoir foi dans les paroles de AL de Saint-Noël!
“ Je vous autorise à m’amener demain à Versailles, habillé dans votre livrée, ce fantôme si prenant. Il

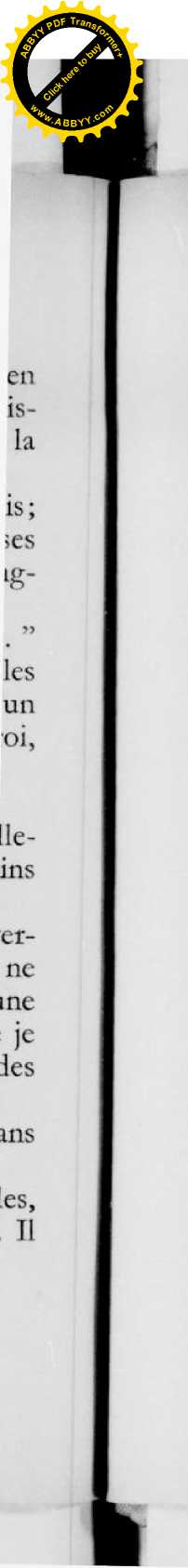
rcśtera dans vos appartements et aussitôt qu’il nous sera possible de l’admettre, je vous appellerai, car je ne veux l’écouter qu’en votre présence! ”
La reine le reçut le lendemain dans une chambre où sa protectrice l’avait précédé.
Après s’être incliné, notre héros déclara :
“ — Le parti encyclopédiste désire le pouvoir : il l’obtiendra par la chute absolue du clergé. Pour assurer ce résultat, il renversera la monarchie. 11 cherche à l’heure actuelle un chef parmi les membres de la famille royale et a jeté les yeux sur le duc de Chartres!
-— Le duc de Chartres?
— Lui-même! Deviendra-t-il 1’inśtrument d’hommes qui le sacrifieront, quand il trouvera l’échafaud au lieu du trône qu’il convoite. Avant ce jour de rétribution, quel crime, quelles cruautés! Les lois ne seront plus longtemps la protection des bons et la terreur des méchants; ce seront ces derniers qui, de leurs mains pleines de sang, saisiront le pouvoir. Ils aboliront la religion catholique, la noblesse, la magistrature.
— De sorte qu’il ne restera rien de la royauté, interrompit la reine avec impatience.
— Non! Pas même la royauté, mais une république avide, dont le sceptre sera le couteau de l’exécuteur. ”
Marie-Antoinette, émue par le ton d’assurance
— 263 —
de Saint-Noël, s’écria que ses oreilles n’étaient point habituées à semblables paroles.
“ — C’est dans la gravité des circonstances que j’ai trouvé cette hardiesse ripoSta froidement notre homme. Je ne suis pas venu avec l’intention de rendre à la reine des hommages dont elle doit être fatiguée, mais pour lui montrer les dangers qui menacent sa couronne, si de promptes mesures ne sont pas prises pour les éloigner.
— Vous êtes positif, monsieur.
— Je dis à l’heure actuelle la vérité, dit Saint-Noël en se tournant vers Mme d’Adhémar et vers la reine. Votre Majeśtć me permettra de lui rappeler, à mon tour, que Cassandrc avait prédit la fin de Troie. Plusieurs années passeront encore dans un calme trompeur, puis les hommes, conduits par l’envie, se tourneront vers la couronne royale. Alors on regrettera de ne pas m’avoir écouté : peut-être me demandera-t-on ce qu’il faut faire, mais le temps aura passé et je ne pourrai plus rien. ”
La reine réfléchit un instant. Lile demanda à Saint-Noël de rapporter cet entretien à Sa Majcśtć.
“ — La confiance du feu roi vous a honoré. Nous ne l’ignorons point et nous ne voulons pas la démentir.
— A vos ordres, madame, mais, je vous supplie, hors dc M. de Maurepas. Je le range, en effet, parmi
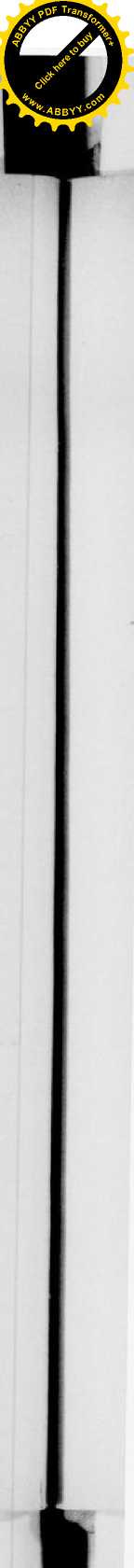
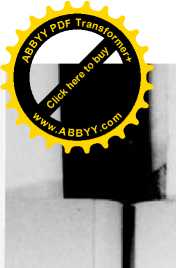
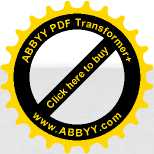
int
í’ai tre de tre aa-)nt
oël ne. ion )ic. me
se •ct-an-ssé
nt-
• ré. ; la
Lie, ■mi
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN ceux qui contribueront à la ruine du royaume, non par malice, mais par incapacité.
— Vous êtes sévère.
— Certes, mais je ne suis point courtisan. J’ai vu la chancelier contribuer à saper votre couronne, et je le dis.
— Monsieur, dit la reine, qui à cette époque1 ne pouvait traiter aucun sujet sérieux, ou êtes-vous né?
— A Jérusalem. Mais que Votre Majeśtć me pardonne d’avoir une faiblesse commune à beaucoup de personnes. Je n’aime pas dire mon âge, car cela porte malheur. ”
M. de Saint-Noël partit aussitôt qu’il se fut débarrassé de la livrée revêtue. Quelques jours après, Louis XVI s’approcha de la comtesse et lui dit, en secret, que le collaborateur du feu roi avait tort de croire au ressentiment dc M. de Maurcpas.
Dans la même soirée, le ministre s’apprêtait à prendre congé de la reine et s’exclamait contre l’impudence de certains magiciens éhontés, quand son attention fut détournée par un bruit de porte qui s’ouvrait.

M. de Saint-Noël, sans que l’on pût savoir d’où il venait, se rendit dire&emcnt vers l’homme d’Etat, esquissa, un inśtant, un geste de violence, comme s’il allait le souffleter, mais domina sa colère et prononça d’un trait devant le Premier :
“ Maurepas, le roi vous a sommé de lui donner un bon avis et vous ne pensez qu'à maintenir votre autorité en vous opposant à ce que je puisse voir votre maître : vous discréditez la monarchie. Je n’ai qu’un temps limité à donner à la France. Le temps écoulé, je n’apparaîtrai plus, de trois générations successives. J’ai dit à la reine ce qu’il m’était permis de lui dire; mes révélations au roi auraient été plus complètes. Vous êtes intervenu entre Sa Majeśtć et moi. Je n’aurai rien à me reprocher quand l’horrible anarchie dévastera la France entière. Ces calamités, vous ne les verrez pas, mais votre mémoire souffrira du mal que vous avez préparé. N’attendez point un jugement favorable de la postérité. Vous serez rangé parmi ceux qui font la ruine des empires. ”
Ayant ainsi parlé sans reprendre haleine, l’homme revint vers la porte, la ferma et disparut. Tous les efforts faits pour retrouver le comte furent inutiles....
Un an environ après ces faits, Marie-Antoinette montra à Mme d’Adhémar une épître en vers de son correspondant mystérieux. C’était une sorte de pré-diftion terrible “ qui, depuis, eśt devenue trop claire ”.
— 266 —


•ù il itat, imc □ro-
Hier otrę voir n’ai mps ions mais plus té et cible lites, Frira t un ^gé
nmc
5 les ïs,«. lette son prête ”,
La voici reproduite comme la comtesse prétend l’avoir copiée sur le manuscrit adressé à la reine :
Les temps vont arriver où la France imprudente Parvenue aux malheurs qu’elle eût pu éviter Rappellera l’Enfer tel que l’a peint le Dante! Reine, ce jour eśt proche, il n’en faut plus douter! Une hydre lâche et vile, en scs orbes immenses Enlèvera le Trône et l’Autel, et Thémis.
Au lieu du sens commun d’incroyables démences Régneront. Aux méchants, lors, tout sera permis. Oui. L’on verra tomber sceptre, encensoir, balance, Les tours, les écussons et jusqu’aux blancs drapeaux. Ce sera désormais vols, meurtres, violences Que nous retrouverons au lieu d’un doux repos. De longs fleuves de sang coulent dans chaque ville; Je n'entends que sanglots, je ne vois que proscrits. Partout gronde en fureur la discorde civile Et partout la vertu fuit, en poussant des cris. Du sein d’une assemblée, un vœu de mort s’élève. Grands Dieux! Qui va répondre à des juges bourreaux? Sur quels augustes fronts, vois-je tomber le Glaive! Quels monśtres sont traités à l’égal des héros! Oppresseurs, opprimés, vainqueurs, vaincus, l’orage Vous atteint tour à tour dans ce commun naufrage; Que de crimes, de maux et d’affreux attentats Menacent les sujets comme les potentats!
Plus d’un usurpateur en triomphe commande, Plus d’un cœur entraîné s'humilie et s’amende. Enfin fermant l’abîme et né d'un noir tombeau, Grandit un jeune lys, plus heureux et plus beau!
Toute la Révolution et peut-être l’Empire semblaient être prophétisés. Le jeune lys était-il l’empereur Napoléon? Cela eśt admissible, car l’expression
— 267 —


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
eśt, sans cloute, prise dans le sens primitif et veut désigner l’emblème d’une autorité Stable.
Outre la visite de Saint-Germain à Versailles, les
rapports assez étranges de police permettent de retrouver M. de Saint-Germain à Vienne, à la fin de
1789 et peut-être de 1790. Ce ne sont pas des documents authentiques, mais la mention de certains bruits qui défrayèrent la chronique de la cour d’Autriche.
Vienne, comme toute l’Europe centrale, était, à l’époque de la Révolution française, un grand centre pour les Rose-Croix et autres sociétés du même modèle, telles que les Frères Asiatiques et les Chevaliers de la Lumière.
Beaucoup d’entre eux s’occupaient très sérieusement d’alchimie et avaient leur laboratoire dans la Landstrasse, derrière l’Hôpital. Parmi eux se trouvaient les disciples de Saint-Germain. On se souviendra de la réponse de ce dernier faite à Louis XV qui le questionnait au sujet de la mort du procureur Dumas.
Si Votre Majesté l’ignore, qu’elle se fasse Rose-
Franz Graëffer, un occultiste peu connu, nous a laissé un singulier récit d’un voyage en Autriche du comte fantôme1. Le seul reproche que l’on puisse
1. Franz Graëffer, H'xwi und Saint-Germain.
--ZÓ8 --
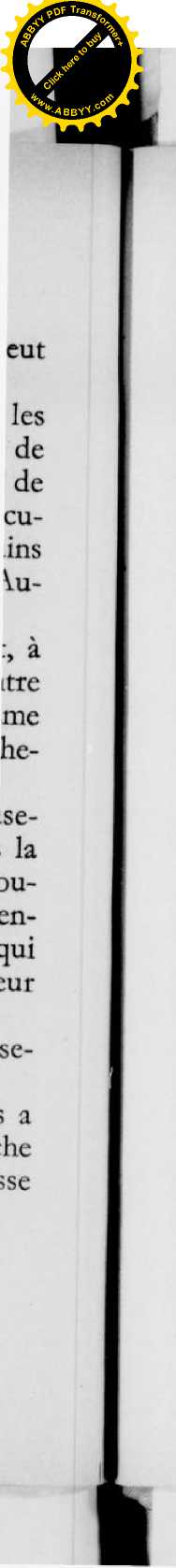
faire c’est qu’il ait été écrit longtemps après que l’auteur fût témoin de la scène racontée. Certes, le souvenir de ce Gracffer, simple initié, montre l’admiration que témoignaient à notre héros les occultistes de l’époque. En voici un court résumé :
“ Le bruit court à Vienne que l’énigmatique Saint-Germain cśt en notre cité. Le frère de l’auteur, Rodolphe, à peine remis de cette surprenante nouvelle, courut à sa maison de campagne de Humberg, où il avait ses affaires et se munit d’une lettre de recommandation, adressée à 1’alchimiśte par Casanova.
“ Saint-Germain, qu’il ne connaissait nullement, lui fit dire à son bureau par un express.
“ Je suis à Fédalhofe, dans la chambre où logeait Leibnitz en 1715. ”
“ Rodolphe y courut avec le baron de Linden, un ami personnel. On ouvrit le laboratoire. Saint-Germain était assis à une table et lisait un ouvrage de Paracelse. La description qu’avait faite de lui le commis n’était que l’ombre de la réalité. Une splendeur brillante semblait envelopper le comte qui marchait vers eux.
“Je savais que vous seriez là, tous deux, à cette “ heure-ci. La lettre de Seingalt cśt inutile. Mais “ vous avez une autre lettre de Brühl. On ne pourra “ sauver ce peintre, car son poumon eśt détruit.
— 269 —
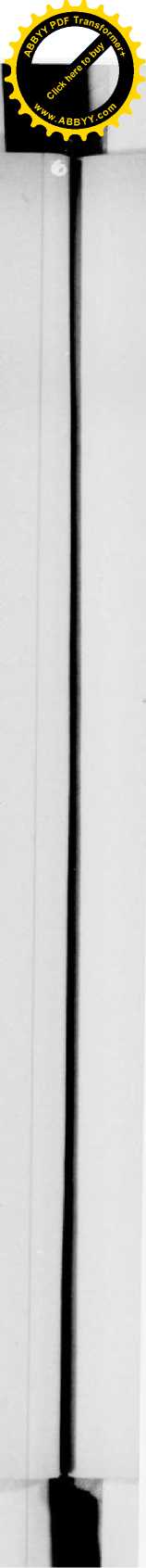
“ Un homme qui n’eśt encore qu’un enfant, nommé “ Bonaparte, sera la cause indirede de sa mort. ”
“ Saint-Germain devint alors rigide comme une statue, et, pendant quelques secondes, ses yeux, toujours expressifs, devinrent ternes et sans couleur. Puis tout son être se ranima.
“ Je vous quitte. Ne venez pas me voir. Je vous “apparaîtrai une fois encore, je pars demain; on a “ grand besoin de moi à Constantinople. J’irai ensuite “ en Angleterre, pour y préparer deux inventions “ que vous aurez au siècle prochain, les trains et les “ bateaux à vapeur. 11 faut, comme moi, avoir étudié “ dans les Pyramides pour faire de semblables choses.
cc
te
Je disparaîtrai de l’Europe, vers la fin du siècle, et je me rendrai dans la région des Himalayas. Je me reposerai. On me reverra dans quatre-vingt-
“ cinq ans, jour pour jour. ”
Quatre-vingt-cinq ans plus tard, en 1875, à la date prédite, eut lieu la fondation de la société théoso-phique qui s’inspire des principes de notre héros. N’y a-t-il là qu’une coïncidence?
Naturellement, nous nous défendons, en rapportant ces faits curieux, de porter foi à ces témoignages, qu’ils viennent de la comtesse d’Adhémar ou de Franz Gractfcr. La croyance à la survie de Saint-Germain eśt au xvine et au commencement du siècle suivant un fait qui ne peut être nié. L’homme, pen-

tmé t. * une ou-mr.
ous n a lite ons les idié ses. cle, yas. igt-
late
>so-ros.
>or-^cs, de
rer-;cle
en-
LE COMTE DE SAINT GERMAIN dant son existence, prépara sa résurrection sous le couvert d’un mvStcre épais et l’imagination de ses contemporains fit le reśte.
De nos jours, par exemple, la légende d’un Saint-Germain, vivant prote&eur de la France, hante certaines écoles d’occultisme, tant est puissant le prestige du comte.
Aux yeux de l’historien moderne, pour qui le surnaturel doit être rigoureusement banni des choses humaines, la physionomie de notre héros ne peut s’entourer de ce halo de mystère. Mais la difficulté commence lorsqu’il s’agit d’en préciser les traits et d’en découvrir, à travers les hâbleries et les déformations, une vérité même approximative.
Plusieurs faits sont hors de doute. Le personnage était, sinon de naissance princière, du moins d’une haute origine. Nous ne saurions accepter d’une autre manière l’intimité du roi Louis XV avec un aventurier inconnu. Les nobles façons du comte, sa courtoisie sont autant de présomptions, sinon de preuves de sa race. Il tranche sur la vulgarité d’un Cagliośtro ou la morgue prétentieuse d’un Casanova. Saint-Germain avait, en outre, de brillantes qualités de causeur, mais encore eśt-il nécessaire de faire observer que ce talent était employé dans des conversations qui prouvaient une culture intellectuelle très développée. Tous les témoignages sont
— 271 —



LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
unanimes à ce sujet. Qui pourrait en douter? Ne fréquentait-il point, dans les salons de Versailles, les courtisans français et étrangers les plus spirituels du monde entier?
Les avis sont, il eSt vrai, extrêmement différents en ce qui concerne son rôle et sa valeur.
Fut-il un simple aventurier qui se servit de dons personnels particulièrement brillants pour profiter de la curiosité et de la crédulité publiques? Etait-il un cabotin jouant un nouveau personnage avec une assurance pleine de cynisme, dont le but était de faire accueillir tous ses gestes par un public fanatisé, ou au contraire n’entrc-t-il point quelque sincérité dans l’attitude qu’il s’imposait?
L’âme humaine eśt chose si complexe qu’il eSt bien difficile de résoudre ce problème avec netteté.
A notre avis, Saint-Germain serait le descendant d’une assez grande famille. Ne pouvant vivre suivant son rang et ses goûts héréditaires avec les ressources dont il disposait, il se serait résolu à mettre à contribution l’extraordinaire engouement que son siècle portait pour tout ce qui était merveilleux et surnaturel.
Il l’aurait fait avec d’autant moins de scrupules que lui-même partageait ces tendances dans une certaine mesure.
Les personnages les plus élevés en dignité, princes,

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

Ne , les : du
ents
ions fiter iit-il une aire
> ou dans
bien
dant vant irccs ntri-iècle irna-
>ules une
aces,
ducs, ministres, les femmes, ne pouvaient se défendre de l’attrait qu’exerçait sur eux l’inconnu de l’Univers. Que de noms nous pourrions citer. Le duc d’Orléans, le prince de Bouillon, le comte de Bou-lainvillicrs, le duc de Richelieu,croyaient à l’alchimie, à la magie et recherchaient avec plus ou moins de persévérance la pierre philosophale.
Les “ Mémoires de Casanova ” nous montrent comment un habile impośteur arrivait à s’emparer de l’esprit des sénateurs vénitiens, de gros marchands d’Amśtcrdam et d’authentiques marquises.
Saint-Germain a dû étudier pendant sa jeunesse tous les livres traitant de l’occultisme, dont les éditions, depuis le xvn® siècle, ne cessaient de se déverser sur le marché.
L’une des croyances les mieux accréditées à cette époque était celle de la réincarnation, et l’on sait les expériences à la fois grotesques et navrantes auxquelles se soumit la marquise d’Urfé pour arriver à tromper la mort.
On eśt alors moins surpris du flegme avec lequel Saint-Germain parlait de sa longévité. 11 pouvait très bien se faire que, sans y croire réellement d’ailleurs, ses paroles narquoises à Gleichen sur les Parisiens le prouvent, il ait pu, dans le cercle de ses admirateurs, subir l’influence de leurs désirs et arriver, par une sorte d’auto-suggeśtion, à entraîner sa propre
conviction. C’cśt là un phénomène bien connu surtout des orateurs : il s’établit entre une personne qui parle et son public une sorte de circuit quasi-magnétique, par lequel le courant passe de l’orateur à son public et lui revient amplifié de.toutes les vibrations de ceux qui l’entendent.
Qu’il y ait eu dans le cadre de Saint-Germain une part de charlatanisme, ceci ne nous paraît pas devoir être mis en doute! Mais cette mystification a été, croyons-nous, au moins involontaire. Ce n’cSt pas uniquement par calcul que le comte eśt arrivé à tenir certains propos extravagants qu’on lui attribue. 11 a subi en cela l’influence de ses leètures et celle plus grande encore d’un public qui demandait à être convaincu.
En tout cas, Saint-Germain n’a pas tenu absolument ce personnage dans un dessein lucratif.
Des son apparition sur la scène du monde politique, il disposait — tous les témoignages en font foi — de richesses assez importantes qui lui permettaient d’étaler un luxe de grand seigneur. Leur origine, cadeaux de nabab, héritages, salaires de son activité industrielle ou politique, nous eśt inconnue. Elles lui servirent seulement de publicité, de “ poudre aux yeux ” et, comme on l’a vu dans les derniers temps de sa vie, elles finirent par s’épuiser, preuve qu’il n’a point songé à monnayer son immense prcśtige.
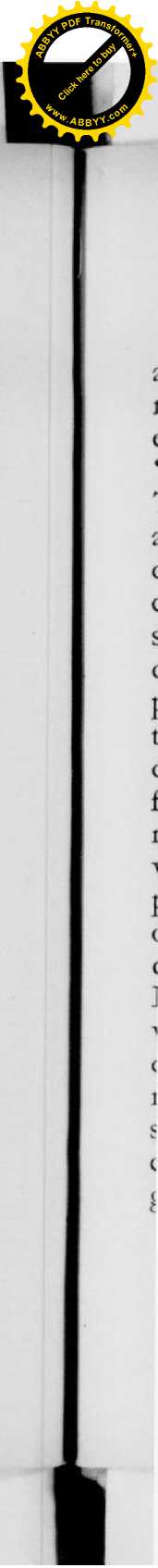
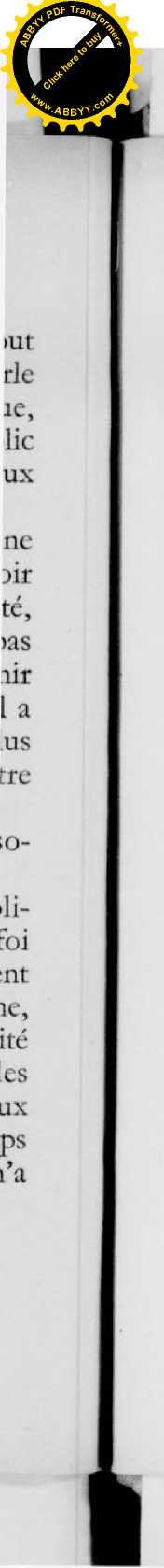
La cupidité ne saurait donc être comptée, à notre avis, parmi les défauts de Saint-Germain. Mais nous n’en dirons pas de même de la vanité. Ce fut là, en effet, le trait dominant ou comme dit Taine, le “ ressort ” principal de son organisme psychique. Tout le révèle dans son attitude, scs manières, ses actes, scs propos. Il se couvre de bijoux, il fait étalage de ses brillantes relations, il montre une décision tranchante qui témoigne de la flatteuse opinion qu’il a de ses mérites. L’admiration extasiée du public ne fait d’ailleurs que développer en lui cette fâcheuse propension. Ainsi les revers sont-ils impuissants à l’abattre : en Hesse ou à Versailles, il se montre aussi sûr de lui, aussi condescendant, aussi prote&eur. Faut-il faire entrer dans cette vanité la bienveillance indéniable dont il fit toujours preuve à l’égard des pauvres et des déshérités? Nous ne le croyons pas! 11 se peut que sa conduite vis-à-vis d’eux ait été un peu ostentatoire, mais ce n’cSt pas une raison pour douter chez lui d’un mouvement sincère de générosité! Il faut le dire à l’avantage du xvnie siècle, trop souvent et trop injustement décrié pour sa sécheresse de cœur, la bienveillance n’était pas seulement une mode : chez beaucoup de favorisés du sort, elle puisait scs sources dans la compréhension de la misère qu’alimentait, à défaut de la foi perdue, la propagande occultiste. Pour quelle raison ne pas admettre
— 275 —
i»
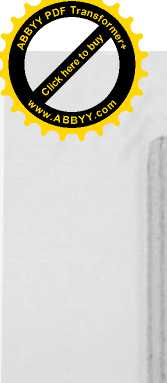

Saint-Germain au bénéfice de cette constatation?
D’autre part, il nous paraît plus difficile de préciser l’étendue de scs connaissances. 11 avait certainement beaucoup lu et, d’après certains documents, il aurait reçu, grâce à la libéralité du dernier des Médicis, une instruction très étendue, notamment en ce qui concerne l’alchimie, car la chimie ne devait être constituée en science digne de ce nom que par Lavoisier. 11 crut, un moment, avoir percé le secret de la transmutation des métaux, mais il reconnut plus tard son erreur et mit en garde contre de telles recherches ceux qui s’adressaient à lui. Fit-il des diamants? La chose cSt peu probable et certains de ses contemporains, pourtant bien disposés pour lui, ne lui accordent que d’avoir trouvé le moyen, en les soumettant à des manipulations mystérieuses, d’enlever aux pierres les taches qui les dépréciaient. J .es réactifs spéciaux qu’il avait inventés pour la teinture des étoffes et le travail des cuirs lui occasionnèrent plus de déboires qu’ils ne lui apportèrent de satisfaèfions. Mais on peut se demander si M. de Saint-Germain avait toutes les qualités requises pour faire un bon administrateur. Rien ne paraît moins sûr. N’abandonnait-il point rapidement scs entreprises, quitte à revenir quand la versatilité de son cerveau, toujours en état d’aétivité fébrile, le reportait vers ses travaux délaissés. En tout cas, si l’on ajoute à ses opérations de la
— 276 —

ion? :iser nent irait licis, qui nśti-sicr. •ans-
son ches ? La npo-:cor-ttant stres :iaux et le lires 5 on •utes śtra-ait-il 'cnir état lais-e la-
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
boratoirc l’intérêt qu’il manifesta aussi à certaines questions de mécanique, plans de bateaux, essais sur l’utilisation de la vapeur, machine pour curer les cours d’eau, ses connaissances indiscutables en médecine, histoire et géographie, on ne peut nier qu’il ait eu une organisation cérébrale des plus remarquables et que, s’il a dispersé ses dons intellectuels sur trop d’objets, il y aurait injustice à ne voir en lui qu’un “ touche à tout ” sans génie.
Là où le jugement ne saurait lui être favorable, c’eSt en ce qui concerne scs prétentions philosophiques. Son système, s’il en a un et s’il n’a pas pris de pâles rêveries pour une révélation de l’énigme cosmique, eSt assez inconsistant et se ramène à une sorte de panthéisme faisant de tous les êtres autant de modalités éphémères de l’éternelle substance, du Grand Tout.
Sa conversation avec le landgrave de Hesse eSt ce qui nous reste de plus net sur ses idées touchant la nature et l’homme, et l’on a pu se rendre compte combien elles étaient vagues et un tantinet naïves. Cette impression sera encore renforcée par la lecture du sonnet suivant attribué à Saint-Germain1 :
Curieux scrutateur de la nature entière,
) 'ai connu du Grand Tout le principe et la hn. J’ai vu l’or en puissance au fond de la minière J’ai compris sa matière et saisi son levain.
J’expliquai par quel art, l’âme aux flancs d’une mère Fait sa maison, l’emporte et comment un pépin Mis comme un grain de blé sous l’humide poussière. L’un plante et l’autre cep, sont le pain et le vin.
Rien n’était. Dieu voulut, rien devint quelque chose. J’en doutais, je cherchai sur quoi l’univers pose, Rien gardait l’équilibre et servait de soutien.
Enfin avec le poids de l’éloge et du blâme Je posai l’éternel, il appela mon âme, je mourus, j’adorai, je ne savais plus rien!

Singulière époque que celle où des propos aussi incohérents revêtaient une allure de “ message ” et étaient accueillis avec ferveur par de prétendus
Cependant cc “ message ” et ces dernières conversations entre Saint-Germain et le landgrave ne sont pas à dédaigner. En effet, le ton de ces documents est assez révélateur de la position tenue par Saint-Germain à l’égard des sedes et des sociétés secrètes qui pullulèrent en Europe dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Dans son ouvrage si impartial et si fortement documenté, M. Aug. Viattc cite une multitude de faits touchant l’engouement de cette époque, considérée trop souvent comme foncièrement rationaliste, pour tout ce qui eśt mystère, pour tout cc qui permet une explication des énigmes d’ici-bas et de
— 278 —

1SSÍ ;e ” dus refont *nts int-btes du t si ilti-[ue, tio-qui de
l’autre monde1. L’Angleterre et l’Allemagne apparaissent à cette époque comme les patries d’élection des alchimiśtes, des mages, des théosophes de tout acabit. On compte, en 1789, une trentaine de princes illuminés et les adeptes titrés sont légion. On aurait peine à le croire, si le fait n’était avéré : le fils de Frédéric II, Frédéric-Guillaume, assistait à des séances de magie et ne gouvernait que par le moyen des initiés. Ferdinand de Brunswick et Charles de I lesse étaient d’éminents Rose-Croix. La princesse Marie de Wurtemberg, épouse du tsar Paul, portait “ l’illuminisme sur le trône de Russie ”. En France, on a soupçonné M. le comte de Provence, le futur Louis XVIII, d’avoir évoqué le diable et lu dans le miroir magique son avènement.
Si l’on en croit d’Allonville, Philippe-Égalité aurait eu, pour sa part, commerce avec des fantômes. Dans une telle ambiance, un homme à la forte personnalité comme Saint-Germain devait réussir, et son succès devait être singulièrement facilité s’il était, comme la chose nous paraît indubitable, maçon et membre d’une secte mystérieuse.
Notre héros avait reçu la quatrième initiation et, en 1776, il avait été désigné comme membre de la loge Strasbourgeoise “ La Candeur ”. Cependant,
1. Aug. Viatte, Les Sources occultes du romantisme.
— 279 —
il ne cachait point son indifférence totale à l’égard de l’activité maçonnique et les francs-maçons qui, en 1778, enquêtèrent à son sujet, furent unanimes à déclarer au prince Frédéric de Brunswick, lui aussi Rose-Croix, “ qu’il n’était pas des leurs ”. L’un d’eux s’avançait même jusqu’à dire qu’il n’était ni mage ni théo-sophe. Un autre, au contraire, sortait bouleversé d’un entretien avec le comte et, n’en voulant point confier le contenu au papier, s’empressait de se rendre auprès de Brunswick pour le mettre au courant des “ secrets étonnants ” de Saint-Germain et dont l’origine paraissait mystérieuse.
Le véritable sens peut, croyons-nous, en être percé. Panthéiste, matérialiste, notre héros ne saurait être rangé, à prime abord, parmi les illuminés qui étaient, avant tout, des mystiques. Certes, il se rapprochait d’eux par certaines idées et par la pratique de multiples opérations. Dans ses “ Mémoires authentiques pour servir à 1’hiStoire dc Cagliostro ” parus en 1785, un an après la mort visible de Saint-Germain, un contemporain dilettante et initié1 affirme que Cagliostro aurait été l’élève de Saint-Germain qui l’avait reçu en Silésie, d’autres disent en Holstein, et lui aurait révélé les secrets pour la conjuration des esprits. Nous savons que l’on tient d’ordinaire cet ouvrage,
1. Le marquis DE Luchet, .Mémoires authentiques.
( I C e 1 c
— 280 —
e n L-
ainsi que “ L’Essai sur les illuminés ” pour de haineux pamphlets, animés du parti pris le plus hośtile contre les sociétés secrètes. Déjà, lorsqu’il en rendait compte
dans la Correspondance littéraire, Grimm les accusait
1)-n :r is ts
5-
de renfermer maintes anecdotes fausses ou témérairement avancées. Cependant ces ouvrages ne méritent pas l’oubli total qui paraît de nos jours les entourer. Les historiens les plus hostiles ne manquent pas d’y puiser maints renseignements utiles. Aussi les allégations de Luchet peuvent donner sur notre personnage des témoignages intéressants, puisés à des sour-
ces différentes.
Un fait, maintenant reconnu, n’eSt-il pas particu
lièrement curieux : la sollicitude témoignée par Charles de Hesse à Saint-Germain? Une telle conduite serait inexplicable à cause des divergences qui séparaient les deux hommes sur les questions religieuses, si l’on ne pouvait découvrir un terrain d’entente sur
lequel leurs esprits pouvaient se rencontrer et collaborer. Précisément c’eSt ce terrain que M. Aug. Viatte va nous faire connaître dans les “ Sources occultes du Romantisme ”. Alchimiste, chercheur d’or, myâtique enthousiaste, le souverain donnait aussi dans la magie et, par des rites spéciaux, évoquait les esprits célcStes. Il convertit à ses visions le fameux Lavatcr, et celui-ci nous a laissé un curieux détail des séances étranges dans une loge où pontifiait le

landgrave : manifestation de phénomènes bizarres, apparition de lumière phosphorescente, conversation avec le Seigneur, qui répond oui ou non au moyen d’un “ signe visible, conique, brillant ”, évocations de fantômes et autres choses. Charles de liesse croit, en outre, à la métempsycose. Pour lui, tous les hommes vivants ont déjà supporté sous plusieurs formes une existence antérieure. Scs disciples professent la meme foi et Lavater apprend à son grand étonnerrtent qu’il fut “ Le roi Josias ” dans l’Ancien Testament, Joseph d’Arimathic dans le Nouveau et Zwingli en dernier lieu. Sa femme a été anciennement épouse de Ponce-Pilate. Catherine de Médicis s’eśt incarné dans Anne d’Autriche et Marie-Antoinette. Enfin Hesse et les visionnaires qu’il groupe vivent dans la persuasion qu’il existe encore sur la terre quelques hommes très élevés, très éclairés, qui reçoivent du Seigneur des réponses et des révélations “ plus précises, plus explicites, plus claires, plus complètes ”.
Etant donné ces idées, on peut admettre la protection du landgrave pour Saint-Germain sous une condition : l’affiliation de ce dernier à une se&e se rapprochant par certains côtés des illuminés de Hesse. Cette secte, nous croyons pouvoir la désigner, c’est celle des Rose-Croix.
Elle était, avant tout, une association d’idéologues, de philosophes, mais aussi de chercheurs, ou, comme
— 282 ■—
:es, ion
/en 3ns oit, les
urs •ro-ind :ien i et tent ,’eśt :tte. [ans [UCS du prés tec-une e sc *ssc. c’cSt
;ues, lime
on disait au xviii® siècle, d’alchimiśtcs. Suivant certains, les adeptes auraient été pénétrés des enseignements des Brahmanes indous, mais les influences des cultes méditerranéens les plus disparates, par exemple celles des Égyptiens, des Eumolpides d’Eleusis, des Gymnosophites d’Ethiopie et surtout des élèves des Pythagoriciens et des Arabes auraient été prépondérantes sur leur évolution.
D’après Spencer Lewis, le chef de la “ Rosa Crucis ”, société américaine secrète, le fondateur véritable aurait été le pharaon Thotmès III. Nous avons lieu de penser, cependant, que l’illuminé américain, adoptant plusieurs règles encore en vigueur, a dirigé une loge dissidente qui n’a reconnu que certains principes fondamentaux du roi d’Égypte.
Le fondateur réel de l’ordre fut Christian Rozen-creutz, qui vécut plus de cent ans (1378-1484), qui rapporta des secrets merveilleux de nombreux voyages en Turquie et en Asie.
Les initiés modernes n’acceptent généralement pas ce dernier comme leur chef et ils opposent à Rozencreutz trois chefs célèbres et accrédités : au xviie siècle, le suédois Swedenborg, au xvill®, Saint-Germain et ensuite Schrœpfer.
D’après Mme Besant, occultiste écoutée, Rozencreutz se serait incarné une première fois, pendant son existence, sous la forme de Jean Carvin Humiado
i»


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
(1380-1436), la seconde fois avec François Bacon et la troisième sous les traits de Saint-Germain.
Les Rose-Croix adoptent généralement ces réincarnations de leur maître et Fr. Synthéticus, écrivain occultiste dont l’œuvre fait loi, s’exprime ainsi à ce sujet.
“ L’esprit du fondateur a depuis sa mort réapparu dans un corps, en plusieurs pays d’Europe. Ainsi, en ces jours, il a pris corps, et quoique méconnu du monde, il reśte une force qui se révélera dans les affaires occidentales. ”
Ce sont là, bien entendu, spéculations théosophi-ques où l’histoire, dépourvue de moyens de contrôle, ne saurait s’aventurer; mais, à notre point de vue, la Rose-Croix ne fut au xvine siècle qu’un groupement spéculatif introduit au sein de la franc-maçonnerie en même temps que la politique jacobite.
Les premières sociétés avaient été formées en Allemagne et en Angleterre sur le modèle légué par Chriśtian Rozcncreutz, inspiré par le double de Thotmès III.
Composé uniquement de quatre membres principaux, l’ordre prit rapidement une grande extension en Prusse, ou quatre nouveaux membres furent adjoints. Il comptait à Paris, en 1623, trente-six loges. L’Allemagne en comptait douze et le souvenir de Swedeborg en avait maintenu quatre en Suède.


. et
in-ain
ce
iru isi, du les
hi->le, , la peín
en
?ar de
in-
on nt ss. de
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
L’illustre Ashmole, introduit dans la société en 1646, précipita sa seconde évolution. Il choisit dans les assises de Rozencreutz un ensemble d’initiés auquel il confia le soin de bâtir le temple idéal de la Science dont Bacon nous a tracé le plan dans “ La Nouvelle Atlantide ”. Nous inclinons, pour notre part, à penser que la légende symbolique du temple de Salomon et d’Hiram fut introduite par cette société-dans la maçonnerie spéculative avec laquelle elle avait des points de contact journaliers.
A cette époque, la société était exclusivement secrète. On devait s’y occuper de sciences naturelles, sous forme allégorique. On entrait apprenti, sans initiation, on passait compagnon et le président d’une loge était reçu maître.
La condamnation de Clément XII, en 1738, dans sa bulle “ In Eminenti apostolatus spécula ” ne toucha pas la maçonnerie. Le pape la condamnait pour ses pratiques secrètes. En France, les parlements refusèrent d’enregistrer les décrets pontificaux et ceux-ci restèrent ignorés. Mais par réaction contre le chef de l’Eglise catholique, la Rose-Croix s’établit en chapitre et un rite plus précis et plus défini eut pour résultat de renforcer les positions de ceux qui s’appelaient les chevaliers du Temple de Salomon1.
1. Certains écrivains qui ont cherché à raconter la Rose-Croix semblent croire que la fondation de cet ordre a été une résurrection des Chevaliers



LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Les chevaliers affectaient d’attendre l’arrivée du soleil dans une grande salle plus étendue de l’Orient à l’Occident que du Midi au Nord. Le corps d’Hiram-Abif, symbole de la nature morte, se trouvait dispercé en douze maisons, figures du Zodiaque, que le Grand*Œuvre devait faire revivre. La pentacule de Salomon, sorte de lame triangulaire en or, était attachée au milieu de la salle. Elle contenait l’œil du Grand Tout capable de tout vivifier par la Vertu divine.
A l’entrée, entre deux colonnes, une étoile flamboyante indiquait le commencement de l’œuvre prenant couleur. Une pierre ordinaire désignait la matière informe et une pierre pyramidale la matière développée par le sel et le soufre. On pouvait remarquer un grand autel où brillait le feu élémentaire, réminiscence préhistorique du culte divin et enfin, une équerre, un niveau à eau, un fil à plomb et un maillet.
Les Rosicruciens croyaient toutes les substances issues de la “ Materia prima ” ou “ Magisterium ” comme ils l’appelaient. Ils s’efforçaient de s’en rendre
du Temple de Jérusalem, appelés Templiers, condamnés par Clément V en 1312. C’càt probablement indiscutable, mais de nombreuses confusions trop souvent répétées prouvent que l’influence de cet ordre militaire a été moins importante qu’on ne le croit généralement sur la fondation de la société maçonnique.
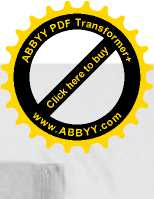
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
lu nt
ns
ae de lit lu
tu
lire la
are lire, in, un
:es i ” Ire
it v ions i été e la
maîtres et de la travailler pour obtenir une matière capable de transmuter les métaux vils en métaux précieux. Cette opération, tentée depuis la plus haute antiquité, s’appelle la recherche de la pierre philosophale ou “ parergon ”.
Beaucoup de ces initiés estimaient cette connaissance secondaire et leur œuvre principale consistait à la recherche de l’“ ergon ”, le fluide aśtral d’où les éléments seuls sont nés.
Comment ces cerveaux, que devait tenir en ébullition le désir d’agir vers un but commun, pouvaient-ils trouver la force de vivre? Dans quelle organisation ces myâtiques, ces illuminés —ils se défendaient farouchement de l’être — avaient-ils le courage de frôler, à chaque instant, la matérialité de la terre, eux qui avaient commencé à mettre debout la conception de l’essence de Dieu?
11 demeure admirable que ces hommes, ayant à leur service un nombre limité de moyens, aient su, par intuition, ce que la science moderne, armée de tous scs instruments de précision et riche d’une expérience de plusieurs siècles, vient seulement de découvrir à son tour. Le chimiste Bcrthelot a reconnu, à la fin de son existence, que tous les corps sont formés d’une même substance et que le déplacement des molécules crée la possibilité de faire de l’or.
Que Saint-Germain ait été orgueilleux n’eSt-il
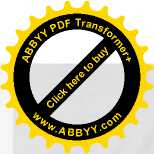
LE COMTE DE SAlNT-GERMAlN
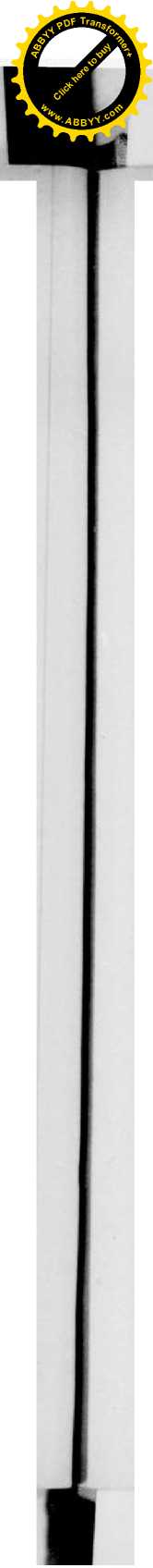
pas naturel? Avons-nous jamais osé songer ce qu’il en serait de notre nature, si, un jour, une révélation, une apparition, ou ce que nous croirions être, nous permettait de déchirer une seconde le voile de l’au-delà? Quand la brume plus intense serait retombée, ne serions-nous point pénétrés de la grandeur de notre rôle et ne verrions-nous point en nous des prédestinés désignés par la volonté divine à la rénovation de l’Humanité? Aurions-nous la force de nous soumettre à la plaisanterie du Monde sans nous révolter? Nous ne le pensons point.
S’il a éprouvé ces sentiments, Saint-Germain, seul, a eu la force qui nous aurait manqué peut-être, car il n’a éprouvé que la fierté de la faveur qu’un Dieu lui avait faite.
En feuilletant l’œuvre de M. Louis Figuier1, on peut constater que déceler une maladie chez certains sujets n’eSt pas impossible. Cet auteur nous cite, parmi tant d’autres, un exemple assez curieux. Nous inclinons à ne pas le croire absolument fantaisiste. Qu’on nous permette de le résumer en quelques lignes :
“ Le doétcur Pelletin, de Lyon, avait à soigner une malade atteinte de troubles spasmodiques et de catalepsie. Pendant une crise où la cliente délirait, le médecin lui demanda brusquement :

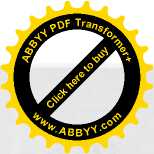
[u’Ü ion, ous ’au-bće, • dc des
:no-dc
1OUS
seul, , car Dieu
, on tains armi ncli-u’on
íes : gner H de irait,
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
“— Parlerez-vous donc toujours?’
“ Tout en disant ces mots, Pelletin plaça, sans doute par hasard, un doigt sur l’épigaStre de la malade. Aussitôt, celle-ci répondit :
“ — Je vois mon intérieur, les formes bizarres des organes enveloppés d’un réseau lumineux. Ma figure doit exprimer la crainte.
— “ Voyez-vous votre cœur? questionna le praticien sans se démonter.
— “ Le voilà, expliqua aussitôt la malade. Il bat en deux temps et des deux côtés à la fois. Quand la partie supérieure se resserre, l’inférieure s’enfle et se resserre bientôt apres; le sang en sort tout lumineux et passe par deux gros vaisseaux, peu éloignés l’un de l’autre. ”
“ Le médecin, un peu sceptique, interrogea la malade sur les principaux organes vitaux, entre autres les poumons, le foie, 1’eśtomac et le gros intestin. Il put, en quelques minutes, suivre le parcours des aliments absorbés depuis le matin. Lorsque la main quittait 1’ćpigaśtre de la malade, celle-ci se taisait. *
Rien ne s’opposerait à ce que Saint-Germain ait pu, par ce meme procédé, déceler bien des maladies cachées et sauver entre autres le maréchal de Belle-Isle, la plus célèbre de ses guérisons, et préserver Mlle de Palois de son poison.

LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

Quoi qu’il en soit, l’admiration de Charles de Hesse, — il avait peut-être assisté à l’un de ces faits troublants, — n’a pu que grandir et développer ses dispositions bienveillantes pour notre héros. On conçoit la désolation du landgrave lorsqu’il se heurtait au matérialisme tranquille de son protégé. Qui sait, devait-il se dire, si en se ralliant au mysticisme cet homme ne deviendrait point l’un de ces élus gratifiés de lumières spéciales qui leur permettent d’entrer en communication plus intime avec le Seigneur? Le comte, on l’a vu, ne lui donna jamais cette satis-fa&ion.
Telle fut la vie mouvementée et pleine d’énigmes du comte de Saint-Germain! Quant à sa survivance, il faut être adepte pour y croire. Modestes historiens, nous ne pouvons point nier les registres de l’état civil d’Eckcnforde, mais, pour attirer, le personnage n’a point besoin d’un surcroît de merveilleux. Le mystère de sa naissance, son activité protéiforme, les larges portions d’ombres qui recouvrent une partie de son existence, suffisent à piquer une curiosité qui enrage de ne pouvoir mieux se satisfaire. L’avenir sera-t-il plus heureux et parviendra-t-il à faire la pleine lumière sur notre héros?
L’espoir, à vrai dire, en cśt faible après les efforts de tant de patients chercheurs. On peut toutefois en exprimer le souhait, car rien ne serait plus désirable
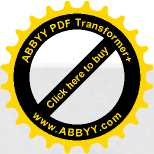
de its ses Jn ar- . fui me raen-ar? tis-
nes ICC, ms, état age
Le , les rtie qui enir dne
orts s en able
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
que de tenir enfin la vérité sur cet être étrange et fascinant qui joint à tant de mérites personnels l’avantage d’avoir été aussi intimement mêlé aux affaires de notre pays et d’être en même temps un personnage éminemment représentatif d’un des courants d’idées les plus surprenants de 1’1 liśtoire.

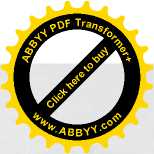
BIBLIOGRAPHIE
Archives du Ministère des Affaires Étrangères du Quai d'Orsay.
Archives du Ministère des Affaires Étrangères de Berlin.
Archii<es du Ministère des Affaires Étrangères de Vienne et de la Hoffburg.
Adhémar (Mme d’). — Mémoires.
Allonville (d’). — Essais sur la Révolution.
Bord (Gustave). — La Franc-Maçonnerie au XVIIIe siècle.
Bulau (Fr.). — Geheime Geschichten und ratsolhaste menschten
Casanova de Seingalt. — Mémoires.
Cooper-Oakley (Mme). — Incidents sur Saint-Germain.
Créquy (Mme de). — Mémoires.
Farrère (Claude). — La Maison des Hommes vivants.
Fay (Bernard). — Histoire de la Franc-Maçonnerie.
Figuier (Louis). — Histoire du Merveilleux.
France (Anatole). — La Rôtisserie de la Reine Pédauque.
Genlis (Mme de). — Mémoires.
Hausset (Mme du). — Mémoires.
Kaus (Gina). — Catherine la Grande.
Le Brun. — Histoire critique des pratiques superstitieuses.
Lecanu (l’abbé). — Diitionnaire des prophéties et des miracles.
Lévi (Eliphas). — Histoire de la Magie.
Longueville-Harcovet. — Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs siècles.


LE COMTE DE SAINT-GERMAIN
Lenglet-Dufresnoy (Nicolas). — Traité historique et dogmatique sur les apparitions et les visions.
Mercier de la Rivière. — L'Ordre naturel.
Moura (Jean) et Louvet (Paul). — Saint-Germain, le Rose-Croix immortel.
Murat (Princesse Lucien). — La Grande Catherine.
Nolhac (Pierre de). — Louis XV à Versailles.
Pouchet. — Archives de la Police.
Richelieu (duc de). — Mémoires.
Volz (Gustave). — Thr Graf ron Saint-Germain.
Wittemens (de). — Histoire des Rose-Croix.
Weber (von). — Quatre saisons.

^g-

ose-
TABLE DES MATIERES
Pages.
XI. — Considérations sur M. de Saint-Germain. . . 257

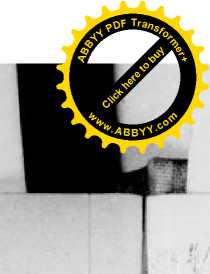
Imprimé en France par Brodard et Taupin — Coulommiers-Paris.
C. O. L. 31.1202—N° 32.89911-1943-
Dépôt légal, 4e trimestre 1943-Éditions Colbert, N ’ 45 — C. O. L. 11.0212
Autorisation N° 12.030.

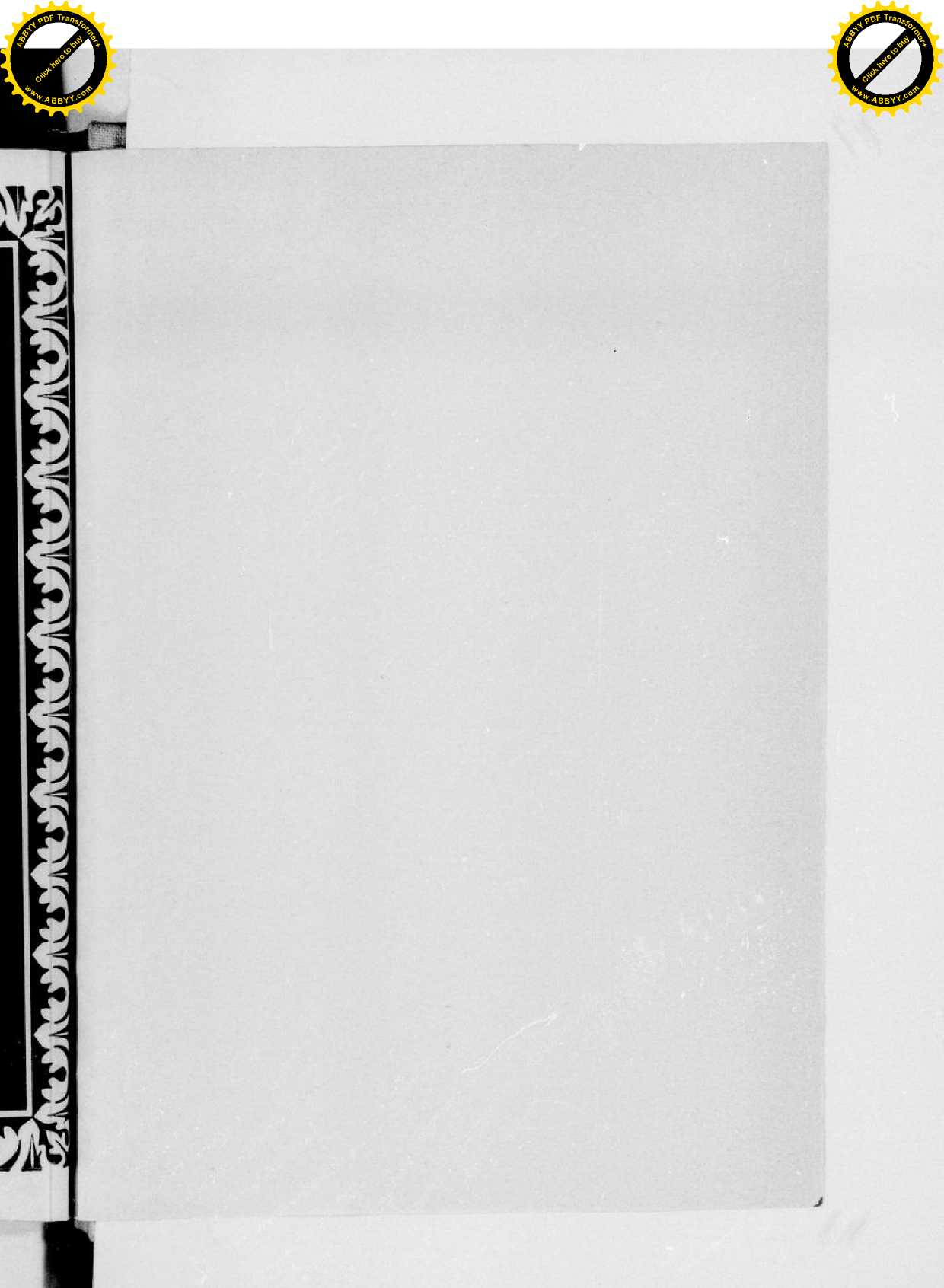
/IŁ