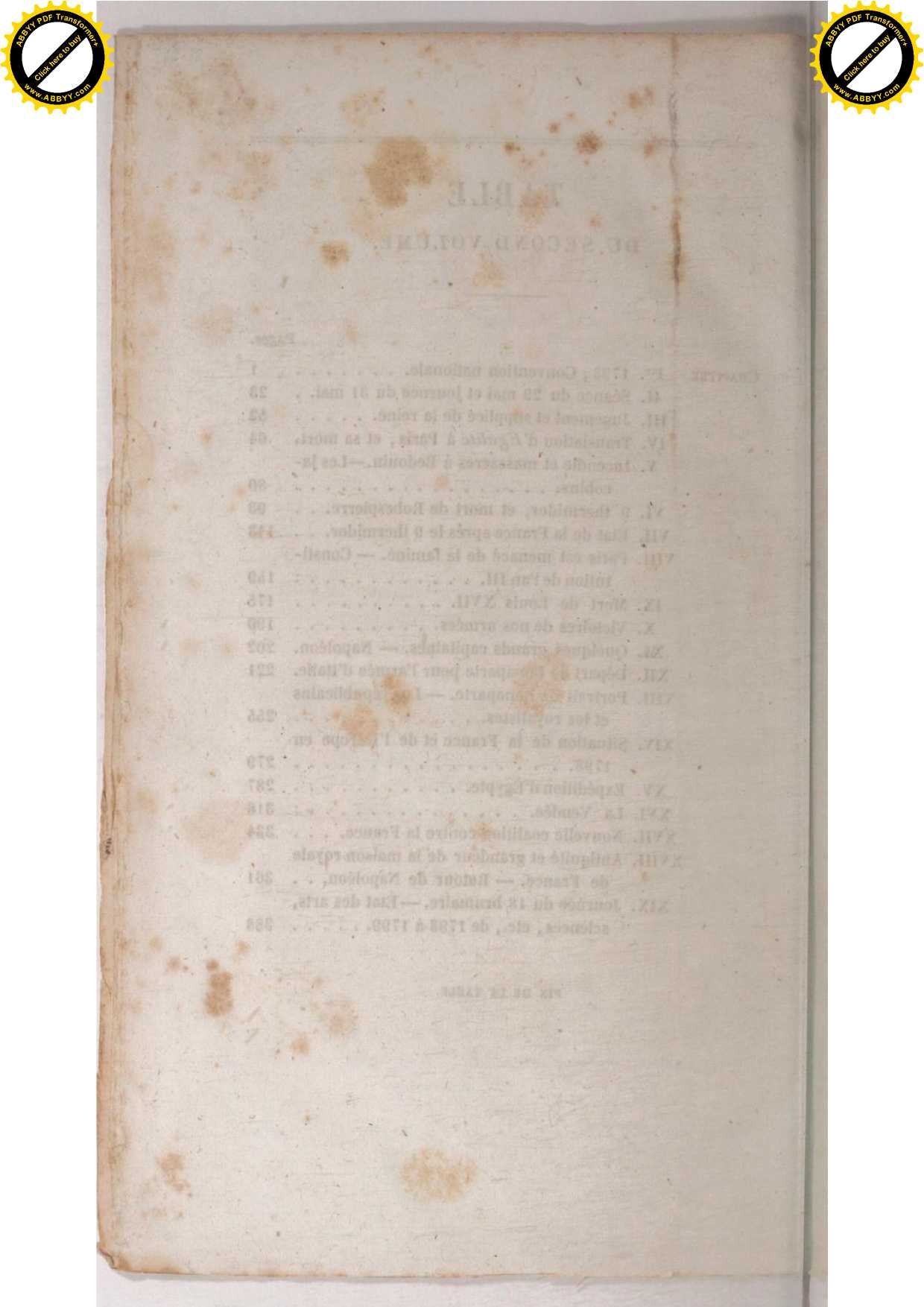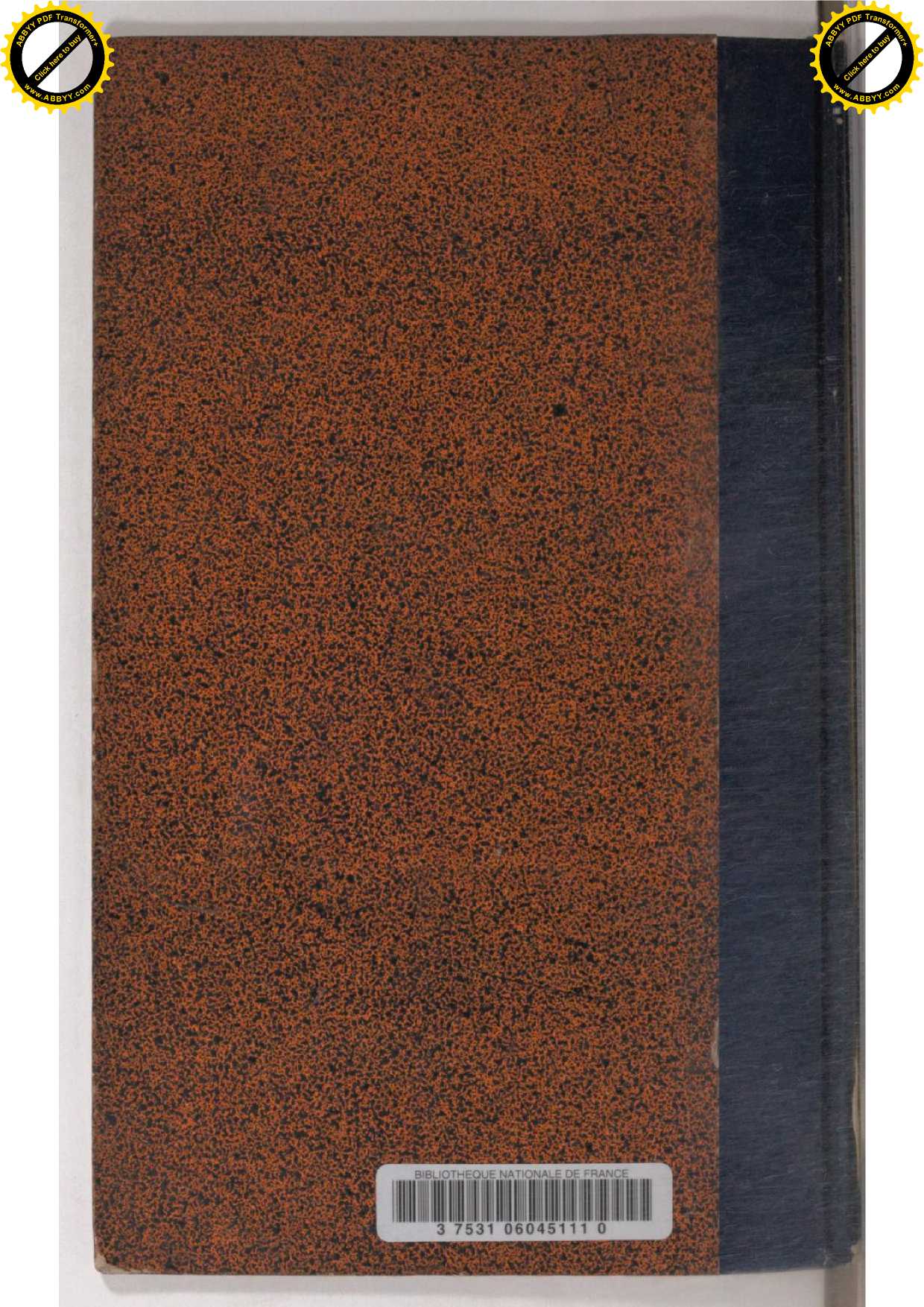Gallica

Gallica

Histoire religieuse, monarchique, militaire et littéraire de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


Lamothe-Langon, Étienne-Léon de (1786-1864). Auteur du texte. Histoire religieuse, monarchique, militaire et littéraire de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration : depuis la première assemblée des notables en 1787, jusqu'au 9 août 1830. Tome 2 / rédigée sur des documents originaux et inédits, par le baron de Lamothe-Langon,.... 1838-1839.
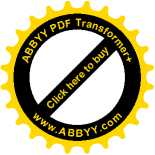
1 / Les contenus accessibles sur le site Galilea sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2 / Les contenus de Galilea sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3 / Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Galilea constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Galilea sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Galilea en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.
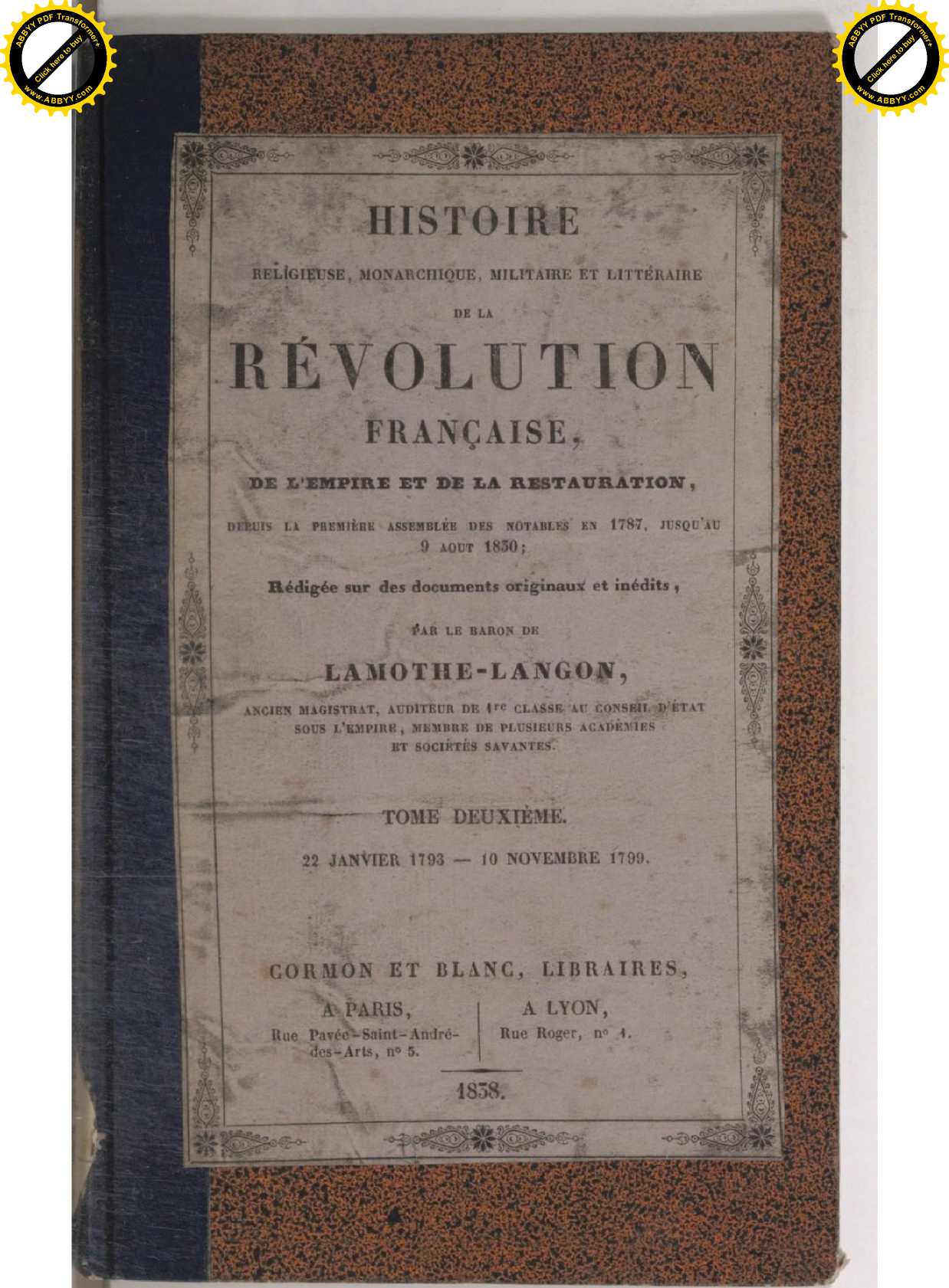
^
V*
HISTOIRE
RELIGIEUSE, monarchique, militaire et littéraire
DE LA
REVOLUTION
DE L'EMPIRE ET DE LA RESTAURATION
Rédigée sur des documents originaux et inédits ,
ÍAR LR BAROK DK
TOME DEUXIÈME.
22 JANVIER 1793 — 10 NOVEMBRE 1799.
1858.
A LYON, Rue Roger, n° t.
GORMON ET BLANC, LIBRAIRES
FRANÇAISE,
À PARIS, Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, n° 5.
DIRUIS LÀ PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES NOTABLES EX 1797. JUSQU'AU 9 AOUT 1830;
. _ LAMOTUE-LAAGOA,
ANCIEN MAGISTRAT, AUDITEUR DE pe CLASSE AU CONSEIL D’ÉTAT sors l'empire, MEMBRE de PLUSIEURS académies ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
Í¿^4SmÍC*J¿^'°^'
Source galllca.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
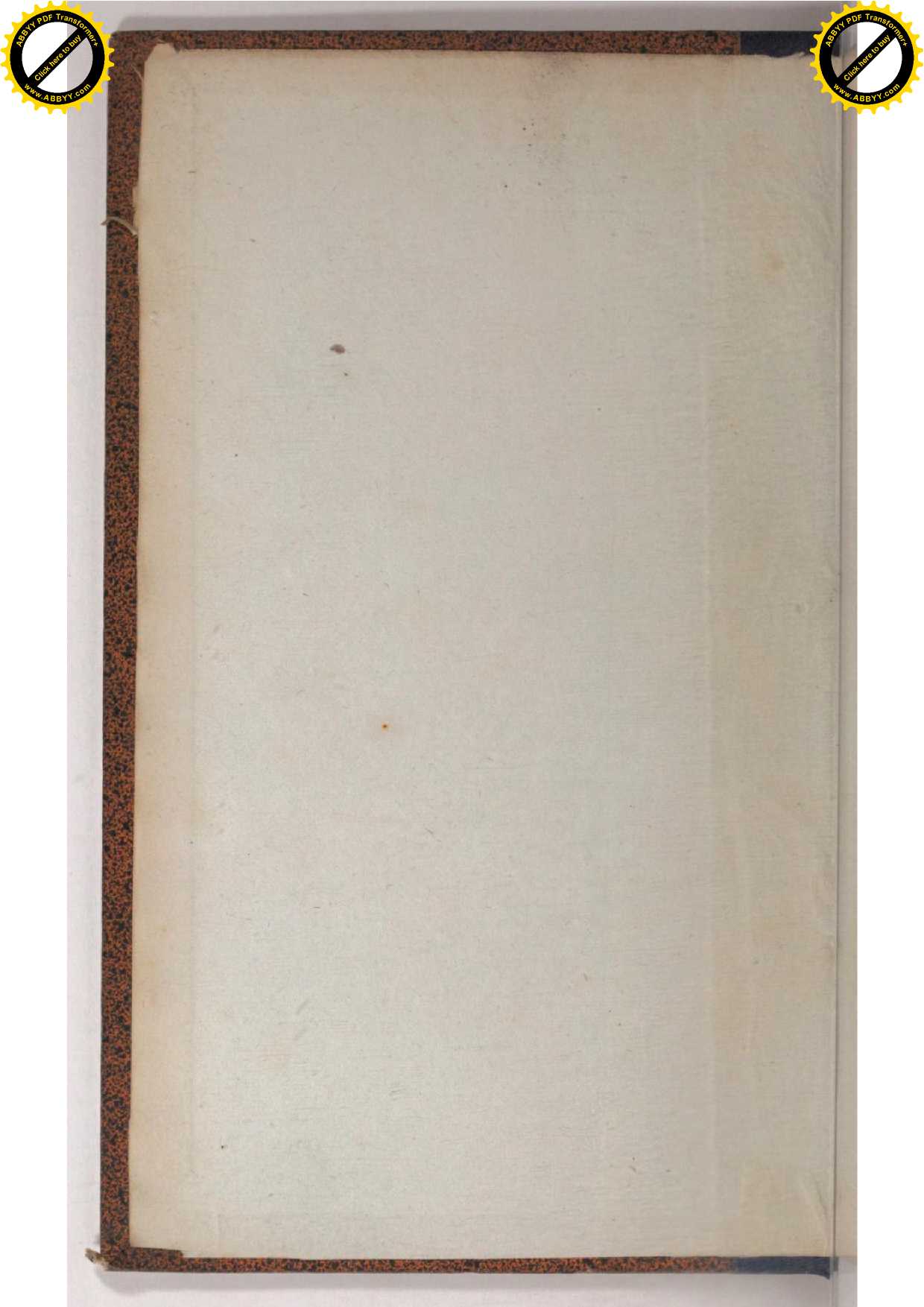
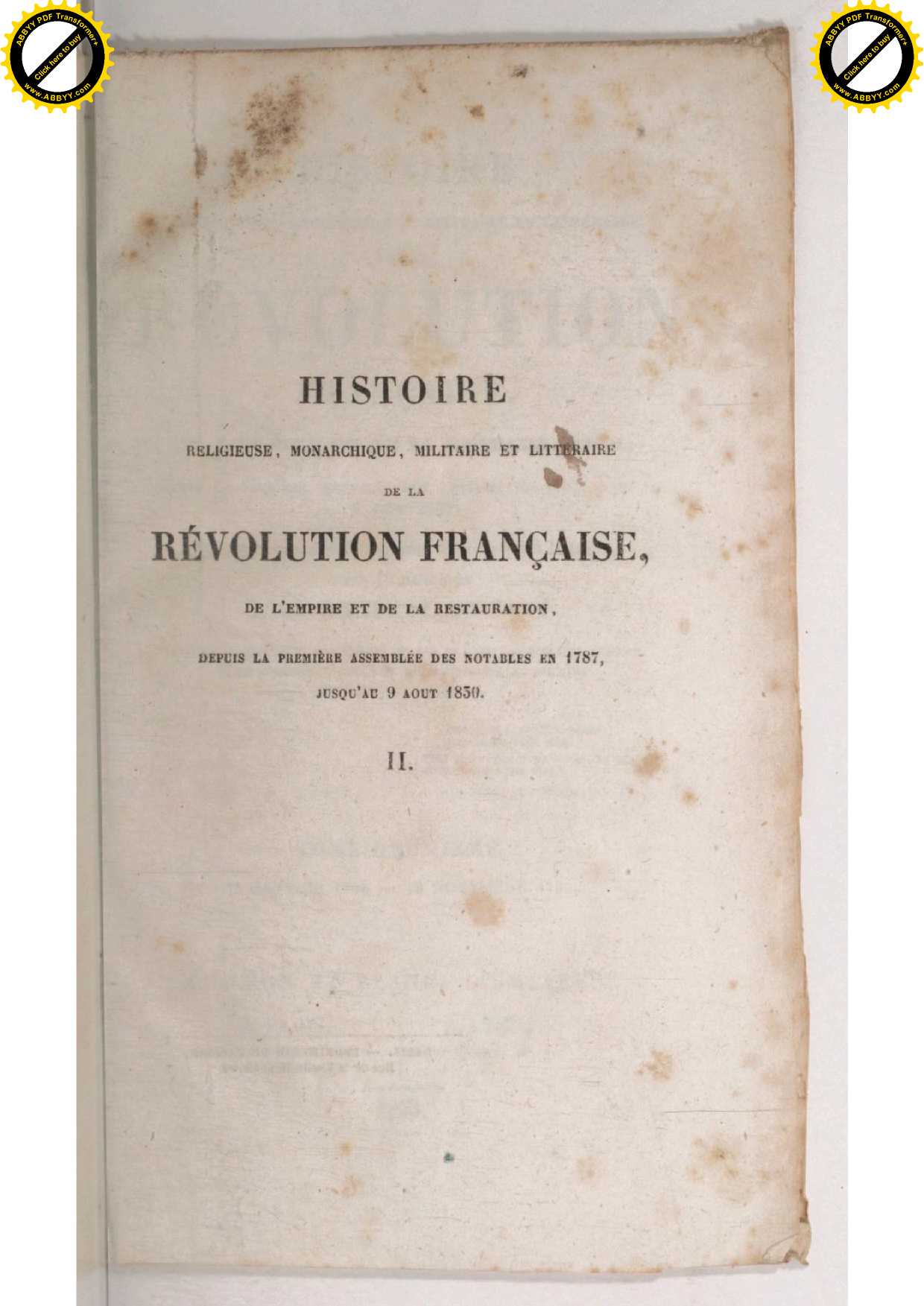
HISTOIRE
DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
DE L EMPIRE ET DE LA RESTAURATION
DEPUIS LA PREMIÈRE ASSEMBLEE DES NOTABLES
JUSQU’AU 9 AOUT 185(1
RELIGIEUSE. MONARCHIQUE, MILITAIRE ET LITTERAIRE
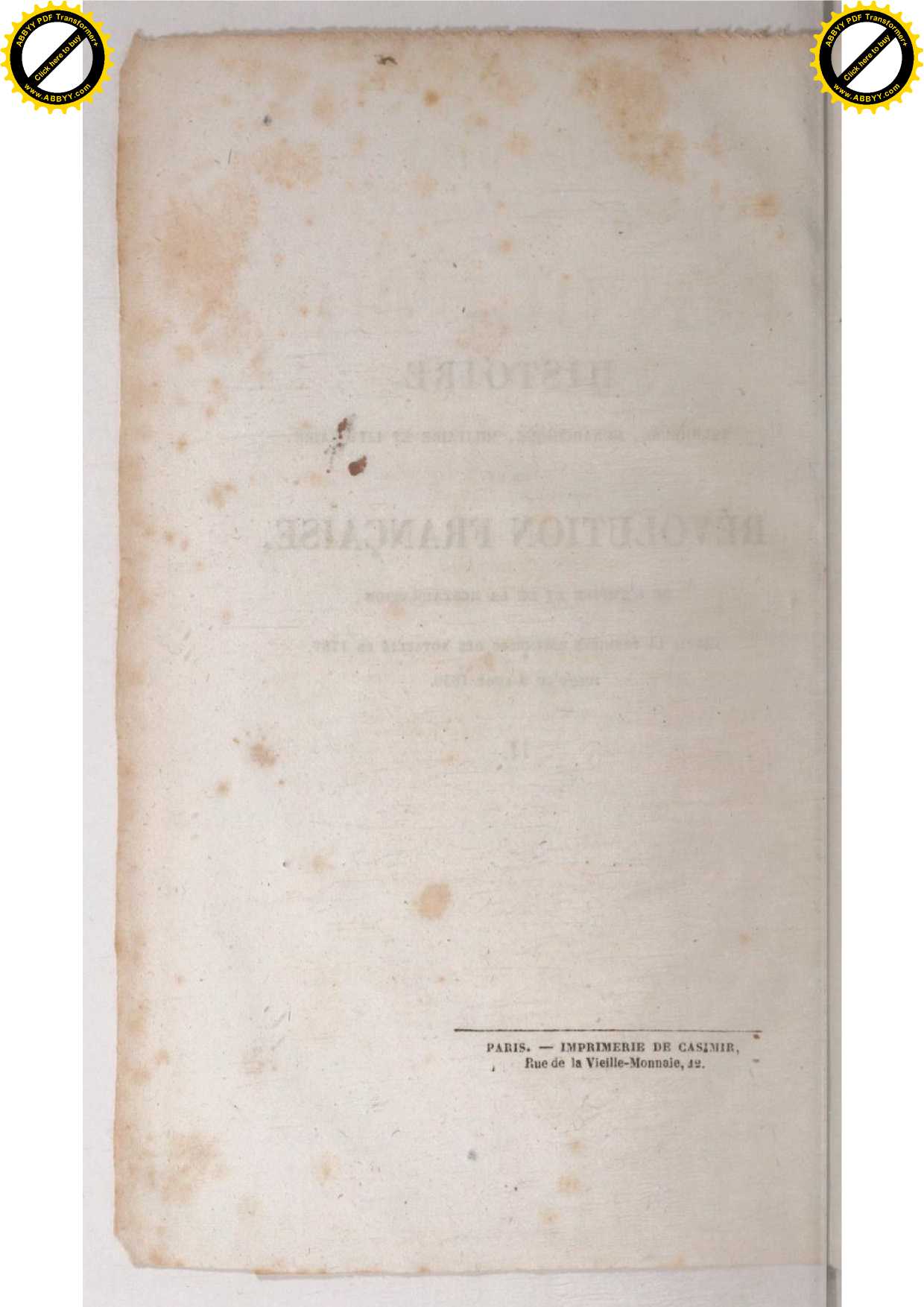


HISTOIRE
RELIGIEUSE, MONARCHIQUE, MILITAIRE ET LITTÉRAIRE
DE LA
RÉVOLUTION
FRANÇAISE,
DE L'EMPIRE ET DE LA RESTAURATION,
«
DEPUIS LÀ PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES NOTABLES EN 1787, JUSQU’AU 9 AOUT 1830;
Rédigée sur des documents originaux et inédits ,
PAR LE BARON DE
LAMOTHE-LANG ON,
ANCIEN MAGISTRAT, AUDITEUR DE Ire CLASSE AU CONSEIL D’ÉTAT SOUS L’EMPIRE, MEMBRE DE PLUSIEURS ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

Quldquld excessif moduni, Pendet Instablil loco.
Ton! ce qui patte le» borne» ne saurait être <te longue durée.
(SÉNÉQUE, OEdipe, acte IV*. )
TOME DEUXIÈME.
22 JANVIER 17 93 — 10 NOVEMBRE 17 99.
CORMON ET BLANC, LIBRAIRES
A PARIS, Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, n® 5.
A LYON, Rue Roger, d* 4.
1858.

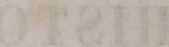

-
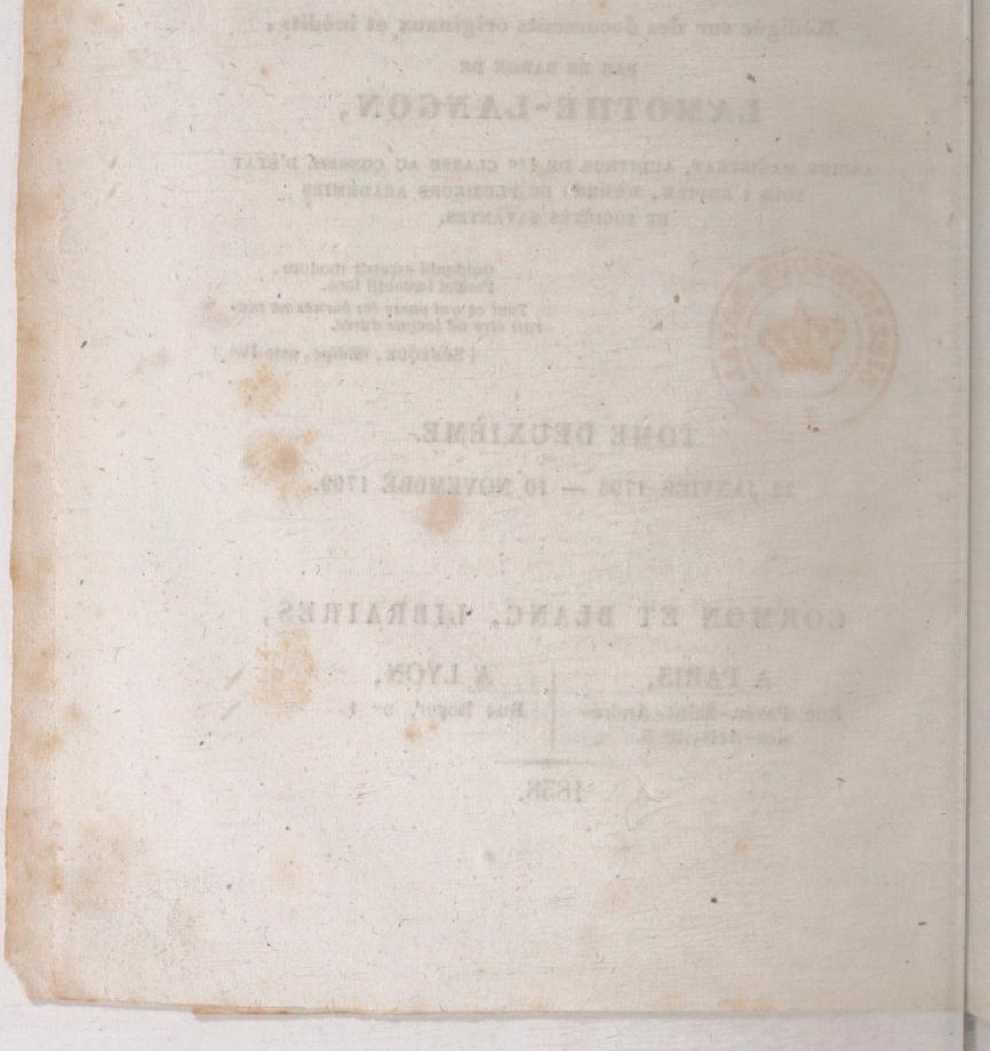


HISTOIRE
DE LA.
RÉVOLUTION FRANÇAISE.
1793.
LA CONVENTION NATIONALE.
Retour sur le passé. — Causes du meurtre de Louis XVI.—Déception des Girondins et des Orléanistes. — Espoir des Montagnards. — Dumou-riez, à Paris, cabale pour le jeune Égalité.—Danton révèle le complot à Robespierre qui en profile.—Chute du ministère Roland. — Oui le remplace.—L’Angleterre renvoie notre ambassadeur.—Marquis de Cliauvelin. —Citoyen Marat. —Propos de Pitt. — Établissement des co-tnilésde Salut public et de Sûreté générale et du tribunal révolutionnaire. — Fouquier-Tinvllle. — Divers décrets anarchiques. — Bataille de Ner-vinde. — Fuite de Dumouriez. — Lejeune Égalité sort du royaume. — Les Bourbons libres alors sont envoyés prisonniers à Marseille. — Querelle entre les Girondins et la Montagne. — Mesures révolutionnaires.— La commission des Douze. —Son projet de loi. — Les Jacobins se prononcent contre les Douze.—Séance orageuse du 28 mai. — Les sections s'insurgent.
Le plus affreux de tous les crimes venait d'être consommé : on avait fait tomber sur un échafaud la tête du roi de France ; des monstres, ayant assassiné le père de la patrie, se préparaient à promener indistinctement
ti. Í


2 HISTOIRE [1793.] la faux de la mort sur les divers membres de la grande famille nationale. Un si noir attentat fut accompli sans aucune résistance sérieuse; partout les populations, ou tremblantes ou entraînées, se taisaient lorsqu’elles n’approuvaient pas.
Qui avait pu amener les Français à ce sacrilège assassinat? la démoralisation des hautes classes, provoquée dans le principe par les mauvaises mœurs du Régent, de ses filles, de ses alentours, et achevée par la dissolution et les perfidies de son descendant Égalité ; par l’esprit d’irréligion souillé par Voltaire, d’A-lembert, Diderot, Holbach, Raynal(l), Rousseau.etc., accueilli par tous les souverains du Nord, à cause de son protestantisme, et par une portion de la haute noblesse ; protégé par Lamoignon de Malesherbes, qui croyait qu’on pouvait être honnête homme sans être catholique ; répandu par les littérateurs dans les classes supérieures. Ceux-là, tout en prêchant l’athéisme, mirent en avant les maximes funestes d’une liberté chimérique et d’une égalité dont la nature même ne veut pas.
A ces causes, il faut joindre les abbayes en com-mende (2) ; mesure impie qui enrichissait des êtres inutiles, des abbés mondains, la plupart noyés dans
(t)Raynal, auteur de VHistoire philosophique du commerce et des établissements des Européens dans les deux Indes , ouvrage impie, anarchique et immoral, se repentit de sa conduite coupable. Il rétracta ses erreurs dans une lettre qu'il adressa à l'Assemblée nationale, et mourut réconcilié avec le Ciel et gracié par les honnêtes gens. L. L. L.
(2) On appelait ainsi des abbayes dont l’abbé titulaire n'était pas soumis à la résidence, bien qu'il en touchât les revenus. Cet abus était criant. L. L. L.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
3
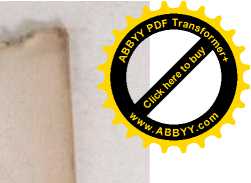
les délices des grandes villes et objets perpétuels de scandale ; le relâchement d'une portion du haut clergé, car, bien que les criminels fussent en petit nombre, leur exemple funeste ne pervertissait que trop les masses, toujours attentives à imiter ce qui est mal.
La destruction de l’ordre des Jésuites fut une des causes principales de la funeste révolution. Cet ordre célèbre, sentinelle avancée de notre saint culte, combattait vigoureusement le jansénisme , qui, lorsqu’il s’exalte, tend à la république, et le philosophisme, dont la pente naturelle va droit à l’anarchie.
Telles étaient les causes de ce crime capital, le plus grand de tous, sans doute, car le régicide est pire que le parricide : tuer un roi est plus que tuer un père. Puissent nos neveux concevoir cette vérité et garder
une horreur profonde pour un nable !
forfait aussi abomi-
approuva, par une infâme, tant l’épou
Chaque commune de France adresse de félicitation, cet acte
vante et le fanatisme régnaient universellement : ce fut un concert déplorable. La terreur dominait les esprits, et il faut avoir vu les hommes à ces époques fatales pour comprendre leur conduite d’alors. Cependant un sentiment d'horreur éclata dans tout le royaume ; l’Europe entendit avec indignation le bruit que fit en tombant cette tête couronnée. L’Europe, qui ne s’était que faiblement occupée de défendre Louis XVI pendant sa vie, entreprit de le venger après sa mort.
Il n’était plus temps de comprimer la révolution : elle était consommée et complète, elle s’était donné un gage, elle avait pris une position; elle régnait et répondit par l’apparition de quatorze armées valeureuses et triomphantes aux menaces qu’on lui adressait et aux

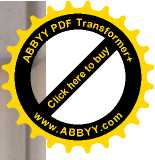
4 HISTOIRE [1793.] démonstrations tardives et par conséquent impuissantes auxquelles on s’était enfin décidé.
Au reste, les divers partis qui divisaient la Convention nationale n’avaient aucunement prévu ce qui résulterait de ce coup éclatant. Les Girondins, véritables assassins du roi, parce qu’ils espéraient reconquérir par ce meurtre leur prépondérance sur la masse jacobine , se trompèrent dans cette spéculation. A les entendre, dès que le peuple serait certain qu’ils ne voulaient pas de monarque. il viendrait à eux et abandonnerait la Montagne; il préférerait leur sagesse, leur modération, leurs grandes vues d’économie et de politique, à la turbulence de l’anarchie. Ils ne conservèrent pas longtemps cette erreur : ils apprirent à leurs dépens qu’on ne recule jamais en révolution qu’au moment où un bras ferme et vigoureux s’empare du timon des affaires. Jusqu’alors la rapidité du mouvement ne fait que s’accroître ; elle exalte le fanatisme et la rage de la populace lancée sur cette route de sang.
La mort de Louis XVI ne rendit donc pas meilleure la position des Girondins : elle devint pire ; cela devait être. On ne leur sut aucun gré de ce crime ; on les regarda comme des vaincus qui, pour obtenir leur grâce, se traînaient à la remorque des vainqueurs.
La faction des Orléanistes, si honteuse et si affaiblie, acheva de disparaître par la même cause, en dépit de la folle espérance qu’elle nourrissait d’en recueillir quelque influence. La couronne ne s’obtient avec le sang (¡ne lorsqu’il y a une main capable de la poser et de la maintenir sur le front de l’usurpateur. Cromwell, après le régicide de Charles Ier, régna et mourut plein de puissance et de gloire, tandis qu’Égalité, après la mort de Louis XVI, ne sut monter que sur un échafaud.
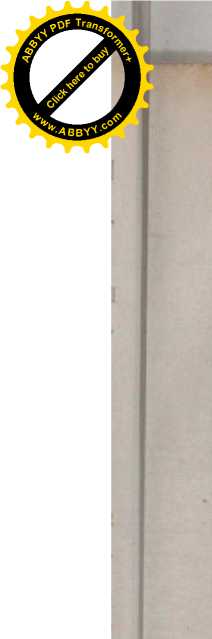
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
5

Enfin la Montagne se flattait que ce forfait assurerait pour longtemps son empire ; elle n’en jouit cependant que pendant dix-huit mois. Ce terme écoulé, la France lasse de la république s’en affranchit en partie, eu passant sous la domination de cinq rois électifs, et moins de cinq ans après celte dernière époque, naquit une monarchie bien autrement absolue que celle que l’on avait cru noyer dans le sang de Louis XVI. Le meurtre de ce saint roi ne profita à aucun parti ; cela devait être : les hommes ne changent point de passions , par cela seul qu’ils changent de système ; leur turbulence l’emportera toujours sur les calculs d’une prudence vaine.
Avant le 21 janvier et pendant les débats du procès, Dumouriez vint à Paris. Les affaires de la république étaient dans une situation favorable. Nous avions environ deux cent mille hommes pour garantir les côtes de l’Océan et de la Méditerranée; soixante-dix mille en Flandre ou en Belgique où Dumouriez agissait en vainqueur. Kcllermann, au commencement de novembre 1792, à la tête de cinquante mille hommes, menait battant les Prussiens, qui achevaient leur retraite honteuse. Custines avec vingt mille hommes occupait Francfort, et Biron distribuait les dix-huit mille soldats placés sous ses ordres dans diverses positions entre Strasbourg et Iluningue. Enfin l’armée des Alpes et de Savoie, forte de vingt-cinq mille hommes, couvrait le territoire sur la frontière des Alpes.
Dumouriez a trompé le public, lorsqu’il a dit dans ses Mémoires qu’il venait à Paris, en janvier 1793, pour sauver Louis XVI ; il leurra, il est vrai, les royalistes de cet espoir; mais le but positif de son voyage était de déterminer Égalité à céder ses prétentions

à la couronne à son fils aîné. Ceci conclu, on convint que le général marcherait contre la Convention, ferait proclamer Louis XVII, et que l’on consommerait plus tard l’usurpation. Certains ont cru que le jeune Égalité ignorait ces intrigues; cela devait être, car on sait qu’en 1830 il a été porté au trône malgré sa volonté et contre son vœu, et qu’il n’a jamais connu les trames ourdies à son avantage pendant seize années de restauration.
Dumouriez essaya de séduire Marat ; il ne le put. Danton, son ami, se montra plus facile. Celui-ci, l’année précédente, l’avait présenté aux Jacobins; dès lors s’établit entre eux une correspondance intime; il en résulta qu’à son arrivée à Paris, il s’ouvrit à ce forcené touchant son projet futur. Danton, homme de feu, avide de plaisirs et de vives émotions, avait des besoins journaliers d’argent, et il ne lui était pas facile de s’en procurer. Les caisses étaient vides ; le numéraire rare passait en entier aux armées. La multitude de surveillants, le grand nombre de ceux auxquels il faudrait recourir pour opérer un détournement de fonds, rendaient la chose à peu près impossible.
L’heure n’était pas encore sonnée, où la terreur et la nécessité de conserver sa vie porteraient chaque personne riche à verser sa bourse dans celle des Jacobins influents. Danton, besogneux, en était aux expédients; Dumouriez le gagna en lui promettant des monts d’or; d’ailleurs, il avait assez de sens commun pour comprendre que l’élévation du jeune Égalité lui profiterait mieux que la perpétuité de la république, et il promit d’aider à donner à la révolution cette nouvelle face.


«793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 7
Dan ton, indiscret d’ailleurs et cherchant à entraîner Robespierre, lui conta ce qui se passait. Celui-ci, qui déjà rêvait pour lui la présidence, s’indigna qu’on jouât son jeu. Il fit peur à Danton, le fit virer de bord, et aussitôt on résolut la perte du général conspirateur et de la famille Égalité. On attendit le succès de son entrée en campagne, afin de l’accabler si la fortune le délaissait un instant.
Dumouriez, certain de réussir, quitta Paris, abandonnant indignement Louis XVI. Le 17 février, son avant-garde entra en Hollande; le 25, Broda fut pris, et le 7 marsGertruydemberg. Vainqueur à Tirlemont, il voyait s’ouvrir devant lui une carrière brillante ; mais la Providence se préparait à le punir. Il attaqua le 18 mars à Nervinde l’enuemi commandé par le prince de Cobourg: il avait sous lui les généraux Lamarche, Égalité et Miranda. Malgré des dispositions savantes, l’inhabileté des généraux en sous-ordre paralysa les efforts de Dumouriez. Les coalisés remportèrent une victoire éclatante, et la couronne échappa à qui l’espérait, pour ne lui revenir que trente-sept ans plus tard.
Tandis que ces choses se passaient à l’armée du Nord, Paris continuait à être livré à l’anarchie. Le ministre Roland, trop vain pour supporter des contradicteurs, donna sa démission le surlendemain du meurtre du roi, quoi que les Girondins pussent faire pour l’en dissuader. Garat le remplaça en quittant la justice, où l’on mit l’honnête et faible Gohier, républicain décidé , prêchant l’égalité sainte et se faisant rendre soigneusement les honneurs dus aux charges qu’il occupait. Véritable avocat, rogue, suflisant, jaloux de tout mérite, au jugement faux, à la judiciaire étroite, c’était un homme tel enfin que le barreau en pullule.


8
HISTOIRE
11793.]
Lebrun demeura aux relations extérieures, jusqu’au SI mai, qu’on lui enleva sa place, enviée par un grand nombre de concurrents. Marat la demandait, Tallien en avait envie. Deforgue, nullité provisoire, en fut investi pendant trois mois. Pacho céda le portefeuille de la guerre à Beurnonville, qui, à peine nommé, aliase faire arrêter par Dumouriez, comme je le dirai plus bas. Clavière, en digne Genevois qui trouve bon tout ce qui procure de l’argent (1), conserva son poste aux finances jusqu’au SI mai, qu’on y plaça un nommé Destournelle, personnage inconnu de tout point, et qui , Napoléon venu, fut retrouvé commis à une barrière avec douze cents francs d’ap-pointement.
La mort du roi décida la guerre avec l’Angleterre. Le marquis de Chauvelin, notre ambassadeur à Londres, fut chassé honteusement; celui-là compte parmi les nobles ingrats envers la famille royale. On l’a vu tour à tour jacobin, valet de Napoléon, sans-culotte à talons rouges (2), désireux delà faveur, et se vengeant par des épigrammes, quand il ne savait l’obtenir. Il avait de l’esprit, du trait, mais pas de conduite, et dans son libéralisme de la restauration, il se montra marquis de l’ancien régime.
La rupture avec la Grande-Bretagne augmenta les embarras de la Convention. On essaya de changer les dispositions de cette puissance, et on y dépêcha le
(1) R iva rol disait : Partout où je verrai uu Genevois se jeter par une fenêtre d'un second étage, sur le pavé, j’en ferai résolument autant, bien certain <|u’il y aura quinze pour cent à gagner.
(2) Avant 1789 on distinguait les seigneurs de la cour par le port

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 9 citoyen Maret, devenu depuis duc de Bassano. Jamais il ne fut diplomate plus médiocre, plus au-dessous de sa fortune que celui-là. Le ministre anglais, le fameux Pitt, eut le plaisir de le mystifier continuellement. 11 y réussit si bien, que la République, trompée par lui, ue prit aucune mesure utile, tandis que celles de l’Angleterre répondirent au but que son cabinet en espérait. Ce fut à la suite d’un colloque avec Maret, que Pitt s’écria :
« Plût à Dieu que tous les généraux de la Convention fussent de la force de ses diplomates! la cause des rois s’en trouverait mieux. »
Cependant la terreur, les mesures violentes, avaient désorganisé la France ; le commerce y était anéanti, par suite de l’épouvante générale et des poursuites actives faites d’un bout à l’autre du royaume contre tout négociant dont les spéculations tendaient à l’approvisionnement de telle ou telle ville. On l’accusait de se livrer à des accaparements; chaque envoi était saisi, visité, pillé, et la vie de l’expéditeur compromise. Il en résultait une stagnation, une absence de circulation et d’affaires, qui de proche en proche répandaient la disette. Les denrées de première nécessité manquaient universellement; chacun se refusait à approvisionner un lieu quelconque, bien certain que les démarches nécessaires pour y parvenir amèneraient des catastrophes fatales à qui les tenterait.
La Convention vit le mal, et pour y remédier elle inventa ce qui devait précisément porter la perturbation au comble, le maximum, c’est-à-dire une taxe

des souliers à talons rouges, qu’eux seuls avaient le droit ou l'usage de porter. L. L. L.


fO
HISTOIRE
[1793.]
moyenne de toute denrée. Cette loi désorganisa trice, évidemment inutile, plut d’abord au peuple, qui n’en apercevait pas les conséquences ; il la demandait avec ardeur, dans les rues, aux clubs, aux tribunes de la Convention, à la barre, enfin par des placards. Les chefs de la Montagne eux-mêmes reculaient devant elle ; ils tâchaient vainement de faire comprendre son danger. Ces représentations, en pure perte, loin d’éclairer la populace aveugle, les rendaient impopulaires à ses yeux. Il y a dans les révolutions une force majeure, mais sans discernement ; elle donne aux chefs un pouvoir apparent, mais à la condition qu’en retour ils obéiront aux caprices de la multitude , quelle que soit leur extravagance et l’impossibilité de les mettre à exécution : cette circonstance en fournit un exemple.
Les Girondins repoussaient le maximum; les Montagnards s’en emparèrent, et s’en servirent pour prouver au peuple que les premiers étaient aussi ses ennemis.
Le peuple, il faut en convenir, était réellement malheureux. Le prix des denrées de première nécessité était augmenté dans une proportion effrayante. L’ouvrier aurait pu s’en dédommager en élevant le prix de son travail; mais le travail manquait, il n’y avait plus de superflus, il n’y avait plus de riches. Ceux qui l’étaient encore affectaient les dehors de la pauvreté. Il ne venait de commandes ni du dehors ni du dedans. Les colonies en révolte ou enlevées à la mère-patrie ne tiraient rien d’elle. La guerre étrangère, la guerre civile à son aurore, achevaient de tout anéantir.
Tel était le résultat du nouvel ordre de choses.
/ .

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. H
Cette liberté prétendue amenait l'anarchie et la ruine; le malaise, augmentant, poussa au désespoir et amena des actes de violence. Un mois à ])eine était écoulé depuis l’assassinat du roi, et déjà le bouleversement était complet. Une première émeute eut lieu le 22 février, jour où un grand nombre de femmes vinrent demander aux Jacobins le prêt de leur salle pour y délibérer sur la situation précaire et présente. Les refus qu’on leur adressa valurent mille injures aux Jacobins. On leur reprocha de ne pas valoir mieux que les nobles.
Le tort du peuple consiste principalement en ce qu’il ne veut pas reconnaître cette vérité : c’est qu’il ne gagnera jamais rien à passer du joug des hautes notabilités sociales sous celui des castes plus rapprochées de la sienne ; l’assujettissement ne sera jamais plus doux, et finira par être plus pénible.
A la nouvelle du meurtre de Louis XVI, le cabinet anglais ne balança pas à déclarer la guerre à la France. Son premier soin fut de s’unir avec la Russie par un traité d’alliance, dans lequel on inséra particulièrement les deux articles suivants :
« Les deux puissances s’engagent à prendre toutes « les mesures qui sont en leur pouvoir pour troubler « le commerce de la France. — Elles s’engagent à « réunir tous leurs efforts pour empêcher d’autres « puissances non impliquées dans cette guerre, de « donner une protection quelconque, soit directe-« ment soit indirectement, en conséquence de leur « neutralité, au commerce ou à la propriété des Fran-« çais, en mer ou dans les ports de la France. »
L’Angleterre allait au but: jamais elle n’a conclu un traité qu’elle n’y ait inséré un article nuisible aux in-
térêts de la France ; dans celui-ci le droit des neutres fut sacrifié.
A l’intérieur, on commençait à concevoir la nécessité absolue de la centralisation du pouvoir. Jusque-là les ministres avaient correspondu avec la Convention, sans intermédiaire ; cela compromettait les intérêts publics. On délibéra et on adopta la création de deux comités de gouvernement (un seul d’abord avait paru nécessaire, et on le décréta ainsi) ; l’un prit le titre de comité de Sûreté générale, l’autre de comité de Salut public. Celui-ci, fondé le 4 avril, reçut des pouvoirs ' illimités : il devint le centre de toutes les opérations; neuf membres devaient le composer ; les premiers élus furent Barrère, Delmas, Bréard, Cambon, Jean de Bry, Danton, Guyton de Morveau, Treilhard, de Lacroix. Trois suppléants leur furent adjoints; les premiers nommés étaient Cambacérès, Isnard et Lindel.
Robespierre, Sieyès, Condorcet, Quinette, Ducos, Genlis, etc., siégèrent aussi au comité de Sûreté générale. Robespierre, peu après, passa à celui de Salut public, dont il devint l’âme et dont il fit son levier pour bouleverser la France.
Dès ce moment, le meurtre régna. Ce fut la première fois qu’un peuple accepta un gouvernement, son ennemi direct, un gouvernement féroce, affamé de crimes, altéré de sang. Mais une institution manquait à ces hommes pervers, celle qui livrerait au supplice les victimes qu’eux-mémes désigneraient. En conséquence, parut un décret terrible, portant dans ses dispositions principales :
« Il sera établi un tribunal extraordinaire révolu-« tionnaire à Paris. Ce tribunal connaîtra de toute u entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 13 « à la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la « République, la sûreté intérieure et extérieure de « l’État, et de tous les complots tendant à rétablir la u royauté ou à établir toute autre autorité attenta-« toire à la souveraineté du peuple, soit que les accu-« ses soient fonctionnaires civils, militaires ou simples « citoyens. Les membres du jury seront choisis par la « Convention ; les juges, l’accusateur public, les deux « substituts, seront également nommés par elle. Une « commission de six membres de la Convention est char-« gée de l’examen des pièces et de la haute surveil-« lance sur les procédures. Le tribunal prononcera « sur la validité de la récusation des juges qui pourra « être faite par les accusés. La déclaration des jurés « sera rendue à la pluralité absolue des suffrages. Les « juges ne pourront rendre de jugements s’ils ne sont « au nombre de trois. Les jugements seront exécu-« tés sans recours au tribunal de cassation; les biens « des condamnés seront acquis au profit de la Répu-« blique. »
Ainsi l’on organisa cette boucherie de chair humaine , cette dérision sacrilège de la justice et de ses formes! Dumas, à qui chaque famille française pourrait demander compte du meurtre d’un des siens, fut le président du tribunal révolutionnaire. L’humanité frémit à son nom, chacun le prononce avec horreur, et pourtant il y avait là un être encore plus exécrable.
On mit en effet à la tète du parquet un de ces démons à face humaine nés pour le forfait et la barbarie. Fouquier-Tinville, né en 1747, Picard de naissance et procureur au Châtelet de Paris, se présente avec l’un de ces caractères extraordinaires qui étonnent par un mélange incroyable de bonnes et de

14
HISTOIRE
[1793.]
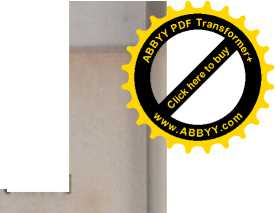
mauvaises qualités : sombre, cruel, atrabilaire ; ennemi impitoyable de tout mérite, de toute vertu ; jaloux, méchant, vindicatif; toujours prêt à soupçonner, à rendre plus dure la position de l’innocence; il paraît insensible à. tout sentiment de compassion et d’équité. La justice pour lui était la condamnation : un acquittement lui causait une affliction profonde ; il n’était heureux que lorsqu’il avait provoqué la mise à mort de tous les prévenus dont il devenait l’ennemi naturel ; il mettait de l’amour-propre à lutter contre eux. Leur fermeté, leur calme en présence des juges assassins, lui causaient des transports de rage qu’il ne prenait pas la peine de dissimuler. Mais avec tant de haine pour ce qui mérite l’amour et la vénération des hommes, il se montra insensible aux attraits de la fortune, aux douceurs de la vie privée; il ne connaissait aucun genre de délassement : les * femmes, la table, les spectacles, lui étaient indiffé
rents et comme étrangers. Sobre de nourriture, si parfois il s’enivrait c’était avec du vin commun. Les orgies auxquelles il prenait part devaient avoir un motif politique, celui, par exemple, de déterminer un feu de file (1); alors il était le premier à réunir les juges, les jurés, à provoquer le désordre des libations bachiques : le vin devait lui servir à faire verser du sang. Quand en effet l'arrêt rendu était complètement meurtrier, la figure de Fouquier-Tinville rayonnait, il devenait véritablement heureux. Travailleur
(1) La feu de file, dans l’argot jacobin, signifiait que le jury condamnerait en masse tous les accusés mis en jugement ce jour-là.
L. L. L.

[1793 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 15 infatigable, il ne se montrait dans aucune société, en aucun lieu public, au club à peine : sa place, disait-il, n’était pas là. Mais lorsque l’abondance de ses occupations surmontait son énergie, quand sa tête fatiguée se refusait à seconder les inspirations diaboliques de son cœur, alors il s’accordait un passe-temps, il allait, à quatre heures, voir tomber sur la place de la Révolution les têtes dont il avait obtenu la mort dans la matinée: cela, disait-il, l’amusait beaucoup.
Il dépendait de ce monstre de s’assurer une fortune énorme, il mourut pauvre; son mobilier vendu ne produisit pas six cents francs : il y avait chez lui l’aspect de la misère et en lui le mépris de l’or. Sa femme, en 1826, expira de faim dans l’allée d'une des maisons de la rue Saint-Martin. Je terminerai le portrait de ce personnage par sa réponse à Robespierre qui lui demandait ce qu’il pourrait lui offrir de plus agréable, lorsque le pouvoir aurait été concentré dans ses mains :
« Le repos, et du travail jusqu’à ce qu’il soit bien prouvé qu’il ne reste plus de têtes à faire tomber. »
Robespierre, ai je dit, s’empara de la direction du comité de Salut public de concert avec Couthon et Saint-Just; ces scélérats voulaient régner sur la France : le premier aurait eu la présidence, avec l’administration des ministères de l’extérieur, de la justice et des finances; Couthon aurait dirigé l’intérieur, et le troisième, la guerre : c’était ainsi que ces nouveaux triumvirs se partageaient déjà l’autorité sur notre malheureuse patrie.
Ce n’était pas pour en faire une longue sinécure que ces différentes créations avaient lieu. Le parti de la Montagne, déterminé à en finir avec les Royalistes et les Girondins, cherchait à les frapper simultanément

du même coup. Le 8 avril, la Convention décréta que tout député convaincu de délit national serait passible du tribunal révolutionnaire. Ce même jour on enleva à Égalité sa dernière ressource , en décrétant que tous les membres de la famille des Bourbons, hors les détenus au Temple, seraient envoyés prisonniers à Marseille.
Ceci n’avait pas eu lieu sans débat. Il faut reprendre les choses de plus haut.
Égalité inquiétait la Montagne, autrefois à sa solde et maintenant sa dominatrice ; on connaissait ses liaisons avec Dumouriez, l’intrigue nouée au profit de son fils: c’en était assez pour qu’on se débarrassât de tous ensemble. La déroute de Nervinde fut appelée trahison: une députation de la Convention nationale, composée de Camus, Quinette, Lamarque, Bancal, et du ministre de la guerre Beurnonville, vint ordonner à Dumouriez de se rendre à Paris pour se justifier de sa conduite. Lui, pour toute réponse, les lit arrêter et conduire aux avant-postes ennemis : il traitait avec les alliés, et il crut le moment convenable pour dévoiler son plan ; mais ses soldats, tous fanatiques révolutionnaires, refusèrent de lui obéir. Ses propres troupes se mirent à tirer sur lui, et, en une minute, ce nouveau Monck fut contraint à prendre honteusement la fuite. Lejeune Égalité ne déserta pas; il quitta seulement la France, et après s’être caché, il passa incognito en Suisse, sauvant ainsi la fortune de sa maison. Nous le retrouverons plus tard.
Cette nouvelle, parvenue à la Convention, y fit l’effet d’un coup de théâtre. Le général Valence, l’un des compagnons de Dumouriez, était gendre du député Genlis; ce fut un prétexte pour arrêter son beau-père.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
17

Le départ du jeune Égalité devint funeste à l’cx-duc d’Orléans ; il eut beau vanter son civisme, rappeler son ‘ vote, jurer d’imiter Brutus, on le mit en état d’arrestation chez lui, puis on l’envoya à Marseille avec ses deux fils, le prince de Montpensier et le comte de Beaujolais. Avec lui partirent pour la même résidence la duchesse de Bourbon, mère infortunée du duc d’En-ghien, honteuse d’être la sœur d’Égalité; le prince de Conti, homme sans caractère, petit-fils dégénéré d'un héros, qui conserva la vie parce qu’on dédaigna de la lui ravir, et qu’on exila en Espagne oit il mourut à Barcelone, en 1814, un moment avant la restauration.
La duchesse d’Orléans, si à plaindre d’être la femme d'Égalité, se trouva malade et obtint un sursis; plus tard, et lorsqu’elle eut fermé les yeux au duc de Pen-thièvre, son vertueux père, elle aussi passa les Pyrénées et ne rentra qu’après le retour de Louis XVIII.
Cette mesure foudroya Égalité ; il vit la chute de ses espérances et il continua à faire parade de républicanisme, ce qui l'avilissait de plus en plus. Brissot, qui le soutenait, essaya de perdre Marat. Les Girondins, harcelés par cette bête fauve, se joignirent à Brissot, et, le 13 avril, la Convention décréta .Maratd’accusation, comme aspirant à la tyrannie. Mais l’anarchie était trop puissante pour qu’on pût la vaincre dans son fils le plus cher. Le 24 du même mois, Marat, ayant paru devant le tribunal révolutionnaire, fut acquitté solennellement et ramené en triomphe, couronné de lauriers, au sein de celte assemblée qui avait voulu s’en délivrer.
Avant ce jour, les Montagnards, pour rendre la pareille à la Gironde, firent présenter à la Convention une demande signée par toutes les sections de Paris, pour que le procès fût fait également à Brissot, Ver-

18 HISTOIRE [1793.]
gniaud, Gensonné, Guadet, Valazé, Fauchet, Ponté-coulant, Lanjuinais, Mercier, etc., et autres, soit qu’ils fissent partie de la faction opposée, soit que leur mérite importunât les meneurs; l’assemblée en majorité déclara la pétition calomnieuse; son rejet inspira le besoin d’un coup de main, et, dès ce jour, le 31 mai fut préparé.
Pendant que la discorde agitait ainsi la prétendue représentation nationale, celle-ci multipliait les décrets désastreux. L’on créa, le 5 mai, douze cents millions d’assignats, qui augmentèrent d’autant la masse énorme de cette monnaie fictive déjà en circulation et que l’on avouait être de trois milliards cent millions, tandis qu’en réalité elle s’élevait au-dessus de sept et peut-être allait à huit milliards.
Les navires neutres chargés pour des ports ennemis étaient déclarés de bonne prise. Le 20 mai, parut l’emprunt forcé d’un milliard, qui devait en rapporter deux et pour lequel on n’accepterait pas le papier-monnaie. Les riches sertis, au terme de la loi, seraient passibles de cette avance. Où étaient-ils les riches eu ce moment? Le maximum fut mis en pleine activité ; on condamna à six ans de fers quiconque vendrait du numéraire; enfin la Convention en délire, semblable aux harpies de la Fable, s’attaquait à tout et souillait tout ce qu’elle touchait.
En vertu du principe de la souveraineté du peuple, la Convention abandonna la salle du manège et s’installa dans le château des Tuileries, à la salle de spectacle que l’on prépara exprès : le 10 mai, eut lieu cette translation. Là on porta la peine de mort contre toutdésappréciateurdu papier-monnaie; on ajouta de nouveaux pouvoirs à ceux confiés au comité de Salut
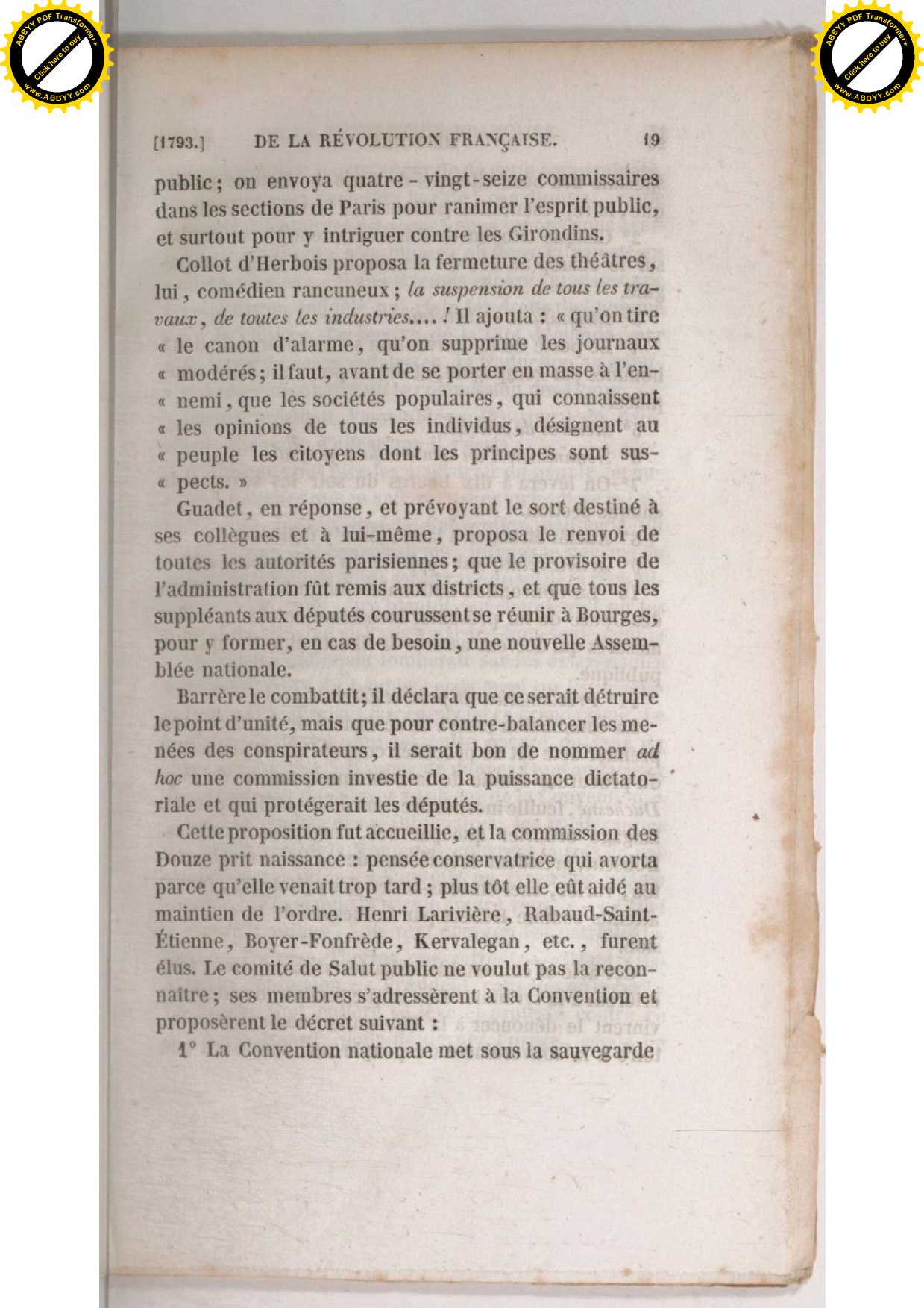
public; on envoya quatre-vingt-seize commissaires dans les sections de Paris pour ranimer l'esprit public, et surtout pour y intriguer contre les Girondins.
Collot d’Ilerbois proposa la fermeture des théâtres, lui, comédien rancuneux ; la suspension de tous (es travaux, de toutes les industries.... ' Il ajouta : « qu'on tire « le canon d’alarme, qu’on supprime les journaux « modérés; il faut, avant de se porter en masse à l’en-« nemi, que les sociétés populaires, qui connaissent « les opinions de tous les individus, désignent au « peuple les citoyens dont les principes sont sus-« pects. »
Guadet, en réponse, et prévoyant le sort destiné à ses collègues et à lui-même, proposa le renvoi de toutes les autorités parisiennes ; que le provisoire de l’administration fût remis aux districts, et que tous les suppléants aux députés courussent se réunir à Bourges, pour y former, en cas de besoin, une nouvelle Assemblée nationale.
Barrèrele combattit; il déclara que ce serait détruire le point d’unité, mais que pour contre-balancer les menées des conspirateurs, il serait bon de nommer ad hoc une commission investie de la puissance dictatoriale et qui protégerait les députés.
Cette proposition fut accueillie, et la commission des Douze prit naissance : pensée conservatrice qui avorta parce qu’elle venait trop tard ; plus tôt elle eût aidé au maintien de l’ordre. Henri Larivière, Rabaud-Saint-Étienne, Boyer-Fonfrède, Kervalegan, etc., furent élus. Le comité de Salut public ne voulut pas la reconnaître ; ses membres s’adressèrent à la Convention et proposèrent le décret suivant :
Io La Convention nationale met sous la sauvegarde
[1793.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
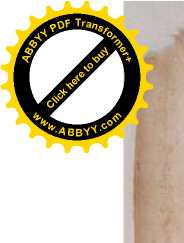
20
HISTOIRE
[1793.]

spéciale des bons citoyens de Paris la fortune publique , la représentation nationale et la ville de Paris.
2° Chaque citoyen de Paris sera tenu de se rendre sur-le-champ au lieu de rassemblement de sa compagnie.
3° Insignifiant et (le détail.
4° Le poste de la Convention sera renforcé de deux hommes par compagnie, et nul ne pourra se faire remplacer.
5° Mesures de célérité.
6° Nomination d'un commandant général.
7° On lèvera à dix heures du soir les séances de chaque section.
8° Aucun étranger à la section n’y délibérera.
9° Article relatif aux rapports des sections entre elles.
10° La Convention nationale charge la commission îles Douze de lui présenter incessamment les grandes mesures qui doivent assurer la liberté et la tranquillité publique.
11° Proclamation du présent décret.
La commission essaya de se donner de la force; son premier acte fut de procéder contre Hébert, substitut du procureur-syndic de la commune, auteur du Père Duchesne, feuille incendiaire, non moins infâme par son langage ordurier que par scs sanglantes maximes. Dobsent, président de la section de la Cité et vrai boutefeu , Varlet, chef en sous-ordre des agitateurs, furent atteints comme Hébert par la mesure de la commission.
Cet acte si convenable irrita les sans-culottes ; tous crièrent à la tyrannie. De chaque section, des députés vinrent le dénoncer à la Convention comme attentatoire à la souveraineté du peuple : on aurait cru que
[1'93.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 21
l’anarchie faisait partie intégrale de cette souveraineté. Un des orateurs (celui de la Cité) osa dire : «..... Le
« temps des plaintes est passé ; nous venons vous avera tir de sauver la république, ou nous la sauverons « nous-mêmes.... 11 en est temps encore ; punissez une a commission infidèle qui viole les droits de l’homme « et du citoyen. La section de la Cité demande, par « l’organe de ses mandataires, la traduction au tribuir nal révolutionnaire de la commission des Douze. »
Isnard présidait l’assemblée ; Provençal de naissance , Girondin d’affection, il s’écria :
« Puisque vous êtes les magistrats du peuple, écou-« tez les vérités que je vais vous dire au nom de la loi : a ..... S’il arrivait que la Convention nationale fût
« violée par des conspirateurs, je vous le déclare au « nom de la France,Paris serait rayé du sol de larépubli-« que... ; et, peut-être bientôt, on chercherait sur les « rives de la Seine si Paris a existé. Non-seulement la a vengeance nationale tomberait sur les assassins des « représentants du peuple, mais aussi sur les magis-« trats qui n’auraient pas empêché ce grand crime. Le « glaive de la loi, qui dégoutte encore du sang du « tyran , est prêt à frapper de nouveau tout audacieux « qui tenterait de s’élever au niveau de la Convention. »
Les hurlements des pétitionnaires, les vociférations des tribunes et delà Montagne, couvrent la voix de l’orateur. Marat dit :— « Vous êtes un tyran ! un infâme « tyran ! je demande la parole contre vous. » — « Oh ! « ajoute Couthon,l’on veut égorger les patriotes!» Challes, Thureau, Thuriot, poursuivent :— « Il faut résis-« ter à l’oppression.....Président, vous êtes un tyran ! » La gauche tout entière se lève et proteste contre ce discours. Isnard, pour détourner l’orage, essaie de
dire que l'ordre du jour est la convocation des assemblées primaires; Robespierre, avec véhémence, lui réplique : C’est la liberté qui est à l'ordre du jour.
Jamais l’assemblée n’avait été en proie à pareil tumulte. La voix tonnante de Danton s’élève au milieu de la clameur :
« Je déclare à la Convention et à tout le peuple a français que si l’on persiste à retenir dans les fers a des hommes dont tout le crime est un excès de pâte triolisme ; que si on refuse la parole à leurs défen-« seurs, nous tous, bons citoyens qui sommes ici, « résisterons.....Je proteste contre votre tyrannie, et « le peuple jugera. »
Danton en appelait au peuple ! voulait-il jouir du privilège refusé à Louis XVI dont c’était le droit. L'appel au peuple ! monstres, vous l’avez enseveli sous l’échafaud de Louis XVI !
Isnard se couvre; Bazire s’élance vers lui, dans le but avoué de lui arracher son chapeau. On refuse au président la parole. Legendre, en ancien boucher, attaque Guadet à coups de poing. Un incident augmente la confusion : la commission des Douze avait fait prendre les armes à plusieurs bataillons fidèles. Des députés ne purent sortir ; on cria des deux parts à l’oppression. Bientôt les sans-culottes accoururent en armes et plus nombreux. La Convention alors, réellement investie, céda à la terreur : elle laissa imprimer dans le Moniteur qu’elle avait décrété la dissolution du comité des Douze, ce qui était faux, quoique par le fait son impuissance, dès cette heure fatale, équivalût à une suppression.
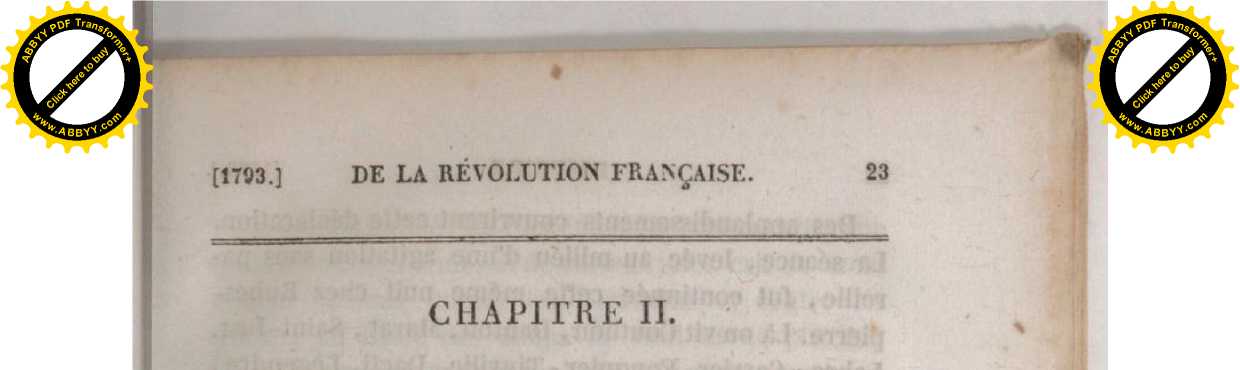
Séance du 29 mai à la Convention nationale. —Mot piquant de Lanjui-nais. — Danton jette le masque. — La Commune usurpe le pouvoir. — Knil du 30 au 31 mai. —Actes insurrectionnels à l'Evèché et à i Hôtel*
de-Ville. — Détails de la fameuse journée du 31 mai 1793.
Ce mouvement avait lieu le 28 mai; il continua pendant la nuit. Le lendemain, la ville de Paris ressemblait à une place de guerre : chacun était en armes. Le canon grondait, le tocsin y répondait. Les Girondins, parvenus au bord de l’abime, se virent perdus ; néanmoins peu d’entre eux abandonnèrent le champ de bataille. Isnard présidait encore la Convention ; Lanjuinais faisait entendre des paroles de sagesse, lorsque Legendre beugla plutôt qu’il ne dit : ,
« Il y a un complot formé pour faire perdre la
« séance ; si Lanjuinais ne cesse de parler, je déclare « que je vais le jeter en bas de la tribune. » — « Eh ! a citoyen, riposte le spirituel et ferme Breton, agis « légalement : fais décréter que je suis un bœuf, et puis « tu m’assommeras constitutionnellement »
Jean-Bon-Saint-André prétendit que la commission des Douze était une monstruosité contraire à tous les principes ; cependant au scrutin on la conserva à l’aide d’une majorité de deux cent soixante-dix-neuf votants contre deux cent trente-huit. A ce résultat, la Montagne déclare qu’on ne veut plus de cette tyrannie, et Danton, qui met de la franchise dans le crime, dit : « Après avoir prouvé que nous passons nos ennemis « en prudence, nous leur prouverons que nous les « passons en audace et en vigueur révolutionnaire. »

24 HISTOIRE [I793.J
Des applaudissements couvrirent cette déclaration. La séance, levée au milieu d’une agitation sans pareille, fut continuée cette même nuit chez Robespierre. Là on vit Couthon, Danton, Marat, Saint-Just. Lebas, Carrier, Fouquier - Tinville, Dacti, Legendre, Billaud-Varennes, Dumas, Fouché, Barrère, Tallinn, Romme, Collot d’Herbois, Cambon et quelques autres; Hébert, déjà mis en liberté, n’y manqua pas, non plus que Chaumette, Anacharsis Cloots, Benta-bolle, Jean-Bon-Saint-André, Merlin de Douai et tous les forcenés anarchistes ; là on détermina l’heure prochaine de la chute des Girondins. Ces hommes, sans vertus réelles, qui avaient froidement versé le sang du juste afin de laisser croire à leur républicanisme, qui, cause première des malheurs de la France, voulaient maintenant la sauver, la ramener au port, ne méritaient aucune pitié, et aucun d’entre eux ne trouva de défenseurs parmi ces Montagnards ennemis. La liste définitive des députés à proscrire fut arrêtée, et l’on remit au peuple excité le soin de poursuivre ces coupables dont d’autres criminels se séparaient.
De Louis XVI, la puissance avait passé à l’ Assemblée législative, qui ne la transmit pas à la Convention nationale; car, dès le 10 août 1792, la Commune de Paris s’en était emparée. Celle-ci, composée de tous les plus forcenés Jacobins, gouvernait la populace des faubourgs et le noyau des Marseillais , qui n’avaient pas encore quitté la capitale de la France. Grâce à ces auxiliaires, les magistrats municipaux, avec Robespierre et Marat, étaient les souverains réels. Ainsi, l’anarchie conduisait au despotisme ; ce qui arrivera nécessairement toutes les fois que la violence viendra se mettre à la place du droit.

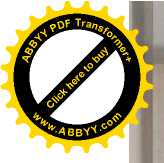
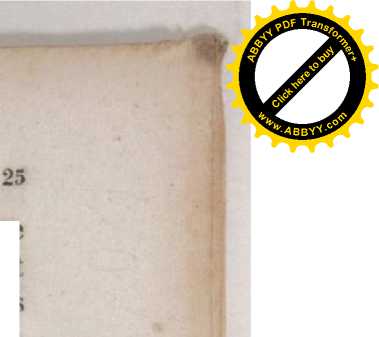
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
La nuil fut agitée ; les rues étaient parcourues par une foule d’hommes armés et de curieux ; des cris de mort étaient poussés contre les Girondins et contre les Douze; on tirait des coups de fusil et de pistolet. Bientôt, aux approches du jour, le canon gronda et l’on battit la générale ; l’air était calme et pur : le soleil du 31 mai brilla de son plus bel éclat. Le mouvement augmenta; dès le matin, les gardes nationaux prirent les armes : on avait dès la veille fermé les barrières , et aucune voiture ne roulait.
La terreur gagnait les esprits. Les Girondins, effrayés comme les autres, ainsi que les ministres, avaient passé la nuit hors de leurs maisons. Buzot, Louvet, Barbaroux, Guadet, Bcrgoing, Rabaud-St-Étienne, tous réunis et rassemblés dans une chambre à la butte des Moulins, yrestèrentla nuit entière, armés et défendus par des barricades. On ne les y tourmenta point; le courage leur revint, ils se rendirent de bonne heure aux Tuileries, et la séance s’ouvrit aus-’ sitôt.
Dès la veille, la Commune de Paris avait convoqué à l’Évêché les commissaires de toutes les sections, pqur y former Vunion républicaine. Là, ces factieux, opposés à d’autres rebelles, se déclarèrent endroit d’insurrection, et ordonnèrent que le tocsin recommencerait son glas sinistre, que la sortie de Paris serait interdite, et que la générale appellerait les citoyens à la défense de la patrie.
Le 31, Dobscnt, président du comité insurrectionnel, suivi des commissaires des sections, munis de pleins pouvoirs, paraît à F Hôtel-de-Ville et déclare au conseii-général assemblé que le souverain (le peuple) a annulé les pouvoirs de toutes les autorités. Il
H.
2

2G HISTOIRE [179:1.] dit, montre les actes, et après la vérification faite, le maire, les officiers municipaux, les membres du conseil-général, se retirent. Mais comme ceci n’était qu’une autre comédie convenue entre eux, dès cette marque de soumission donnée, Dobsent consulte ses acolytes, et tous conviennent que le corps municipal a bien mérité de la patrie, et qu’on peut le rétablir.
Cette jonglerie, inutile eu apparence, avait un but, celui de rendre les pouvoirs illimités, afin qu’ils pussent aider l’insurrection. Henriot fut ensuite nommé commandant en chef provisoire ; cet homme, exportier, ex-cocher, misérable, imbécile,méprisé, sans aucun talent et souillé de tous les vices; féroce et lâche, insolent et bas valet, capable d’égorger des malheureux désarmés, et hors d’état de combattre des troupes réglées; monstre toujours ivre, toujours furieux, et qu’on donna pour successeur au marquis de Lafayelte : c’était par trop rabaisser ce dernier.
En même temps, une haute-paie de quarante sous est promise à chaque citoyen qui, se rendant à la maison commune, combattra pour la cause de la liberté et de l’insurrection. Le paiement de cette canaille fut assigné sur les premiers fonds de l’emprunt forcé; ainsi on gaspillait cette unique ressource de la patrie. ,Quatre-vingt mille hommes, ou se rangeaient du parti des insurgés, ou (et c’étaient ceux des sections du Mail, delàButte-des-Moulinset des Champs-Elysées) se rendaient à leur place d’armes en gens qui n’ont pas encore pris un parti décidé. Cependant la contenance ferme de ces derniers inquiétait les Montagnards , qui, pour se renforcer, violèrent la loi qui punissait de mort ceux qui tireraient le canon d’alarme placé au terre-plein du

B

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 27 Pont-Neuf sans le commandement exprès de la Convention. Henriot, avec un groupe de misérables, ses complices, chassa la troupe qui gardait ces pièces, et bientôt après on entendit gronder le signal de la patrie en danger. La consternation remplit Paris, et le plus brave se crut à sa dernière heure.
Danton était à la tribune ; il préparait l’assemblée à recevoir la députation insurrectionnelle : dès qu’elle eut été admise, elle demanda la suppression des Douze, leur mise en jugement et l’épuration de la Convention nationale. La discussion s’engage : Malarmé, Dufriche, Valazé, Thuriot, Mathieu Cambon, s’injurient, s’attaquent et se défendent tour à tour. Les tribunes se mêlent à la querelle : leurs cris impératifs soutiennent l’émeute. Vergiiiaud, Rabaud, tâchent de rétablir l’ordre et d’obtenir le silence. On annonce une autre députation, celle de la Commune ; elle est introduite ; son orateur dit :
« Représentants, un grand complot a été formé, « mais il est découvert. Le peuple, qui s’est soulevé « au 14 juillet et au 10 août pour renverser la tyran-« nie, se lève de nouveau pour arrêter la contre-« révolution. Le conseil-général nous envoie pour vous a faire connaître les mesures qu’il a prises. La pre-« mière a été de mettre les propriétés sous la garde « des républicains ; la seconde, de donner quarante « sous par jour aux républicains qui resteront en armes ; « la troisième, de nommer une commission qui corres-« ponde avec l’assemblée. Dans ce moment de tu-« multe, le conseil-général vous demande d’établir « cette commission dans une salle voisine où elle puisse « se concerter avec vous. »
Répondre favorablement à cette prétention dernière


28 HISTOIRE [ 1793.]
était se donner de nouveaux maîtres; la Convention passait en tutelle. Guadet s’écria : « La Commune , en « prétendant qu’elle a découvert un complot, ne s’est « trompé que d’un mot, elle l’a exécuté..... » Les tribunes lui coupent la parole, la Montagne vocifère, et l’assemblée, cédant à la peur, accepte tout ce qui lui est intimé. Sa lâcheté rend l’insurrection plus exigeante ; chaque pas que le pouvoir fait en arrière est un pas que l’anarchie fait en avant.
Voici venir le faubourg Saint-Antoine : il prétend que la section de la Butte-des-Moulins, retranchée dans le Palais-Royal avec ses canons et son équipage de guerre, a arboré la cocarde blanche; il faut donc l’exterminer. Cependant il y a des pourparlers; on s’explique, on s’embrasse; ladite section renonce à défendre la représentation nationale, qui reste seule à se débattre contre les insurgés.
Barrère propose l’abolition de la commission des Douze ; alors une troisième députation de la Commune se présente, apportant F ultimatum résolu. Le procureur-syndic du département, Lhuillier, dit en s’adressant à la Convention :
« Depuis longtemps on calomnie aux yeux de l’uni-« vers la ville, le département de Paris. Les mêmes « hommes qui ont voulu perdre cette belle cité dans « l’opinion publique sont les fauteurs des massacres « de la Vendée ; ce sont eux qui soutiennent et qui « flattent les espérances de nos ennemis; ce sont eux « qui avilissent les autorités constituées, qui cher-« chcnt à égarer le peuple pour avoir le droit de s’en « plaindre ; ce sont eux qui vous dénoncent des com-« plots imaginaires, pour en créer de réels; ce sont « eux qui vous ont demandé le comité des Douze,

[1793.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
29

« pour opprimer le peuple; ce sont eux enfin qui, par a une fermentation criminelle, par des adresses conte trouvées, par leurs correspondances, entretiennent « les haines et les divisions dans votre sein... » Il poursuit, dénonce les projets fédéralistes, et demande justice d’Isnard, qui a dit : Pans sera rayé de la liste des cités. Enfin, il demande vengeance contre les Douze, contre beaucoup d’autres coupables,'et en désigne soixante-douze environ.
Grégoire présidait en ce moment. Il donne gain de cause aux insurgés, en invitant les chefs aux honneurs de la séance. Les députations victorieuses en vahissent l’enceinte, vont s’asseoir à la Montagne, et y fraternisent publiquement avec les membres leurs complices.
Les Girondins, ayant Vergniaud àleur tête et suivis de presque tout le côté droit, déclarent que la Convention n’est pas libre, et sortent de la salle. Quitter la partie, c’était la perdre. La Plaine, épouvantée, ne sait ce qu’elle doit faire ; à ce départ impolitique , la joie éclate sur la Montagne et dans les tribunes. Chabot veut l’appel nominal, afin que la France connaisse les déserteurs. Hélas! ceux-ci tardent peu il reparaître ; menacés au dehors par les section-naires go armes, ils rentrent, on les siffle, on les bafoue. Robespierre veut que le peuple soit satisfait avec promptitude et vigueur... «Concluez, lui cric Ver-« gniaud. — Prenez patience, répond l’orateur, je « vais conclure, et contre vous; contre vous, qui, « après la révolution du 10 août, avez voulu conduire « il l’échafaud ceux qui l’ont faite; contre vous, qui « n’avez cessé de provoquer la destruction de Paris, « qui avez voulu sauver le tyran; contre vous qui avez

30 HISTOIRE [1793.]
< conspiré avec Dumouriez.... Ma conclusion, c’est le « décret d’accusation contre tous les complices de Du-« mouriez et contre tous ceux désignés par les péti-« tionnaires. »
Cette apostrophe foudroyante anéantit Vergniaud; la Convention, entraînée par la terreur, et sachant qu’elle était investie, passa sous le joug. Un décret fut rendu, par lequel ou cassa la commission des Douze, avec ordre de saisir leurs papiers et de faire un rapport à ce sujet. Il était, en outre, statué dans ce décret, que la force armée (l’insurrection militante) serait maintenue, que les autorités veilleraient à la tranquillité publique, et qu’on enverrait aux départements une proclamation pour les éclairer sur les résultats de cette journée, que les royalistes ne manqueraient pas de calomnier.
La victoire demeurant à la Montagne, on crut que tout était fini. Il n’en fut rien cependant. Le lendemain, la commission de l’Évêché continua de s’assembler et de prendre des mesures menaçantes. A l’entendre, il fallait poursuivre l’insurrection, car les députés coupables étaient encore en liberté (1).
En effet, le 2 (c’était un dimanche), le canon d’alarme du Pont-Neuf gronde de nouveau, les cloches sonnent le tocsin, la générale est battue dans tous les quartiers; les bataillons armés débouchent sur la Convention et l’investissent; Henriot fait avancer l’artillerie, forte de cent soixante bouches à feu ; ou établit auprès des fourneaux, des grils pour chauffer les
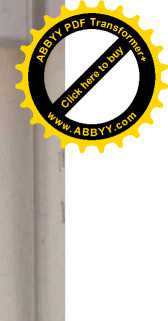
(I) Les membres de la commission des Douze, et vingt-deux autres députés, pris parmi les Girondins et ceux qu’on soupçonnait de royalisme. L. L. L.
[H93.J DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 31 boulets à blanc ; on rappelle clans Paris les demi-brigades qu’on envoyait dans la Vendée. Chaque soldat reçoit un corset (assignat de cent sous), et on les amène, eux aussi, dans la rue Saint-Honoré, le jardin, les cours des Tuileries et le Carrousel. Quatre-vingt mille hommes, aveuglés par le fanatisme, vont dicter des lois à ki Convention.
La Montagne et la Plaine y étaient au grand complet; tous les Girondins, excepté le courageux Barbaroux, avaient reculé devant le péril et se tenaient cachés. La séance est ouverte; Drouet, Jullien de Toulouse, Robespierre jeune, Legendre, se précipitent sur Lanjuinais, qui parlait, à la tribune, de justice, d’équité, de vertu ; ces furieux veulent l’on arracher. Cet odieux spectacle indigne les sans-culottes eux-mêmes. Jullien de Toulouse, seul, ne rougit pas. Pour distraire l’assemblée, les orateurs de l’émeute se présentent et prennent la parole :
« Depuis quatre jours, disent-ils, les citoyens de « Paris sont sous les armes; depuis quatre jours, ils « réclament auprès de leurs mandataires leurs droits « indignement violés, et depuis quatre jours, leurs « mandataires se rient de leurs plaintes. Il faut qu’on « mette les conspirateurs en état d’arrestation provi-« soire ; il faut qu’on sauve le peuple sur-le-champ, ou « il va se sauver lui-même. »
L’exaspération des Jacobins est au comble : on entend ces mots : Aux armes! aux armes! les femmes poussent des cris ; les lâches tremblent ; Lanjuinais, seul calme, se justifié; insulté de nouveau par Jullien et Drouet, il leur dit : « Le sacrificateur qui traînait « jadis à l’autel une victime, la couvrait de fleurs et « de bandelettes, et ne l’outrageait pas. » Mais que


34 HISTOIRE [1793.]
peuvent des mots contre la violence? La lutte continue; Lacroix, zélé Montagnard , voulant sortir de la salle, y est violemment repoussé ; il se plaint : les autres députés sont traités coinmelui. Boissy-d’Anglas a ses vêlements déchirés ; alors la majorité de l’assemblée voit constater son asservissement. Le président, Hérault de Séchelles, se transporte avec ses collègues auprès des canonniers, mais Ilenriot les repousse en leur disant : Canaille, vous ne sortirez pas que les vingt-deux et les Douze ne soient décrétés d’arrestation.
11 est faux, comme l’avance M. Thiers , que le président ait ordonné d’arrêter ce rebelle; au contraire, bien loin de lui faire tête, il se rendit au jardin, du côté du pont-tournant , pour s’assurer positivement de la situation critique où se trouvait l’assemblée ; mais là encore on lui déclara que la Convention était prisonnière. Marat accourt, fatigué de cette comédie : « Je « somme, dit-il, les députés qui ont déserté la salle « de rentrer à leur poste. » Ceux-ci obéissent; ils regagnent leurs sièges, pâles, consternés, abattus, car leur perte prochaine est positive. Alors Couthon, avec une effronterie qu’on a peine à concevoir, apostrophe ainsi l’assemblée :
« Représentants, vous le voyez, le peuple vous « obéit et vous respecte ; vous êtes libres; rien ne doit « vous empêcher de voler légalement sur la question « qui vous est soumise : hâtez-vous de combler les « vœux des bons citoyens. » Le vole a lieu, et tous les députés proscrits par le comité de l’Évêché le sont par leurs propres collègues. La liberté n’existe plus que de nom ; elle fait place au règne absolu de l'arbitraire. Les députés ainsi sacrifiés essayèrent de se soustraire par la fuite à la mort qui les menaçait. On
[1793.] DE LA RÉVOLUTION' FRANÇAISE. 33 apprit l’évasion des ministres Lebrun, Roland et Cía-vieres, des députés Brissot, Bergoing, Buzot, Chambón , Corsas, Grangeneuve, Larivière, Laborie , Lesage, Louvet, Lydon, Rabaud-Saint-Étienne, Vigée. On arrêta Vergniaud, Gensonné, Pétion, Valazé, Bi-roteau, Guadet, Gardien, Boileau, Bertrand, Molle-vaut, Gomaire; mais quelques-uns d’entre eux trouvèrent moyen de s’échapper.
Les députés libres se réfugièrent dans le Calvados et dans l’Eure. La ville de Caen se déclara insurgée contre la Convention; la guerre civile était ouverte par ceux-là mêmes qui accusaient les Vendéens de défendre leur culte et le trône des rois; ils organisèrent un point de résistance, se flattèrent de vaincre en s’appuyant sur les soulèvements révolutionnaires de Lyon et de Marseille qui avaient lieu à cette époque et dont je parlerai plus loin ; mais les Girondins étaient condamnés irrévocablement. Mandataires égarés, ils allaient porter la peine de leurs fautes; ils allaient être frappés par leurs propres complices, qui devaient bientôt, eux aussi, s’exterminer les uns les autres.
Soixante-treize conventionnels se récusèrent et protestèrent contre les journées du 31 mai et du 2 juin. Cet acte de courage amena leur proscription. Ils furent mis en état d’arrestation ; mais la journée du 9 thermidor les sauva. Parmi ceux qui avaient été déjà condamnés, comme ayant fait partie des Douze ou des Vingt-deux, Brissot, Pétion, Buzot,Duchûtel, Barbaroux, cherchèrent un asile dans les départements ; ils se dispersèrent en tous sens, en Normandie, en Bretagne, à Bordeaux, à Nîmes, à Marseille.
La Normandie reçut la plus grande partie des proscrits. Brissot, Barbaroux, Guadet, Louvet, Salles,
2,
34 HISTOIRE [1793.]
Péliooj Bergoing, Lesage, Cassy, Kervalegan, se retirèrent au chef-lieu du Calvados (Caen). Les administrations de l’Eure, de l’Orne, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, de la Mayenne, de la Loire-Inférieure , d’Ille-et-Vilaine , se constituèrent Assemblée centrale de résistance cl l'oppression. Félix Wimpffen, général au service de la république, organisait une armée le long de la côte de Cherbourg. On eut la témérité de lui offrir le commandement en chef des forces de VAssemblée centrale : capitaine aussi présomptueux que médiocre, il eut celle de l’accepter.
Wimpffen était né d'une famille noble de Deux-Ponts. Entré au service, il se distingua parsa bravoure en Corse, à Mahon, à Gibraltar, en Amérique. Devenu général, il fut licencié à la paix de 1783. Le bailliage de Caen le nomma aux États-généraux. Mécontent de la cour, il prit part aux actes hostiles de la minorité de la noblesse et marcha ensuite avec les révolutionnaires.
Rentré depuis 1790 au service avec son ancien grade, il défendit Thionville en 1792 contre la coalition, et rejeta l’offre d’un million qui lui fut faite par l’ Autriche. Après cinquante-cinq jours de siège, la place fut délivrée. La Convention décréta que 'Wimpffen avait bien mérité de la patrie. Il refusa le ministère de la guerre et se rendit quelque temps après à Cherbourg, où il £ se lia avec les proscrits. Il écrivit à Custine pour l’en
traîner dans son parti, aux Parisiens pour les détacher des démagogues, se vanta d’avoir bientôt sous ses ordres une armée de soixante mille hommes, et ne fit absolument rien, soit imprévoyance, nullité ou trahison. Use laissa surprendre et battre à Pacy-sur-Eure, futpris, mais se sauva, et ne reparut qu’après le 18 brumaire. Il reprit du service et mourut ignoré en 1814.
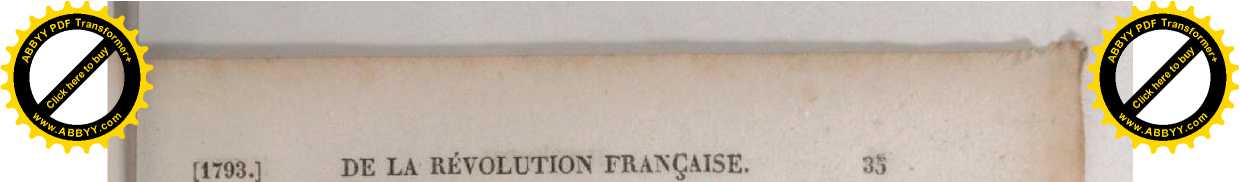
Les députés vaincus furent saisis ou traqués. Le vertueux Pétion alla mourir dans un champ, où les loups le dévorèrent; d’autres se tuèrent de désespoir; le reste s’évada et périt çà et là de faim, de misère ou sur l’échafaud. La justice de Dieu fut prompte et complète.
C’était une époque terrible où les passions exaltées se déchaînaient, où le prétendu patriotisme n’était que de la rage, et où la résistance se montraitsous le caractère de la faiblesse : lutte effroyable, où chaque jour on immolait des victimes au nom de la liberté, où le peuple était esclave et où l’égalité n’existait que parmi les assassins. Il faut avoir été témoin de ces horribles catastrophes, pour s’en faire une idée. Tout autre pouvoir, quelle que soit son origine, lui sera toujours préférable. Malheur et exécration à qui doterait de nouveau le pays d’un semblable gouvernement !
Oui, je le répète, cette époque ne ressemble à aucune autre. J’ai vu la main de fer de Napoléon, j’ai assisté à la terreur de 1815, faible image de ces trois sanglantes années ; je me suis toujours indigné lorsqu’au second retour du roi,'j’entendais comparer la justice du souverain à l’aveugle furie du jacobinisme. La France, depuis 1792 jusqu’au mois d’août 1794, fut constamment sillonnée par la foudre révolutionnaire. La plus chétive commune eut ses dénonciateurs, ses spoliateurs, ses victimes et ses bourreaux. Souvent le ridicule se mêlait à l’atroce.
Sur le clocher d’un village du Limousin flottait le drapeau tricolore obligé... il disparaît... grande rumeur. On le cherche ; vingt suspects sont arrêtés ; c’est un complot conçu d’intelligence avec Pitt et Cobourg.... lorsqu’un paysan, errant dans la forêt voisine, aperçoit des lambeaux d’étoffe bariolée qui pendent à la cime
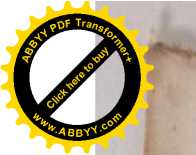
36 HISTOIRE [1793.] d’un arbre; on y grimpe, el l’on y trouve un nid de pie ; l’oiseau voleur a fait une couche molle à sa progéniture avec le drapeau national... Oli ! la bête sacrilège, royaliste et liberlicide! on la saisit, on la décapite , et du tout on dresse procès-verbal qu’on envoie à la Convention : et celle-ci félicite la commune de Saint-Yrieix de son civisme.
Des lois favorables aux mauvaises mœurs furent rendues; on encouragea la débauche; on renouvela les erreurs impies du polythéisme : la liaison fut une déesse dont l’échafaud devint l'autel. Quiconque était vertueux périssait du dernier supplice; on honorait la délation. Oh! l’horrible époque! qui la regrette est l’ennemi de la France et mérite un sévère châtiment.
L’acte le plus insensé de cette ère de crimes et d’extravagance fut la rédaction de la Constitution de 1793. Jamais la folie la plus délirante ne produisit une œuvre pareille. Les misérables qui la rédigèrent en eurent une telle frayeur, qu’ils ne purent se résoudre à en faire l’application. C’était l’anarchie complète avec ses aberrations et ses fureurs; c’était le bon sens immolé à la démagogie. Robespierre en eut honte, et, après le 9 thermidor, on se hâta de l’annuler. Ainsi, depuis le 10 août jusqu’à ce jour, la France n’eut pas de loi fondamentale ; elle exista sans constitution , selon le bon vouloir de ceux-là mêmes qui avaient renversé la puissance absolue.
La victoire remportée par la Montagne à Paris n’avait pas d’échos aux armées. La Vendée faisait des progrès; le combat d’Arion devenait mutile ; les Autrichiens prenaient Condé (13 juin) ; les Espagnols, Belle-garde (24 juin) ; Lyon, Marseille, se maintenaient dans leur révolte ; enfin le 13 juillet, Marat, l’infâme Marat
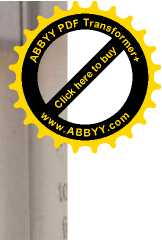
■
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 3T tombait frappé du poignard de Charlotte Corday. Celte fille étrange, issue d’une famille noble, républicaine par principes, sans religion aucune, forma le projet de délivrer la France de Fun de ses bourreaux. Exaltée par la conversation des députés réfugiés à Caen, elle arrive à Paris, sollicite un rendez-vous.de Marat qui le refuse; elle insiste, vient chez lui pendant qu’il prenait un bain, est introduite, et tandis que le scélérat lit un papier qu’elle lui a remis, Charlotte Corday lui plonge un poignard dans le sein. Marat crie au secours ; mais la blessure est mortelle, il expire. La vierge stoïque n’essaie pas de fuir; on l’arrête, on lui fait son procès, et elle va au supplice du même air dont elle aurait été à une fête républicaine.
La mort de Marat épouvanta les Jacobins. Privés de leur complice, ils en firent un dieu. Son corps fut porté au Panthéon, d’où l’indignation populaire devait l’exhumer un jour pour le jeter dansl’égout de lame Montmartre. Son cœur, mis dans une urne d’agate, reçut d’abord au Luxembourg, puis au Carrousel, les honneurs de l’apothéose. Il veut des litanies au saint cœur de .Marat, et je n’ose pas répéter jusqu’à quel point ces misérables fanatiques poussèrent leur impiété sacrilège.
Le châtiment de Marat fut en pure perte, ou plutôt il servit de prétexte à d’autres assassinats non moins criminels, quoique juridiques en apparence. Franchet, Duperret, périrent parce que Charlotte Corday les avait connus.
Audouinle conventionnel, le chevalier de Cubières, chantèrent le grand homme immolé ; le sculpteur Beau-valet modela son buste, dont la Convention décora son enceinte. David , en peignant Marat expirant, fit un

38
HISTOIRE
[1793.]
horrible chef-d’œuvre. Au reste, il ne possédait au moment de sa mort qu’un assignat de vingt-cinq sous. Sa concubine, que, suivant Chaumette, il avait prise pour femme un jour de beau temps et à la face du soled, obtint une pension sur l’État.
Cet événement mit la discorde entre deux hommes jusque-là unis,Robespierre et Danton; le premier, aspirant à la tyrannie, sentit qu’il n’y parviendrait pas tant qu’il aurait devaut lui ce terrible adversaire. Couthon, Coflinbal, Saint-Just, Lebas, Henriot, étaient les appuis de Y incorruptible. Avec eux, il espérait faire oublier les qualités qu’il n’avait pas; l’échafaud d’ailleurs devait le délivrer de tous les généraux dont la renommée ferait ombrage à son ambition. Ce fut la cause de la mort de Custine, de Luckner, de Biron, d’Alexandre de Beauharnais, de Westermann, de tous les guerriers, en un mot, qui marquaient alors.
• Il ne laissa pas non plus en repos les hommes d’un grand nom, mais sans talents, et ceux dont le mérite augmentait l’illustration. Il attaqua les célébrités contemporaines , et au moment même où elles tombaient sur l’échafaud, il envoyait au supplice les républicains dévoués, ceux dont la conduite révolutionnaire était irréprochable. Il voulait seul gouverner la France : voilà pourquoi l’adroit conventionnel cherchait à se '. débarrasser de ses complices.
Tels étaient les deux hommes qui allaient se disputer le pouvoir dont Marat en mourant avait rompu l’équilibre. D’un côté, il y aurait audace, irréflexion, confiance ; de l’autre, dissimulation profonde, opiniâtreté constante, ruse satanique. Danton agirait ouvertement ; il transporterait le combat au milieu de la place publique et descendrait, s’il le fallait, dans l’arène.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
39

Robespierre , suivant une route opposée, ferait une guerre sourde, cachée, obscure, qui au besoin pourrait être désavouée sans néanmoins la suspendre un moment. 11 n’attaquerait pas son adversaire en face, mais il ferait si bien jouer ses ressorts que la fortune finirait par se ranger de son côté.
La république se trouvait dans une position périlleuse ; la Montagne voyait avec effroi arriver à Paris les députés des sections primaires, ceux-là mieux que tous autres revêtus du véritable caractère de représentants du peuple souverain. Le bruit se répandit qu’ils se proposaient de chasser la Convention et de se mettre à sa place. On employa contre eux la ruse et la violence ; on ferma les barrières; on les mit en chartre privée, tandis qu’on écartait ceux qui auraient pu les éclairer; on les environna de Jacobins, de femmes perdues; on les amena à l’Évêché ; on entendit les plaintes des départements; on promit d’y satisfaire; on s’embrassa, on fraternisa, et ces députés, ainsi séduits, s’en retournèrent ardents révolutionnaires et chargés d’amples pouvoirs, afin de mettre au pas leurs concitoyens.
Danton, à qui les moyens de terreur avaient bien réussi, eut l’idée d’une levée en masse. Il fit monter d’abord à la tribune l’orateur des députations primaires qui prononça le discours suivant : « Citoyens repré-
«
« a « a
sentants. depuis quatre ans nous combattons pour la liberté, et cependant elle n’est encore qu’un vain nom dont les tyrans se jouent; leurs infâmes cohortes occupent notre territoire. Le moment est venu de donner un grand exemple à l’univers... Faites un appel au peuple ; qu’il se lève en masse, lui seul peut anéantir les ennemis. Il n’est plus temps
40
HISTOIRE

« de délibérer, il faut agir. Nous demandons que tous « les hommes suspects soient mis en arrestation et « précipités aux frontières, suivis de la masse terrible « des sans-culottes. Là, placés au premier rang, ils com-« battront pour la liberté qu’ils outragent depuis quatre « ans, ou ils seront immolés par le canon des tyrans. « Leurs femmes, leurs enfants, les infirmes, les a ieil-« lards, seront mis sous la sauvegarde de la loyauté « française et seront gardés en otages par les femmes et « les enfants des sans-culottes. Nous demandons que « le principe de cette proposition soit décrété sur-le-« champ, et que le comité de Salut public soit chargé « du mode d’exécution. Citoyens, n’accordez aucune « amnistie aux coupables, ne transigez pas avec les « despotes ; alors les tyrans coalisés contre la liberté « du peuple français s’évanouiront devant lui comme « un vain songe. »
Danton répliqua : « Les députés des assemblées « primaires viennent d’exercer parmi nous l’initiative « de la terreur contre les ennemis de l’intérieur, ré-« pondons à leur voix. Non, point d’amnistie aux trai-« 1res! L’homme juste ne fait pas de grâce au mé-« chant.... On vous dit qu’il faut se lever en masse; m oui, sans doute, mais avec ordre.... C’est à coups « de canon qu’il faut signifier la constitution à nos en-« nemis.... Je demande que l’on mette eu arrestation « tous les hommes véritablement suspects, unáis que « cette mesure s’exécute avec plus d’intelligence qu’on « ne l’a fait jusqu’à présent, ou, au lieu de saisir les « grands scélérats, les vrais coupables, on n’aura ar-« rété que des hommes plus qu’insignifiants. Qu’une « première levée en masse de quatre cent mille < hommes pour la seule armée du Nord soit décrétée. »

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 41
Ou l’applaudit; l’assemblée, les tribunes, se lèvent par un mouvement spontané, et on approuve cette terrible mesure. Robespierre, jaloux dotant de popularité, ajoute :......« Nous avons été trop indul-
« gents envers les traîtres. C’est à l’impunité des Du-« mouriez, des Lafayette,des Custine, que les tyrans « doivent leurs triomphes et nous nos alarmes. La « seule mesure à prendre est de balayer nos armées des « aristocrates. Ne craignez pas de ne pouvoir les rem-« placer : trois héros suffiront à sauver la république , « ils sont cachés dans nos rangs ; qu’on les y cherche... « Comment déjouer les conspirateurs s’ils sont sûrs de « l’impunité, et s’il faut des mois entiers pour pro-« noncer leur condamnation ? Que la tête de Custine, « tombant sous le glaive de la loi, soit le garant de « la victoire ; que ce glaive, planant avec rapidité sur « la tête des conspirateurs, frappe de terreur leurs « complices..... Il faut stimuler le zèle du tribunal « révolutionnaire, il faut lui ordonner de juger les « coupables vingt-quatre heures après la remise des « pièces; il faut plus, il faut multiplier son action... « Je demande que lorsque l’on a arrêté un homme « prévenu, on ne le relâche pas le lendemain sur des « prétextes frivoles. Je demande que la France, les « administrations, les armées, soient purgées des traî-« tres; que l’on poursuive sans relâche les conspira-« teurs; que les commissaires, dont le patriotisme est « bien connu, remplacent les administrations contre-« révolutionnaires par les martyrs des arrêtés liber-« ticides de ces ennemis de la patrie. »
Custine, ainsi poursuivi, périt le 28 août 1793. Homme de qualité, né en 1740, sous-lieutenant à sept ans, à huit faisant une campagne avec le maréchal de

12 HISTOIRE [1793.]
Saxe, commandant à dix-huit les avant-gardes, cité avec éloge par Frédéric le Grand, illustré dans la campagne d’Amérique, député aux États-généraux, il y fit partie de la minorité; chargé d’un commandement en chef, il s’illustra par la prise de Mayence. Sa sévérité lui fit des ennemis: en vain il se mit sous le patronage de la Montagne; Robespierre, qui voulait sa mort, l’en écarta, et celui-là aussi mourut avec le regret d’avoir servi une cause ingrate.
Mais ces meurtres, ces fureurs, ne procuraient pas ce qui fait le nerf de la guerre, l’argent. Cambon imagina un moyen infernal. Les assignats étaient presque sans valeur; les emprunts devenaient impossibles; les capitalistes, dans la crainte du retour de l’ancien gouvernement qui sans doute se refuserait à payer les dettes de l’anarchie, serraient les cordons de leur bourse. Or, pour les amener à la dénouer, il convenait d’introduire dans les inscriptions de toutes les dettes tant anciennes que modernes une telle confusion, que l’on ne pût retrouver ni l’origine ni la trace d’une priorité quelconque, ni rien confondre, ni rien perdre de ce qui dorénavant serait déterminé.
Cambon, en conséquence, proposa et fit adopter le mode suivant : tout emprunt de gouvernement, de province, d’états, de villes, de corporations, de caisses, à telle ou telle époque, dans tel ou tel but, à telle ou telle condition, serait anéanti dans le titre original et remplacé par une suscription muette et sans énonciation de cause de rente sur l’état, au denier cinq et au capital de cent mille francs. Là on accumulait les remboursements de charges, cautions, finances, consignations, dépôts, en un mot, tout ce dont l’État avait à payer la rente.


[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
¿3
Cette mesure à laquelle il fallait se soumettre sous les peines les plus graves , nonobstant la perle de la créance, présentait, malgré sa rigueur, une équité apparente; elle assurait ce qui était incertain, régularisait des opérations immenses et apportait dans la comptabilité un ordre que jusque-là on n’y avait pas connu. Les mois de mars et de septembre étaient désignés pour le paiement de l’intérêt. Cette régularité plaisait à tout le monde: aussi la loi passa-t-elle à une immense majorité.
Elle devança l’emprunt d’un milliard ; emprunt forcé, et qui produisit une plus forte somme que celle qu’on avait énoncée. Il s’agissait de retirer de la circulation une masse énorme d’assignats qu’il fallait détruire. On arrêta que dans chaque famille riche on laisserait intact un revenu de mille francs par tête, savoir : mille pour le mari, mille pour la femme, et autant pour chacun des enfants; au-dessous d’un revenu de dix mille francs, le dixième appartenait à l’emprunt, mais tout ce qui dépassait dix mille francs et les mille par tête appartenait de droit, pour cette année, au trésor de l’État. Ainsi le propriétaire de cent mille francs de rente, ayant sa femme et quatre enfants, gardait d’abord six mille francs pour les six têtes, puis neuf mille sur les dix premiers mille, et abandonnait à la patrie les quatre-vingt-cinq mille francs restants; et des charges, des pensions, des intérêts de dettes, des remboursements à termes, pas un mot. Cela s’appelait une mesure révolutionnaire ; et on envoyait à la mort le récalcitrant.
Des événements politiques survenus à cette époque légitimèrent aux yeux des meneurs ces actes d’une tyrannie insupportable. Toulon ayant proclamé
Louis XVII, s’était rendu aux Anglais. La Vendée luttait et se débordait dans la Bretagne ; Lyon était en pleine révolte. Dans cette ville, un monstre nommé Ghalier avait, à force d’exécutions, poussé à bout la patience des Lyonnais : ils l'avaient arrêté, jugé, condamné, exécuté; puis, prenant les armes, ils s’étaient déclarés indépendants de la Convention opprimée. Le début du mouvement fut républicain.
Des années nombreuses investirent cette malheureuse ville, qui se défendit avec un acharnement héroïque. Cent mille hommes, tour à tour commandés par Dubois-Crancé, Kellermann, Dumay, la bombardèrent pendant près de deux mois. Les flammes avaient dévoré l’arsenal, la place Bellecour, le grand hôpital, le quartier Saint-Clair, le port du Temple, et Lyon se défendait encore. Mais l’insurrection, commencée dans le système républicain, ne tarda pas à suivre une autre route. Les royalistes dominèrent dans Lyon. Le drapeau blanc remplaça le drapeau tricolore. On appela M. de Precy (1) pour prendre le
(t) Louis - François Perrin, comte de Precy, né à Semur en 1742, se distingua dans les guerres d'Allemagne de 1755 à 1762, et dans celle de Corseen 1785. Commandant des chasseurs des Vosges , il fut nommé en 1791 lieutenant-colonel de la garde constitutionnelle de Louis XVI. Au 10 août, il se battait parmi les Suisses, et le roi, le voyant à ce dernier moment, lui dit : Ah! fidèle Precy! Chargé par les Lyonnais du commandement de leur ville, il se signala par des faits de haute vaillance et de science consommée. Sa retraite fut celle d’un héros. Caché pendant huit mois dans un souterrain, il émigra , et en 1810 obtint sa rentrée. Il fut depuis nommé cordon rouge et lieutenant-général, commandant-général des gardes nationales de Lyon et du Rhône. Il mourut à Marcigny en 1820. Le roi Louis XV lit lui permit de prendre pour devise les mots que son auguste frère lui avait adressés au 10 août 1792. L. L. L.
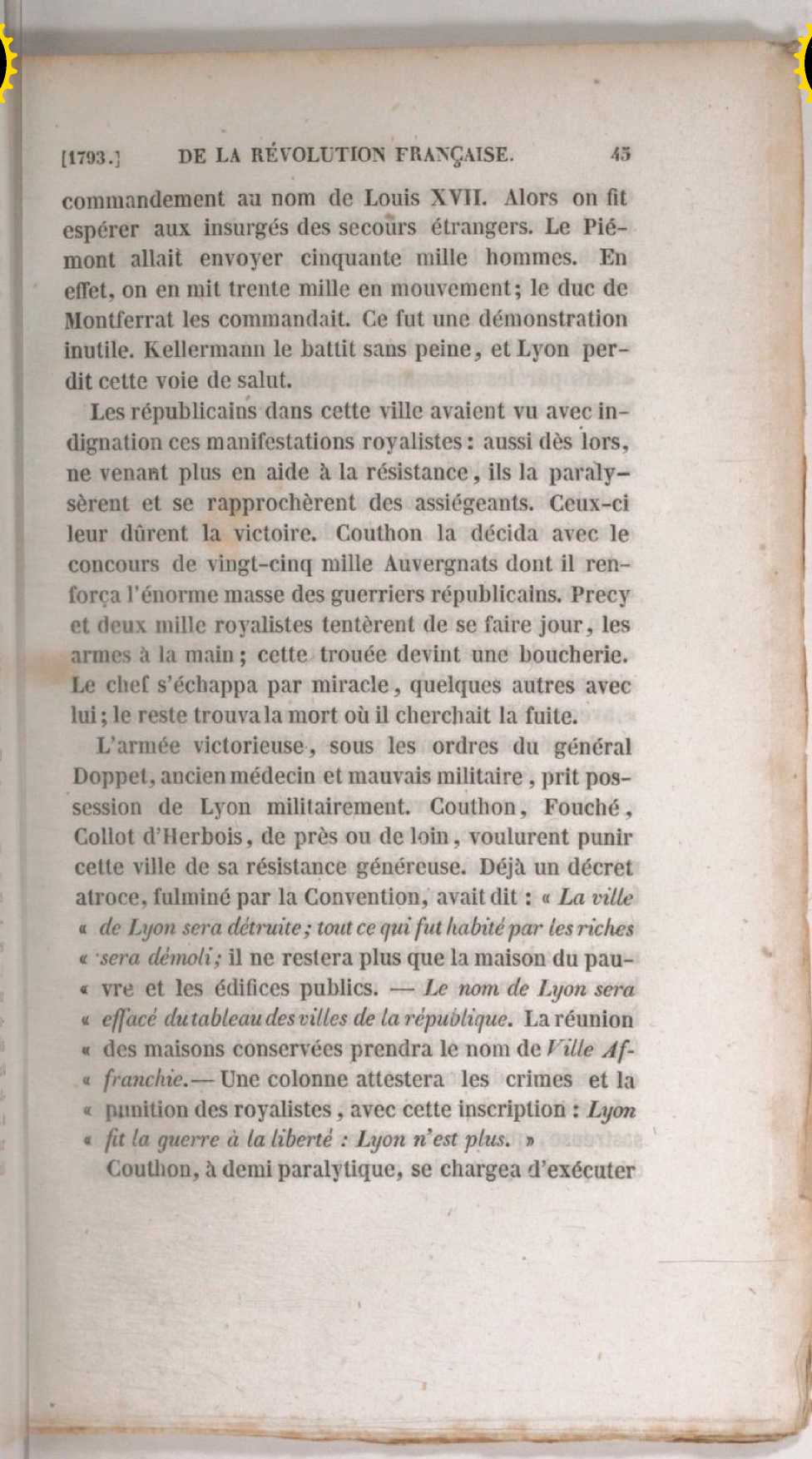
commandement au nom de Louis XVII. Alors on fit espérer aux insurgés des secours étrangers. Le Piémont allait envoyer cinquante mille hommes. En effet, on en mit trente mille en mouvement; le duc de Montferrat les commandait. Ce fut une démonstration inutile. Kellermann le battit sans peine, et Lyon perdit cette voie de salut.
Les républicains dans cette ville avaient vu avec indignation ces manifestations royalistes: aussi dès lors, ne venant plus en aide à la résistance, ils la paralysèrent et se rapprochèrent des assiégeants. Ceux-ci leur dûrent la victoire. Couthon la décida avec le concours de vingt-cinq mille Auvergnats dont il renforça rénorme masse des guerriers républicains. Precy et deux mille royalistes tentèrent de se faire jour, les armes à la main ; cette trouée devint une boucherie. Le chef s’échappa par miracle, quelques autres avec lui ; le reste trouva la mort où il cherchait la fuite.
L’année victorieuse, sous les ordres du général Doppet, ancien médecin et mauvais militaire, prit possession de Lyon militairement. Couthon, Fouché, Collot d’IIerbois, de près ou de loin, voulurent punir cette ville de sa résistance généreuse. Déjà un décret atroce, fulminé par la Convention, avait dit : « La ville « de Lyon sera détruite; tout ce qui fut habité par les riches « sera démoli; il ne restera plus que la maison du pau-« vre et les édifices publics. — Le nom de /.yon sera « effacé dutableau des villes de la république. La réunion « des maisons conservées prendra le nom de Ville Af-« franchie.— Une colonne attestera les crimes et la « punition des royalistes, avec cette inscription : Lyon • fit la guerre à la liberté : Lyon nest plus. »
Couthon, à demi paralytique, se chargea d’exécuter
[1793.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

HISTOIRE
[1793.]

celle sentence. Il se fit porter sur un fauteuil en face des maisons de la place Bellecour, et, frappant chaque porte d’un marteau, il s’écriait : Ait nom de la loij sois renversée. Fouché écrivait à la Convention :
« .....Convaincu qu’il n’y a d’innocent dans cette « infâme cité que celui qui fut opprimé ou chargé de « fers par les assassihs du peuple, nous sommes en a garde contre les larmes du repentir.....Les démoli-« tions sont trop lentes. Il faut des moyens plus race pides. L’explosion de la mine et l’ardente activité « delà flamme peuvent seules exprimer la toute-puis-« sanee du peuple..... elle doit avoir l’effet du fonce nerre..... Le peuple sera vengé ; notre courage « répondra à sa juste impatience. Le sol qui fut rougi « du sang des patriotes sera bouleversé.....et sur les ce débris de celte ville rebelle et superbe, qui fut assez « impie pour vouloir un maître, le voyageur verra « avec satisfaction quelques monuments simples élevés « à la mémoire des martyrs de la liberté, et des chau-« mières éparses que les amis de l’égalité viendront « habiter pour y vivre des bienfaits de la nature. »
Les effets répondirent aux paroles. On égorgea en masse les Lyonnais à la plaine des Brotleaux. Les échafauds ne pouvant suffire au nombre des victimes, on en noya dans le Rhône; on en mitrailla un grand nombre : beaucoup d’autres périrent de la main du bourreau. On n’épargna ni le sexe, ni l’âge. Les enfants, les adolescents, les vierges, les femmes enceintes, furent immolés, et cinquante mille habitants, ou morts ou en fuite, disparurent de cette ville infortunée !
La violence des partis était telle à celte époque désastreuse , que ces exécutions infâmes furent commandées par les prétendus amis de ia liberté et de l’égalité.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

47
Mayence s’était rendue le 23 juillet aux Prussiens. Le 28, Valenciennes était également tombée au pouvoir des troupes de l’Empereur. Coudé, dès le 13 j uin, avait eu le même sort, et les drapeaux autrichiens et la prise de possession de ces deux dernières cités, au nom de François II, annoncèrent que la guerre ne se faisait plus pour les intérêts de la maison de Bourbon.
Ces malheurs consternaient les Jacobins. Ils crurent que des mesures féroces relèveraient l’esprit p ublic, et le comité chargé des intérêts de la république invita Barrère à faire à la Convention le rapport de ce qu'avait résolu ce capia mortuum du sans-culottisme. Ce fut le 1er août que ce misérable, montant à la tribune , y présenta cinq projets de loi ; le premier disait :
«
«
«
« u « « a « «
« Marie-Antoinette est renvoyée au tribunal révolutionnaire. Elle sera transférée sur-le-champ à la Conciergerie. Tous les individus de la famille des Bourbons seront déportés, à l’exception des deux enfants de Capet et de ceux qui sont sous le glaive de la loi. Élisabeth Capet ne sera déportée qu’après le jugement de Marie-Antoinette. La dépense des deux enfants de Louis Capet sera réduite à ce qui est nécessaire pour l’entretien et la nourriture de deux individus; les tombeaux des ci-dcvaht rois qui sont à Saint-Denis et dans les autres églises seront détruits le 10 août. »
Le second article faisait partir la garnison de Mayence
en poste pour la Vendée : on disait ensuite : « Il y sera envoyé (dans la Vendée) par le ministère de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis, les genêts; les forêts seront abattues; les repaires des brigands seront détruits;
J
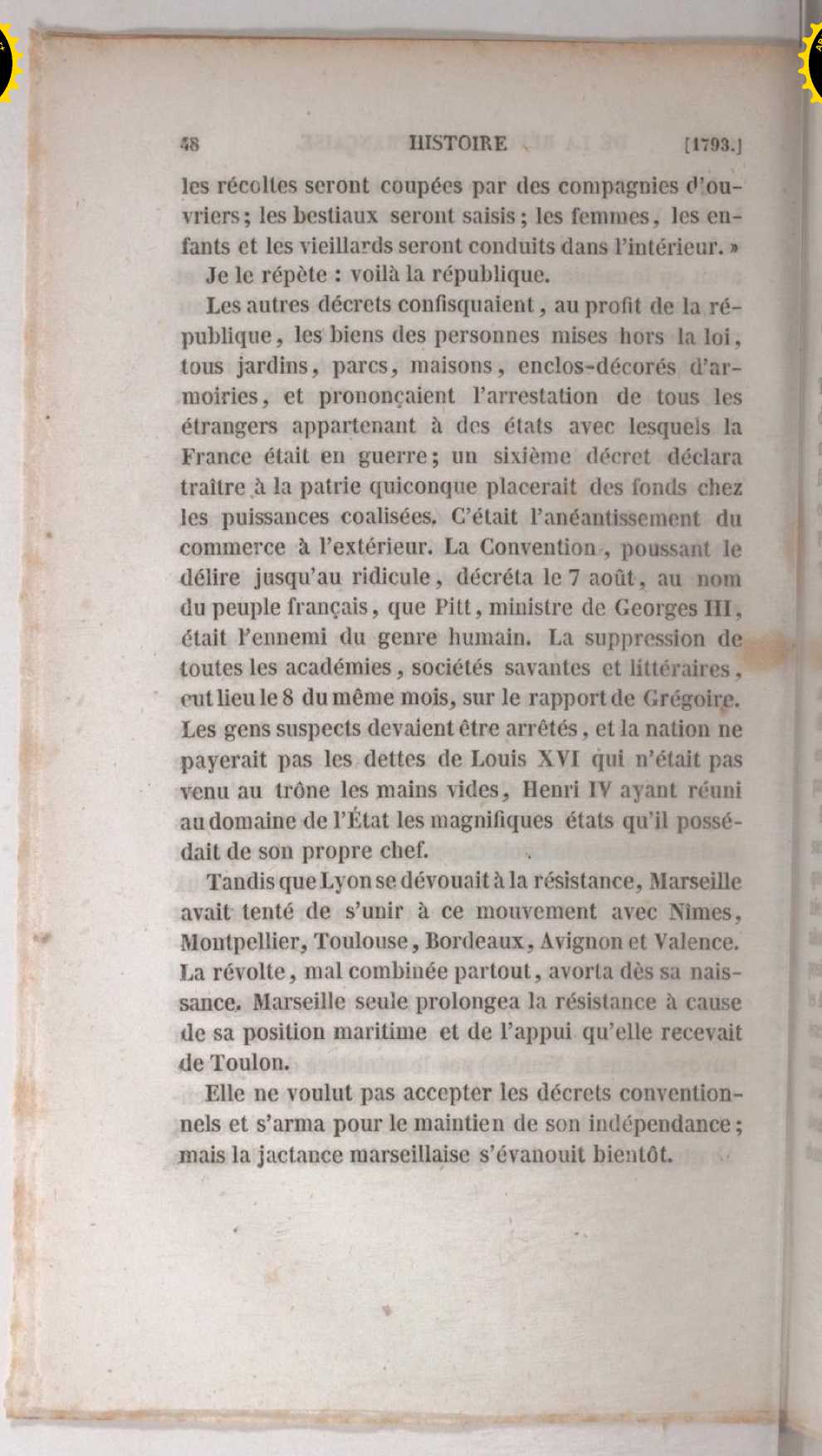
les récolles seront coupées par des compagnies d’ouvriers; les bestiaux seront saisis; les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l’intérieur. »
Je le répète : voilà la république.
Les autres décrets confisquaient, au profit de la république, les biens des personnes mises hors la loi. tous jardins, parcs, maisons, cnclos-décorés d’armoiries, et prononçaient l’arrestation de tous les étrangers appartenant à des états avec lesquels la France était en guerre; un sixième décret déclara traître à la patrie quiconque placerait des fonds chez les puissances coalisées. C’était l’anéantissement du commerce à l’extérieur. La Convention , poussant le délire jusqu’au ridicule, décréta le 7 août, au nom du peuple français, que Pitt, ministre de Georges III, était l’ennemi du genre humain. La suppression de toutes les académies, sociétés savantes et littéraires. eut lieu le 8 du même mois, sur le rapport de Grégoire. Les gens suspects devaient être arrêtés, et la nation ne payerait pas les dettes de Louis XVI qui n’était pas venu au trône les mains vides, Henri IV ayant réuni au domaine de l’État les magnifiques états qu'il possédait de son propre chef. .
Tandis que Lyon se dévouait à la résistance, Marseille avait tenté de s’unir à ce mouvement avec Nîmes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Avignon et Valence. La révolte, mal combinée partout, avorta dès sa naissance. Marseille seule prolongea la résistance à cause de sa position maritime et de l’appui qu’elle recevait de Toulon.
Elle ne voulut pas accepter les décrets conventionnels et s’arma pour le maintien de son indépendance; mais la jactance marseillaise s’évanouit bientôt.
(1793.J
HISTOIRE


[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 49
Les Jacobins reprirent leur influence, et le général Cadeaux, après avoir livré des combats insignifiants, entra le 25 août dans la vieille colonie phocéenne. Le sang y coula comme à Lyon, avec moins d’abondance toutefois, parce que la lutte n’avait pas été aussi désespérée. Marseille soumise, il fallut attaquer Toulon.
Ici la résistance était beaucoup plus redoutable. Les Toulonnais, plus royalistes en masse que républicains, dès qu’ils eurent renoncé au pacte sans-culotte, tournèrent leurs yeux vers leur roi légitime, et Louis XVII fut proclamé. Ils appelèrent bientôt à leur secours les coalisés; l’Espagne, la Grande-Bretagne, Naples, le Portugal, envoyèrent des flottes unies qui occupèrent Toulon, le port et l’arsenal. On débarqua des troupes dp ligne; il eût fallu pousser en avant, maintenir Marseille, entraîner le Languedoc, marcher sur Lyon. Peut-être, à l’aide des Piémontais et des Autrichiens, aurait-on maîtrisé la fortune. Mais là aussi il y eut des tâtonnements, des hésitations ; on se laissa battre en rase campagne, et bientôt renfermer dans les remparts de Toulon.
Les généraux Canclaux, Dugommier, Doppet, eurent successivement le commandement en chef de ce siège que prolongea l’impéritie du premier, que hâta le génie du second, et que décida un officier d’artillerie , alors obscur, Napoléon Bonaparte. Il parvint par ses dispositions savantes et ses habiles manœuvres à enfermer les Anglais dans un cercle de feu. Ceux-ci dûrent enfin évacuer la ville. Ils la quittèrent en lâches ennemis, incendiant notre flotte qu’on leur avait remise poulie service de notre roi, l’arsenal, la corderie, tous les beaux et nombreux établissements militaires. Ils abandonnèrent les malheureux habitants à la vengeance il 3
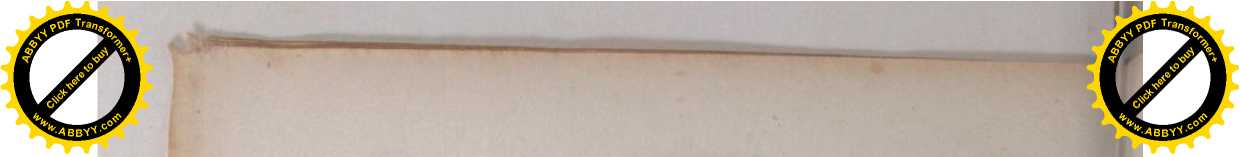
50 HISTOIRE [1793.]
des vainqueurs. Ici recommencèrent les exécutions sanguinaires de Lyon ; les représentants Barras, Fréron. Robespierre jeune, Gasparin, firent mitrailler plus de huit mille individus. Ceux que le canon avait épargnés s étant relevés sur la foi d’une pleine amnistie, furent mitraillés de nouveau, tant ces proconsuls exécrables étaient avides de sang humain. Au reste, j'anticipe sur les événements : Toulon ne fut repris qu’à la fin du mois, le 27 août.
Ces succès engagèrent la Convention à livrer le sol français à des hordes de brigands, d’assassins, d’incendiaires, réunis sous le titre d’armée révolutionnaire, qui s’en allaient de lieu en lieu, élevant partout des échafauds, régularisant le meurtre, le pillage et toutes les exactions imaginables. Les municipalités dûrent faire chaque jour des visites domiciliaires, établir le maximum, incarcérer les suspects et conduire au supplice les conspirateurs.
Au moment où les villes rebelles se soumettaient, le général Houchard gagna, le 8 septembre, la bataille de Hondtschoote contre le duc d’York, généralissime des forces alliées. Celui-ci leva le siège de Dunkerque pendant que le général autrichien Clayrfait s’emparait du Quesnoy.
Merlin de Douai, l’un des plus ardents Jacobins, profita de cette circonstance pour faire décréter la fameuse loi des suspects, dernier acte d’odieuse tyrannie que les sans-culottes nous réservaient. Elle disait:
« Immédiatement après la publication du présent « décret, tous les gens suspects qui se trouvent sur le « territoire de la république et qui sont encore en « liberté seront mis en arrestation. Sont réputés sus-« pects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs
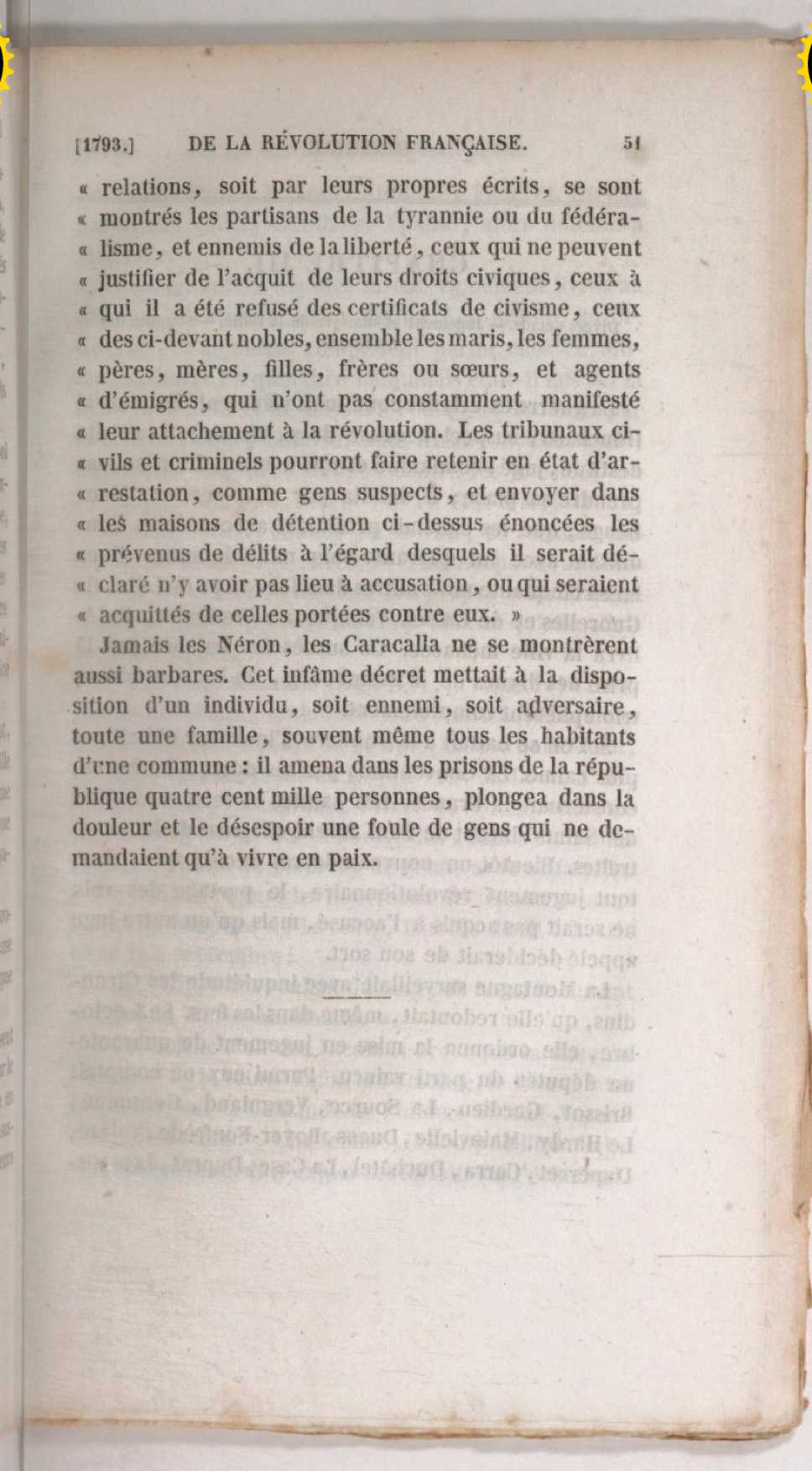
« relations, soit par leurs propres écrits, se sont < montrés les partisans de la tyrannie ou du fédéra-« lisme, et ennemis de la liberté, ceux qui ne peuvent « justifier de l’acquit de leurs droits civiques, ceux à a qui il a été refusé des certificats de civisme, ceux a des ci-devant nobles, ensemble les maris, les femmes, « pères, mères, filles, frères ou sœurs, et agents a d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté « leur attachement à la révolution. Les tribunaux ci-« vils et criminels pourront faire retenir en état d’ar-« restalion, comme gens suspects, et envoyer dans « les maisons de détention ci-dessus énoncées les « prévenus de délits à l’égard desquels il serait dé-« claré n’y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient « acquittés de celles portées contre eux. »
Jamais les Néron, les Caracalla ne se montrèrent aussi barbares. Cet infâme décret mettait à la disposition d’un individu, soit ennemi, soit adversaire, toute une famille, souvent même tous les habitants d’une commune : il amena dans les prisons de la république quatre cent mille personnes, plongea dans la douleur et le désespoir une foule de gens qui ne demandaient qu’à vivre en paix.
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

52
HISTOIRE
[1793.]
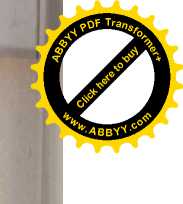
Divers détails.— Jugement et martyre de la reine. — Supplice des Girondins.
La guerre extérieure continuait vivement. Le général Bouchard, suspect à cause de sa victoire, avait été destitué, jugé, condamné et mis à mort. Jourdan osa prendre sa place ; il débuta par aller secourir Mau-beuge, que les ennemis pressaient avec ardeur. Conduisant avec lui quarante-cinq mille hommes, il en laissa cinquante mille autres dans les camps de Lille, de Guorelleset de Cassel. Vainqueur à Watignies, il délivra la ville menacée. Ce succès fut balancé par la prise des lignes de Wissembourg, où les Autrichiens triomphèrent complètement.
Si l’on se battait à la frontière, l’intérieur n’était pas plus calme. La Convention, par ses décrets barbares, consternait la France. Les saintes et vertueuses filles de Saint-Vincent de Paul furent chassées de leurs retraites. Bientôt un nouveau décret décida que, dans tout jugement révolutionnaire, le partage des voix ne serait pas acquis à l’accusé, mais qu’un autre juge appelé déciderait de son sort.
La Montagne surveillait avec inquiétude les Girondins, qu’elle redoutait, même dans les fers. Le 3 octobre, elle ordonna la mise en jugement de quarante-un députés du parti vaincu. Parmi eux on comptait Brissot, Gardien, La Source, Vergniaud, Gensonné, Le Hardy, Mainvielle,Ducos, Boyer-Fonfrède, Valazé, Duperret, Carra, Duchâtel, La Case, Duprat, Lescrps-
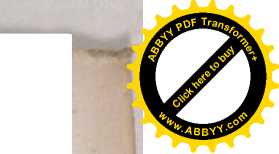
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 53
Beauvais, Vigée, Boileau, Antiboul, Fauchet. On jeta parmi eux Sillery-Genlis et Égalité, alors détenus à Marseille.
Vingt-un autres députés furent également livrés au tribunal révolutionnaire : Pétion (en fuite), Buzot, Gorsas et Lanjuinais comptaient parmi ceux-ci. Mélange bizarre ! A (piel titre Lanjuinais était-il mis sur la ligne de Pétion et de Gorsas? Voulait-on le flétrir par ce contact impur ? Enfin soixante-treize conventionnels, signataires des protestations contre les journées du 31 mai et du 2 juin, furent mis en état d’arrestation.
La Convention, comme on le voit, ne reculait pas devant les grandes mesures, ne craignait pas de se décimer et de porter le fer dans son propre sein. Mais ce n’était la que le prélude du coup affreux qu’elle allait bientôt frapper.
Depuis l’assassinat de Louis XVI, la reine de France, Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, était retenue dans la tour sombre du Temple, avee sa belle-sœur, ses deux enfants, madame Royale et S. M. Louis XVII, son fils, notre roi légitime. Privée de tout secours, de toute consolation du dehors, elle goûtait du moins le triste plaisir de pleurer, de gémir avec sa famille.
De temps en temps les bourreaux de l’époux demandaient le supplice de la veuve. Barreré disait à la tribune le 5 septembre :
« Les royalistes veulent du sang, eh bien ! ils auront « celui de Marie-Antoinette. »
Deux fois le club des Jacobins provoqua la mise eu jugement de la reine. Enfin, le3 octobre, le décret fatal fut lancé, sur la demande de l’infâme Billaud-Várennos, qui osa dire: « Une femme, la honte de l’humanité « et de son sexe, doit expier ses forfaits sur l’échafaud.
« Déjà le bruit court parmi le peuple qu’elle a été « transférée à la Conciergerie, qu’elle a été jugée se-« crètement, et que le tribunal révolutionnaire a re-« connu son innocence ; comme si une femme qui a fait « couler le sang de plusieurs milliers de Français pou-« vait être acquittée par un jury français ! Je demande « que le tribunal révolutionnaire prononce cette se-« maine sur son sort. »
On l’avait déjà séparée violemment de sa famille ; transportée à la Conciergerie, elle y fut atrocement persécutée. Gardée à vue par des gendarmes qui ne la quittaient ni de nuit ni de jour, en butte à d’odieux outrages, elle vit périr le municipal Michonis et un chevalier de Saint - Louis qui avaient cherché à lui donner quelque espérance. Une pauvre fille nommée Rosalie, fille de service des geôliers, fut la seule qui lui montra de l’intérêt. La reine, sans linge de corps, sans coiffes, sans robes, raccommodait elle-même les chiffons qu’elle portait; elle possédait une seule robe blanche qu’elle réservait pour le jour de sa mort.
Marie-Antoinette, prévenue qu’elle serait bientôt appelée devant le tribunal révolutionnaire, choisit Chauveau-Lagarde pour la défendre. Ce noble avocat accepta celte grande mission et la remplit avec autant de talent que de courage. Ce fut le 5 octobre qu’eut lieu le premier interrogatoire. Tronçon-Ducoudray, autre généreux défenseur de la majesté royale, servait de second conseil à la reine; il s’illustra, lui aussi, dans cette biche pénible.
Les juges (car il convient d’infliger à ces misérables le supplice de la publicité), les juges, ou, pour mieux dire, les magistrats assassins étaient Hermann, président, Foucault, Scellier, Coflinhal, Deliége, Rumey,
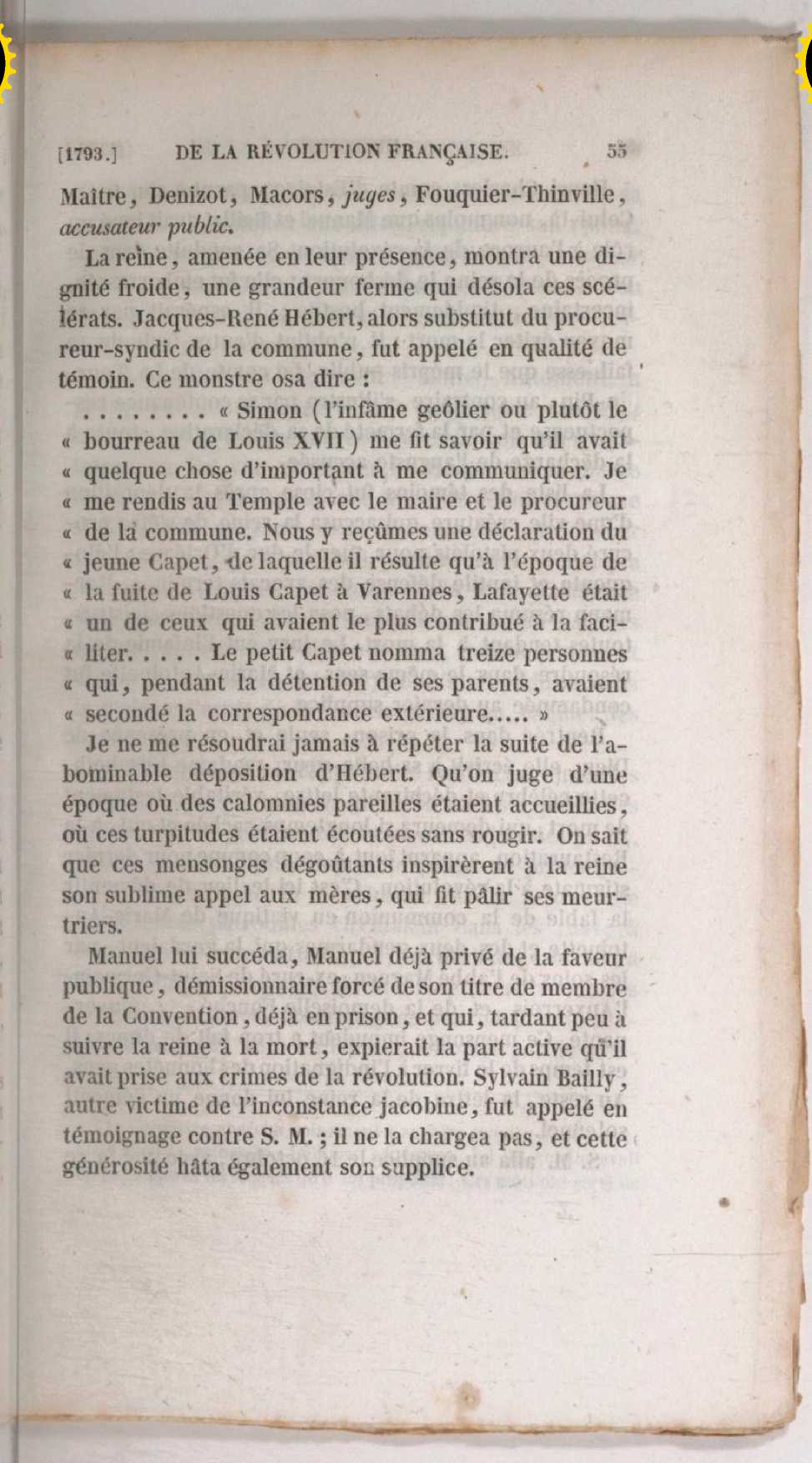
Maître, Denizot, Macors, jiq/es, Fouquier-Thinville, accusateur public,
La reme, amenée en leur présence, montra une dignité froide, une grandeur ferme qui désola ces scélérats. Jacques-René Hébert, alors substitut du procureur-syndic de la commune, fut appelé en qualité de témoin. Ce monstre osa dire :
........« Simon (l’infâme geôlier ou plutôt le « bourreau de Louis XVII ) me fit savoir qu’il avait « quelque chose d’important à me communiquer. Je « me rendis au Temple avec le maire et le procureur « de la commune. Nous y reçûmes une déclaration du « jeune Capet, -de laquelle il résulte qu’à l’époque de « la fuite de Louis Capet à Varennes, Lafayette était « un de ceux qui avaient le plus contribué à la faci-« liter.....Le petit Capet nomma treize personnes « qui, pendant la détention de ses parents, avaient « secondé la correspondance extérieure..... »
Je ne me résoudrai jamais à répéter la suite de l’abominable déposition d’Hébert. Qu’on juge d’une époque où des calomnies pareilles étaient accueillies, où ces turpitudes étaient écoutées sans rougir. On sait que ces mensonges dégoûtants inspirèrent à la reine son sublime appel aux mères, qui fit pâlir ses meurtriers.
Manuel lui succéda, Manuel déjà privé de la faveur publique, démissionnaire forcé de son titre de membre de la Convention, déjà en prison, et qui, tardant peu à suivre la reine à la mort, expierait la part active qu'il avait prise aux crimes de la révolution. Sylvain Bailly, autre victime de l’inconstance jacobine, fut appelé en témoignage contre S. M. ; il ne la chargea pas, et cette générosité hâta également son supplice.
[1793.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

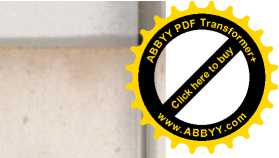
[1793.]
Henri-Charles, comte d’Estaing, parut à son tour. Celui-là, non moins que Manuel et Bailly, avait jouu un rôle à l’aurore de la révolution. Sa conduite dans le procès de la reine le déshonora : elle fut embarrassée, incertaine , timidement hostile ; il espérait par ce moyen éviter la mort : il n’obtint d’autre fruit de sa faiblesse que le mépris public. Le comte de La Tour-du-Pin, au contraire, s’illustra par sa contenance respectueuse et par la fermeté de sa déclaration, toute à la décharge de l’auguste accusée.
La liste des témoins fut close après la déposition d’une vile créature qui accusa la reine de s’être procuré deux pistolets pour tuer le duc d’Orléans : l’éloquente et inutile défense des avocats terminée, Hermann résuma les débats, posa les questions sinistres, toutes tendant à la mort. Le jury eut l’infamie de la résoudre dans le même sens, et Marie-Antoinette fut condamnée au dernier supplice.
Rentrée dans la prison, seule et en présence de Dieu, elle écrivit à sa belle-sœur, madame Élisabeth, cette célèbre et déchirante lettre, véritable testament de mort, qui demeura si longtemps cachée et qui, à la Restauration, apparut tout à coup comme pour dernier stigmate à la révolution. C’est ici le lieu de démentir la fable de la communion en viatique de Marie-Antoinette et des deux gendarmes qui la gardaient, par les soins de l’abbé Maguen, ex-curé de Saint-Germain-l’Auxerrois, et de la demoiselle Fouché, sa gouvernante. Ce mensonge impudent a trop fait de dupes; il est temps de le livrer à l’indignation des honnêtes gens. Au reste, la lettre de la reine lui donne un démenti
solennel.
\
S. M. alla au supplice le 16 octobre, avec une force

[1793.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 57 d’ije et une dignité royale. Ses traits annonçaient sa prochaine béatitude : elle allait rejoindre son époux. Je crois convenable de transcrire l’article du Moniteur du 17 octobre 1793 ; il porte dans sa contexture l’aveu de la grandeur de la victime et de l’admiration dissimulée de ses bourreaux.
« Lors de son jugement, Marie - Antoinette a presque toujours conservé une contenance calme et assurée. Dans les premières heures de son interrogatoire, on l’a vue promener les doigts sur la barre du fauteuil, avec l’apparence de la distraction et comme si elle jouait du forte-piano. En entendant prononcer sa sentence, elle n’a laissé paraître aucune marque d’altération, et elle est sortie de la salle d’audience sans proférer une parole, sans adresser aucun discours ni aux juges ni au public. Il était quatre heures et demie du matin (16 octobre) ; on l’a reconduite dans la maison d’arrêt de la Conciergerie, au cabinet des condamnés.
« A cinq heures, le rappel a été battu dans toutes les sections; à sept, toute la garnison était sur pied. Des canons ont été placés à toutes les extrémités des ponts, places et carrefours, depuis le palais-de-juslice jusqu’à la place de la Révolution. A dix heures, de nombreuses patrouilles circulaient dans les rues; à onze, Marie-Antoinette Capet, en déshabillé blanc, a été conduite au supplice de la même manière que les autres condamnés, accompagnée par un prêtre constitutionnel (1) vêtu en laïque, escortée par de nom-
(t) Ce prêtre chercha vainement à sc faire écouler de la reine; cette auguste princesse, toujours généreuse, lui dit qn'elie avait eu par d’autres les secours qu'il lui proposait. Ces mots ont servi de
3.


58 HISTOIRE [1793.]
breux détachements à pied ou à cheval. Antoinette, le long de la route, paraissait voir avec indifférence la force armée qui, au nombre de trente mille hommes, formait une double haie par les rues où elleapassé. On n’apercevait sur son visage ni abattement ni fierté, et elle paraissait insensible aux cris de vive la République! à bas la tyrannie! qu’elle n’a cessé d’entendre sur son passage. Elle parlait peu à son confesseur. Les flammes tricolores occupaient son attention dans les rues du Roule et Saint-Honoré; elle remarquait aussi les inscriptions placées aux faîtes des maisons. Arrivée à la place de la Révolution, ses regards se sont tournés vers le Jardin National (les Tuileries). On apercevait alors sur son visage les signes d’une vive émotion. Elle est montée ensuite sur l’échafaud avec courage. A midi un quart, sa tête était tombée, et l’exécuteur l’a montrée au peuple..... »
Certes, il suffit d’être royaliste pour sentir son cœur se briser quand on transcrit ces tristes récits; mais combien cette douleur n’est-elle pas encore plus profonde, lorsque, ainsi que moi, l’on aperdu son père à la même époque, par un pareil supplice, et pour cette sainte cause î Alors l’âme est anéantie, et ses sensations se partagent entre la pitié qu’elle ressent pour la victime et la haine qu’elle éprouve pour les assassins.
Les Girondins allaient bientôt porter la peine de leurs égarements. Robespierre se montrait impatient de s’en débarrasser. Il ne pouvait prétendre
base au mensonge du sieur Maguen et de sa gouvernante, la demoiselle Fouché. Il faut lire l’excellent ouvrage de l’abbé La-font d’Auxonne, qui détruit cette fourberie. L. L. L.


[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 59 ouvertement au souverain pouvoir, tant qu’il aurait ces adversaires à combattre. A peine le meurtre de la reine eut-il été consommé, que les Girondins à leur tour furent traînés à la barre du tribunal révolutionnaire.
Les témoins à charge, dans ce procès où les mêmes coupables se divisaient en accusés et en accusateurs, furent Hébert, Chaumette, Desfieux, Dutrain, Chabot et Fabre d’Églantine ; ils avaient déjà parlé contre les Girondins aux Jacobins ou dans l’Assemblée. Ceux-ci, dirigés par Vergniaud, qui paraissait les présider, se défendirent avec tant de chaleur et d’entraînement, que l’auditoire, quoique renforcé par des sans-culottes dévoués, fut un instant attendri. La conviction de leur patriotisme faisait des progrès parmi la populace. La commune et la Montagne en conçurent de l’effroi; on eut peur que les fondateurs réels de la république n’échappassent à l'échafaud et ne reprissent leur ascendant sur la multitude. On se hâta de prendre des mesures nouvelles afin que les prévenus ne pussent point se soustraire au coup mortel dont on voulait les frapper.
L’instruction continuait ; l’on aurait bien voulu qu’elle n’allât pas plus loin, mais comment faire? Nul ne songeait encore à intervenir dans la défense, à l’empêcher d’être complète. Ce fut pourtant la mesure à laquelle on s’arrêta ; il est à remarquer, et il convient surtout que la jeunesse comprenne bien que les fauteurs les plus effrénés de la tyrannie sont toujours ceux qui se proclament les amis les plus ardents de la liberté. Certes, ce ne fut jamais sous les monarchies légitimes que l’on imagina cruellement d’arracher à l’accusé sa dernière ressource. Les Jacobins prirent l’initiative ;
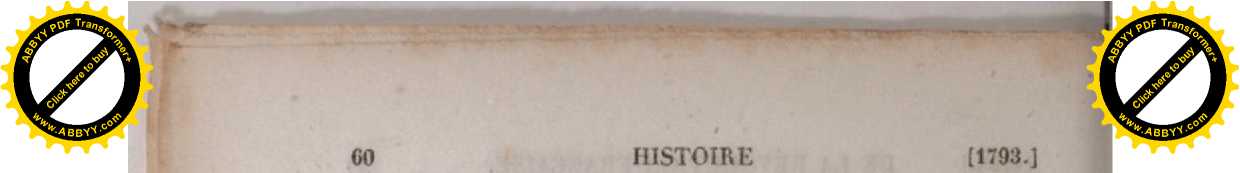
ils sollicitèrent auprès de la Convention, et celle-ci, sur le rapport de Robespierre, qui avait hâte de se débarrasser de ses anciens collègues, rendit un décret portant qu'après trois jours les débats des procès criminels pourraient être fermés si le jury, sur la question du président, se déclarait assez instruit.
C’était porter aux Girondins le coup de mort; néanmoins le jury n’osa pas, le premier jour oii cette loi fut promulguée, s’en servir pour faire feu de /'de. Chabot, dénonciateur, témoin à charge, et qui lui-même tarderait peu à tomber victime de la mesure qu’il avait provoquée, se signala par son acharnement contre les prévenus, qui le qualifièrent de fripon et d’infàme; il s’en vengea en décidant leur mort.
Le lendemain, qu’ils savaient être leur dernier jour, les prisonniers, au moment de monter au tribunal, et à la porte de la Conciergerie, eurent un instant la pensée de se donner la mort-; ils n’y cédèrent pas. Le jury, sur les conclusions de Fouquier-Thinville, porta contre eux cette peine capitale qu’ils avaient eux-mêmes prononcée contre leur roi. Valazé, qui avait dérobé à ses gardiens une paire de ciseaux , s’en frappa au cœur. 11 tomba sans vie ; on décida que le cadavre n’en serait pas moins conduit sur l’échafaud.
Égarés par les principes philosophiques, les condamnés ne demandèrent pas les divins secours de la religion ; au contraire, ils burent, mangèrent, et chantèrent en chœur la Marseillaise, ce chant révolutionnaire mais sublime qui guida si souvent les Français à la victoire. Ils périrent le 31 octobre , quinze jours après la reine et quarante-six jours avant Égalité. Que les hommes qui sont imbus de leurs maximes et qui suivent leurs principes s’extasient sur la fermeté
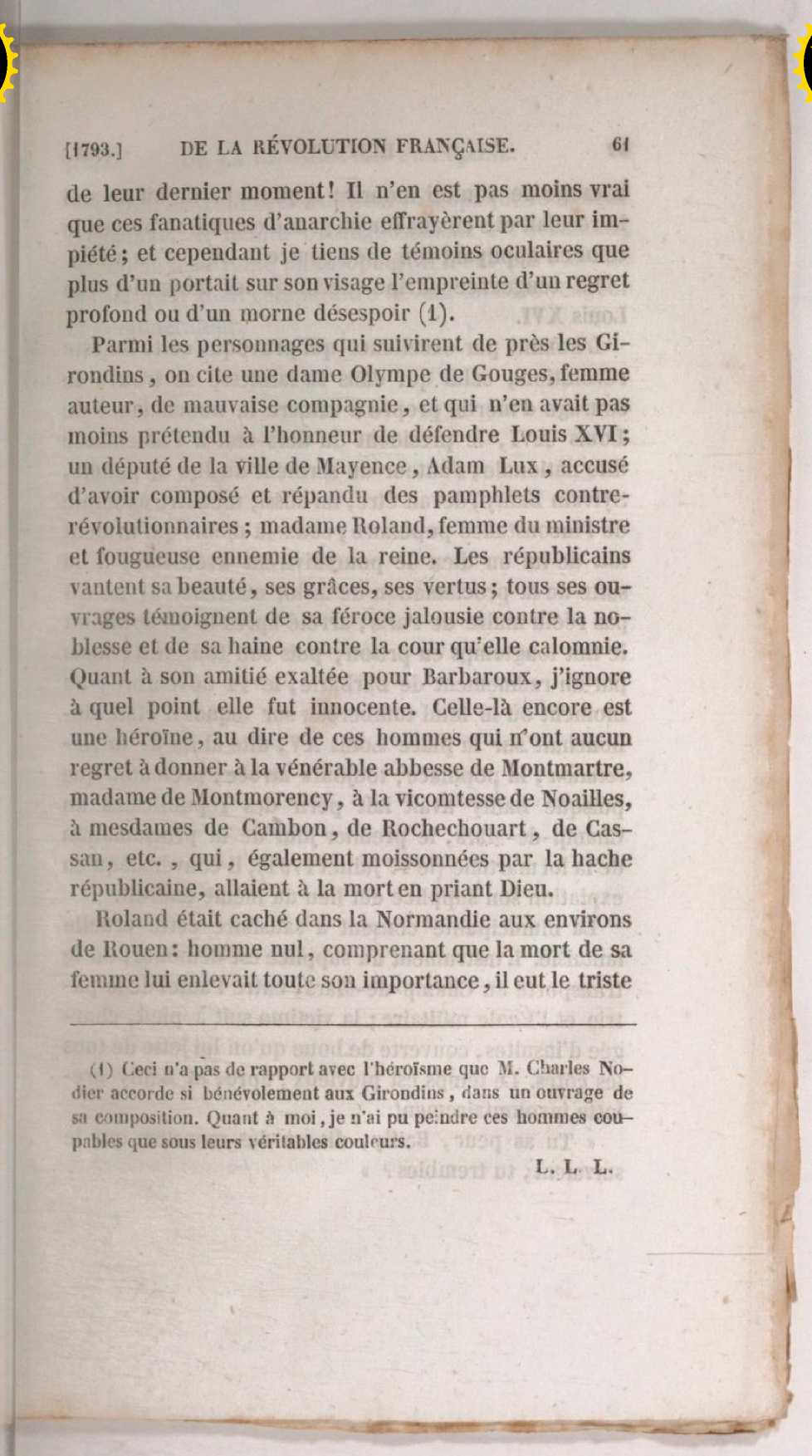
(I) Ceci n'a pas de rapport avec l'héroïsme que M. Charles Nodier accorde si bénévolement aux Girondins , dans un ouvrage de sa composition. Quant h moi,je n’ai pu peindre ces hommes coupables que sous leurs véritables couleurs.
L. L L.
de leur dernier moment! Il n’en est pas moins vrai que ces fanatiques d’anarchie effrayèrent par leur impiété; et cependant je tiens de témoins oculaires que plus d’un portait sur son visage l’empreinte d’un regret profond ou d’un morne désespoir (1).
Parmi les personnages qui suivirent de près les Girondins, on cite une dame Olympe de Gouges, femme auteur, de mauvaise compagnie, et qui n’en avait pas moins prétendu à l’honneur de défendre Louis XVI ; un député de la ville de Mayence, Adam Lux , accusé d’avoir composé et répandu des pamphlets contre-révolutionnaires ; madame Roland, femme du ministre et fougueuse ennemie de la reine. Les républicains vantent sa beauté, ses grâces, ses vertus; tous ses ouvrages témoignent de sa féroce jalousie contre la noblesse et de sa haine contre la cour qu’elle calomnie. Quant à son amitié exaltée pour Barbaroux, j’ignore à quel point elle fut innocente. Celle-là encore est une héroïne, au dire de ces hommes qui n’ont aucun regret à donner à la vénérable abbesse de Montmartre, madame de Montmorency, à la vicomtesse de Noailles, à mesdames de Cambon, de Rochechouart, de Cas-san, etc. , qui, également moissonnées par la hache républicaine, allaient à la mort en priant Dieu.
Roland était caché dans la Normandie aux environs de Rouen: homme nul, comprenant que la mort de sa femme lui enlevait toute son importance, il eut le triste
[1793.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
HISTOIRE

[1793.]
courage de vouloir mourir ; il quitta l’asile où un ami le recelait et s’en alla sur un grand chemin se percer le cœur en appuyant son épée contre le tronc d’un arbre.
La vengeance divine décimait les meurtriers de Louis XVI.
L’homme par excellence qui provoqua cette funeste révolution, celui qui dans sa faiblesse se trouva le courage d’inertie propre à vaincre la nonchalance de Louis XVI, le président du tiers-état à l’Assemblée dite nationale, l’auteur du serment du Jeu de paume, Sylvain Bailly, devait être, lui aussi, un autre exemple de l’inconstance populaire ; ceux-là même qui avaient fait de lui un dieu le poursuivirent avec furie à la suite de la proclamation de la loi martiale. Il ne fut pas réélu maire de Paris; arrêté après le 10 août, on le tint longtemps en prison, puis son tour vint; mais par un raffinement de barbarie, le 11 novembre, au moment où le fatal tombereau sur lequel il était débouchait sur la place Louis XV, dite alors de la Révolution , la populace, toujours atroce, prétendit que puisque Bailly avait fait périr des républicains au Champ-de-Mars, le premier jour de la proclamation de la loi martiale (le 17 juillet 1791), il convenait qu’en expiation son supplice eût lieu au même endroit
La municipalité consent à satisfaire cette cruelle fantaisie. L’instrument du supplice est démonté, on le transporte au Champ-de-Mars, entre l’autel de la patrie et l’École militaire; la victime suit à pied, chargée d’insultes, couverte de boue qu’on lui jette de tous les côtés. Le temps est pluvieux, âpre, et Bailly grelotte involontairement.
« Tu as peur, Bailly, dit un des monstres qui le suivaient, tu trembles? »
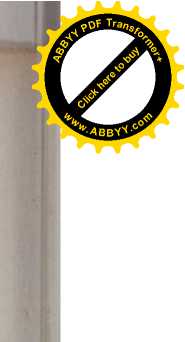
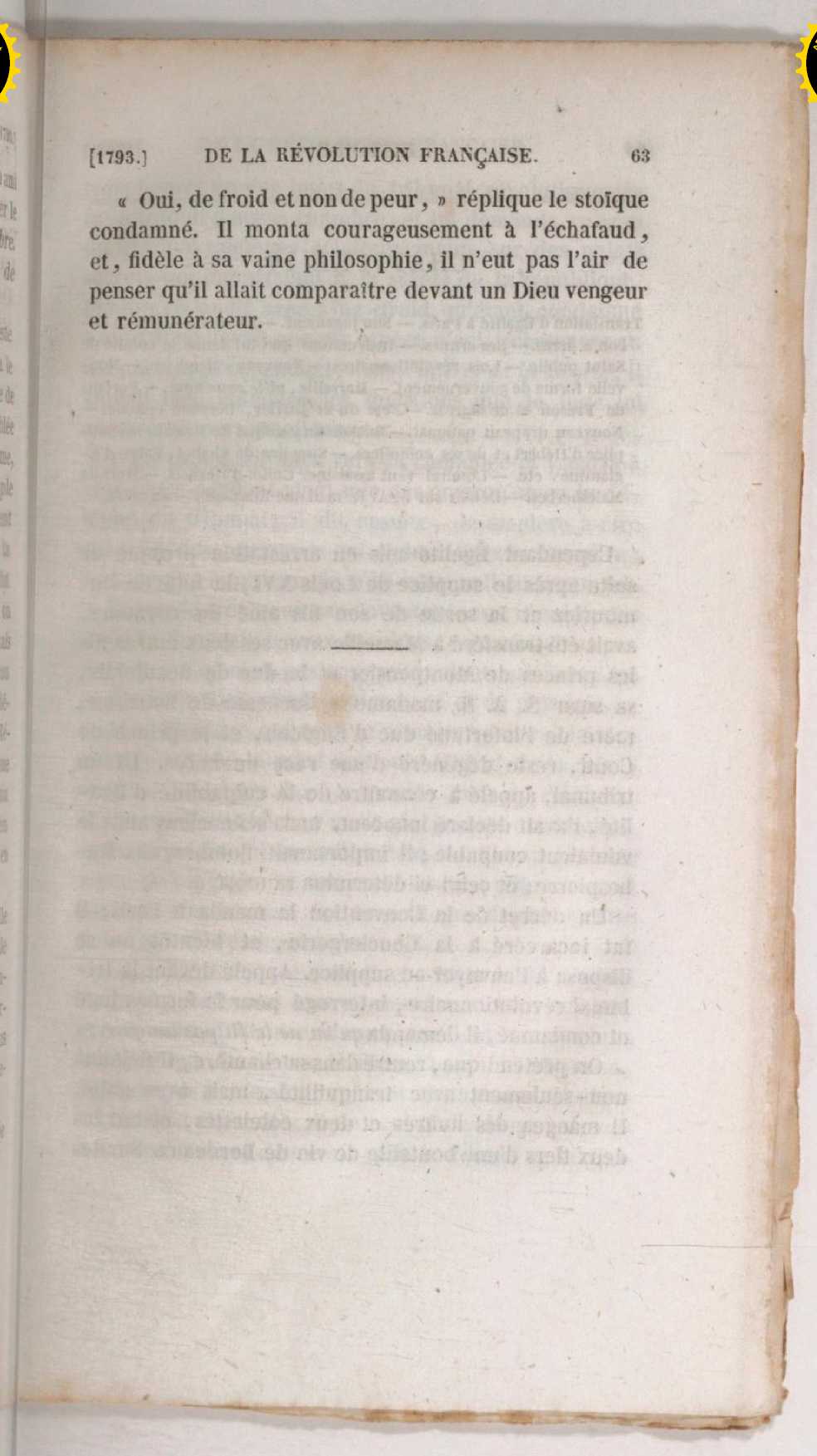
———
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
« Oui, de froid et non de peur, » réplique le stoïque condamné. Il monta courageusement à l’échafaud, et, fidèle à sa vaine philosophie, il n’eut pas l’air de penser qu’il allait comparaître devant un Dieu vengeur et rémunérateur.
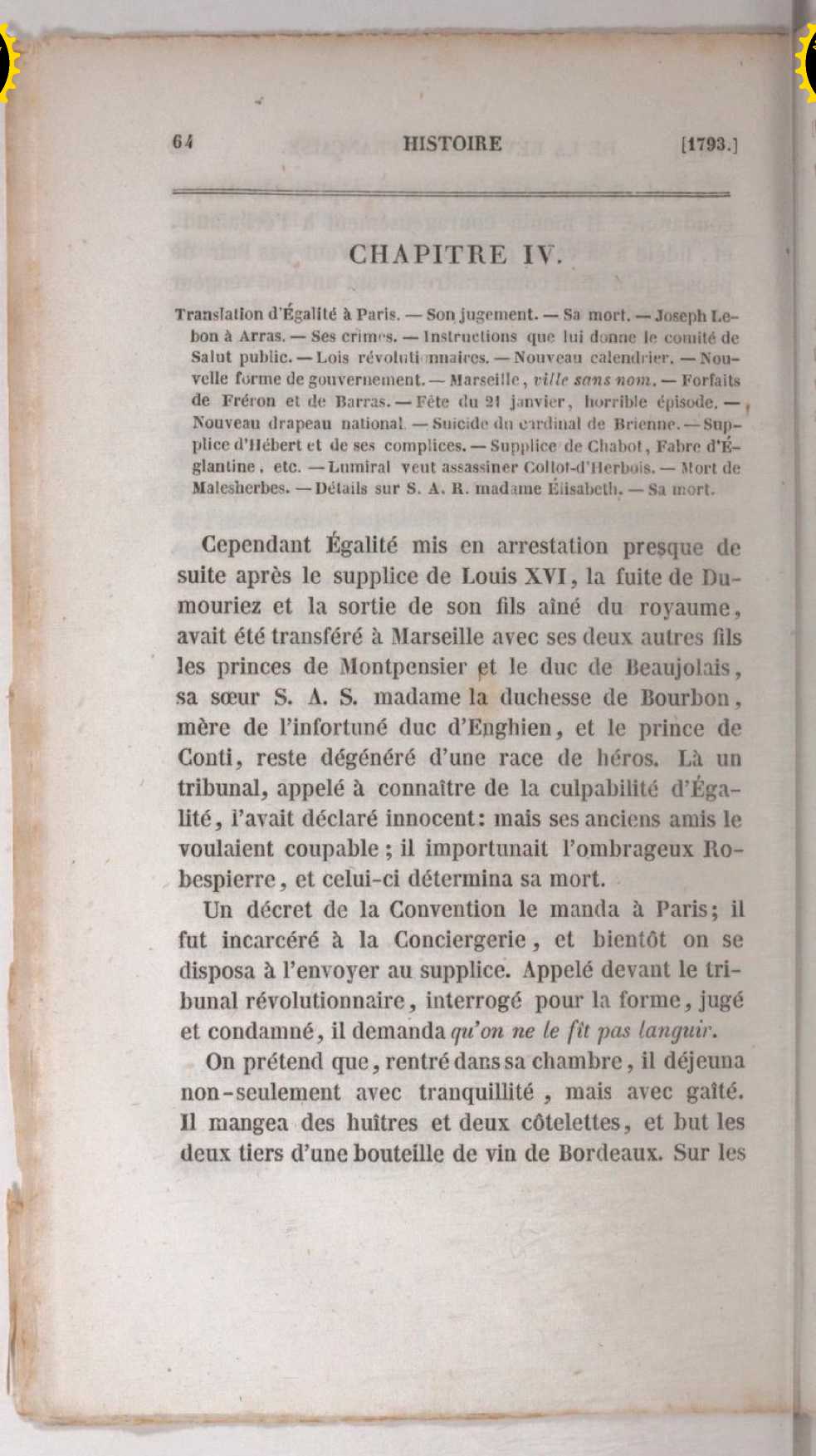
HISTOIRE
11793.]
CHAPITRE IV.
Translation d'Egalité à Paris. — Son jugement. — Sa mort. — Joseph Lebon à Arras. — Ses crimes. — Instructions que lui donne le comité de Salut public. — Lois revoluti nnaircs.— Nouveau calendrier. — Nouvelle forme de gouvernement. — Marseille, ville sans nom. — Forfaits de Fréron et de Barras.— Fête du 21 janvier, horrible épisode. — , Nouveau drapeau national —Suicide du cardinal de Brienne. — Supplice d’Hébert et de ses complices. — Supplice de Chabot, Fabre d’É-glantine. etc. —Lnmiral veut assassiner Collof-d’Hcrbois. — Mort de Malesherbes. — Détails sur S. A. H. madame Elisabeth. — Sa mort.
Cependant Égalité mis en arrestation presque de suite après le supplice de Louis XVI, la fuite de Du-mouricz et la sortie de son fils aîné du royaume, avait été transféré à Marseille avec ses deux autres fils les princes de Montpensier et le duc de Beaujolais, sa sœur S. A. S. madame la duchesse de Bourbon, mère de l’infortuné duc d’Enghien, et le prince de Conti, reste dégénéré d’une race de héros. Là un tribunal, appelé à connaître de la culpabilité d’Égalité, l’avait déclaré innocent: mais ses anciens amis le voulaient coupable ; il importunait l’ombrageux Robespierre , et celui-ci détermina sa mort.
Un décret de la Convention le manda à Paris; il fut incarcéré à la Conciergerie, et bientôt on se disposa à l’envoyer au supplice. Appelé devant le tribunal révolutionnaire, interrogé pour la forme, jugé et condamné, il demandaron ne le fit pas languir.
On prétend que, rentré dans sa chambre, il déjeuna non-seulement avec tranquillité , mais avec gaîté. Il mangea des huîtres et deux côtelettes, et but les deux tiers d’une bouteille de vin de Bordeaux. Sur les
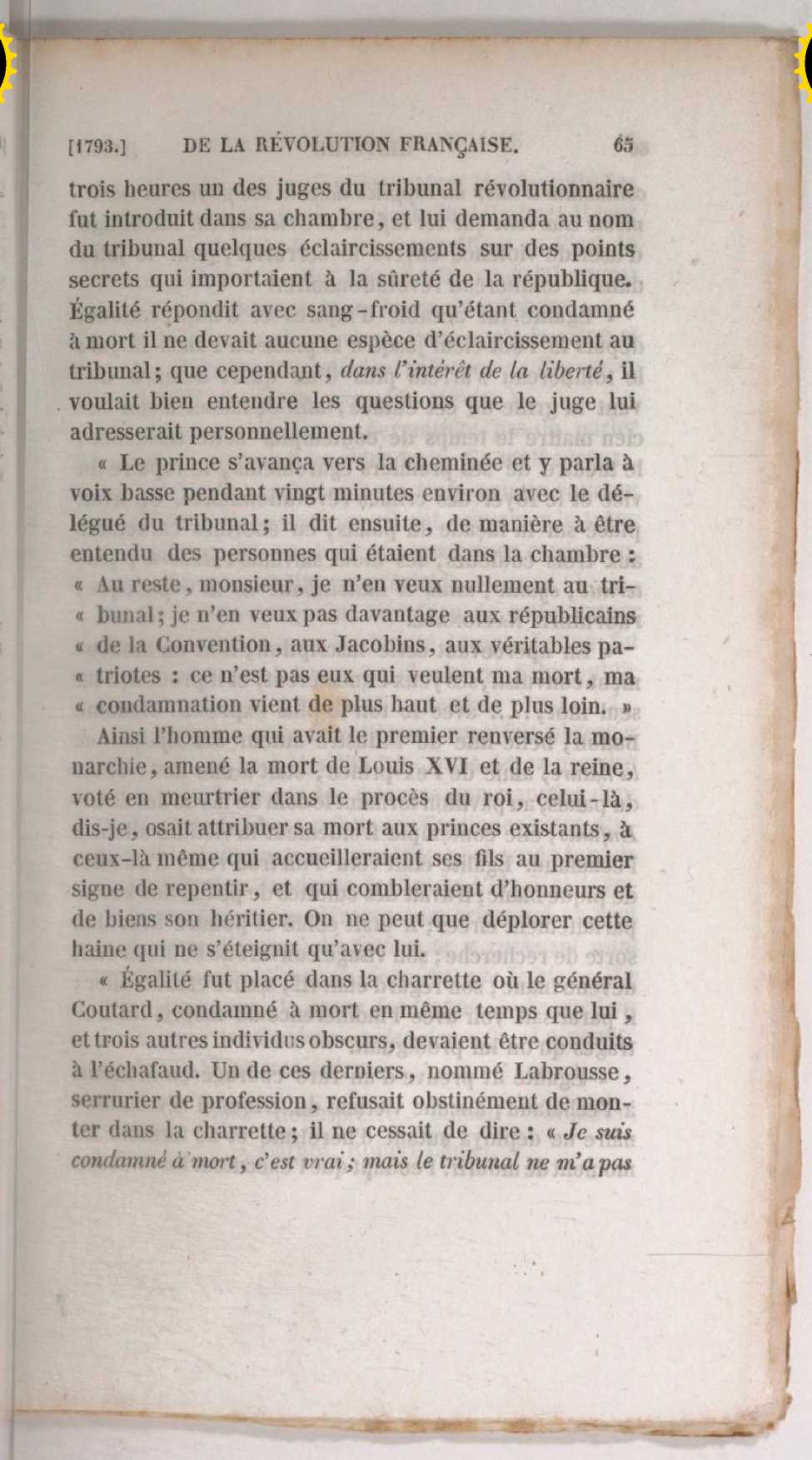
[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 65 trois heures un des juges du tribunal révolutionnaire fut introduit dans sa chambre, et lui demanda au nom du tribunal quelques éclaircissements sur des points secrets qui importaient à la sûreté de la république. Égalité répondit avec sang-froid qu’étant condamné à mort il ne devait aucune espèce d’éclaircissement au tribunal; que cependant, ((ans l'intérêt de (a liberté, il voulait bien entendre les questions que le juge lui adresserait personnellement.
« Le prince s’avança vers la cheminée et y parla à voix basse pendant vingt minutes environ avec le délégué du tribunal; il dit ensuite, de manière à être entendu des personnes qui étaient dans la chambre : « Au reste, monsieur, je n’en veux nullement au tri-« bunal ; je n’en veux pas davantage aux républicains « de la Convention, aux Jacobins, aux véritables pa-« triotes : ce n’est pas eux qui veulent ma mort, ma « condamnation vient de plus haut et de plus loin. »
Ainsi l’homme qui avait le premier renversé la monarchie, amené la mort de Louis XVI et de la reine, voté en meurtrier dans le procès du roi, celui-là, dis-je, osait attribuer sa mort aux princes existants, à ceux-là même qui accueilleraient ses fils au premier signe de repentir, et qui combleraient d’honneurs et de biens son héritier. On ne peut que déplorer cette haine qui ne s’éteignit qu’avec lui.
« Égalité fut placé dans la charrette où le général Coutard, condamné à mort en même temps que lui, et trois autres individus obscurs, devaient être conduits à l’échafaud. Un de ces derniers, nommé Labrousse, serrurier de profession, refusait obstinément de monter dans la charrette ; il ne cessait de dire : « Je suis condamné a mort, c'est vrai; mais le tribunal ne m'a pas


condamné à aller au supplice dans la compagnie et sur la même charrette que cet infâme d’Orléans. Ou fut obligé d’user de violence envers le serrurier, pour le jeter dans le tombereau révolutionnaire.
« Égalité fut accablé d’injures et d’imprécations, depuis le Pont-Neuf jusqu’à la place du Palais-Royal; le tombereau s’arrêta plus d’un quart d’heure devant la grille de cet édifice, afin délaisser à son ancien maître le temps de contempler cette résidence, le théâtre de ses premiers égarements, le repaire du vice et le foyer des crimes révolutionnaires. On avait placé sur la façade du palais, en énormes caractères aux trois couleurs, les mots suivants: Liberté, fraternité, égalité, unité et indivisibilité de la république ; PROPRIÉTÉ NATIONALE.
JT 1
« En apercevant cette inscription, il fit un mouvement convulsif, ses yeux étincelèrent, et il prononça un seul mot,..... avec le ton le plus expressif. Madame Buffon, belle-fille de l’illustre auteur des Époques de la nature, amie de l’ex-prince, était à une des croisées du palais, au pavillon formant le coin de la rue des lions-Enfants ; elle contempla froidement la victime allant à l’échafaud. Égalité était vêtu d’un frac vert, d’un gilet de piqué blanc ; il avait des culottes de peau, des bottes parfaitement cirées ; il était coiffé et poudré avec une sorte de recherche ; son visage couvert de boutons était devenu blanc ; son regard était vif, assuré et même lier ; il paraissait voir avec l’indifférence du mépris les outrages qu’on lui prodiguait.
« Égalité fit preuve d’un rare courage en montant à l’échafaud ; aucune victime du tribunal révolutionnaire ne déploya autant d’héroïsme et de fermeté au moment de mourir. Pendant que l’exécuteur 1 ui ôtait son

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
67

I»
habit, les valets, à qui appartenaient la dépouille des suppliciés, se mirent en devoir de le débotter. Il leur dit d’un ton de voix ferme et tranquille : « C’est du « temps et du soin perdu, laissez cela, vous débotterez « bien plus facilement le cadavre, dépêchons..... » Il périt le 6 novembre, vingt jours après la reine et six jours après les Girondins. » (Histoire de France de Montgaillard, tome III, page 150 etsuiv. )
Les circonstances ne me permettent pas de parler de ce prince comme il conviendrait. Ce malheureux , trompé dans son ambition, eut trop peu de courage pour profiter de ses crimes ; il sut renverser le trône et non le relever à son profit; usurpateur en espérance, il ne put être en réalité que régicide.
Ce fut à cette époque et au milieu de cette terreur toujours croissante que le député Joseph Lebon fut envoyé en mission à Arras. Le comité de Salut public lui manda, sous la date du 17 novembre :
« « a « « a a a « a a
« Le comité, citoyen collègue, vous fait observer qu’investi de pouvoirs illimités, vous devez prendre avec énergie toutes les mesures commandées dans l’intérêt de la chose publique. Continuez votre attitude révolutionnaire. L’amnistie prononcée lors de la constitution captieuse (celle de 1791 ) et invoquée par tous les scélérats est un crime qui ne peut en couvrir d’autres ; les forfaits ne se rachètent point contre une république, ils s’expient par le glaive. Le tyran l’invoqua, le tyran fut frappé.... Secouez sur les traîtres le flambeau et le glaive..... Le comité applaudit à vos travaux.
« Signé Robespierre , Billaud - Várennos , « Carnot, Robert LindeL »
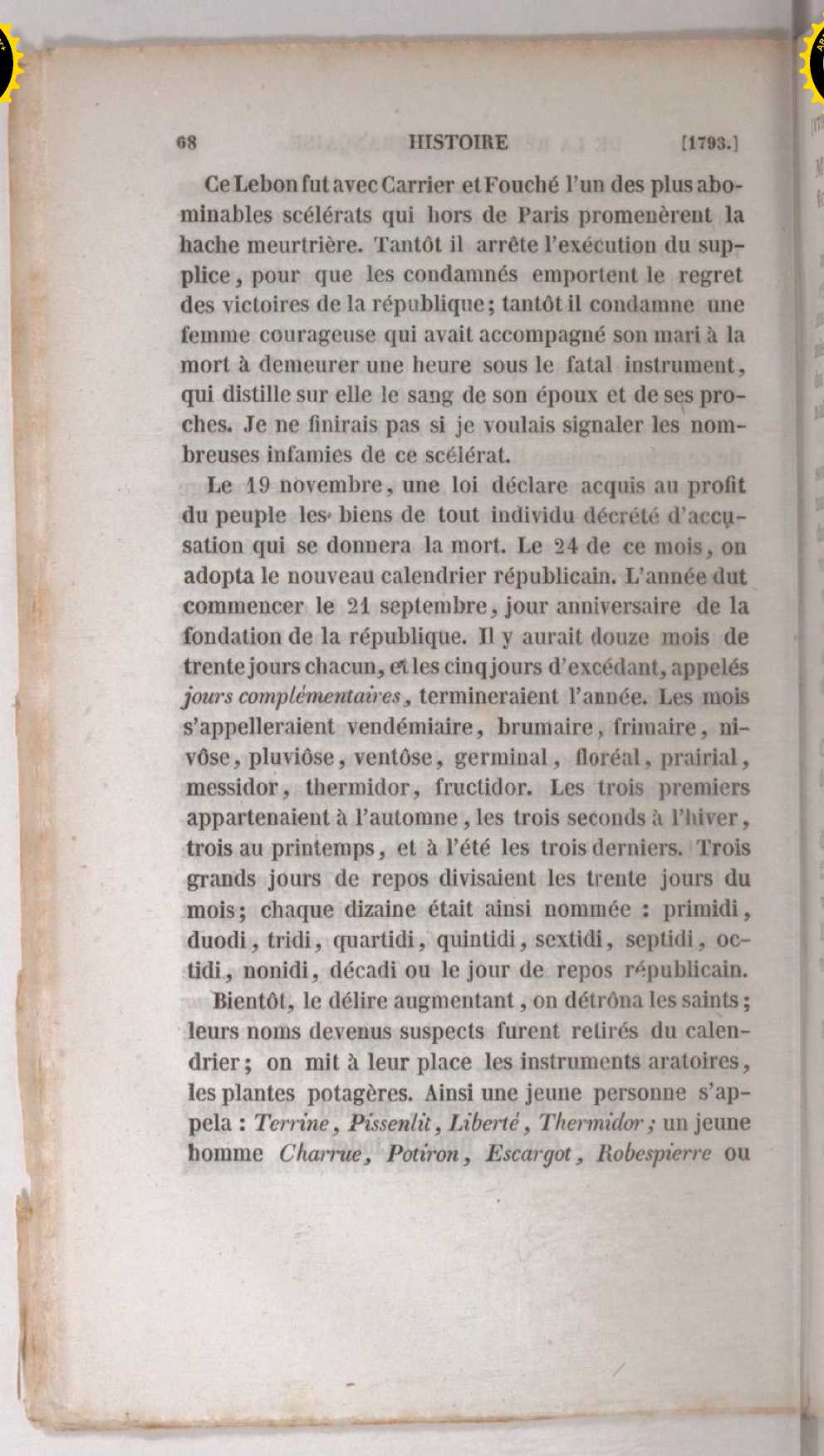
Ce Lebon fut avec Carrier et Fouché l’un des plus abominables scélérats qui hors de Paris promenèrent la hache meurtrière. Tantôt il arrête l’exécution du supplice, pour que les condamnés emportent le regret des victoires de la république ; tantôt il condamne une femme courageuse qui avait accompagné son mari à la mort à demeurer une heure sous le fatal instrument, qui distille sur elle le sang de son époux et de ses proches. Je ne finirais pas si je voulais signaler les nombreuses infamies de ce scélérat.
Le 19 novembre, une loi déclare acquis au profit du peuple les* biens de tout individu décrété d’accusation qui se donnera la mort. Le 24 de ce mois, ou adopta le nouveau calendrier républicain. L’année dut commencer le 21 septembre, jour anniversaire de la fondation de la république. Il y aurait douze mois de trente jours chacun, et les cinq jours d’excédant, appelés jours complémentaires, termineraient l’année. Les mois s’appelleraient vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor. Les trois premiers appartenaient à l’automne, les trois seconds à l’hiver, trois au printemps, et à l’été les trois derniers. Trois grands jours de repos divisaieut les trente jours du mois; chaque dizaine était ainsi nommée : primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, oc-tidi, nonidi, décadi ou le jour de repos républicain.
Bientôt, le délire augmentant, on détrôna les saints ; leurs noms devenus suspects furent retirés du calendrier; on mit à leur place les instruments aratoires, les plantes potagères. Ainsi une jeune personne s’appela : Terrine, Pissenlit, Liberté, Thermidor; un jeune homme Charrue, Potiron, Escargot, Robespierre ou
HISTOIRE
[1793.]

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 69
Marat. C’était un temps d’extravagance, mais où la folie conduisait à la mort.
Cependant, au milieu de ces ridicules et de ces atrocités, l’anarchie seule régnait en France; on le voyait, on l’éprouvait, et nul pourtant n’osait demander un changement. Enfin, et en attendant la mise en vigueur de la dernière constitution, une loi du 4 décembre organisa un gouvernement révolutionnaire.
La Convention était à elle seule le représentant du souverain ; tous les corps constitués et les fonctionnaires publics étaient mis sous l’inspection immédiate du comité de Salut public, pour les mesures de gouvernement, et du comité de Sûreté générale pour tout ce qui était relatif aux personnes et à la police universelle et intérieure. Au comité de Salut public appartenait le changement des autorités civiles, militaires et diplomatiques.
Le 22 décembre, le fort Saint-Elme, les villes de Colliourc et de Port-Vendres, tombèrent au pouvoir des Espagnols.
Ainsi finit l’année de fatale mémoire, 1793, année d’opprobre et de sang, où l’on vit mourir sur l’échafaud un roi et une reine de France ; où trois grandes villes du royaume, Lyon, Marseille et Toulon, furent livrées à la rage jacobine ; où le meurtre et le vol devinrent des mesures d’état légales.
L’année 1794 ne s’ouvrit pas sous de meilleurs auspices , et bien que pendant son cours une partie des bourreaux qui avaient ensanglanté 1793 dût expier ses forfaits, en périssant à son tour, le nombre des victimes qui perdirent la vie cette année-là fut encore très-considérable. Les tyrans qui gouvernaient la mal-
--ABU- -%-*"** -¿Ol
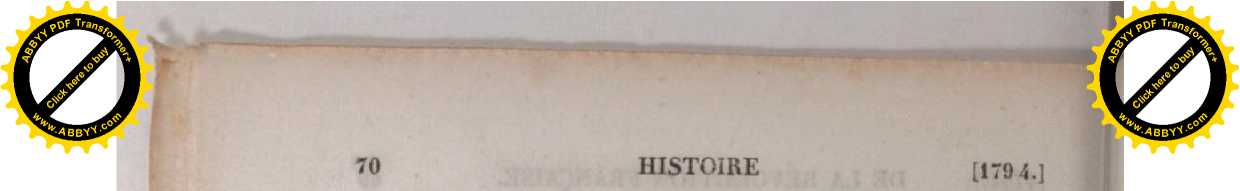
heureuse France traitèrent Marseille et Toulon avec non moins de barbarie que Lyon.
Le 16 janvier, un décret priva la ville de Marseille de son antique nom, et le remplaça par celui absurde de Commune sans nom (1). Barras et Fréron, dignes proconsuls d’une Convention féroce, jaloux d’imiter les excès de Coulhon, tirent démolir à Marseille les lieux où les sections insurgées s’étaient réunies. Le portique de Saint-Féréol fut renversé, ainsi (pie nombre d’autres beaux édifices. Alors l'anarchie, déguisée sous le nom de république, parcourait la France entière; le génie de la dévastation la suivait. Ils organisèrent une compagnie qui devait chasser dans les bois et traquer sur les rochers les fugitifs des diverses villes de la Provence. Par leur ordre le sang coula à flots à Marseille, à Toulon, à Aix, à Arles, à Avignon, à Orange; et tandis que les populations gémissaient, eux, établis dans une bastide avec des prostituées, s’y abandonnaient au plaisir et à la débauche.
Le 21 janvier, une fête ayant été organisée, on sut par le programme que la Convention se rendrait sur la place de la Révolution (Louis XV ), où avait péri le dernier tyran, et que là, en commémoration de cette journée, le bourreau, qui donnerait le bras au président, ferait tomber sous la hache la tête de quatre victimes. Cet abominable cérémonial eut lieu ; mais le Ciel ayant en horreur ces nouveaux Atrides, jamais journée ne fut plus affreuse que celle-là ; la pluie tomba sans interruption.
(I) Cet absurde décret fut bientôt révoqué, et Marseille recouvra son nom [le 12 février suivant.
L. L. L.
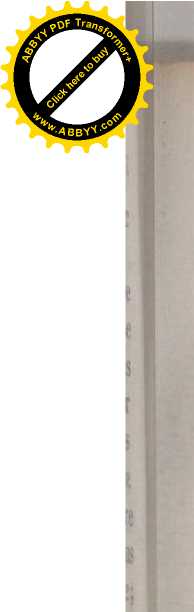
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 71
Le 15 février, un nouveau drapeau fut adopté, celui qui avait été déterminé par l’Assemblée constituante ne convenant plus ; le décret porta : « Le pa-« villon national sera formé des trois couleurs natio-« nales, disposées en trois bandes égales posées « verticalement, de manière à ce que le bleu soit at-« taché au bois de la lance du pavillon, le blanc au a milieu et le rouge flottant dans les airs. »
Ce fut le 16 février que le cardinal de Brienne s’empoisonna, pour éviter le supplice auquel son frère marcha avec courage. Ce mauvais prêtre, sacrilège, apostat, déserteur de la foi, avait déjà renvoyé le chapeau rouge au Saint-Père; fauteur de la révolution, il croyait lui avoir donné assez de gages; mais semblable à Saturne et sans reconnaissance, la révolution dévorait ses enfants les plus dévoués. On vint pour l'arrêter, il demanda de ne partir que le jour suivant; on le lui accorda, et ce lendemain venu, on le trouva couché dans son lit et sans vie : il s’était donné la mort.
Si de tels coupables eussent péri seuls, on aurait moins de reproches à faire à cette ère sanglante; mais que de sang innocent était versé ! Les cannibales qui s’étaient emparés du pouvoir n’épargnaient ni l’adolescence , ni la vieillesse ; souvent aussi leur rage se ruait sur leurs propres complices, et ceux-ci périssaient à leur tour de la main de leurs amis, ou, pour mieux dire, de leurs collègues. Ainsi on a vu les Girondins monter à l’échafaud, puis Danton et les siens; maintenant arrivait le tour de ce scélérat d’Hébert, dit le Père Duchêne.
Robespierre haïssait et jalousait à la fois tous les Jacobins influents et ambitieux; il savait qu’ils s’opposeraient constamment à ses projets : en conséquence
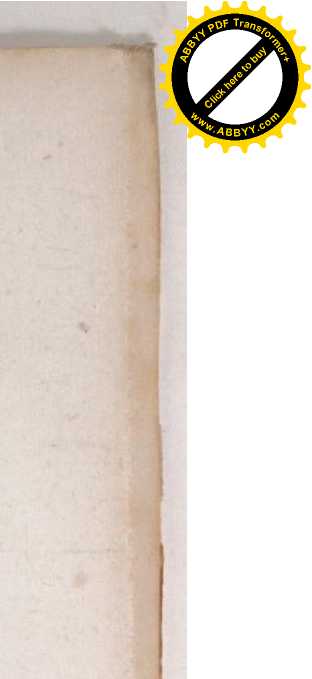
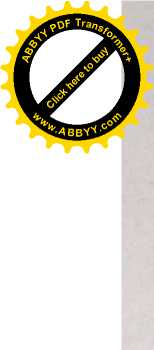
HISTOIRE
[1794.]

il s’arrangea de manière à les envoyer successivement au supplice. Pour y parvenir sûrement, son séide, son alter ego, Saint-Just, proposa et fit passer un décret qui déclarait traîtres à la patrie tous ceux qui seraient convaincus d’avoir excité des inquiétudes dans Paris, à dessein d’empêcher les arrivages des denrées; d’avoir donné asile à des émigrés; d’avoir introduit des armes dans Paris, dans le dessein d’assassiner le peuple ; d’avoir tenté d’altérer la forme du gouvernement républicain : toute résistance à la volonté de la Convention devenait un attentat, et la peine de mort suivait contre quiconque chercherait à entraver ou à avilir la Convention.
Ce décret élastique menaçait Hébert, le général Ron-sin, l’ex-baron Palhen, Clootz, surnommé Anacharsis, et décoré du titre A’Orateur du genre humain, parce qu’il avait porté la parole lors de la ridicule parodie qui eut lieu en 1790, quanti de prétendus députés de toutes les nations existantes sur le globe vinrent, dit-on, féliciter l’Assemblée constituante sur les droits de l’homme solennellement proclamés et reconnus dans son sein; Vincent Monmoro, dont la femme faisait dans les fêtes publiques tantôt la Liberté, tantôt la Raison ; Ducroquet, le général Le Camus, tous révolutionnaires subalternes et déjà emprisonnés.
Couthon, chargé de les vouer au supplice, les accusa d’avoir comploté le massacre des représentants. Hébert, au dire de Saint-Just, organisait la famine; Ronsin affichait un luxe insultant pour la misère publique. Avec eux était Dubuisson, autre conjuré, qui avait quelques talents littéraires (1).
(i) Dubuisson (Paul-UJric), né à Laval en 1755, embrassa h
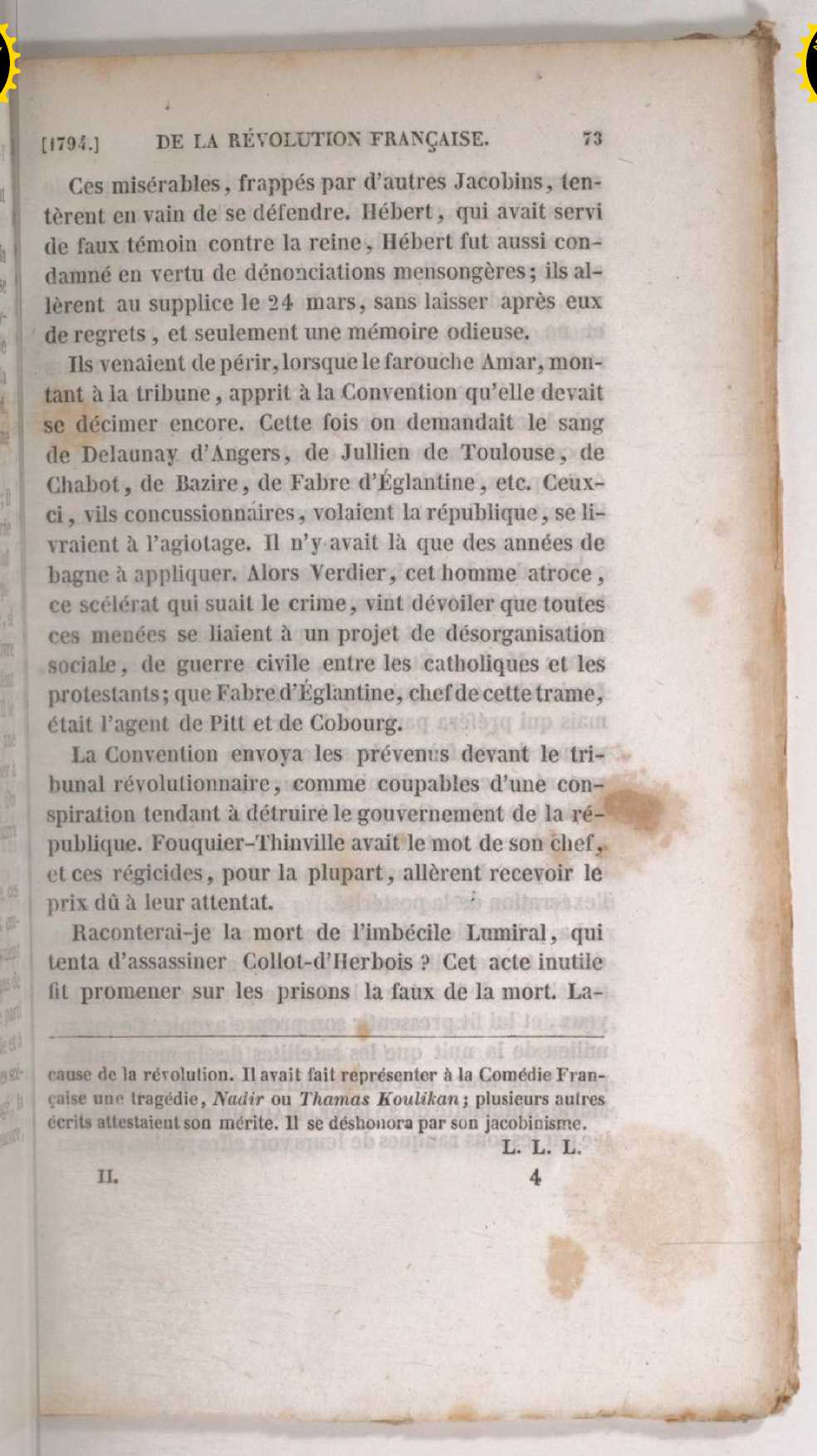
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
[1794
Ces misérables, frappés par d’autres Jacobins, tentèrent en vain de se défendre. Hébert, qui avait servi de faux témoin contre la reine, Hébert fut aussi condamné en vertu de dénonciations mensongères; ils allèrent au supplice le 24 mars, sans laisser après eux de regrets, et seulement une mémoire odieuse.
Ils venaient de périr, lorsque le farouche Amar, montant à la tribune, apprit à la Convention qu’elle devait se décimer encore. Cette fois on demandait le sang de Delaunay d’Angers, de Jullicn de Toulouse, de Chabot, de Bazire, de Fabre d’Églantine, etc. Ceux-ci , vils concussionnaires, volaient la république, se livraient ii l’agiotage. H n’y avait là que des années de bagne à appliquer. Alors Verdier, cet homme atroce, ce scélérat qui suait le crime, vint dévoiler que toutes ces menées se liaient à un projet de désorganisation sociale, de guerre civile entre les catholiques et les protestants; que Fabre d’Fglantine, chef de cette trame, était l’agent de Pitt et de Cobourg.
La Convention envoya les prévenus devant le tribunal révolutionnaire, comme coupables d’une conspiration tendant à détruire le gouvernement de la république. Fouquier-Thinville avait le mot de son chef, et ces régicides, pour la plupart, allèrent recevoir le prix dû à leur attentat. ;
Raconterai-je la mort de l’imbécile Lumiral, qui tenta d’assassiner Collot-d’Herbois ? Cet acte inutile lit promener sur les prisons la faux de la mort. La-
rause de la révolution. Il avait fait représenter à la Comédie Française uno tragédie, Nadir ou Thomas Koulikan; plusieurs autres écrits attestaient son mérite. 11 se déshonora par son jacobinisme.
L. L. L.
IL 4

71
HISTOIRE

moignon de Malesherbes , le ministre, l’ami de Louis XVI, qui, par tant de vertus et d’héroïsme, racheta ses erreurs philosophiques, fut pres<|ue regretté de ses bourreaux. Il en fut ainsi du sa_e Angrand d’Alle-ray, président du Châtelet. Fouquier voulait le sauver, et ne pouvant y parvenir, à cause de la fermeté stoïque de la victime, du moins il la para de fleurs par ses éloges. Ce fut un spectacle étrange que de voir l’accusateur rendre hommage à l’accusé, parler de cette vie sans tache, et conclure à la mort.O temps! ô temps exécrable, que des insensés regrettent, car ils font tous leurs efforts pour le faire renaître parmi nous !
Mais dans le nombre de ces victimes, il en est une tellement sainte, tellement auguste, que mon cœur saigne en y pensant, que ma plume hésite à tracer son nom : Madame Élisabeth, l’incomparable sœur de Louis XVI, celle qui aurait pu fuir de bonne heure, mais qui préféra partager le sort de sa famille, compagne de son frère, de sa sœur, de sa nièce chérie, restant avec cette dernière pour pleurer ceux qu’elles avaient perdus. Qui pouvait imaginer que dans cette vie si pure et toute d’amertume on trouverait un motif de trépas ? Les monstres ! ils voulaient mériter toute l’exécration de la postérité.
La prison de cette princesse, au Temple, lui fut douce tant qu’elle put la partager avec les siens. La translation de la reine à la Conciergerie lui dessilla les yeux, et lui fit pressentir son propre avenir. Ce fut au milieu de la nuit que les satellites de la mort entrèrent à la tour, et commandèrent impérieusement à Marie-Antoinette de se lever. Madame royale, réveillée par les sons rauques de leurs voix effroyables, poussa
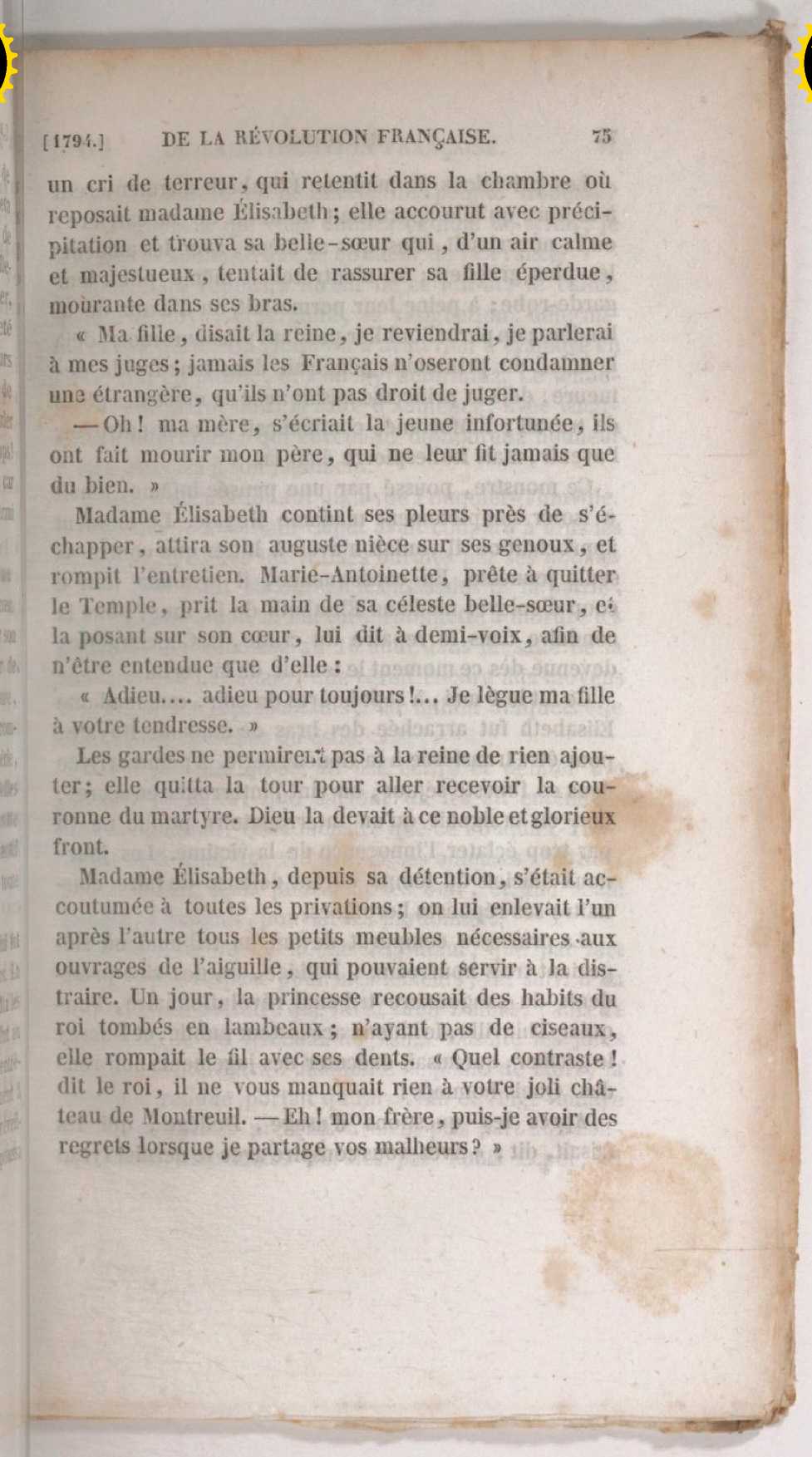
un cri de terreur, qui retentit dans la chambre où reposait madame Élisabeth; elle accourut avec précipitation et trouva sa belle-sœur qui, d’un air calme et majestueux , tentait de rassurer sa tille éperdue, mourante dans scs bras.
« Ma lilie, disait la reine, je reviendrai, je parlerai à mes juges ; jamais les Français n’oseront condamner una étrangère, qu'ils n’ont pas droit déjuger.
— Oh! ma mère, s’écriait la jeune infortunée, ils ont fait mourir mon père, qui ne leur fit jamais que du bien. »
Madame Élisabeth contint ses pleurs près de s’échapper , attira son auguste nièce sur ses genoux, et rompit l'entretien, Marie-Antoinette, prête à quitter le Temple, prit la main de sa céleste belle-sœur, c« la posant sur son cœur, lui dit à demi-voix, afin de n’ôtre entendue que d’elle :
« Adieu.... adieu pour toujours!... Je lègue ma fille à votre tendresse. »
Les gardes ne permirent pas à la reine de rien ajouter; elle quitta la tour pour aller recevoir la couronne du martyre. Dieu la devait à ce noble et glorieux front.
Madame Élisabeth, depuis sa détention, s’était accoutumée à toutes les privations ; on lui enlevait l’un après l'autre tous les petits meubles nécessaires aux ouvrages de l’aiguille, qui pouvaient servir à la distraire. Un jour, la princesse recousait des habits du roi tombés en lambeaux; n’ayant pas de ciseaux, elle rompait le ¡il avec ses dents. « Quel contraste ! dit le roi, il ne vous manquait rien à votre joli château de Montreuil. —Eh ! mon frère, puis-je avoir des regrets lorsque je partage vos malheurs ? »
[Í79L] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
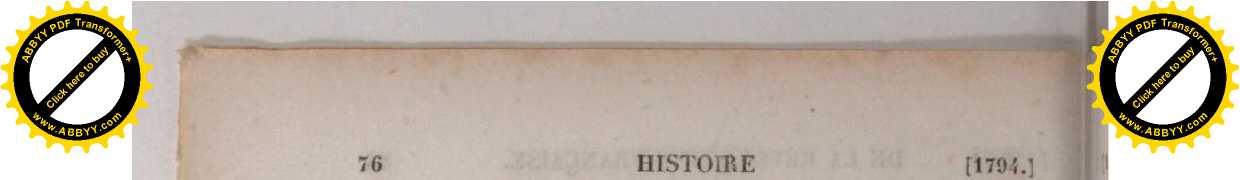
ï.es privations de madame Elisabeth augmentèrent à mesure qu’elle approchait de la fin de sa carrière: on la nourrissait, ainsique sa nièce, avec les aliments les plus grossiers; on n’entretenait même point leur garde-robe; à peine leur permettait-on d’avoir de la lumière ; on parut l’oublier pendant plusieurs mois ; déjà le soleil du printemps pénétrait dans leur froide demeure, déjà la princesse faisait avec sa nièce des plans de travail ; l’infortunée commençait à oser entrevoir l’avenir , mais Robespierre était là.
Ce monstre, poussé par une pensée infâme, tenait à isoler complètement madame Royale. Le moment approchait où il voulait n’avoir à lutter que contre sa seule jeunesse. En conséquence, il ordonna tout à coup d’enlever madame Élisabeth de la tour, pour la conduire dans le repaire du crime, la Conciergerie, devenue dès ce moment le temple de la vertu.
Ce fut le 9 mai, à sept heures du soir, que madame Élisabeth fut arrachée des bras de madame Royale, pour être transférée à la Conciergerie. A peine arrivée dans ce funeste séjour, on vint l’interroger en secret, tant on craignait qu’un interrogatoire public ne fît par trop éclater l’innocence de la victime. Les journaux officiels du temps eurent défense de faire connaître ses réponses héroïques.
La princesse comparut devant un tribunal où siégeaient trois bourreaux : Deliége, un des vice-présidents du sanguinaire tribunal révolutionnaire, Fou-quier-Thinville, le hideux accusateur public, et Ducray le greffier, qui faisait exécuter des jugements non rendus. Quels hommes !
Après les questions d’usage , Deliége , qui les faisait, dit : « Avez-vous conspiré avec le dernier tyran

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 77 contre la sûreté et la liberté du peuple français ?
— J’ignore à qui vous donnez ce nom de tyran; je n’ai jamais souhaité que le bonheur de la France. »
Toutes ses réponses furent de ce ton-là; le calme qu’elle déploya, sa sérénité, sa résignation, déterminèrent sa perte. On vit qu’on n’avait rien à craindre en l’amenant en public, et l’on s’y détermina. Le lendemain, elle parut dans la salle d’audience, avec vingt-quatre infortunés, qui eurent le douloureux honneur d’être associés à son jugement.
L’acte d’accusation fut digne de Fouquicr-Thinville. A l’entendre, Élisabeth Capot avait coopéré à tous les complots, à toutes les trames ourdies par ses infâmes frères. Elle avait encouragé les assassins de la patrie , elle!... Elle aidait la barbare Antoinette à mordre les balles.... et, conduite au 10 août dans la salle de la souveraineté nationale, elle rêvait encore aux moyens d’égorger les représentants, au milieu desquels elle était venue chercher un asile. »
Est-il possible qu’on ait osé écrire et débiter des phrases pareilles, que surtout on les ait entendues sans indignation ? Quel monstre que ce Fouquier-Thin-ville, et à quel ange il prêtait ses odieuses rêveries ! Les Jacobins seuls pouvaient les ouïr, et une seule femme, Élisabeth , pouvait les pardonner.
La lecture de ce libelle dégoûtant, que j’ai fort abrégé, par respect pour mes lecteurs, fut suivi d’un second interrogatoire que lui fit subir Dumas, l’affreux président de ce tribunal de sang. Ensuite les jurés consultés votèrent à l’unanimité la peine de mort; la sentence rendue portait qu’Élisabeth et vingt-quatre autres complices présents avaient pris part aux conspirations liberticides ourdies par Louis Capet, sa

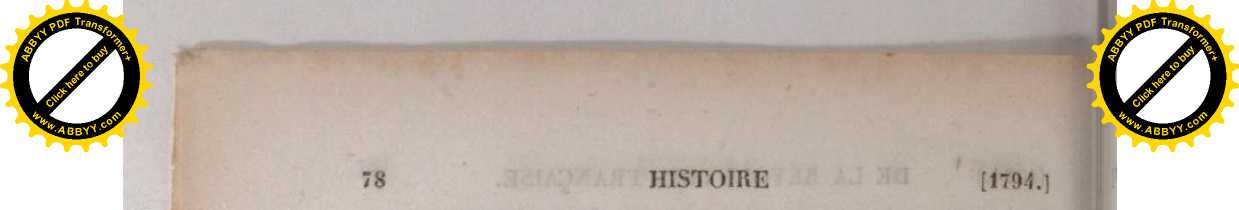
femme et sa famille. En conséquence, la loi les condamnait à la peine de mort.
A la lecture de cet effroyable arrêt, la princesse ne changea pas de visage; elle avait appris, en entrant à la Conciergerie, le destin de la reine, qu’elle ignora jusque-là, et dès lors elle avait désiré être réunie à son frère et à sa sœur. Lorsqu’elle se trouva seule avec les infortunés qui devaient l’accompagner à la place de la Révolution, elle s’oublia pour ne leur parler que d’eux-mêmes; elle leur montra les portes du Ciel ou! vertes pour les recevoir, leur dit qu’il était de leur
intérêt d’aller chercher une patrie au ciel qui ne leur serait pas ingrate : elle s’efforça de semer leur chemin de fleurs jusque sur les marches de l’échafaud.
Je tiens d’une personne qui eut le courage de suivre le char funèbre depuis le Palais-de-Justice jusqu’à la place de la Révolution, que madame Élisabeth conserva tout le long de la route une altitude noble et tranquille. Elle causa avec la sœur de Malesherbes et la veuve de Montmorin, comme si elle eût été encore dans la galerie de Versailles, sans faire attention aux vociférations de la populace égarée.
Parvenue au pied du fatal autel, la férocité de ses bourreaux l’y suivit encore ; on eut la barbarie de ne lui faire monter les marches que lorsque les vingt-quatre tètes furent tombées. Dans cet intervalle horrible, la princesse remercia la marquise de Crussol d’Amboise du tendre intérêt qu'elleluiavaittémoigné,et, les larmes aux yeux, exprima son regret de ne pouvoir le reconnaître comme elle le voudrait. « Ah ! madame, si Votre Altesse Royale daignait m’embrasser, je serais au comble de mes vœux. —Bien volontiers, marquise, et de tout mon cœur. »
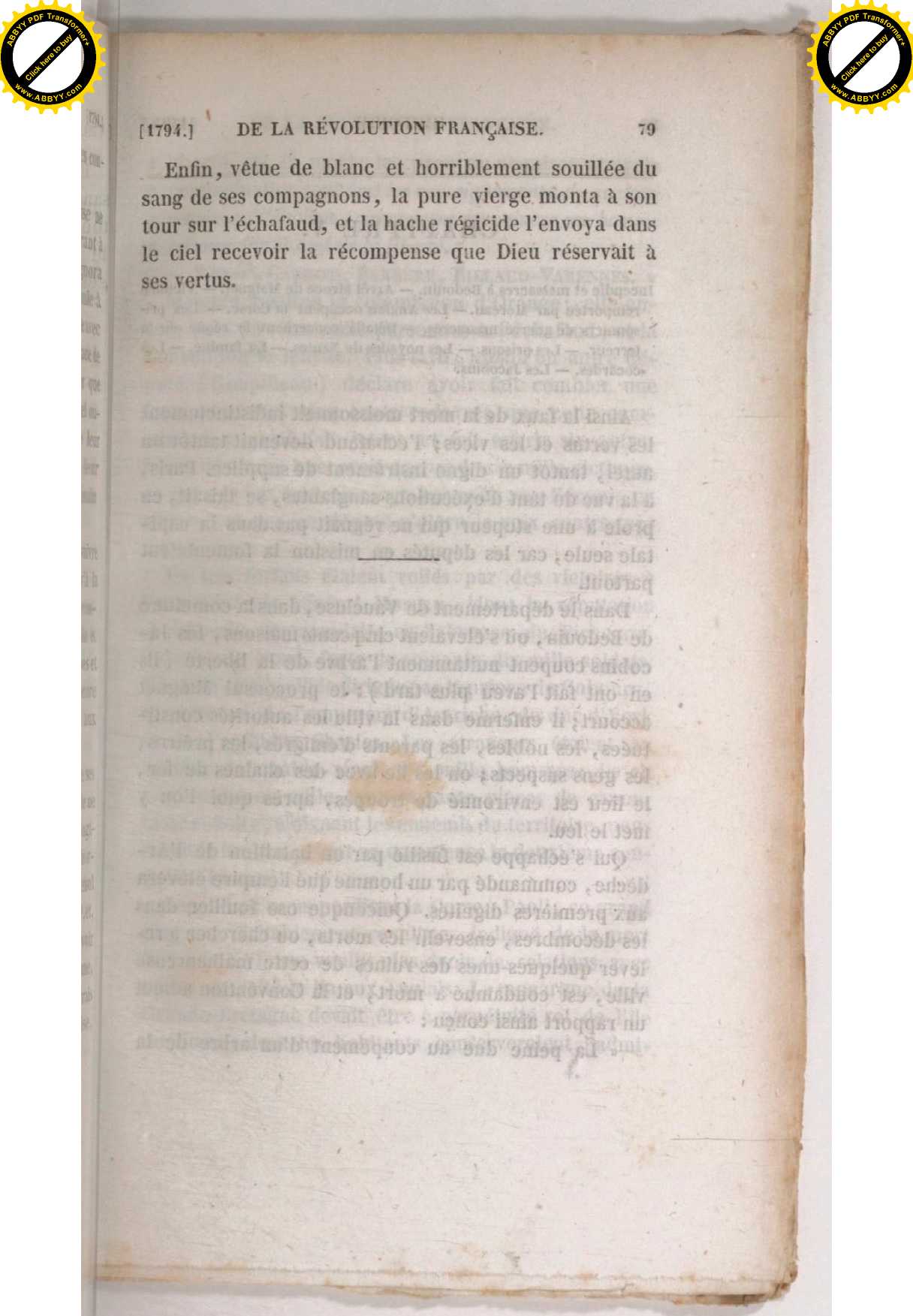
[1794J DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 79
Enfin, vêtue de blanc et horriblement souillée du sang de ses compagnons, la pure vierge monta à son tour sur l’échafaud, et la hache régicide l’envoya dans le ciel recevoir la récompense que Dieu réservait à ses vertus.

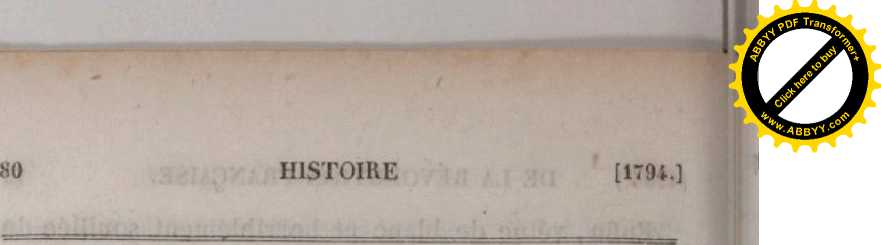
Incendie et massacres à Bédouin. — Arrêt atroce de Maignet. — Victoire remportée par Moreau. — Les Anglais occupent la Corse. — Les prisonniers de guerre massacrés. — Détails concernant le règne de la terreur. — Les prisons. — Les noyades de Nantes. — La famine. — Les cocardes. — Les Jacobins.
Ainsi la faux de la mort moissonnait indistinctement les vertus et les vices; l’échafaud devenait tantôt un autel, tantôt un digne instrument de supplice. Paris, à la vue de tant d’exécutions sanglantes, se taisait , en proie à une stupeur qui ne régnait pas dans la capitale seule, car les députés en mission la fomentaient partout.
Dans le département de Vaucluse, dans la commune de Bédouin, où s’élevaient cinq cents maisons, les Jacobins coupent nuitamment l’arbre de la liberté ( ils en ont fait l’aveu plus tard ) : le proconsul Maignet accourt; il enferme dans la ville les autorités constituées, les nobles, les parents d’émigrés, les prêtres, les gens suspects; on les lie avec des chaînes de fer, le lieu est environné de troupes, après quoi l’on y met le feu.
Qui s'échappe est fusillé par un bataillon de F Ardèche, commandé par un homme que l’empire élèvera aux premières dignités. Quiconque ose fouiller dans les décombres, ensevelir les morts, ou chercher à relever quelques-unes des ruines de cette malheureuse ville, est condamné à mort, et la Convention admet un rapport ainsi conçu :
« La peine due au coupement d’un arbre de la
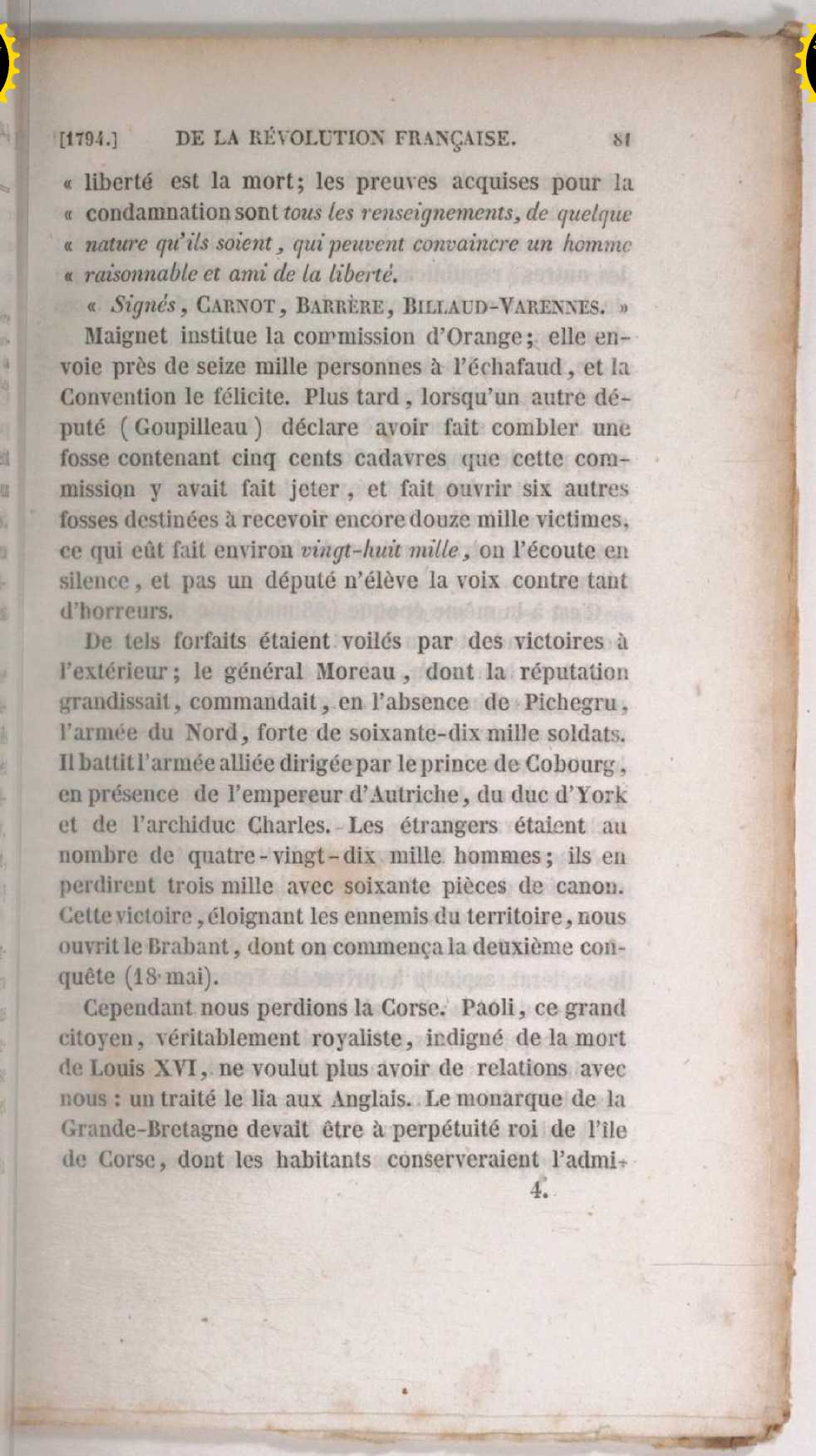
« liberté est la mort; les preuves acquises pour la « condamnation sont tous les renseignements, de quelque « nature qu’ils soient, qui peuvent convaincre un homme a raisonnable et ami de la liberté.
« Signés, CARNOT, BARRERE, BILLAED-VARENNES. »
Maignet institue la commission d’Orange ; elle envoie près de seize mille personnes à l’échafaud, et la Convention le félicite. Plus tard, lorsqu’un autre député ( Goupilleau ) déclare avoir fait combler une fosse contenant cinq cents cadavres que cette commission y avait fait jeter, et fait ouvrir six autres fosses destinées à recevoir encore douze mille victimes, ce qui eût fait environ vingt-huit mille, ou l’écoute en silence, et pas un député n’élève la voix contre tant d’horreurs.
De tels forfaits étaient voilés par des victoires à l’extérieur ; le général Moreau, dont la réputation grandissait, commandait, en l’absence de Pichegru. l'armée du Nord, forte de soixante-dix mille soldats. Il battit l’armée alliée dirigée par le prince de Cobourg, en présence de l’empereur d’Autriche, du duc d’York et de l’archiduc Charles. Les étrangers étaient au nombre de quatre-vingt-dix mille hommes; ils en perdirent trois mille avec soixante pièces de canon. Celte victoire, éloignant les ennemis du territoire, nous ouvrit le Brabant, dont on commença la deuxième conquête (18-mai).
Cependant nous perdions la Corse. Paoli, ce grand citoyen, véritablement royaliste, indigné de la mort de Louis XVI, ne voulut plus avoir de relations avec nous : un traité le lia aux Anglais. Le monarque de la Grande-Bretagne devait être à perpétuité roi de File de Corse, dont les habitants conserveraient l’admis
[1794.]
DE LA RÉVOLUTION* FRANÇAISE
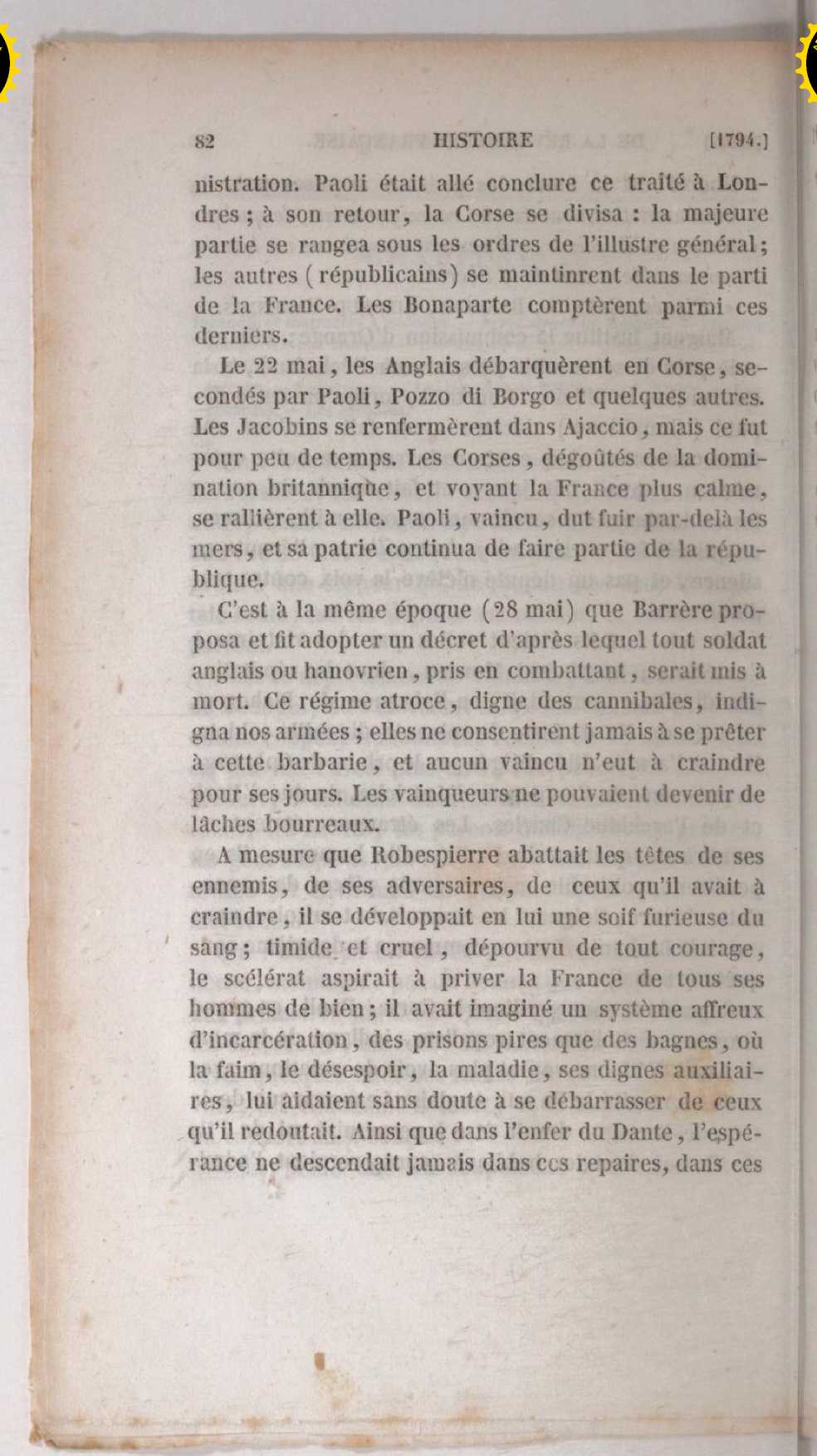
nistration. Paoli était allé conclure ce traité à Londres ; à son retour, la Corse se divisa : la majeure partie se rangea sous les ordres de l’illustre général; les autres ( républicains) se maintinrent dans le parti de la France. Les Bonaparte comptèrent parmi ces derniers.
Le 22 mai, les Anglais débarquèrent en Corse, secondés par Paoli, Pozzo di Borgo et quelques autres. Les Jacobins se renfermèrent dans Ajaccio, mais ce fut pour peu de temps. Les Corses, dégoûtés de la domination britannique, et voyant la France plus calme, se rallièrent à elle. Paoli, vaincu, dut fuir par-delà les mers, et sa patrie continua de faire partie de la république.
C’est à la môme époque (28 mai) que Barrèreproposa et lit adopter un décret d'après lequel tout soldat anglais ou hanovrien, pris en combattant, serait mis à mort. Ce régime atroce, digne des cannibales, indigna nos armées ; elles ne consentirent jamais à se prêter à cette barbarie, et aucun vaincu n’eut à craindre pour ses jours. Les vainqueurs ne pouvaient devenir de lâches bourreaux.
A mesure que Robespierre abattait les tètes de ses ennemis, de ses adversaires, de ceux qu’il avait à craindre, il se développait en lui une soif furieuse du sang; timide et cruel, dépourvu de tout courage, le scélérat aspirait à priver la France de tous ses hommes de bien; il avait imaginé un système affreux d’incarcération, des prisons pires que des bagnes, où la faim, le désespoir, la maladie, ses dignes auxiliaires, lui aidaient sans doute à se débarrasser de ceux qu’il redoutait. Ainsi que dans l’enfer du Dante, l’espérance ne descendait jamais dans ces repaires, dans ces
HISTOIRE
[1794.]
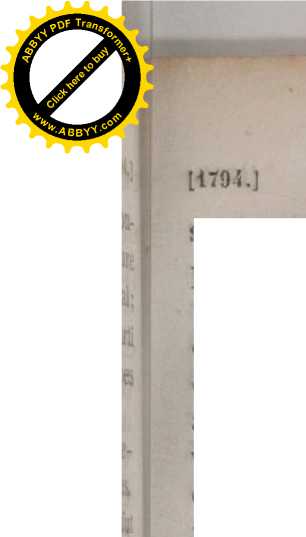
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
83

soixante mille bastilles, car il y en avait une au moins par commune dans la république.
Là on rencontrait d’énormes portes fermant des cachots appelés souricières, réduits infects où des rats, des reptiles énormes, faisaient une guerre continuelle aux malheureux qu’on y renfermait, rongeant leurs provisions , leur linge, leurs effets, souvent leur nez, leurs oreilles, et leur ravissant la jouissance d’un sommeil réparateur.
Le jour pénétrait à peine dans ces cachots ; la paille dont se composait la litière des prisonniers, bientôt corrompue par le défaut d’air et la puanteur des seaux oîi les détenus faisaient leurs ordures, exhalait une telle infection, que dans le greffe même il fallait tenir perpétuellement la porte ou les fenêtres ouvertes.
Les prisonniers étaient ou à la pistole, ou à la paille, ou au cachot; la pauvreté devenait un nouveau crime que les plus cruelles privations et la plus affreuse inégalité faisaient expier dans ces lieux d’horreur, les cachots ne s’ouvrant que pour passer la nourriture. faire les visites et retirer les baquets.
La table commune était appelée la gamelle; par elle on remplaçait les dîners particuliers, que l’on trouvait trop aristocratiques. Ou avait divisé les repas en trois temps. Ceux des détenus qui étaient du second et du troisième temps prenaient sous le bras tout l’attirail nécessaire, et se tenaient debout comme des laquais de l’ancien régime, attendant patiemment qu’on leur cédât la place. Ils bravaient le soleil, le froid et la pluie, selon la saison. L’amalgame des tables était singulier : galeux, voleurs, assassins, honnêtes gens, nobles, grands seigneurs, se trouvaient là pêle-mêle ;
*

81 HISTOIRE [1795.] un seul repas devait suffire, et si l’on se plaignait on vous dénonçait au tribunal révolutionnaire.
Chaque prison avait son comité de délation, composé d’un certain nombre d'individus tarés, de nobles lâches et peureux, de richards, qui, dans l’espoir de sauver leur tète, jouaient ce rôle infâme. Plusieurs n'étaient prisonniers qu’en apparence ; ils se réunissaient et de concert dressaient la liste de proscription : quand elle était close, ils montaient au greffe, faisaient leur rapport, et très-souvent ils servaient de témoins au tribunal révolutionnaire.
Les lits étaient à l’avenant de la nourriture. Deux ou trois fois on avertit les prisonniers qu'on leur permettait de se meubler ; presque tous firent apporter de bonnes couchettes, des lits montés, des couvertures de prix, des draps superbes, du beau linge de table, des meubles d’acajou ou d’incrustation ; puis tout à coup une réquisition leur enlevait ces divers objets au profit de la république.
Je renvoie aux ouvrages spéciaux qui ont été faits sur les diverses prisons en France, pour qu’on y recherche des détails pénibles sur lesquels je ne peux m’appesantir, et que je peux à peine esquisser. Je voudrais montrer aussi l’instrument de mort promené de ville en ville, de commune en commune, faisant partout son sanglant office; présenter la France désolée, presque tous les nobles émigrés, prisonniers, en fuite, cachés ou soldats; les prêtres bannis, errants, dans les fers, égorgés, ou conduits à l’échafaud. Des enfants au-dessous de seize ans furent condamnés par le tribunal révolutionnaire. Les fermiers-généraux , ayant en tête le célèbre Lavoisier, Par-scval-Grandinaison, Frileuse, D’Arlincourt, Dela-
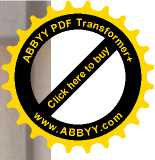

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
S5
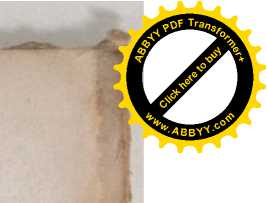
borde, etc., périrent malgré leurs énormes richesses.
Les treize parlements du royaume comparurent en majorité devant cet abominable tribunal. On vit aller à ki mort, dit un auteur, du même air majestueux que s’il se fût agi d’aller à une cérémonie publique, les membres des parlements de Toulouse et de Bordeaux. Le premier, dont mon infortuné père faisait partie, fut décimé et perdit plus des deux tiers de ses conseillers. Jours affreux, jours de sang, éternellement couverts d’un voile de deuil dans notre triste histoire ! Quel est l’homme qui pourrait regretter ces temps horribles où le crime seul jouissait de la liberté !
A Nantes, et sous prétexte de réduire la Vendée , l'indigne Carrier employait la fusillade, l’échafaud et les bateaux à soupape. La Loire vil les atroces mariages républicains ; un homme et une femme liés nus ensemble étaient ainsi jetés dans les ondes. D’autres fois deux à trois cents condamnés abandonnés sur le fleuve, à la dérive, tombaient dans les flots, qui rejetaient sur les rivages épouvantés ces tristes victimes de la rage révolutionnaire.
Un jour vint où l’on ne voulut plus manger du poisson pêché dans la Loire, parce qu’il se nourrissait de chair humaine. Les requins affluaient à son embouchure; il n’était pas rare de voir une quantité de cadavres roulés par les eaux venir échouer sur la grève. De hideux serpents s’entortillaient autour de cette fétide proie, et les vautours descendaient des monts pour disputer aux loups, aux renards, cette dégoûtante pâture.
El c’étaient des philosophes, des hommes nourris aux maximes de Rousseau, de Voltaire, qui ordonnaient ces abominations ! C’était au nom de la Raison
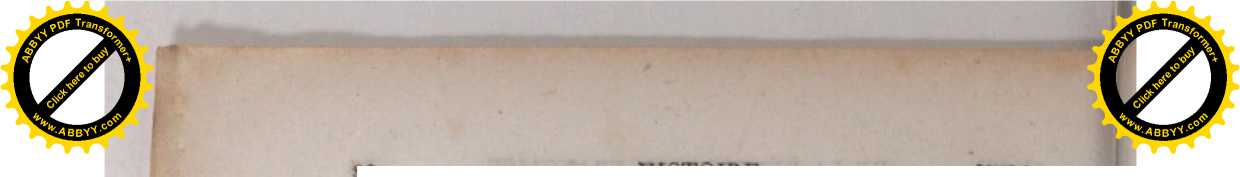
HISTOIRE
96
[1791]
que l’on rétablissait l’idolâtrie, au nom de la Liberté que l’on réédifiait les prisons, au nom de l’Égalité que l’on multipliait les suspects et les proscriptions !
La famine, la défiance, la désolation, la terreur, s’étendaient sur chaque habitation, troublée le jour et la nuit par des visites domiciliaires multipliées ; nul, dès la nuit venue, n’osait sortir de chez soi, où toute une famille n’avait pour s’éclairer que la chandelle unique accordée par décade à chaque individu. Le pain blanc, devenu objet de luxe, se vendait chez les bijoutiers, tant il était rare. « Venez dîner chez moi, disait-on, la chère sera bonne, mais apportez votre paiu, car je n’en ai pas à vous offrir. » On s’envoyait des pains de munition en guise de cadeau, et j’ai été témoin de la joie étrange qu’occasionnait un pareil présent.
Nul ne serait sorti, quel que fût son sexe, sans avoir en évidence, les hommes à leur chapeau, les femmes à leur coiffe ou sur le cœur, le signe de civisme. On dînait dans les rues ; ces agapes républicaines dégénérèrent en impudiques saturnales. Chaque fête avait un caractère bizarre et féroce : toujours une montagne gigantesque en formait la décoration principale; là on exposait aux regards le livre de la loi, la constitution de 1793, encensée par des lévites et couverte de Heurs par de jeunes filles : mais des haches luisantes étincelaient parmi les guirlandes et les bouquets.
Une horde de sales escrocs, mal mis, armés de sabres, de pistolets, de bâtons noueux, ayant les cheveux courts et huileux, portant une carmagnole rayée, un gilet à grandes pointes, un bonnet rouge, des sabots ou tout au moins de gros souliers, erraient dans les rues le jour, la nuit, le soir, le matin, injuriant, battant, tuant parfois, ou traînant en prison le sus-

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
87
pect, le muscadin, l’aristocrate qu’ils rencontraient. Malheur au créancier dont le débiteur faisait partie de cette troupe ! Malheur à la jeune, belle et sage tille qui inspirait d’impudiques désirs à ces scélérats! elle devait ou y répondre ou marcher au supplice, en la compagnie de tous ses parents.
Chaque jour voyait augmenter cet état affreux. L’épouvante régnait d’une extrémité de la France à l'autre. On égorgeait à Lyon, à Orange, à Avignon, à Nîmes, à Marseille, à Toulon, à Montauban, à Toulouse, à Nantes, au Mans, dans la Bretagne , dans toute la Vendée. Vingt à quarante, et quelquefois soixante accusés étaient conduits, chaque après-midi, d’abord à la place de la Révolution, puis à la barrière du Trône. Les têtes tombaient aux cris de vive la république ! Lue joie féroce éclatait parmi les spectateurs de ces assassinats juridiques.
On alla plus loin; la prétendue conspiration de Dillon ayant encombré le Luxembourg de ceux qu’on accusait d’avoir pris part à cette trame imaginaire, cent soixante, dans le nombre, furent destinés à périr. Fouquier-Thinville imagina de frapper les esprits et les yeux par un appareil inusité, par une forme de supplice rapide et atroce. Il commanda de grands changements dans la disposition de la salle des jugements; à la place du siège des prévenus et de celui des avocats, où dix-huit à vingt personnes pouvaient s’asseoir, il fit construire un amphithéâtre, destiné à recevoir cent cinquante accusés à la fois : il appelait cela les petits gradins. Puis, poussant la fureur jusqu’à l’extravagance, il fit dresser l’échafaud à l’extrémité de la salle.
Son plan était de faire exécuter les accusés aussitôt


88
HISTOIRE
[1794.]

après le jugement rendu, et sans désemparer. Cette monstruosité lit peur au comité de Salut public. On donna ordre à Fouquier qu’il eût à remettre la salle sur l’ancien pied, à faire disparaître l'instrument de mort, et on lui défendit de faire condamner plus de soixante accusés dans la même séance.
« Ce misérable fou, dit à cette occasion Collot-d’Herbois, veut démoraliser le supplice. »
Au reste, Fouquier, horriblement plaisant, avait dit de la vieille duchesse de Luxembourg, qui était privée de l’ouïe : « Elle aura conspiré sourdement. » Un maître en fait d’armes étant condamné à mort : a Mon cher, lui dit l’exécrable accusateur public, tâche de parer cette botte. »
Voici la composition de cet abominable tribunal révolutionnaire. La postérité doit conserver les noms des monstres qui consentirent à en faire partie, afin de les dévouer à une réprobation universelle.
Président, Dumas. Vice-présidents, Coflinhal, Sccl-lier, Naudin.
Accusateur public, Fouquier - Thinville. Substituts, Gribeauval, Roger-Liendon, Givois. Agent national du district de Cassel, Legracieux, employé à la bibliothèque nationale de Strasbourg.
Juges, Ramey, Deliége, Foucauld-Verteuü, Maire, Barbier de Lorient, Harny, Garnier, Launay; Paillet, professeur de rhétorique à Chutons; Laporte, membre de la commission militaire à Tours; Fliex, idem; Boyer, de la section Marat.
Jurés, Renaudin, Renatrais, Fauvetty, Larmière, Feneaux, Gauthier, Maigre, Challet, Petit-Tressin, Trinchand, Topini-Lebrun, Pijot, Girard, Dusselin, Didier, Vilalte, Dix-Aout, Laporte, Lanney, Drochet,
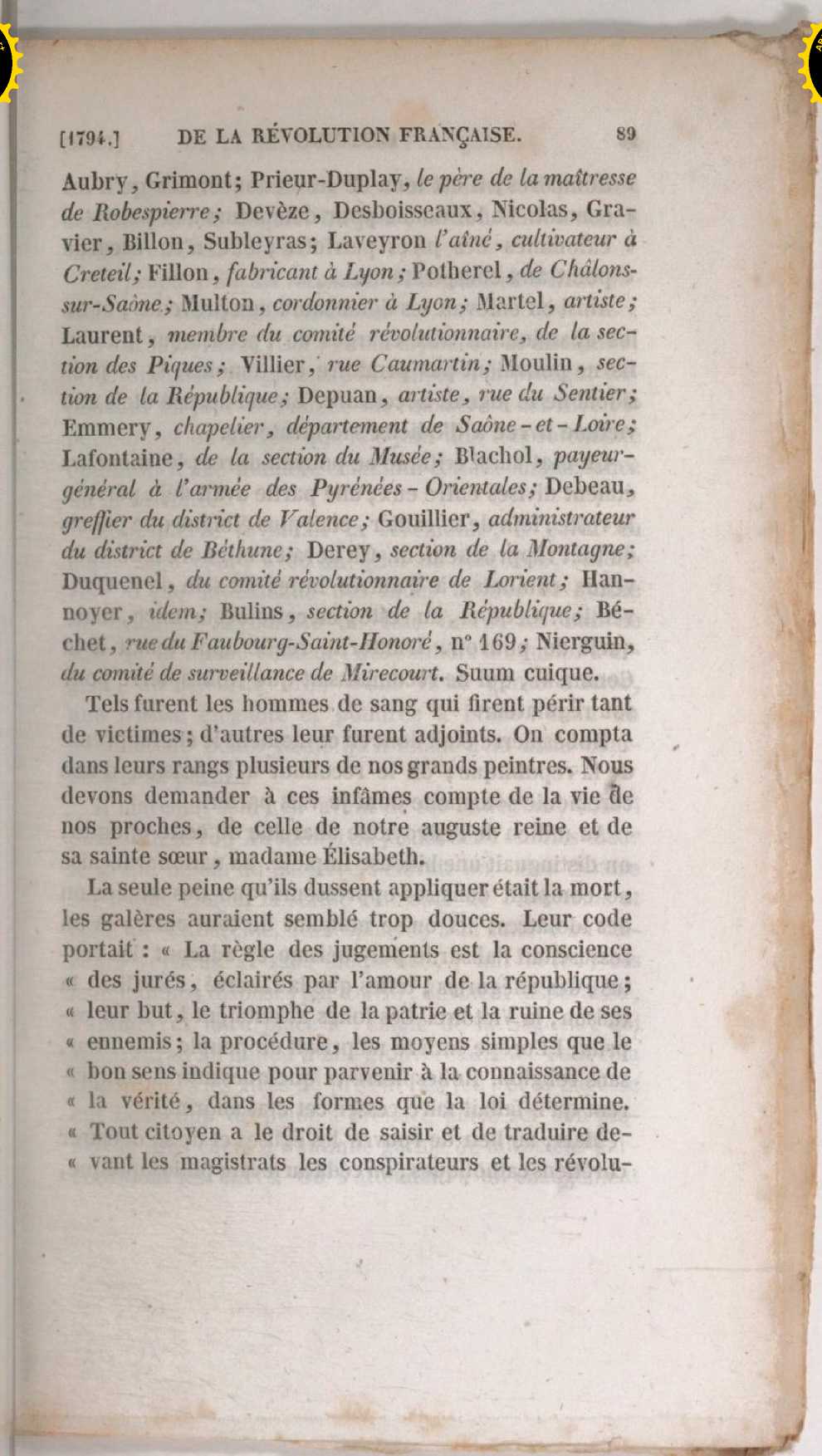
[nOL] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 89 Aubry, Grimont; Prieur-Duplay, le père de la maîtresse de Robespierre; Devèze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Bilion, Subleyras; Laveyron rainé, cultivateur à Creteil; Fillon, fabricant à Lyon; Potherel, de Chàlons-sur-Saône; Multon, cordonnier à Lyon; Martel, artiste; Laurent, membre du comité révolutionnaire, de la section des Piques; Villier, rue Caumartin; Moulin, section de la République; Depuan, artiste, rue du Sentier; Emmery, chapelier, département de Saône-et- Loire; Lafontaine, de la section du Musée; Blachol, payeur-général à l'armée des Pyrénées - Orientales; Debenu, greffier du district de Valence; Gouillicr, administrateur du district de Béthune; Derey, section de la Montagne; Duquenel, du comité révolutionnaire de Lorient; Han-noyer, idem; Bulins, section de la République; Bé-chet, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n" 169; Nierguin, du comité de surveillance de Mirecourt. Suum cuique.
Tels furent les hommes de sang qui firent périr tant de victimes; d’autres leur furent adjoints. On compta dans leurs rangs plusieurs de nos grands peintres. Nous devons demander à ces infâmes compte de la vie (le nos proches, de celle de notre auguste reme et de sa sainte sœur, madame Élisabeth.
La seule peine qu’ils dussent appliquer était la mort, les galères auraient semblé trop douces. Leur code portait : « La règle des jugements est la conscience « des jurés, éclairés par l’amour de la république ; « leur but, le triomphe de la patrie et la ruine de ses « ennemis ; la procédure, les moyens simples que le « bon sens indique pour parvenir à la connaissance de « la vérité, dans les formes que la loi détermine. « Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire de-« vaut les magistrats les conspirateurs et les révolu-

90
HISTOIRE
[1794.]

«
K
«
«
tionnaires ; il est tenu de les dénoncer dès qu’il les connaît. La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n’en accorde point aux conspirateurs. »
Ainsi on enlevait les défenseurs aux prévenus, et on
les abandonnait aux charges de l’accusateur public. Ils ne pouvaient pas produire de témoins, si le président ne le jugeait nécessaire. Enfin l’accusé était une victime livrée à d’odieux sacrificateurs.
In étal aussi critique ne pouvait durer; les meneurs étaient divisés entre eux; une partie avait déjà péri, et le reste, loin de se rallier, était plus éloigné que jamais de tout rapprochement. On devait s’attendre à de nouveaux combats, à d’autres luttes au sein de la Convention. Celle-ci, au reste, en cette occurrence, manquait de pouvoir. L’autorité réelle appartenait à la Commune, qui ne reconnaissait que Robespierre pour son régulateur.
Robespierre était donc en ce moment le chef suprême de la république ; on le reconnut à l’occasion d’une cérémonie solennelle dont je vais parler.
Au milieu de l’effroyable anarchie de cette époque, on distinguait une hideuse impiété. La nation française ne comptait dans ses oppresseurs que des athées ou des idolâtres: ici on se moquait de tout culte; là on ressuscitait l’absurde polythéisme en adorant des vertus, des allégories , telles que la Liberté, l'Égalité, la Raison, la Victoire. Ces folies attristaient les bons esprits; l’Europe entière méprisait un peuple sans Dieu, sans religion. Robespierre et quelques autres comprirent qu’il fallait faire cesser cet état anormal.
Mais, au lieu de rouvrir les églises et de se déclarer chrétiens catholiques, on céda au levain philosophique,
IL
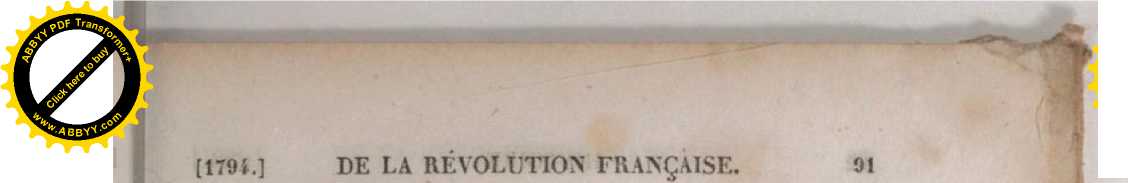

on imagina de proclamer la connaissance d’un Dieu séparée de tout dogme. Un jour, la Convention rendit un décret ainsi conçu :
Le peuple français reconnaît l'existence de / Etre SUPRÊME et l'immortalité de Came.
Tout se borna là ; il n’y eut ni mystères, ni discipline, ni cérémonies religieuses, ni temples, ni prêtres. Cependant un jour de l’année fut consacré à cet Être supérieur, et on décida que le 8 juin une fête solennelle établirait d’une manière éclatante cette reconnaissance de la Divinité.
Robespierre présidait la cérémonie; il parut en habit bleu clair, avec un gilet de soie rose, recouvert d’une mousseline des Indes brodée et garnie de franges, la culotte de soie noire, les bas de soie de la même couleur, des souliers à boucles d’argent, un tricorne orné d’une riche ganse d’acier, une frisure élégante et poudrée à blanc : enfin un bouquet de belles fleurs qu’il tenait à la main complétait sa parure.
Il marchait seul, en avant de ses collègues, dont il paraissait le roi. Au milieu du jardin des Tuileries et sur le grand bassin du parterre s’élevait un vaste théâtre sur lequel étaient la statue colossale de l’Athéisme et celle de l’Anarchie. Robespierre, à la suite d’un discours verbeux et sans éloquence, y mit le feu; ces mannequins, disposés par David, devaient disparaître, s’abîmer et faire place à l’cfligie de la Sagesse, qui apparaîtrait au milieu d’une gloire éclatante. Tout cela réussit mal : les vices ne prirent pas feu, et la Sagesse eut beaucoup de peine à prendre place sur son piédestal. Des chars à l’antique garnis de musiciens parcouraient les allées. On s’attendait à un changement


92 HISTOIRE [1794.]
de système; on espérait que la douceur succéderait à l’oppression. Il n’en fut rien, et Robespierre eut soin d’informer les Français que le lendemain les dénonciations , les jugements iniques et les supplices atroces recommenceraient avec un nouvel acharnement. Et, certes, on ne manqua pas de tenir parole; mais ce ne devait pas être pour longtemps, et l’époque approchait où des méchants, pour se défendre contre leurs complices, ramèneraient, malgré eux, le règne de la
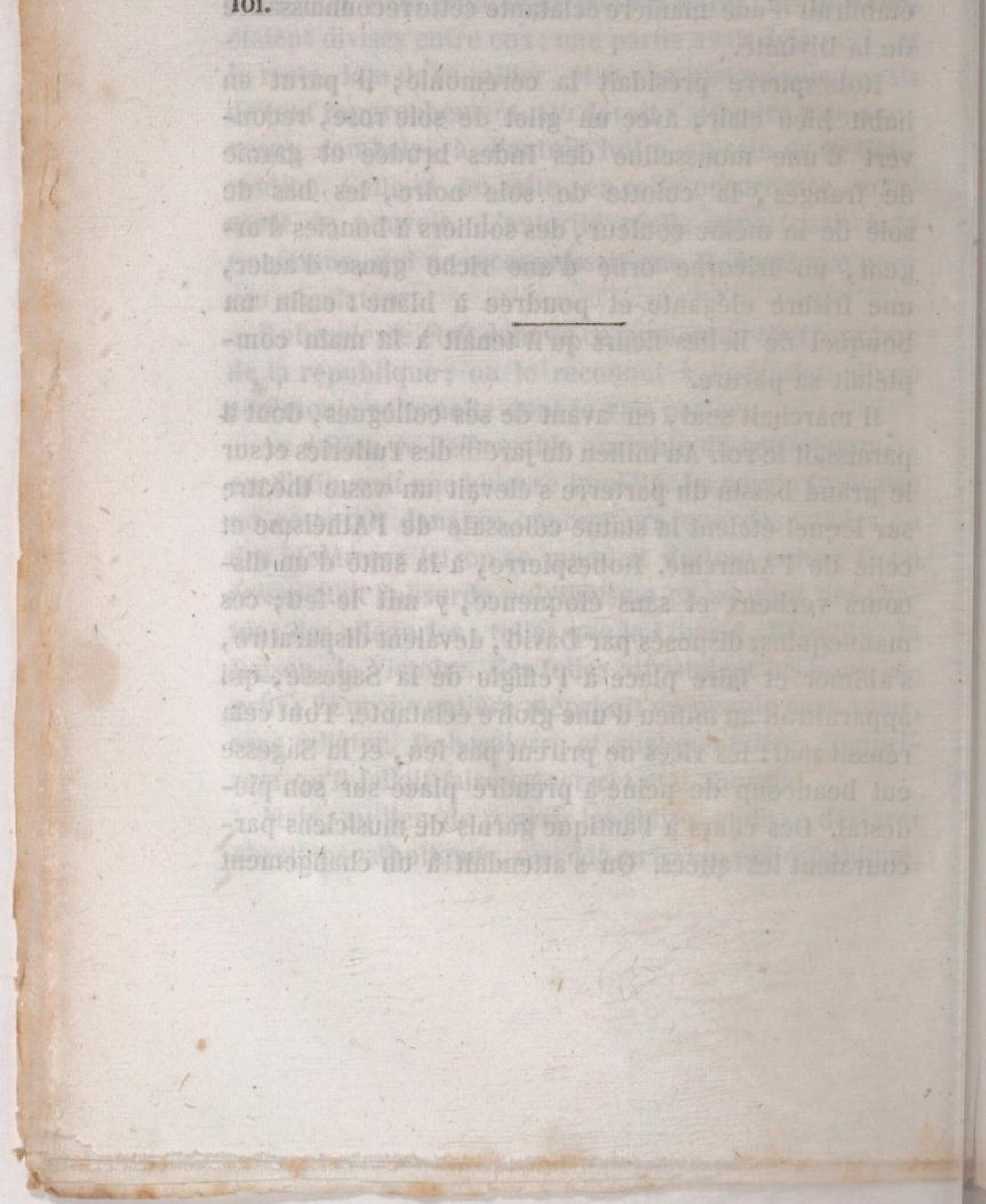
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 93
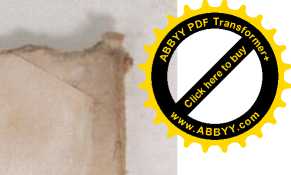
Préliminaires (les 9 et 10 thermidor. — Comment on surprend le secret de Robespierre. — Tallien forme une conspiration. — Saint-Just au comité.—Ce qui lui arrive.—Séance du 8 thermidor. — Robespierre ne peut parler à la Convention. —Détails de celle séance. — Scène aux Jacobins. —Comment les deux partis emploient la nuit du 8 au 9 thermidor. — Récit circonstancié de cette célèbre journée. — Attaque nocturne de rnôtei-de-Ville. —Comment les rebelles finissent.— 10 thermidor.—H isloire de cette journée. — Supplice de Robespierre et de scs complices.
Robespierre avait jusqu’alors marché d’un pas ferme et conduit avec habileté sa fortune au point où elle devait crouler. Il possédait cette portion de science nécessaire à l’élévation d’ambitieux vulgaires, et non ce mâle courage des Cromwell et des Bonaparte. L’énergie lui manquait, et il n’y avait en lui rien de cet esprit supérieur qui commande aux événements, qui est au-dessus des rigueurs de la destinée.
Tant que la Providence eut besoin de lui pour le rude châtiment qu’elle réservait à cette génération pervertie par le philosophisme, Robespierre eut assez de succès; mais aussitôt que cette verge cessa d’être utile, on le vit tout à coup marcher au hasard, d’un pas incertain, sans plan arrêté, et complètement dominé par ce fanatique esprit d'imprudence et d'erreur qui signale la chute des monarques et des tyrans.
Il est certain que dans les dernières semaines de sa vie il ne commit que des fautes. La première fut sa rupture avec presque tous scs collègues dans les comités; il se sépara d’eux par le dépit que lui causait la résistance qu’ils opposaient à sou projet de gouverner

94
HISTOIRE
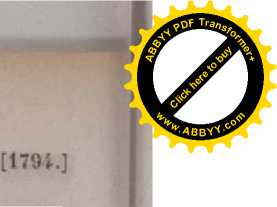
la Convention. Ceux d’ailleurs qui étaient là ne pouvaient plus ignorer où tendait Robespierre : comprenant que nécessairement ils seraient les premières victimes qu’il immolerait à ses vues ambitieuses, ils lui résistèrent. Mais Robespierre, au lieu de les tromper en feignant de vivre avec eux en bonne intelligence, s’en sépara brusquement, et ne reparut presque plus aux séances du comité de Salut public.
En s’éloignant, il laissa ses trois créatures, Saint-Just, Lebas et Coulhon, appelés à partager en sous-ordre cette autorité souveraine vers laquelle il marchait d’un pas rapide. On peut donc dire que , quoique absent du comité, il y dominait encore; sa volonté y était exécutée impérieusement : cela est si positif, que malgré sa retraite il y faisait adopter les projets de loi et de décrets à présenter à la Convention, les mesures, les actions qu’il jugeait nécessaires, et le placement de ses créatures; en un mot, on lui obéissait comme s’il y eût paru chaque jour.
Néanmoins il pressentait une résistance sourde, il connaissait parmi les meneurs ceux sur qui il ne devait pas compter: en conséquence, il dressa une longue liste de proscription où étaient portés tous les députés influents de la Montagne, excepté ceux liés intimement avec lui.
Les choses en étaient à ce point, lorsque, pour faire l’essai de son influence sur la Convention, il lit demander par les Jacobins la mise en jugement de cinq de ses collègues qu’il appelait des scélérats ; les royalistes ne le contrediront pas. C’étaient Dubois de Crancé, usurpateur de titres nobiliaires, régicide, concussionnaire, orléaniste et jacobin exagéré; Delmas, cx-gi-rondin, régicide, aussi ex-dantoniste, espion de Ma-
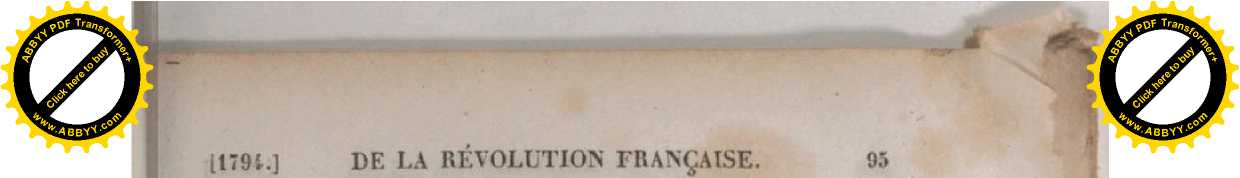
ral, et détesté par Robespierre ; Thuriot, assassin de son roi, tour à tour orléaniste, sans-culotte, partisan de la terreur, et je ne sais pourquoi ennemi de Robespierre, car ils étaient dignes l’un de l’autre ; Léonard Bourdon, vil scélérat, assassin des citoyens d’Orléans , en horreur à tous les gens de bien et même à ses complices; enfin Bourdon de l’Oise, régicide comme les quatre autres. Celui-là dans la Vendée tuait de sa main les prisonniers; athée déclaré, il accusait Robespierre d’avoir voulu reconnaître un Dieu. Cependant c’était des cinq le moins exécrable; peut-être ,
même valait-il au fond mieux que sa réputation.
Tels étaient ceux qui devaient ouvrir ce que les partisans de Robespierre appelaient le grand branle de la mortel qui, par bonheur pour eux, ne furent pas mis en jugement avant le 9 thermidor, dont le jour approchait
Robespierre avait un parti nombreux et en apparence rempli d’énergie, composé de tous les brigands sans aveu, des membres des armées révolutionnaires, de la canaille turbulente des faubourgs, du conseil-général et des administrateurs de la commune de Paris. Pache n’était plus maire; écarté lors de l’affaire d’Hébert et emprisonné, il attendait qu’on l’envoyât à la mort. Fleuriot Lescot occupait celte place ; criminel subalterne, ni sa vie ni sa mort n’ont pu le soustraire à l’obscurité, malgré les excès de l’une et l’éclat de l’autre. Enfin le dictateur pouvait compter sur la totalité du tribunal révolutionnaire.
C’était à l’aide de ces éléments que Robespierre voulait frapper ses adversaires. Déjà de vastes souterrains, les catacombes de l’Observatoire, étaient disposés pour recevoir des masses de cadavres. La boucherie générale commandée par lui devait avoir lieu le jour
4

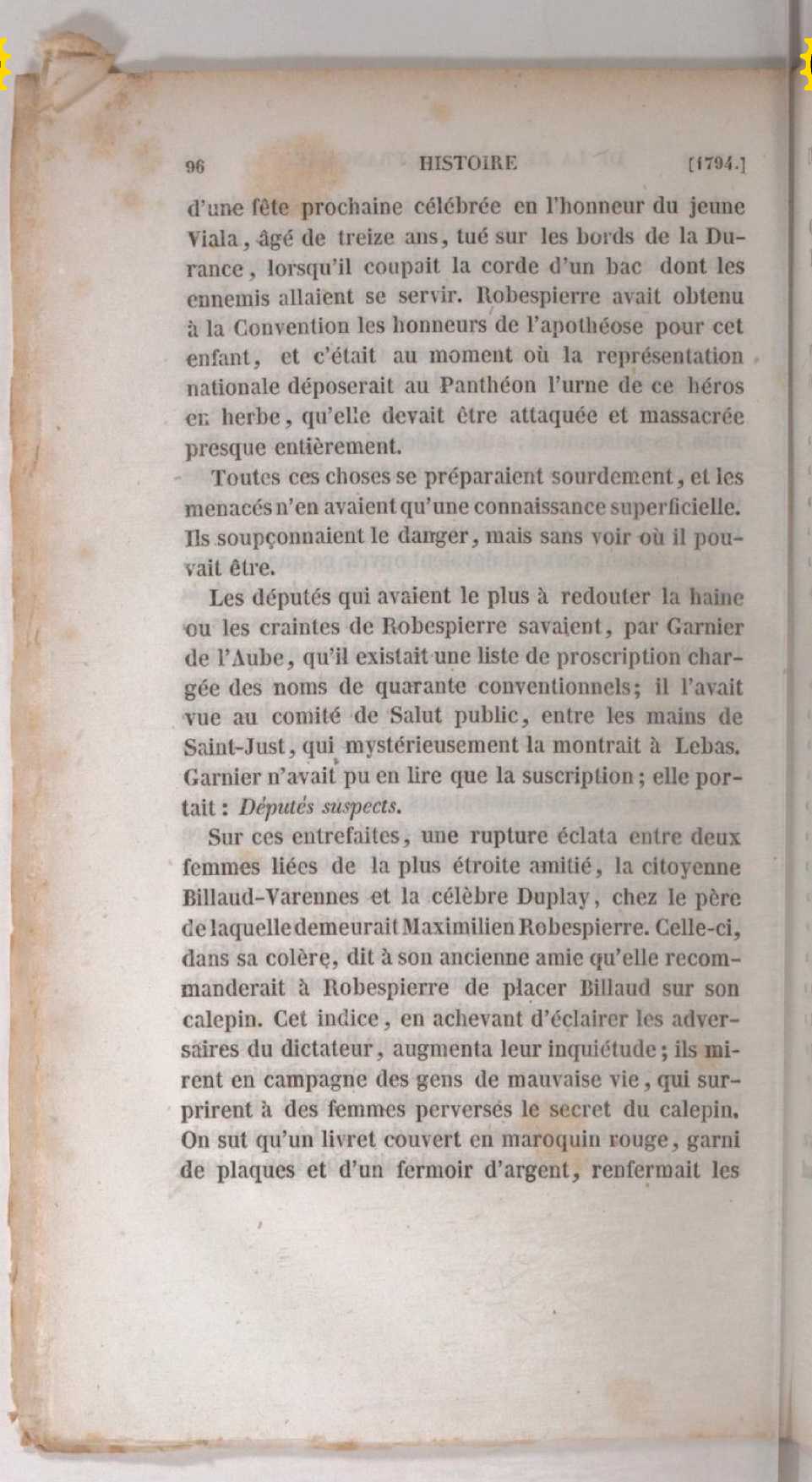
d’une fête prochaine célébrée en l’honneur du jeune Viala, âgé de treize ans, tué sur les bords de la Durance , lorsqu’il coupait la corde d’un bac dont les ennemis allaient se servir. Robespierre avait obtenu à la Convention les honneurs de l’apothéose pour cet enfant, et c’était au moment où la représentation nationale déposerait au Panthéon l’urne de ce héros en herbe, qu’elle devait être attaquée et massacrée presque entièrement.
Toutes ces choses se préparaient sourdement, et les menacés n’en avaient qu’une connaissance superficielle. Ils soupçonnaient le danger, mais sans voir où il pouvait être.
Les députés qui avaient le plus à redouter la haine ou les craintes de Robespierre savaient, par Garnier de l’Aube, qu’il existait une liste de proscription chargée des noms de quarante conventionnels; il l’avait vue au comité de Salut public, entre les mains de Saint-Just, qui mystérieusement la montrait à Lebas. Garnier n’avait pu en lire que la suscription ; elle portait : Députés suspects.
Sur ces entrefaites, une rupture éclata entre deux femmes liées de la plus étroite amitié, la citoyenne Billaud-Varennes et la célèbre Duplay, chez le père de laquelle demeurait Maximilien Robespierre. Celle-ci, dans sa colère, dit à son ancienne amie qu’elle recommanderait à Robespierre de placer Billaud sur son calepin. Cet indice, en achevant d’éclairer les adversaires du dictateur, augmenta leur inquiétude; ils mirent en campagne des gens de mauvaise vie, qui surprirent à des femmes perverses le secret du calepin. On sut qu’un livret couvert en maroquin rouge, garni de plaques et d’un fermoir d’argent, renfermait les
HISTOIRE
[1794.]
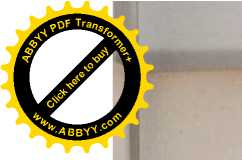
[179k] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 97 noms des victimes que Robespierre voulait immoler. Il portait toujours ces tablettes dans une poche faite
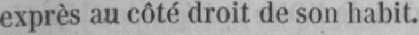

Billaud-Varennes, Collot-d’Herbois, Carnot, Tal-lien, Vadier , Dubois - Crancé , Legendre, Léonard Bourdon, etc., et tous les autres, mouraient d’envie de voir ce qu’il y avait dans ce livre fatal. On cherchait des moyens, nul ne convenait. La fortune vint en aide à ces méchants.
Couthon donne à diner. Afin, sans doute, de tromper la vigilance des proscrits, il les invite avec Robespierre, Lebrun , Saint-.lust, Lebas, Henriot et quelques autres. Il faisait chaud ; dans le laisser-aller de l’intimité, chacun ôtant son habit ou sa veste les dépose dans le salon de Couthon.
Le repas était à peine commencé que Carnot, frappé soudain d’une idée lumineuse, feint une violente colique, se lève brusquement de table et court au salon où il sait qu’est déposé l’habit de Robespierre. Il fouille dans la poche secrète, ouvre le calepin et y lit son nom et celui d’environ quarante deses collègues; il n’en demande pas davantage, remet tout en place, et se rend aux lieux privés, afin de continuer le jeu qu’il a commencé ; puis il rentre dans la salle où l’on dîne, et n’aperçoit pas le dictateur. Où est-il?—On lui répond qu’il s’est plaint du froid, et qu’il est allé se vêtir.
Que l’on juge de l’émotion de Carnot, lorsqu’il voit reparaître Robespierre ; le danger qu'il a couru le fait pâlir, mais la ruse a réussi, le tyran ne soupçonne rien. Carnot, ayant hâte d’aller prévenir ses collègues, persiste dans son indisposition feinte. Il demande la permission de se retirer, et les convives étaient à peine au second service, que lui était déjà fort loin. Il vole
IL 5

98
HISTOIRE
[1794.]
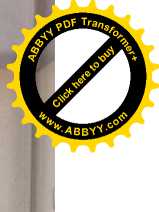
d’abord chez Tallien, auquel il conte ce qu’il alu. Tous deux vont ensuite prévenir Legendre, Vadier, Barras, Fréron, Bourdon de l’Oise, et tous les députés inscrits sur la liste fatale. En révélant à ceux-ci le danger qu’ils courent, on enflamme leur courage, et par un serment que la nécessité commande, tous jurent de réunir leurs forces contre l’ennemi commun. Enfin des mesures sont prises pour que l’attaque ait lieu le 11 thermidor, ou le 12 au plus tard (29 et 30 juillet 1794).
De son côté, Robespierre ne s’endort pas; il prépare les coups qui doivent renverser ses ennemis, et loin d’ajourner le combat, il a hâte d’en avancer l’époque.
Le 7 thermidor (25 juillet), la Convention, présidée par Collot-d’Herbois, voit paraître à sa barre une députation du club des Jacobins, ayant à sa tête Intonnelle, député régicide, qui parle en ces termes : « Les amis de la liberté et de l’égalité viennent dénoncer à la Convention des complots que l’étranger forme dans son désespoir.... C’est lui qui voudrait rompre les liens qui unissent les représentants entre eux, et .es représentants au peuple;.. Représentants, c’est la justice et non la clémence que vous avez mise à l’ordre du jour. »
Le but de ce discours était de provoquer de nouveaux décrets contre les proscrits. Dubois - Crancé parle à son tour; il se défend, mais on songe peu à lui, en présence de la lutte qui se prépare. Barrère le remplace à la tribune : que va-t-il dire? Le misérable y était envoyé par Robespierre. Il parle au nom du comité de Salut public; dans son rapport il rappelle les conspirations de Danton et d’Hébert, il attaque les


[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
99
alarmistes, puis il divise en deux époques remarquables la vie politique de la Convention nationale : la première ? depuis le 21 septembre 1792 jusqu’au 31 mai 1793 ; la seconde, depuis le 3 juin suivant jusqu’au 7 thermidor. Scs paroles oiseuses, ses phrases ambiguës, n’apprennent rien: on se demande ce qu’il veut; mais en rapprochant son rapport du discours d’Antonnelle, il est facile de prévoir un coup d’éclat et un vaste complot dont les conséquences immédiates sont la ruine de la représentation nationale.
La séance était à peine levée que Carnot, Fréron, Tallien, Bourdon de l’Oise, Delmas, Dubois-Crancé . Legendre,Geoffroy, Thuriot, Rovère,Barras, Vadier, Vouilan, Cambon, Fouché, Bentabole, Pañis, Courtois, Gaston, Collot-d’Herbois et quelques autres, se rassemblent afin d’aviser aux mesures à prendre. Chacun émet son opinion. Mais Tallien, craignant pour les jours d’une prisonnière, madame de Fontenay, qu’il épousa peu après, décide ses collègues à remettre l’attaque au surlendemain, pour tout délai.
Une heure après ce conciliabule, Robespierre en connaissait jusqu’aux moindres détails. Croyant être prêt à le gagner, il accepta le combat.
Le 8 thermidor (26 juillet), la séance de la Convention commença par quelques discussions insignifiantes, auxquelles personne ne prêta la plus légère attention. Jamais l’assemblée n’avait été plus nombreuse; les divers partis avaient convoqué leurs chefs, et il était facile de voir qu’un grand événement se préparait. Cependant les rapports, les motions, les actes à l’ordre du jour, se succédaient, et rien d’extraordinaire n’éclatait encore. Ce calme, en présence de l’anxiété générale, agissait vivement sur tous les esprits. Chacun
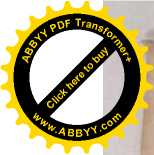

100 HISTOIRE [1701.1
était impatient de voir la lutte s'engager enfin, et déjà il était fort tard lorsqn’arriva Robespierre.
Son apparition étonna: il y avait plus d’un mois qu’il ne s’était montré à l’assemblée ; il la boudait ainsi qu’il faisait des comités. Cette fois , la surprise augmenta , lorsqu’on le vit s’acheminer vers la tribune et demander la parole, qui lui fut accordée.
Son discours était un labyrinthe dans lequel il fut impossible de le suivre. Tl défendit les comités qu’on n’accusait pas, puis il s’écria :
« Est-il vrai qu'on ait colporté des listes odieuses « de victimes, où l’on désignait certains membres de a la Convention, listes qu’on prétend être l’ouvrage du « comité de Salut public, ou plutôt le mien? Est-il « vrai qu’on ait osé supposer des séances du comité, « des arrêtés rigoureux qui n’ont jamais existé, des « arrestations non moins chimériques? Est-il vrai qu’on « ait cherché à persuader à un certain nombre de repré-« sentants vénérables que leur perte était résolue?... « Est-il vrai que l’imposture ait été répandue avec « tant d’art et d’audace, qu’une foule de membres « ne couchent plus chez eux ? Oui, ces faits sont « constants, et les preuves en sont au comité de Salut « public.
«........On accuse d’abord les comités, puis
« on assume toute la responsabilité sur ma tête seule ; « on donne mon nom à tout ce qui se fait de mal dans « le gouvernement. Si, par hasard, on enferme des « patriotes que l’on a pris pour des aristocrates, on « dit : C’est Robespierre qui le veut; si quelques pa-« trioles ont succombé, victimes d’une erreur déplo-« rabie , c’est Robespierre qui l’a ordonné ; si des « agents nombreux du comité de Sûreté général
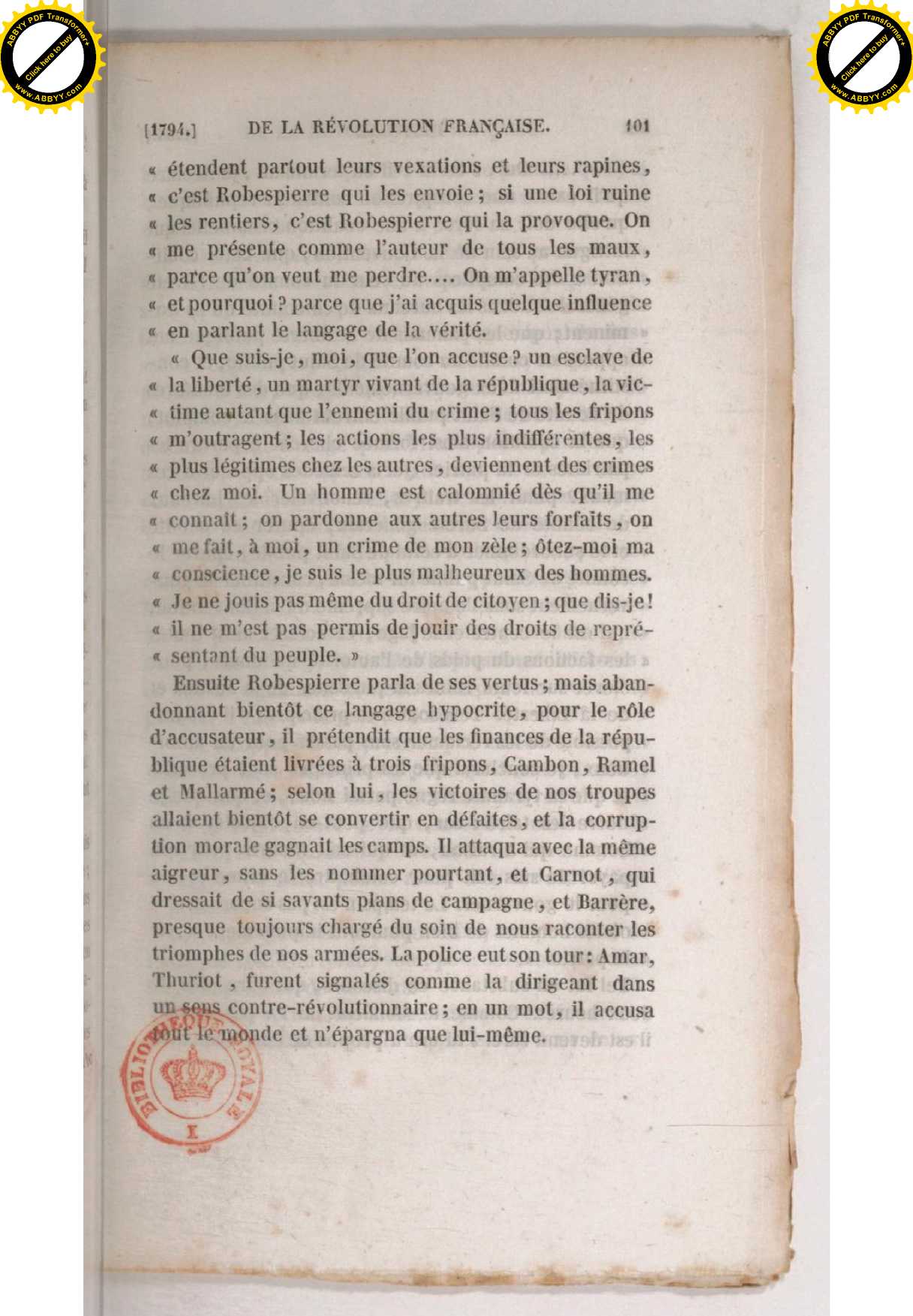
«
«
« « a
étendent partout leurs vexations et leurs rapines, c’est Robespierre qui les envoie ; si une loi ruine les rentiers, c’est Robespierre qui la provoque. On me présente comme l’auteur de tous les maux, parce qu’on veut me perdre.... On m’appelle tyran, et pourquoi ? parce que j’ai acquis quelque influence en parlant le langage de la vérité.
« Que suis-je, moi, que l’on accuse? un esclave de la liberté, un martyr vivant de la république, la victime autant que l’ennemi du crime ; tous les fripons m’outragent ; les actions les plus indifférentes, les plus légitimes chez les autres, deviennent des crimes chez moi. Un homme est calomnié dès qu’il me connaît; on pardonne aux autres leurs forfaits, on méfait, à moi, un crime de mon zèle; ôtez-moi ma conscience, je suis le plus malheureux des hommes. Je ne jouis pas même du droit de citoyen ; que dis-je ! il ne m’est pas permis de jouir des droits de représentant du peuple. »
Ensuite Robespierre parla de ses vertus ; mais aban
donnant bientôt ce langage hypocrite, pour le rôle d’accusateur, il prétendit que les finances de la république étaient livrées à trois fripons, Cambon, Ramel et Mallarmé; selon lui, les victoires de nos troupes allaient bientôt se convertir en défaites, et la corruption morale gagnait les camps. Il attaqua avec la même aigreur, sans les nommer pourtant, et Carnot, qui dressait de si savants plans de campagne, et Barrère, presque toujours chargé du soin de nous raconter les triomphes de nos armées. La police eut son tour: Amar, Thuriot , furent signalés comme la dirigeant dans un Mmscontre-révolutionnaire ; en un mot, il accusa le môpde et n’épargna que lui-même.
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

102 HISTOIRE [1794.]
* —.....Oui, s’écria-t-il en terminant, je déclare « qu’il existe une conspiration contre la république; « qu’elle doit sa force à une coalition criminelle qui « intrigue au sein de la Convention ; que cette coali-« tion a des complices au sein du comité de Sûreté « générale et dans les bureaux de ce comité qu’ils do-« minent; que les ennemis de la liberté publique ont « opposé ce comité au comité de Salut public, et con-« stitué ainsi deux gouvernements ; que des membres « du comité de Salut public entrent dans le complot; « que la coalition ainsi formée cherche à perdre les « patriotes et la patrie. Quels remèdes opposer à ces « maux? punir les traîtres, renouveler les bureaux « du comité de Sûreté générale, épurer ce comité « et le subordonner à celui de Salut public, épurer le « comité de Salut public lui-même, constituer le gou-« vernement sous l’empire suprême de la Convention, « qui est le centre et le juge, et écraser ainsi toutes « les factions du poids de l’autorité nationale, pour « élever sur leurs ruines la puissance de la Justice et « de la Liberté. Tels sont mes principes; s’il est im-« possible de les réclamer sans passer pour un ambi-« lieux, je conclurai que les principes sont proscrits « et que la tyrannie règne parmi nous, et non que je « doive les taire : car, que peut-on objecter à un « homme qui a raison, et qui sait mourir pour son « pays? Je suis fait pour combattre le crime et non « pour le gouverner. Le temps n’est pas encore arrivé « où les hommes de bien pourront impunément servir « la patrie. »
Tel fut en substance ce discours, qui dura plus de deux heures. Comme le Moniteur ne l’a pas inséré, il est devenu rare. J’ai cru à propos de faire connaître

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 103
l’éloquence de Robespierre, dans ce passage que j’ai entendu louer plusieurs fois par Cambacérès, Carnot et Dubois-du-Bay.
L’assemblée, silencieuse, écoutait en proie il une vive agitation, incertaine et inquiète de ce qui allait suivre; on craignait que la salle ne fût environnée de sicaires prêts à agir et n’attendant que le signal du massacre. Cependant, malgré ces craintes, et pour la première fois, aucun applaudissement ne partit du milieu de l’assemblée ni des hauteurs de la Montagne, comme c’était d’usage quand Robespierre parlait. Les tribunes, garnies de ses tricoteuses et de ses sans-culottes, gardèrent le silence, tellement chacun voyait qu’était venu le moment d’une crise extraordinaire.
On se taisait de toutes parts. Robespierre, peu accoutumé à une semblable froideur, promenait sur les bancs un regard où se peignaient la colère et l’étonnement, quand Lecointre, de Versailles, vil Batteur de cet homme de sang, demanda l’impression du discours: ce fut le signal du combat. Bourdon de l’Oise, le premier à relever le gant, s’écria :
« Je m’oppose à l’impression ; ce discours contient « des matières assez graves pour qu’il soit examiné; « il peut y avoir des erreurs comme des vérités, et il « est de la prudence de la Convention nationale de « l’envoyer à l’examen des comités de Sûreté géné-« raie et de Salut public avant d’en ordonner l’im-« pression. » . • . à, .
Barrère, ignorant la conjuration, et épouvanté de l’attaque tacite du tyran, vota, pour se réconcilier avec lui, l’impression du discours.
Couthon, accoutumé à tout emporter de vive force, vota non-seulement pour l’impression, mais encore
104 HISTOIRE [1794.]
pour l’euvoi du discours aux quarante-quatre mille communes de la république, « et, ajouta-t-il, quand a on a osé demander qu’il fût remis à la censure des « deux comités, c’est un outrage qu’on a fait à la « Convention nationale, car elle sait sentir , elle sait « juger. »
Cambon, Vadier, demandent la parole; celui-ci disculpe le comité de Sûreté générale dont il fait partie. Cambon , après s’être justifié , défend ses deux collègues, Ramel et Mallarmé; il termine en disant:
« .... Il est temps de dire la vérité tout entière: « un seul homme paralyse la volonté de la Conven-« tion nationale; cet homme est celui qui vient de « prononcer ce discours, c’est Robespierre; ainsi « jugez ! »
On applaudit.... Des applaudissements contre Robespierre! Quelle surprise pour l’assemblée et pour les tribunes! Couthonet Lebas se courroucent, le tyran lui-même commence quelques phrases incohérentes, se livre à des divagations , avance des faits auxquels Cambon ne répond que par ces mots : C’est faux'. La discussion continue. Billaud - Varen nés, Pañis, Benta-bole, Couthon, Chalier, y prennent part ; Robespierre, à qui l’on reproche sa tyrannie et l’expulsion du club des Jacobins de tous ceux qui lui déplaisent, se défend avec désavantage : on dirait qu’il sent le terrain fuir sous ses pas ; enfin, et, avec une émotion toujours croissante , il s’écrie :
« Quoi ! j’aurai le courage de venir déposer dans le a sein de la Convention des vérités que je crois néces-« saires au salut de la patrie, et l’on renverrait l’exa-« men de mon discours aux membres que j’accuse ! »
Des murmures se font entendre, et Chalier réplique:

[1794.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 103
« Quand on se vante d’avoir le courage de la vertu, « il faut avoir celui de la vérité; nommez ceux que « vous accusez. »
« Oui, oui, s’écrie-t-on de toutes parts, nommez-les! »
Robespierre court à la tribune ; ah ! cette fois, il va parler sans réticence; le tumulte cesse, tant la curiosité a d’empire ; tous écoutent. Que va-t-il révéler? qui accusera-t-il? C’était le moment de montrer de l'audace, de prendre ses ennemis corps à corps; mais le lâche sent faillir son cœur; sa pusillanimité hâte sa perte, et, au lieu d’une vive repartie, il déclare en peu de mots persister dans ce qu’il a avancé, et ne vouloir prendre aucune part à la discussiou sur l’envoi de son discours.
Des huées le punissent de sa faiblesse. Lebas, plus hardi, reproche au dictateur son peu de courage par un geste expressif ; mais par préoccupation, ou pour tout autre motif, Robespierre ne le voit pas, et il descend de la tribune. 11 a perdu la partie si positivement, que Bavière, fidèle à sa coutume de porter au vaincu les derniers coups, ne craint pas de blâmer hautement la conduite de Robespierre. On rit, on siffle, puis, sur la proposition de Bréard, l’envoi de la diatribe du tyran est rejeté à une immense majorité.
La séance est levée. Aussitôt Robespierre, Augustin son frère, Lebas, Fleuriot-Lescot, Henriot, Coflinhal, courent aux Jacobins. Déjà le club était informé et indigné de la nouvelle attitude de la Convention. Les motions les plus hostiles à l’indépendance du pouvoir législatif se succédaient rapidement. La disposition du club devenait encore plus menaçante, lorsqu’arriva Robespierre, encore pâle et tremblant.
a.


106 ÍÍISTOIRE [1794.]
Les Jacobins le reçoivent avec de tels transports qu’il s’en émeut et revient difficilement à lui; on l’entoure, on le plaint, on le console, on promet de le venger, on le conjure de lire aux frères et amis le beau discours si indignement repoussé par la Convention. Charmé de cet accueil et flatté de la demande, Robespierre fait une seconde lecture de ce discours, monument de la scélératesse et de la rage sanguinaire de son auteur. La lecture provoque les applaudissements unanimes, les acclamations frénétiques des auditeurs, et Robespierre termine en disant :
« Le rapport que vous venez d’entendre est mon tes-« lament de mort. Je l’ai vu aujourd’hui, ’a ligue des « méchants est tellement forte que je ne puis pas espé-« rer de lui échapper. Je succombe sans regret, je « vous laisse ma mémoire, elle vous sera chère; vous « la défendrez. »
Cette adroite péroraison provoque une seconde explosion de fureur et d’enthousiasme; chacun représente à Robespierre qu’il a tort de désespérer de l’avenir, que le peuple se lèvera en masse pour sauver la liberté et la patrie, que des traîtres ont mise en péril, comme il a su le faire en plus d’une circonstance. Déjà le maire de Paris, Payan, l’agent municipal Henriot, David, Romme, Dumas, Javogues, Dobsent, Collinhal, Mehée de La Touche, Saint-Hu-rugues. Lebas, Lhéritier, et les autres meneurs, David le peintre, l’ex-chevalier de Cubières, Jullien, ne parlent que d’agir ; ils emploieront la force pour défendre la république attaquée dans la personne de sou député chéri.
« Les sans-culottes, dit Henriot, n’ont pas oublié, depuis le 31 mai, la route des Tuileries, et s’ils ne s’en
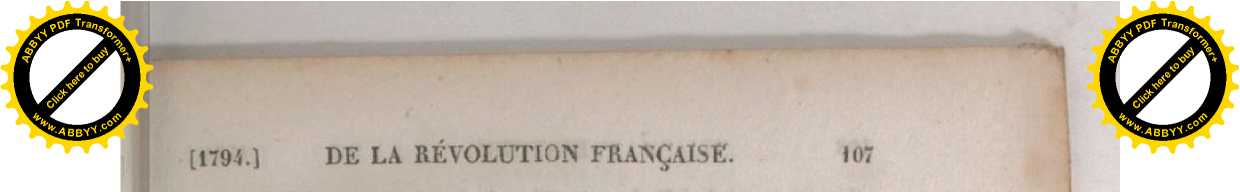
souvenaient plus, je suis là pour leur rafraîchir la mémoire. »
Gouthon, qui, à son entrée, a eu sa part des hom- • mages adressés à Robespierre, propose et fait adopter des moyens violents. Tous font acte d’énergie; le tyran seul, abattu, tremble de voir commencer la guerre civile, car le misérable sent que le courage nécessaire pour la soutenir lui manquera toujours.
« Cependant, dit-il, vous ne pouvez laisser violen-« ter la cause nationale, ni perdre la patrie ; séparez, « dans ce que vous tenterez, les méchants des fai-« bles; délivrez ’a Convention des scélérats qui l’op- ' « priment ; rendez-lui le service qu’elle attend de vous « comme au 31 mai, comme au 2 juin. Si, malgré de « tels efforts, il faut encore succomber, eh bien! mes « amis, vous me verrez boire la ciguë avec calme. » « — Robespierre, je la boirai avec toi, » s’écrie le peintre David, et des applaudissements accueillent l’allocution et la réplique. C’est le moment que Couthon saisit pour prendre la parole : il dénonce au club ceux de ses collègues qui, à la Convention, viennent de se déclarer contre Vincorruptible Robespierre ; il les représente comme des ennemis des sans-culottes, des partisans dé la royauté, des salariés de Pitt et de Cobourg ; il les connaît tous, ces perfides; il a eu le loisir de prendre la liste de leurs noms ; plusieurs appartiennent à l’honorable club : aussi l’orateur propose qu’on leur fasse subir la justice d’un scrutin épuratoire.
La proposition est adoptée, on se met à l’œuvre. Collot-d’Herbois entend son nom avec surprise: il réclame, on le siffle, et le jeune Duplay l’arrache de vive force de la tribune où il s’est cramponné; on le menace de plusieurs couteaux, il se sauve, et l’on

ios HISTOIRE [1794.]
chasse avec lui Delmas, Thuriot et bon nombre de ses collègues.
Payan va plus loin : il prétend qu’il convient de procéder à l’heure même à l’arrestation des membres suspects des deux comités suprêmes. Cette mesure exécutée rapidement eût donné la victoire au parti de la terreur. Robespierre la repoussa par ce seul motif qu’elle sortait de la voie de la légalité. Ce qu’il veut, c’est un nouveau 31 mai; il espère d’ailleurs reprendre son ascendant sur la Convention nationale, afin de mieux éblouir la France quand il la précipitera dans l’abîme qu’il lui a creusé. On convient donc aux Jacobins que les mesures énergiques auront lieu, mais seulement quand Robespierre aura essayé d’entraîner à sa suite la majorité de l’assemblée.
On arrête que, le lendemain , le tyran et les députés de son parti viendront attaquer leurs adversaires au sein de l’Assemblée; que pendant cette lutte la commune de Paris se tiendra en permanence à l’Hôtel-de-Ville, afin de pouvoir donner habilement les ordres nécessaires à l’insurrection convenue; que les Jacobins, afin de prendre part à celte nouvelle révolution, se réuniront dans le local de leurs séances ; qu’Hen-riot fera battre la générale, rassemblera les bataillons fidèles, et principalement les canonniers sectionnaires; enfin on compte, en dernière ressource , sur la coopération des Élèves de la patrie, cantonnés au Champ -de-Mars, dirigés par leur commandant, le citoyen Labresche, homme propre à tout, mais dont le nom est mort avec lui.
La nuit du 8 au 9 thermidor (26 au 27 juillet) fut à la fois grave et solennelle : une vague inquiétude agitait les esprits; on s’attendait à une catastrophe.
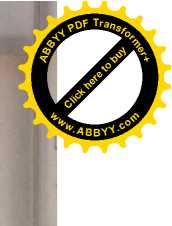

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. <09 mais nul n’osait espérer qu’elle profiterait aux. gens de bien. Les Jacobins parcouraient les rues, chantant la Marseillaise, la Carmagnole, Ah! ça ira, le Chant du départ, et l’hymne Ceilions au salut de l'empire; ici, ou entendait le cliquetis des armes; là, on voyait une pièce de canon traînée à la lueur des torches et aux cris de : Mort aux aristocrates et aux traîtres ! En un mot, tout Paris était en mouvement lorsque commença la fameuse journée qui mit fin au plus odieux despotisme.
Saint-Just était absent : envoyé aux armées pour les mettre au pas, il devait réveiller en elles l’ardeur révolutionnaire ; mais rappelé par Robespierre, dont il était le bras droit, il revint à Paris le 8 au matin. Son premier soin fut de s’aboucher avec le dictateur. Celui-ci le chargea de faire un rapport qui fût le complément et le résumé de celui qu’il avait fait lui-même à la Convention , et qu’il renforcerait de ce qu’il avait appris à l’armée de plus propre à exaspérer les esprits. . •
Après a.oir promis ce que l’on exigeait de lui, Saint-Just vint au comité de Salut public, où plusieurs membres s’étaient rassemblés, à la sortie de la séance du jour. Ils délibéraient sur les mesures de circonstance à prendre; tous se turent ou changèrent de discours à la vue du survenant. Celui-ci, plein de jactance, leur apprit, en forme de conversation, qu’il avait en main un rapport qui compromettait plusieurs membres du gouvernement ; mais il ne détailla rien, se tenant, par méchanceté, dans une réserve aussi mystérieuse qu’effrayante.
Ses collègues, incertains encore de la manière dont les événements tourneraient, craignirent de le heurter

HO
HISTOIRE
[179 í.]

de front, et, au lieu de l’accabler d’injures, ainsi qu’il l’aurait mérité, ils lui représentèrent avec douceur le mal que venait de faire le discours de Robespierre ; ajoutant qu’il valait mieux que lui, Saint-.lust, lût d’abord le sien au comité, que par-là on préviendrait des suites fâcheuses, toute autre marche ne devant servir qu’à augmenter le trouble existant.
Saint-Just, pour mieux les tromper, répondit qu’il ferait volontiers ce qu’on lui demandait, mais qu’il avait remis, pour qu’il l’examinât, son manuscrit à un ami. qui ne le lui avait pas encore renvoyé. Alors on le pria d’en faire connaître les divisions capitales, les conclusions.
Saint-Just, pris au piège, au lieu de répondre franchement, équivoque, embrouille la question, assurément bien simple, et, poussé à bout, finit par dire que sa conscience ne lui permet pas de trahir le secret de la patrie.
Ses collègues, se récriant contre cette phrase étrange, veulent en avoir fa solution, lorsque tout à* coup Collot-d’Herbois ouvre la porte du comité. If vient des Jacobins d’où on l’a exclu, où sa vie a été en danger; ses traits sont altérés, il est pâle, sa physionomie marque la frayeur et la colère; il toise Saint-Just avec une affectation marquée et peu bienveillante. Celui - ci , lâche comme son chef , perd contenance, et, pour rompre cette situation pénible, demande à Collot-d’Herbois s’il vient du club et ce qui s’y passe. A cette question aussi maladroite qu’intempestive, la bombe éclate. Collot répond avec véhémence :
« Ce qui s’y passe! Quoi! tu nous demandes ce qui « se passe aux Jacobins! Mais n’es-tu pas complice de
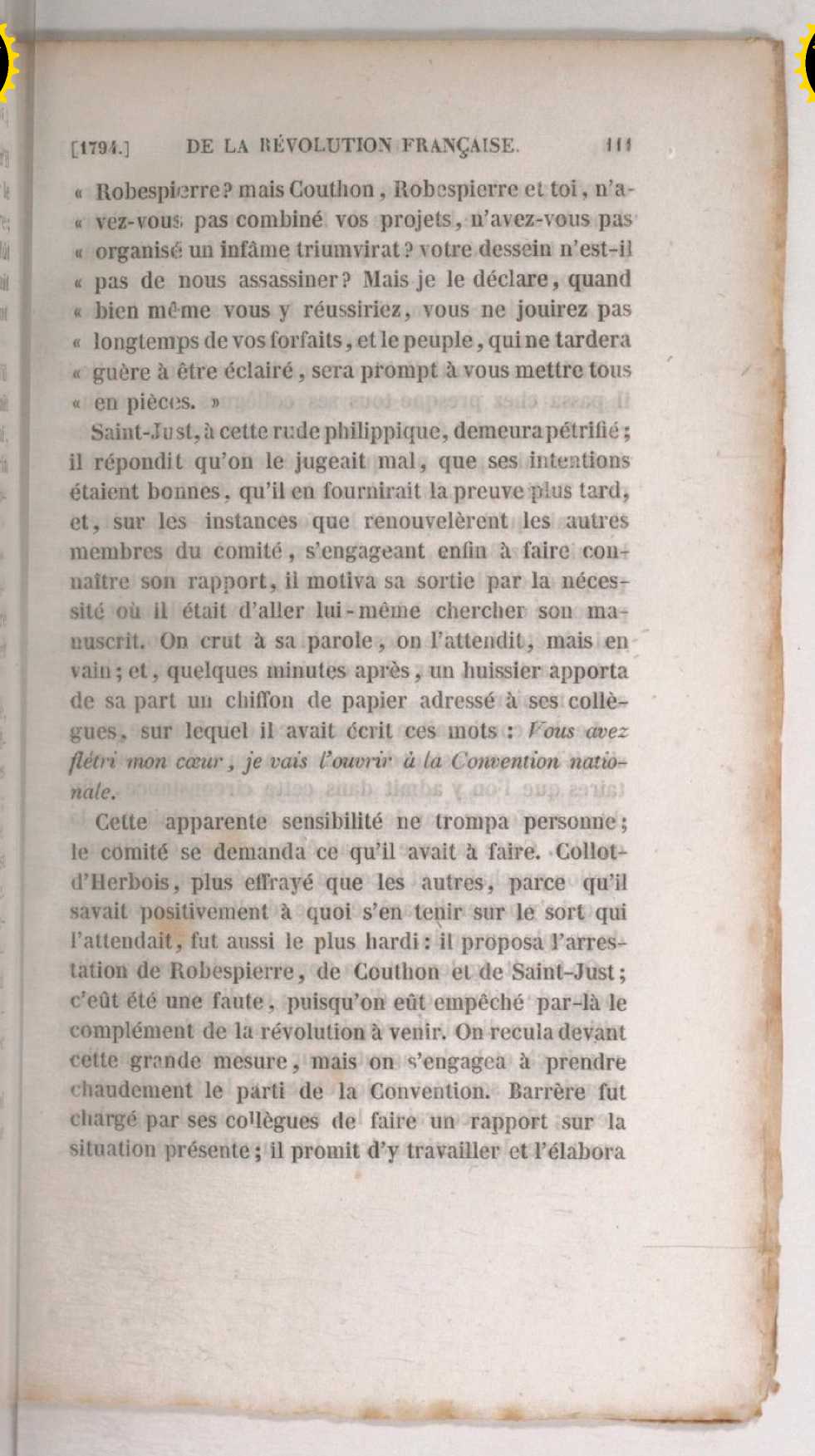
« Robespierre? maisCouthon, Robespierre et toi, n’a-« vez-vous pas combiné vos projets, n’avez-vous pas « organisé un infáme triumvirat? votre dessein n’est-il « pas de nous assassiner? Mais je le déclare, quand « bien même vous y réussiriez, vous ne jouirez pas « longtemps de vos forfaits, et le peuple, qui ne tardera « guère à être éclairé, sera prompt à vous mettre tous « en pièces. »
Saint-Just,à cette rude philippique, demeura pétrifié ; il répondit qu’on le jugeait mal, que ses intentions étaient bonnes, qu’il en fournirait la preuve plus tard, et, sur les instances que renouvelèrent les autres membres du comité, s’engageant enfin à faire connaître son rapport, il motiva sa sortie par la nécessité où il était d’aller lui-même chercher son manuscrit. On crut à sa parole, on l’attendit, mais en vain;et, quelques minutes après, un huissier apporta de sa part un chiffon de papier adressé à scs collègues. sur lequel il avait écrit ces mots : l ous avez flétri mon cœur, je vais Couvrir à la Convention nationale.
Celte apparente sensibilité ne trompa personne; le comité se demanda ce qu’il avait à faire. Collot-d’Herbois, plus effrayé que les autres, parce qu’il savait positivement à quoi s’en tenir sur le sort qui l’attendait, fut aussi le plus hardi: il proposa l’arrestation de Robespierre, de Couthon et de Saint-Just; c’eût été une faute , puisqu’on eût empêché par-là le complément de la révolution à venir. On recula devant cette grande mesure, mais on s’engagea à prendre chaudement le parti de la Convention. Barrère fut chargé par ses collègues de faire un rapport sur la situation présente; il promit d’y travailler et l’élabora
[1794.]
DE LA B ÉVOLUTION FRANÇAISE.
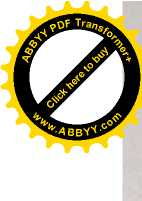
112 HISTOIRE LH94.J
en effet; mais en même temps il en prépara un autre •dans le sens de la cause de Robespierre, afin d’être prêt à tout événement, quelle que fût la faction qui l’emportât.
Le monde est rempli de ces hommes prêts à crier tour à tour : Vive (e roi! vive la ligue!
Tallien se multipliait; du comité de Salut public, il passa chez presque tous ses collègues, les conjurant de ne point faiblir , leur assurant que le succès était certain, pour peu que la défection ne s’en mêlât pas. Tallien, après avoir ranimé les faibles, alla où il savait qu’il trouverait les forts : ceux-ci passèrent la nuit chez Barras, avec des armes et dans une orgie, préparés d’ailleurs à se défendre jusqu’à la mort. Mais personne ne songea à les attaquer individuellement, ce qui eût été si facile; les Jacobins avaient adopté une autre tactique, car ils veillaient aussi, mais d’une autre manière.
Le club continuait sa permanence, et La foule se grossissait à chaque instant de gens sans aveu et de non-sociétaires que l’on y admit dans cette circonstance, afin de se renforcer par le nombre, si ce n’était par la qualité. Celte caverne devait être le foyer de l’insurrection prochaine, et le centre des opérations, afin que ce qui s’y passerait parût être le résultat de la volonté du peuple souverain.
On faisait également à la Commune des préparatifs moins de défense que d’attaque ; on disposait les munitions, on dictait les réquisitions nécessaires, on envoyait çà et là des agents pour soulever la canaille. Henriot et son état-major étaient à la tête des meneurs; ils parcouraient les rues à cheval, appelant aux armes les sectionnâmes, les suppliant de courir à


[179LJ DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. H3

la délivrance de la Convention opprimée par les factieux et les traîtres. ' ,
L’irritation, l’inquiétude et l’épouvante gagnaient les divers quartiers. Le bruit de la générale, le tintement lugubre du tocsin, arrachaient les habitants aux douceurs du sommeil ; on se levait avec peur ou avec colère ; on se demandait quel événement allait arriver ; néanmoins, aucun citoyen ne se doutait que l’on tut aussi près d’une catastrophe dont les résultats devaient faire marcher le gouvernement dans une voie opposée à celle qu’il avait suivie jusqu’alors.
Barras, Billaud-Varennes, Tallien, Fréron, Bourdon de l’Oise,Collot-d’Herbois, Legendre, et tous ceux dont la vie ne pouvait être sauvée que par le succès, travaillaient avec ardeur à s’assurer la victoire. Tallien se montrait animé de cette espérance confiante qui est déjà la victoire même, car, plus que toute autre aide, elle sert à la déterminer. Il entrait à onze heures du matin dans la salle de la Convention, lorsque , rencontrant Goupilleau de Montaigu que la peur en faisait sortir : « Rentre, lui dit-il, et viens être le témoin du succès des amis de la liberté. Ce soir, Robespierre ne sera plus. »
Saint-Just arrivait en ce moment, porteur de son rapport, que, selon quelques-uns, il s’était mis à écrire seulement après la scène que j’ai racontée, et que, selon quelques autres, il avait refondu, à cause de cette scène même et des instructions que Robespierre lui aurait fournies pendant la nuit. A la vue de Saint-Just, Tallien dit aux membres qui l’environnaient : « Mes collègues, entrons, voici le moment; l’attaque va commencer. »
En ce jour mémorable, un petit nombre de peureux
exceptés, personne n’abandonna son poste. Robespierre parut avec les siens ; on pouvait les compter. Les tribunes lui appartenaient par leur composition ; il ne fallait 'compter sur elles que si le succès déclaré passait à la bonne cause.
A peine a-t-on achevé la lecture du procès-verbal de la dernière séance et le dépouillement de la corres-poudance, que Saint -Just paraît au pied de la tribune, tenant en sa main un énorme rouleau de papier, et demande ,1a parole. Son regard sombre et farouche, son ton peu assuré , l’heure à laquelle il se présente ( midi ), son intimité avec Robespierre, la présence inaccoutumée de celui-ci à la Convention nationale, le souvenir de ce qui s’est passé la veille; tout semble annoncer de grands événements, une discussion orageuse et des résultats importants. Le calme qui succède enfin à cette espèce de tumulte, occasionné par l’anxiété générale, permet à Saint-Just de se faire entendre ; mais , à peine a-t-il prononcé quelques paroles, que Tallinn l’interrompt pour faire une motion d’ordre. Cette motion était intempestive et contraire aux usages parlementaires; mais la majorité de l’assemblée y accéda avec une facilité qu4 ne laissait aucun doute sur ses véritables sentiments.
« Le membre qui m’a précédé , ditTallien, a com-« meucé par dire qu’il n’était d’aucune faction. Je . , « répète la même chose : je n’appartiens qu’à moi et
« à la liberté. C’est pour cela que je vais vous faire « entendre la vérité.... Partout on ne voit que divi-« sions ; hier un membre du gouvernement s’est isolé, « il a prononcé un discours en son nom particulier. Un » autre l’imite aujourd’hui ; on vient s’attaquer, aggra-
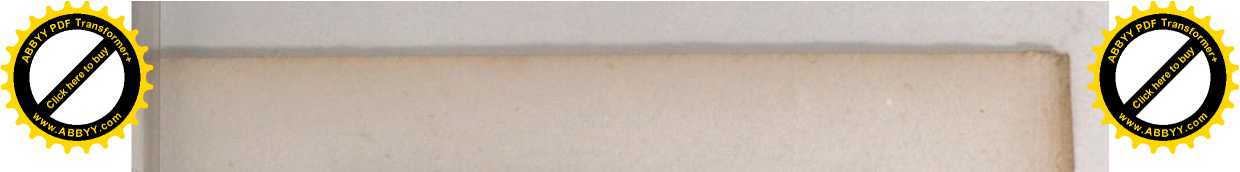
[1794.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 115
« ver les maux de la république.... Je demande que « le rideau soit déchiré. »
« Oui, oui, » s’écrie-t-on de toutes parts; et trois salves d’applaudissements accueillent la proposition de Tallien. Billaud - Várennos . enhardi, demande aussi la parole. On la lui accorde , tandis que Saint-Just ne peut obtenir de continuer son rapport. Billaud , en commençant, et comme pour faire l’essai des forces de la conjuration, signale et fait arrêter un sans-culotte des tribunes, qu’il accuse d’avoir menacé les représentants ; puis il ajoute :
« Je m’étonne de voir Saint-Just à la tribune, après « ce qui s’est passé. Il avait promis aux deux comités « de leur soumettre son discours avant de le lire à la » Convention, et même de le supprimer, s’il leur « semblait dangereux. L’assemblée jugerait mal ces « événements et la position dans laquelle elle se trouve, « si elle se dissimulait qu’elle est entre deux égorge-« ments. Elle périra si elle est faible. »
« Non ! non ! » s’écrie la majorité de l’assemblée, se levant tout entière, en agitant des mouchoirs et des chapeaux. A la vue de ce mouvement spontané, l’enthousiasme gagne les tribunes publiques, jusqu’alors indécises, et il en part le cri plusieurs fois répété de : Vive la Convention!
Tout cela ressemblait à un traité d’alliance et mettait en péril le parti de Robespierre. Lebas s’en inquiète ; il veut parler, afin de reprendre l’avantage ; la parole lui est refusée. Emporté par la colère, il court à la tribune et tente vainement d’en arracher Billaud-Va-rennes par la force. Delmas, à la vue de cette violence , demande que Lebas soit rappelé à l’ordre. Sa proposition est accueillie et adoptée avec transport, et

Lebas n’en est pas effrayé ; mais la menace de l’Abbaye produit plus d'effet : il cède en frémissant de rage. Billaud, interrompu, poursuit et cette fois attaque sans ménagement Robespierre ; à l’appui de ses paroles il ne cite que des faits, et ceux qu’il rapporte prouvent la duplicité du dictateur. Il le montre à la fois incorruptible et protecteur des concussionnaires; il rappelle ses efforts pour décimer la représentation nationale, et le zèle qu’il avait mis d’abord à défendre Hébert et Danton, qu’il n’abandonna que lorsqu’il ne lui fut plus possible de profiter de leurs rapines. Bil-laud-Varenncs termine en ces termes :
« On voulait détruire, mutiler la Convention, et « cette intention était si réelle qu’on avait organisé un « espionnage des représentants qu’on voulait égorger. « Il est infâme de parler de la justice et de lavertu quand « on les brave, et de ne s’excuser que quand on est « contrarié ou arrêté. »
Robespierre, à cette apostrophe bien capable d’irriter sa fureur, s'empare de la tribune, et, songeant au passé, croit en imposer encore par les manières hautaines qui lui réussissaient naguère. Mais le charme a disparu ; l’assemblée, généralement convaincue de ses intentions hostiles, s’oppose à toutes ses motions, et un cri général, à bas le tyran ! vient plonger Robespierre dans la stupeur. Indigné et terrifié tout à la fois, le dictateur n’a pas le courage de persister à vouloir prendre la parole; il s’arrête, hésite, baisse la tête, descend quelques degrés et s’en retourne à sa place comme s’il était indifférent à la discussion.
Tallien, succédant à Billaud, se montre empressé de porter les derniers coups à celui qu’on a qualifié de tyran; sa tête est haute, son visage enflammé, sa voix

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 117
sonore, ses accents remplis de véhémence, ses gestes animés.
« Je demandais tout à l’heure, dit-il, qu’on dé-« chirât le voile. Je vois avec plaisir qu’il l’est entiè-« rement, que les conspirateurs sont démasqués, qu’ils « seront bientôt anéantis, que la liberté triomphera. ( Vifs applaudissements dans la salle et les tribunes. ) « Tout annonce que l’ennemi de la représentation na-« tionale va bientôt tomber sous ses coups......Te me « suis jusqu’ici imposé le silence, parce que je savais, « d’un homme qui approchait le tyran de la France, « qu’il avait dressé une liste de proscription; je n’ai « pas voulu récriminer : mais j’ai vu hier la séance des « Jacobins , j’ai frémi pour la patrie, j’ai vu se former « l’armée du nouveau Cromwell, et je me suis muni « d’un poignard pour lui percer le sein, si la Conven-« tion nationale n’avait pas le courage de le décréter « d’accusation.... » .
11 dit, et sa main brandit ce poignard. L’aspect du fer , le courage héroïque qu’il fait supposer , inspirent à l’assemblée un frémissement d’enthousiasme qu’augmentent encore les plus vives acclamations. Certes, Talliensort delà légalité; mais qui pourrait le lui reprocher lorsqu’il s’agit de délivrer la France de Robespierre ? Les plus modérés regardent cet instrument de meurtre comme le symbole du salut général. Cependant Tallien, qui s’est arrêté , reprend avec plus d’impétuosité encore :
« Citoyens républicains, accusons Robespierre avec « la loyauté du courage, en présence du peuple fran-« çais.... Ce n’est pas un individu que j’attaque, c’est « l’attention de mes collègues que j’appelle sur une « vaste conspiration. Je ne doute pas que l’assemblée


118
HISTOIRE
il 794.]

H «
«
« a a
a a « a a « « u
« «
«
« «
a
«
«
ne prenne des mesures promptes et énergiques, qu’elle ne reste en permanence pour sauver le peuple. Et quoi qu’aient dit les partisans de l’homme que je dénonce, il n’y aura ni de 31 mai, ni de proscriptions. Les scélérats connus seront seuls frappés par la justice nationale..... ( Applaudissements prolongés. ) Je demande en outre l’arrestation d'Ilcnriot et de son état-major, afin que les chefs de la force armée ne puissent compromettre la chose publique. Ensuite, nous examinerons le décret rendu sur la proposition de l’homme qui nous occupe. Nous ne sommes pas modérés, mais nous ne voûtons pas que l’innocence soit opprimée ; nous voulons que le président du tribunal révolutionnaire traite les accusés avec décence et justice. (Nouvelles marques d’approbation.^ NíVaIa. véritable justice, voilà la véritable vertu. « Hier, un membre du tribunal révolutionnaire a excité des citoyens à insulter un représentant du peuple (Collot-d'Herbois)\ il a été outragé dans une société (aux Jacobins), et la représentation nationale s’est vue avilie dans sa personne.....L’homme qui est à la tribune (Robespierre venait d'y remonter et tachait de s'y maintenir'} est un nouveau Catilina,
« ceux qui l’entourent sont de nouveaux Nérons
a a « « a «
Robespierre voulait tour à tour nous attaquer, nous isoler, et cela, pour rester seul avec les hommes de crapule, de débauché et de crime qui l’escortent. Je demande que nous décrétions que nos séances seront permanentes jusqu’à ce que le glaive de la loi ait assuré la révolution, et que nous ordonnions
« l’arrestation des créatures de cet autre Pisistrate. » L’assemblée accueillit avec transport et convertit en décrets les propositions de Tallien. Elles furent lues

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 119
au bruit des acclamations de la Convention, mais écoutées en silence par les tribunes publiques, où l’effroi et la stupeur régnaient parmi les gardes-du-corps et les tricoteuses de Robespierre (1).
Si, un moment, Robespierre avait été frappé de mutisme comme ses partisans, il était revenu à lui, et cherchait à se défendre; mais Thuriot, présidant en ce moment, savait, par une tactique habile, feindre de ne voir ni de n’entendre les demandes que le tyran lui faisait, tandis qu’au contraire il accordait toujours la parole aux conjurés, qui la demandaient en même temps que lui. Billaud, jaloux de délivrer la France de ses émules en forfaits, profitant d’une, inadvertance de Thuriot, dit qu’il fallait décréter d’accusation non-seulement Robespierre, mais encore ses amis et ses satellites. Boulanger, ex-associé d’Hébert; Dumas, président du tribunal révolutionnaire ; Dufraise, autre

(1) Les gardes-du-corps de Robespierre n'étaient autre chose quede forts et vigoureux sans-culottes, qui, armés d’un bâton, le sabre au côté, deux pistolets à la ceinture, les cheveux huilés, escortaient nuit et jour Robespierre. Ces misérables dénonçaient sans pudeur leurs parents et leurs amis, frappaient sans pitié, assommaient quelquefois les suspects, les nobles, les prêtres, en un mot tous les honnêtes gens. Pour solde. Robespierre leur accordait l’impunité, le droit de pillage et une indemnité plus forte à la distribution des sommes données par les municipaux aux sans-culottes de la commune.
Duplay, le plus jeune des fils du menuisier de ce nom, demeurant me Saint-Honoré, en face de la rue Saint-Florentin, et frère de la maîtresse en titre du tyran, commandait cette hideuse cohorte. Les Jacobins, dans cette suite armée, ne voyaient rien qui révélât la tendance de Roliespierre.
Les tricoteuses étaient des femmes du peuple, payées à raison de quarante sous par jour pour applaudir Robespierre à la tribune et siftler ses ennemis.

Í20 HISTOIRE [1795 1
brigand du temps, et les aides de-camp d’Henriot, furent enveloppés dans la même mesure.
Cependant Robespierre, toujours cramponné à la tribune, peut articuler quelques mots; il tente de se justifier; mais les cris de : « bas le traître! à bas le tyran! pas de parole au tyran! retentissent avec plus de violence, et, en même temps, un décret place à la tête de la force armée parisienne le citoyen Deymard, commandant de la cavalerie. Deymard était un homme obscur, qui depuis n’a guère été plus connu.
Robespierre ne se lasse pas d'assiéger la tribune; il monte, des huées l’accueillent; il insiste, on crie à bas le tyran! Il se retourne vers Saint-Just. lui parle avec chaleur; mais le tumulte est tel que ses paroles ne sont pas entendues. Saint-Just, si féroce , si perfide, se tait en ce moment ; une pâleur livide couvre son beau visage, dont les traits sont défigurés ; il tient le rapport qu’il avait commencé de lire ; souvent il le parcourt machinalement, comme pour se donner une contenance ; Robespierre semble vouloir l’arracher à cette apathie et le contraindre à prendre un parti. On voit que le séide a perdu son énergie et qu’il ne pourra plus se défendre vigoureusement.
Sur ces entrefaites, Barrère vint avec un de ces rapports qu’il tenait toujours prêts, qu’il eût employé en faveur des sans-culottes, si ceux-ci avaient eu de l’énergie. Mais ils en manquèrent, et je tiens de plusieurs membres de la Convention que, si le parti modéré l’emporta, ce ne fut que grâce à l’inertie et à la démoralisation de celui de Robespierre. Si ces scélérats avaient eu parmi eux un homme de courage, la France demeurait peut-être, pour longtemps encore, sous le joug de ses tyrans.

[1794.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 121
Vadier, par son bavardage diffus, en fatiguant la Convention, servait mieux le tyran qu’il ne le combattait. Tallinn comprit ce qu’il y avait à faire.
« Je demande, dit-il, à ramener la question à son « véritable point de vue. »—«Je saurai l’y ramener, » repart Robespierre, avec tant d’arrogance qu'il pro-wque un nouvel élan d'indignation.
« Citoyens, poursuit Tallinn, ce n’est pas en ce « moment que je porterai votre attention sur des faits « particuliers...... C’est sur le discours .iprononcé « hier à la Convention, et répété {aux Jacobins, que « j’appelle toute votre attention. C’est là que je ren-« contre le tyran, que je retrouve toute la conspi-« ration.... ; c’est dans ce discours que je veux trou-« ver des armes pour terrasser cet homme dont la « vertu et le patriotisme étaient tant vantés, mais < qu’on avait vu , à l’époque mémorable du 10 août, « disparaître et ne se montrer que trois jours après « la révolution. Cet homme, qui devait être, dans « le comité de Salut public, le défenseur des oppri-« mes, qui devait être à son poste , l’avait aban-« donné depuis quatre décades, et à quelles époques, « lorsque l’armée du Nord donnait à tous ses collè-« gués la plus vive sollicitude; il l’a abandonné pour « venir calomnier les comités, et tous ont sauvé « la patrie. Certes, si je voulais retracer les actes « d’oppression particuliers qui ont eu lieu, je re-« marquerais que c’est pendant le temps que Robes-« pierre a été chargé de la police générale qu’ils « ont été commis. »
Robespierre, entraîné par la fureur qui le domine, s’agite avec emportement; il pousse des cris aigus, il hurle et demande la mort, appelant ainsi, le premier, if. 6
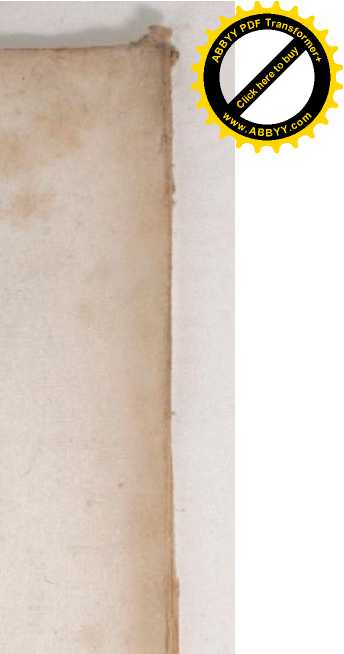


!122 HISTOIRE [1794.]
sur sa tête, le châtiment dû à ses crimes. Augustin, son frère, moins scélérat peut-être, sans mériter pour cela quelques regrets, puisqu’il a trempé dans tous les crimes de l’époque, s’écrie : « Je suis aussi coupable « que mon frère, je partage ses vertus, je demande à « être compris dans le décret d’accusation. »
Maximilien, de plus en plus exaspéré, apostrophe l’assemblée en termes injurieux..... La Convention tout entière se lève pour lui reprocher ses forfaits. Le plus affreux désordre règne dans la salle.
Charles Duval s’écrie : « Représentants , est-ce qu’un homme sera le maître de la Convention ? » Le député Loiseau : « Aux voix l’arrestation des deux frères! » Billaud-Varennes : «J’ai des faits positifs que Robespierre n’osera dénier. » Le tumulte s’accroît; l’impotent Couthon y prend part, et son impudence provoque son arrestation. Pendant ces débats inouïs , Robespierre va de sa place à la tribune, parcourt toutes les parties de la salle; il ne cesse de parler, de gesticuler, de menacer ; il se consume en vains efforts pour obtenir la parole, mais ceux à qui il s’adresse le repoussent avec horreur ; le courage est revenu au plus faible. Le dictateur entend avec désespoir une majorité imposante demander son arrestation. Le président la met aux voix, et elle est adoptée. Aussitôt, toute rassemblée se lève aux cris de:rwe/« république! répétés à l’envi par les tribunes qu’entraîne l’exemple ou que domine la crainte. C’est alors que le tyran se voit abandonné. « La patrie et la liberté vont sortir de leurs ruines,» s’écrie Fréron. — «Oui, réplique insolemment Robespierre, en employant toute la force de sa voix, car les brigands triomphent. »
Couthon, Lebas, Saint-Just, les deux Robespierre,
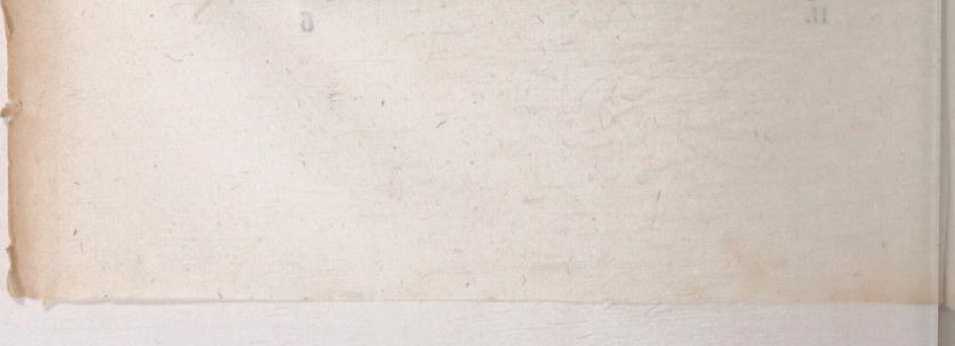

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 123
Dumas, Dufraise, Boulanger et Henriot,les dignes acolytes de Maximilien, sont compris dans le même décret d’accusation. Les huissiers se présentent pour mettre le décret à exécution ; mais Robespierre les repousse d’un geste menaçant et d’un regard où brillent encore les derniers éclairs de son pouvoir expirant. Ceux-ci s’en retournent tremblants à leur place, et les députés observent avec anxiété celte pantomime terrible dont le peu de succès laisse la question indécise.
« A la barre ! à la barre ! » s’écrie-t-on de toutes parts. Thuriot, qui a conservé la présidence, lutte contre Robespierre, qui s’obstine à parler encore, et sa sonnette, qu’il agite avec force, couvre la voix du tyran ; celui-ci l’appelle président de brigands et de scélérats. Garnier de l’Aube, qui s’aperçoit que la langue
■ de Robespierre s’épaissit et que les mots expirent sur ses lèvres, lui crie : « Misérable ! ne sens-tu pas que « le sang de Danton t’étouffe? » Le tumulte continue, Robespierre parvient à le dominer un instant, et, reconnaissant qu’il n’a plus rien à espérer du côté de la Montagne soulevée tout entière contre lui, il s’adresse cette fois à la Plaine, naguère l’objet de ses sarcasmes: « C’est à vous, hommes vertueux, dit-il, et non aces scélérats de la Montagne, que je demande la parole. » ■
O surprise! la Plaine, qui, hier encore, encensait le tyran, refuse de l’entendre aujourd’hui. Bien plus, un de ses membres, Lezéau, rappelant à la Convention qu’elle a fait comparaître a sa barre tous ceux qu’elle a décrétés d’accusation, demande pourquoi, dans la même circonstance , elle hésiterait plus longtemps. « Devons-nous, ajoute-t-il, faire acception de persornes? »
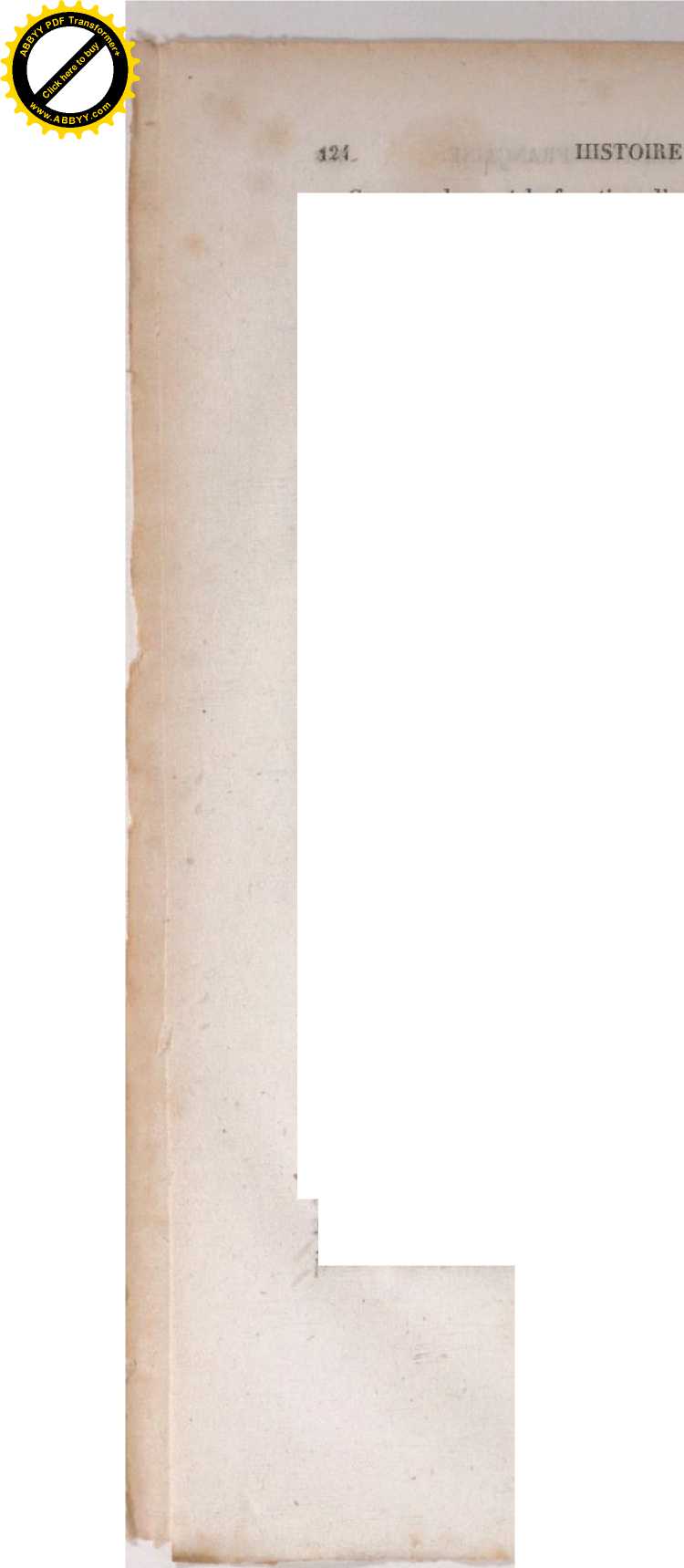
[179 i.]
Ces paroles, et la fraction d’où elles émanent, sont les derniers coups portés à la puissance de Robespierre. Par ordre du [ résident, les accusés, malgré leur vive résistance, sont arrêtés et conduits par les huissiers hors de la salle, aux applaudissements de l’assemblée et des tribunes elles-mêmes, entièrement subjuguées.
Ainsi finit cette séance mémorable. Il était cinq heures et demie du soir. Les députés, accablés de lassitude, tout en se constituant en permanence, commirent ki faute énorme de suspendre la séance jusqu’à sept heures. Ce laps de temps, perdu pour l’attaque, pouvait servir à la résistance , et si Robespierre et les Jacobins avaient bien su l’employer, il leur eût été facile de déjouer les projets des conjurés et d’annihiler le succès que ceux-ci avaient obtenu en courant de si grands dangers. •
Que serait, eu effet, devenue la Convention, si, profilant de l’absence momentanée des députés, leurs principaux ennemis se fussent emparés de la salle où ils n’auraient laissé entrer que les hommes de leur parti. Cela eût sufli pour déconcerter les mesures prises, et pour ramener la victoire du côté de ceux qu’elle avait abandonnés.
Cependant, tandis que ces choses se passaient au sein de l’assemblée, la Commune et les Jacobins, prévenus dès la veille, dressaient un plan de résistance et d’attaque. Armée par leurs soins, la populace des divers quartiers était excitée et poussée à la révolte, et tout Paris n’offrait que la triste image d’une Aille près d’être livrée aux horreurs de la guerre civile. Ici, on battait la générale et le rappel ; là, on sonnait Je tocsin, et les environs de l’Hôtel-de-Ville se garnissaient d'une multitude avide de se porter aux derniers excès.

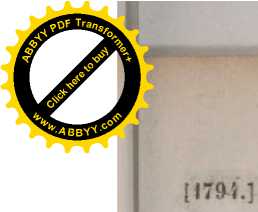

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Í25
Le corps municipal, au grand complet, siégeait en permanence, chaque membre ceint de l’écharpe tricolore. Les délibérations perturbatrices se succédaient rapidement , et cependant aucune détermination n’était prise, rien n’était arrêté, aucun parti adopté. C’est qu’il manqùait aux Jacobins un homme de tête, un de ces caractères supérieurs, habiles à s’emparer des événements et à les diriger à leur gré ; un de ces personnages qui, par son éducation et ses lumières, sût dominer et les hommes et les choses. En effet, les municipaux vivaient au jour le jour, ne savaient ou ne pouvaient rien prévoir, et leur apathie les laissa toujours dans un état d’indécision funeste et d’autant plus remarquable, qu’ils étaient en proie à une vive agitation et que chacune de leurs paroles semblait dictée par une noble fermeté.
Dans cet état, privée de lumières,4q Commune se préparait à renouveler au 9 thermidor le 31 mai, (juand entra l’huissier de la Convention, le citoyen Cervol, porteur du décret concernant Henriot, et de celui qui mandait à la barre de l’Assemblée nationale le maire Fleuriot-Lescot et Payan. Après avoir notifié ces décrets au conseil, Cervol en demanda un reçu. « En
a
K
«
«
des jours comme celui-ci, répondit Henriot, de tels reçus ne se donnent guère; va dire à la Convention que nous saurons nous maintenir, et à Robespierre qu’il n’ait pas peur, car nous sommes là. » Quelques auteurs prétendent que Cervol fut jeté
dans un cachot ; je tiens le fait pour peu vraisem-. hl.ible.
Fleuriot, dans la crainte de paralyser les membres du conseil, leur cacha le véritable sens de la dépêche. Il leur dit au contraire que la Convention chargeait
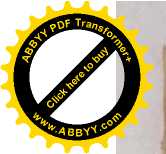
1-26 HISTOIRE [1794.]
la Commune de veiller d’une manière toute spéciale à la sûreté de Paris. Payan, pérorant sur ce texte, demanda que deux membres allassent sur la place de Crève fraterniser avec le peuple.
Bientôt, conduite et. organisée par Cotfinhal, apparaît une horde d’insurgés, ayant à sa tête la municipalité, Sijeas, Simon, Couthon, Grenard et quelques autres misérables qui allaient trouver le châtiment dû à leurs crimes. Par les soins de ses chefs est publiée une proclamation dans laquelle sont présentés comme traîtres à la patrie Collot-d’Herbois, Bourdon de l’Oise, Barrère, Tallien et Fréron, et sont au contraire déclarés sauveurs et dieux tutélaires de la patrie Robespierre, Saint-Just, Couthon et Lebas. Enfin les insurgés répandent l’adresse suivante :
« Le 9 thermidor. La Commune révolutionnaire or-« donne, au nom du peuple, à tous les citoyens de ne « reconnaître d’autre autorité que la sienne; déclare « traîtres tous ceux qui abusent du titre de représen-« tant pour faire des proclamations perfides et mettre « hors la loi ses défenseurs; déclare encore que tous « ceux qui n’obéiront pas à ce môme ordre seront « traités en ennemis du peuple. »
Quand on prend de telles mesures, il faut les soutenir en sortant des bornes de la légalité ; c’est ce qui arriva. Le comité d’exécution fit fermer les barrières, sonner le tocsin contre la Convention, et entretint avec les Jacobins une correspondance active. Ce club, de son côté, fraternisa avec la Commune, et la révolte fut consommée.
Ainsi, depuis la chute du trône, les destructeurs de la monarchie n’avaient pu s’entendre encore sur le



[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 127 mode de gouvernement à lui substituer. Comparons la longue paix, dont la France avait joui de 1654 à 1789, alors qu’elle obéissait aux lois paternelles d’un roi jaloux du bonheur de ses peuples, à l’état d’anarchie dans lequel l’avaient plongée les novateurs et les philosophes, bouleversé sur tous les points, l’empire offrait le triste spectacle d’un vaste incendie. Lyon, Marseille, Toulon , après avoir opposé une résistance héroïque aux armées d’un gouvernement révolutionnaire , étaient saccagées ou rejetées du rang des villes. La Vendée tout entière, en proie aux horreurs de la guerre civile, voyait scs châteaux pillés, détruits ou livrés aux[flammes. Tous les crimes étaient commis au nom de la loi. Chaque jour, les places publiques voyaient immoler des milliers de victimes, envoyées à l’échafaud par ce qu’on appelait la justice du peuple, et les citoyens divisés eux-mêmes s’entr’égorgeaient au nom d’une liberté dont ils ne pouvaient et ne savaient pas jouir.
Aux mesures que j'ai rapportées, les meneurs ajoutèrent celle d’écrire à toutes les communes de la République, afin de les attacher à leur propre cause. Les sections, le ban des Marseillais et les Septembriseurs furent convoqués. On se garda bien d’oublier cette tourbe de gens sans aveu qui vivent dans l’ombre, et que Paris ne voit apparaître qu’aux jours de ses calamités. «Il s’agit, leur disait-on, de défendre voire père, Robespierre. » Les geôliers des diverses prisons reçurent la défense de laisser sortir aucun détenu et d’ouvrir les portes à aucun de ceux que la Convention y enverrait.
Ilenriot, accompagné de ses aides-de-camp et environné d’une troupe de fidèles Jacobins, parcourait les
128 ■ HISTOIRE [179 IJ
rues, le sabre à la main, appelant à lui le peuple, vociférant d’une manière terrible. L’état d’ivresse dans lequel il était ne lui aurait pas permis de se défendre contre une attaque vigoureuse, et l’insensé perdit un temps considérable en essayant d’ameuter le faubourg Saint-Antoine contre la Convention. On ne crut pas à ses- mensonges, et si quelques masses se rendirent sur la place de Grève, ce fut plutôt par curiosité que par sympathie. Le monstre ne réussit qu’à faire marcher au supplice les condamnés du jour, que déjà quelques citoyens généreux avaient délivrés.
Henriot n’a pas plutôt appris l’incarcération de Robespierre au Luxembourg , qu’il se hâte de voler à la délivrance de son maître. Mais la gloire d’un si beau fait lui avait été ravie ; le gardien de cette maison d’arrêt, jacobin exalté, au lieu de faire passer le guichet au tyran, se prosterna devant lui, et les portes demeurèrent ouvertes.
Robespierre, dans le même fiacre qui l’avait amené captif, alla en triomphateur à la Commune, où bientôt il fut rejoint par Augustin Robespierre, Couthon, Saint-Jusl et Lebas, échappés, le premier de Saint-Lazare , et les autres de la Conciergerie , les gardiens de ces différentes maisons ayant refusé de les recevoir.
Du Luxembourg, Henriot vint occuper la place des Tuileries ; il y rencontra Meriin-Ó^cct. Les canonniers reçurent l’ordre de pointer sur la Convention ; mais la garde nationale opposait une vive résistance. quand parut un huissier tenant le décret de mise hors la loi lancé contre Henriot.
« Soldats, s’écria-t-il, arrêtez ce rebelle ; l’ordre de vos représentants vous l’enjoint. » Soudain, et comme par un coup de théâtre, le vil brigand est
I


[179L] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 129
abandonné ; les gendarmes venus à sa suite l’entourent, le saisissent lui et la majeure partie de ses aides-de-camp, et les enferment tous désarmés dans la salle du comité de Sûreté générale.
Coflinhal, à qui l’on porta la nouvelle de cet échec pour son parti, accourut, le sabre à la main, escorté de plusieurs compagnies sectionnaires, pour délivrer Henriot et ses acolytes. La Convention n’avait pris aucune mesure, et, quand arrivèrent Coflinhal et les • sectionnâmes, les Tuileries leur furent abandonnées.
Coflinhal délivra sans peine ses dignes amis, tandis que les membres du comité de Sûreté générale, alors en séance, se dispersèrent dans le palais et se cachèrent de leur mieux.
Enhardi par ce succès, Coflinhal annonça à la garde civique, aux gendarmes et aux canonniers que la Convention , mieux conseillée, avait reconnu l'innocence d’Henriot et lui avait rendu ses pouvoirs. Ce mensonge obtint un plein succès. Les divers corps se réunirent sous le commandement du sans-culotte, et celui-ci lit cerner la salle des représentants.
D’un autre côté, la présence de Robespierre à l’Hô-tel-de-Yille et l’inertie de la Convention avaient attiré plusieurs légions de la garde nationale ; une partie des faubourgs Saint - Antoine et Saint-Marceau s’ébranla. La victoire était aux Jacobins s’ils eussent pris l’initiative. Mais Henriot, dans un état d’ivresse complet, abandonnait à chaque instant le champ de bataille pour se livrer à de nouveaux excès de boisson. Ainsi fut perdu un temps précieux, et la Convention comprit enfin tout le danger de sa position.
Le son du tocsin, le bruit de la générale, rappelèrent les députés à leur poste, vers sept heures du soir.
_ 6.


130
HISTOIRE
[179kl
C’était le moment fixé pour la reprise de la permanence, et les craintes des députés avaient éveillé leur vigilance.
Bourdon de l’Oise, sous la présidence de Thuriot, parle le premier. Au milieu de la stupeur générale, il annonce que les comités ont pris des mesures énergiques; il fait connaître l’alliance conclue entre les Jacobins et la Commune, et, pour la neutraliser, il propose de flatter le peuple en fraternisant avec lui.
« Qu’importe, s’écrie vigoureusement Legendre, « qu’importe à la Convention et à la République qu’un « Conseil-général de commune se déclare en insurrec-« tion ?... Ne le confondez pas avec les citoyens, comp-« tez sur le peuple.... Il n’est pas facile de mettre en « mouvement un peuple instruit... Le peuple, en con-« servant l’instinct qu’il avait au commencement de la « révolution pour s’insurger contre les tyrans, ne se « rattachera qu’à vous; il n’adorera plus personne. »
Des conversations particulières s’engagent ensuite au sein de l’assemblée. Elle perd un temps précieux , et cependant chaque minute ajoute au danger de sa situation. Elle apprend successivement que l’huissier chargé de porter aux municipaux le décret qui les mande à la barre, n’a pu pénétrer qu’avec peine dans l’IIÔtel-de-Ville, et que le maire lui a répondu: Oui, nous y irons, niais ce sera arec /e peuple ; qu’Henriot et ses aides-de-camp, que tous les députés rebelles sont rendus à la liberté et placés à la tète de l'insurrection ; qu’un gouvernement provisoire s’organise à la Commune , et que ce gouvernement tardera peu à frapper un grand coup. A toutes ces nouvelles alarmantes et malheureusement vraies, se joignent bientôt des faits positifs. Ilenriot, à la tète d’une troupe armée aussi


[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
131
nombreuse que redoutable, envahit le Carrousel, s’empare des rues voisines et interrompt les communications avec les divers comités.
Tout à coup Collot-d’Herbois, président de droit du jour, traversant rapidement la salle, monte au fauteuil, que lui cède Thuriot. A sa pâleur, à son émotion, il est facile de prévoir une révélation sinistre. « Repré
a
« « «
sentants, dit-ii, voici l’heure de mourir à notre poste! Des scélérats, des hommes armés, ont investi les comités de Salut public et de Sûreté générale , et s’en sont emparés. »
A ces mots, et d’un mouvement sublime, digne d’une
belle cause, tous les députés qui erraient dans la salle et dans les couloirs remontent précipitamment sur leurs sièges. On eût dit les sénateurs romains, assis sur leurs chaises enrules, attendant, après la défaite d’Allia, les Gaulois et la mort.
Par un contraste frappant, dès les premières paroles de Collot-d llerbois, les tribunes s’étaient dégarnies ; ceux qui les remplissaient s’étaient hâtés de prendre la fuite. Ainsi la Convention est abandonnée à ses propres forces. Ceux qui, hier encore, lui applaudissaient, fuient lâchement aujourd’hui qu’il s’agit de la défendre : sans doute ils vont saluer le vainqueur. Tels sont les hommes en général.
Le silence succède enfin à une longue agitation ; des mesures sont prises. Barras, soldat brave et capable de résister à l’insurrection, est nommé commandant de la force publique ; on lui adjoint Féraud, Fréron, Delmas, Balctti, Bourdon de l’Oise et Léonard Bourdon. Tous les députés vont se faire reconnaître par la garde nationale fidèle, les troupes en disponibilité, et prennent les dispositions que la prudence leur suggère et

132 HISTOIRE [1794J
que leur position commande. L’arrestation de Labres-che, commandant des élèves de l’École de Mars, est décrétée, et la fête en l'honneur du jeune Víala est ajournée, parce (pie, dit BiHaud-Varennes , on ira arec plus de plaisir au Panthéon, quand la terre sera purgée des scélérats et des révoltés. Enfin, Peyssard et Benta-bole sont envoyés au camp des Sablons.
Cependant les diverses sections arrivaient en force et entouraient la Convention; les bons citoyens, les royalistes surtout, firent, en cette circonstance, cause commune avec les représentants ; quinze cents d’entre eux s’emparèrent du poste important du Pont-Neuf et de la batterie qui dominait la Seine et foudroyait les deux quais.
La nuit était venue depuis quelques heures, et les ténèbres semblaient ajouter à la gravité de la lutte qui allait s’engager. Les quais situés entre le Carrousel et la Grève étaient couverts d’une foule indécise et curieuse. Chacun attendait avec anxiété. Le malheureux, gémissant au fond d’un cachot, espérait ; mais ses amis n’étaient pas sans crainte. Comme on redoutait le triomphe des Jacobins, dont la cruauté était connue, de même un pressentiment secret faisait voir dans le triomphe de la Convention la fin du règne de la terreur. Telle était la tendance des esprits : d’ailleurs il n’y avait dans la Convention aucun député assez osé, assez puissant , pour marcher sur les traces de Robespierre.
Les propriétaires, les marchands, non moins que les nobles, abhorraient le régime révolutionnaire; ils en étaient écrasés, et tous soupiraient après un gouvernement doux et réparateur. Aussi ce fut avec une sympathie vraie, un dévouement entier, que les hommes influents des sections cherchèrent à convertir les masses
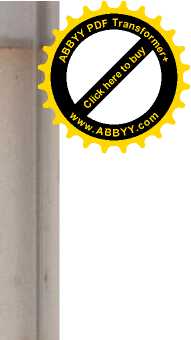
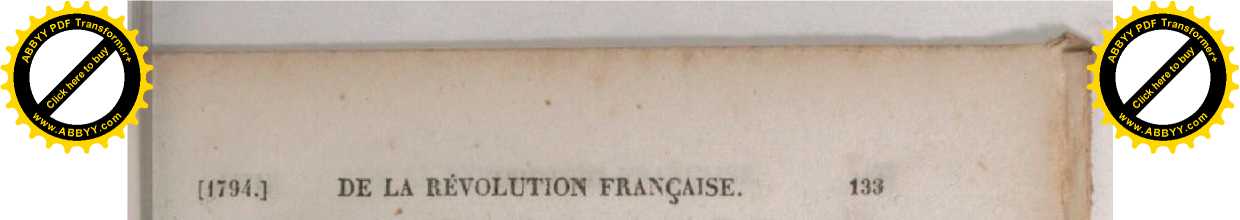
au parti de la Convention. Leurs efforts et leurs . démarches furent couronnés d’un plein succès, et la
Commune, qui avait tant compté sur le peuple, en fut abandonnée.
Léonard Bourdon prit le commandement des bataillons sectionnaires , et Tallien, qui dans le moment présidait aux comités, en l’absence de Coliot-d’Iler-bois, dit à Léonard prêt à combattre : « Pars* et que « le soleil à son lever ne trouve pas les conspirateurs « vivants. »
J’ai dit que la nuit était profonde : on était au commencement de la nouvelle lune ; l’illumination forcée des maisons, en suppléant à la pâle clarté de cet astre, dissipait l’épaisseur des ténèbres. Les défenseurs de la-Convention nationale suivaient les quais, conduisant plusieurs pièces de canon. Leur marche était silencieuse. La cause légitime a, dans le combat, quelque chose de grave et de solennel que la révolte ne peut imiter. Chez celle-ci, tout est tumulte, vociférations et cruautés ; elle (
ne peut être animée que par des cris, des attentats ou des actes de barbarie ; l’orgie et les excès lui donnent cette brutalité qu’elle prend pour du courage, cette opiniâtreté qu’elle appelle de l’énergie. Le bon droit, au contraire, marche avec calme et fermeté; il a le sentiment de la justice de sa cause, et n’a pas besoin de se signaler par la violence et le crime.
La place de l’Hôtel-de-Ville était remplie de détachements perdus de garde nationale, de canonniers , de gendarmes, et d’une foule de misérables, armés ou « ’
non , les uns jacobins jusqu’au délire, les autres sacrifiant peut-être à la peur, et rangés sans affection vers le parti qui semblait le plus à craindre, parce que, vainqueur. il se fût baigné dans le sang.
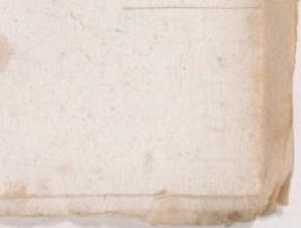
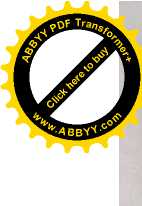
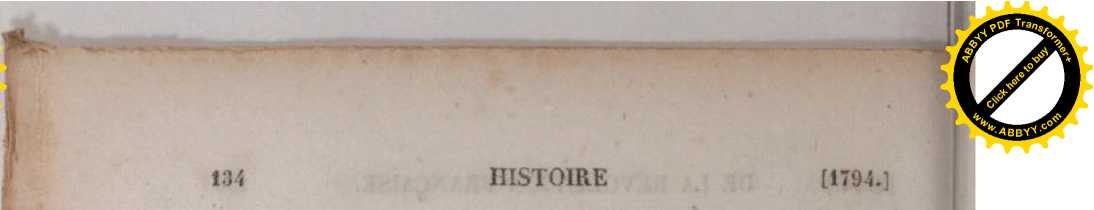
Avant d’attaquer cette foule à force ouverte, Léonard Bourdon lui envoya Dulac, agent du comité de Salut public, homme courageux et aussi peu soucieux
de sa vie que de sa réputation. Dulac se présente avec hardiesse et lit à plusieurs groupes le décret qui met la Commune hors la loi. A cette nouvelle, la frayeur gagne les auditeurs, et le plus grand nombre fuient sur tous les points. Sectionnâmes, gendarmes, canonniers, se réunissent à Léonard Bourdon et augmentent scs forces. Cependant celui-ci n’ose encore fondre sur rilôtel-de-Ville : le bruit s’est répandu que cet édifice est miné, et que les rebelles, poussés au désespoir, ont résolu de s’ensevelir sous ses ruines. En conséquence, il prend position sur les quais.
Mais cette prudence était inutile: l’Hôtel-de-Ville offrait l’image du plus affreux désordre. Tous les municipaux donnaient des ordres, aucun d’entre eux ne voulait obéir. Les avis, les mesures les plus contradictoires, étaient tour à tour proposés, adoptés ou rcuiis en discussion. C’est que la Commune ne comptait parmi ses chefs aucun homme d’action, et les orateurs ne contribuaient pas peu à maintenir ses membres dans l’indécision. Robespierre ne sut jamais se servir d’une épée; Saint-Just avait déshonoré la sienne ; Henriot s’était, par son ivresse, mis hors d’état de combattre ; Lebas, Couthon et Fleuriot, quoique méchants, manquaient d’énergie et de courage; Robespierre jeune était un homme nul. Coffinhal avait seul de l’âme; les autres n’étaient que les conseillers ou les instruments passifs de la majorité. Enfin tous ensemble attendaient du hasard ce que le génie d’aucun n’était capable de concevoir.
Sur ces entrefaites, arrive à la municipalité Tarn-

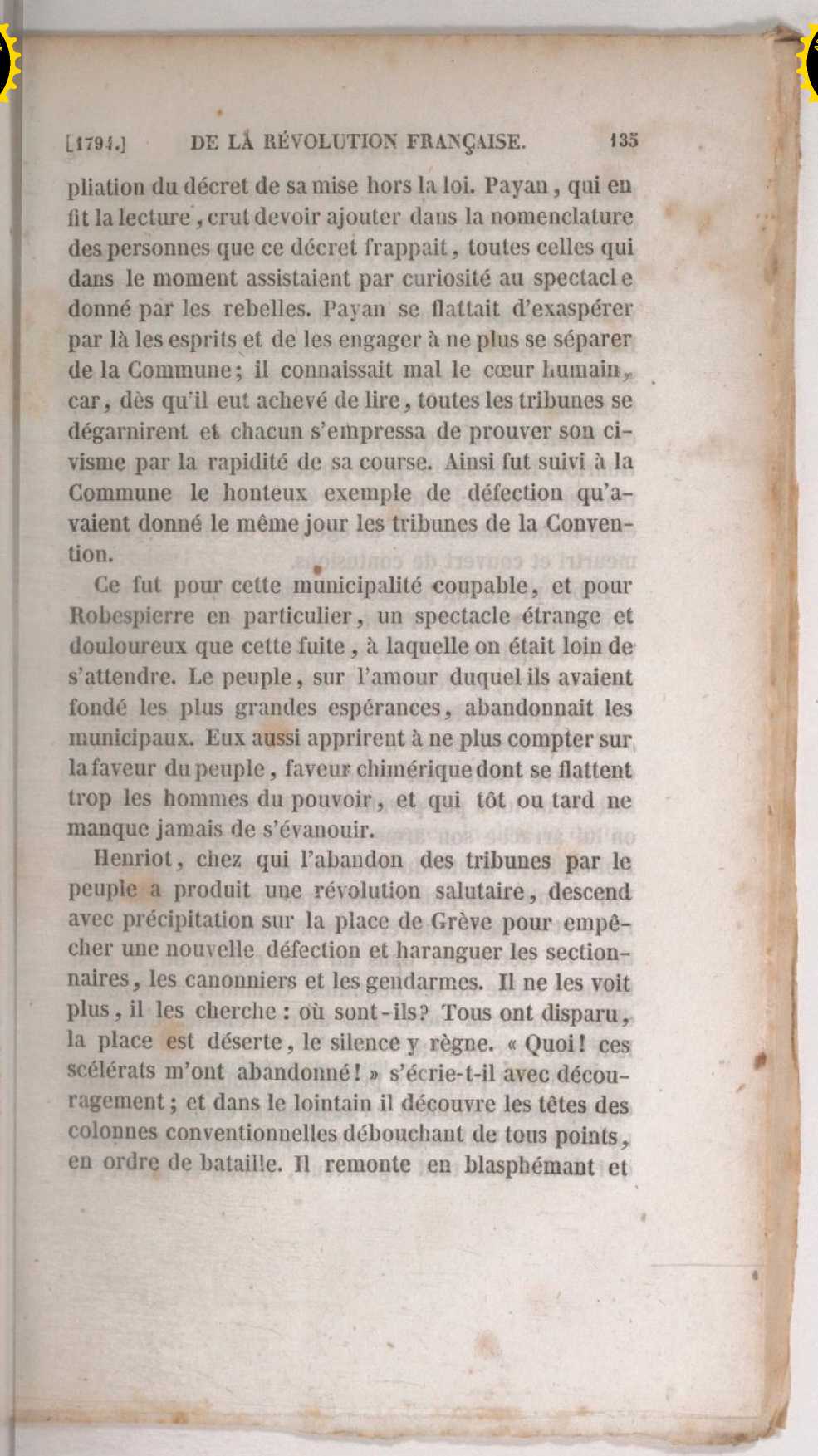
pliation du décret de sa mise hors la loi. Payan, qui eu lit la lecture, crut devoir ajouter dans la nomenclature des personnes que ce décret frappait, toutes celles qui dans le moment assistaient par curiosité au spectacl e donné par les rebelles. Payan se flattait d’exaspérer par là les esprits et de les engager à ne plus se séparer de la Commune; il connaissait mal le cœur humain, car, dès qu'il eut achevé de lire, toutes les tribunes se dégarnirent et chacun s’empressa de prouver sou civisme par la rapidité de sa course. Ainsi fut suivi à la Commune le honteux exemple de défection qu’avaient donné le même jour les tribunes de la Convention.
Ce fut pour cette municipalité coupable, et pour Robespierre en particulier, un spectacle étrange et douloureux que cette fuite, à laquelle on était loin de s’attendre. Le peuple, sur l’amour duquel ils avaient fondé les plus grandes espérances, abandonnait les municipaux. Eux aussi apprirent à ne plus compter sur la faveur du peuple, faveur chimérique dont se flattent trop les hommes du pouvoir, et qui tôt ou tard ne manque jamais de s’évanouir.
Henriot, chez qui l’abandon des tribunes par le peuple a produit une révolution salutaire, descend avec précipitation sur la place de Grève pour empêcher une nouvelle défection et haranguer les section-naires, les canonniers et les gendarmes. Il ne les voit plus, il les cherche : où sont-ils? Tous ont disparu, la place est déserte, le silence y règne. « Quoi ! ces scélérats m’ont abandonné! » s’écrie-t-il avec découragement ; et dans le lointain il découvre les têtes des colonnes conventionnelles débouchant de tous points, en ordre de bataille. Il remonte en blasphémant et
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
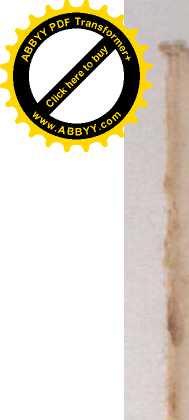
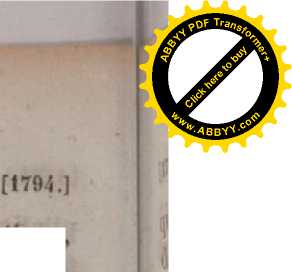
136
HISTOIRE
rentre terrifié au Conseil. IL annonce la défection , due peut-être à son absence et à son ivresse. Le découragement , le désespoir, gagnent tous les membres de ce conciliabule. Ils s’accusent entre eux, et en viennent réciproquement aux derniers excès de fureur. La plupart, n’ayant pu trouver leur salut dans la fuite, . se cachent honteusement ; d’autres se donnent la mort.
Coffînhal saisit Henriot et le précipite par une fenêtre, en disant : « Vil coquin, ta lâcheté nous a perdus! » Henriot, lancé sur le pavé, n’eut pas le bonheur d’y trouver la mort; il tomba sur un monceau d’ordures, et se traîna ensuite vers un égout, d’où on le repêcha. meurtri et couvert de conlusiqps.
Lebas prend un pistolet pour se brûler la cervelle. Robespierre veut l’imiter : sa main tremblante trahit sa faiblesse, il se défigure horriblement et ne peut se tuer; il demande à Lebas de lui rendre ce service; mais celui-ci répond en s’ajustant lui-même : J'ai bien autre chose à faire (¡u à m'occuper de toi. On trouve Saint - Just armé d’un poignard , dont sa lâcheté ne lui a pas permis de faire usage; il pleure, on lui arrache son arme et on l’on frappe. Augustin Robespierre saute du premier étage de l’HÔtel-de-Ville; il n’est pas plus heureux que son frère et qu’Hen-riot, et ne peut trouver la mort dans sa chute. Cou-thon est découvert dans un sale réduit où il s’est traîné à l’aide de ses béquilles. Coffînhal a dédaigné de se donner la mort. Les autres rebelles attendent leur sort avec anxiété.
Cependant plusieurs personnes, Bourdon, le gendarme Metta qui ment en se donnant comme le meurtrier de Maximilien Robespierre, un adjudant, Ozan, qui devint plus lard législateur, tribun et préfet, et

[1791.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 137
quelques autres, pénétrèrent les premiers dans la salle des séances, arrivèrent assez à temps pour empêcher aux ofliciers municipaux de se dépouiller de leurs écharpes. « Non, dit Ozan , qu’elles déposent en té-« moignage de votre révolte et de votre lâcheté. »
On rassemble ces misérables ; Robespierre, couvert de sang, privé d’un œil, est tourné contre la muraille. Simon, l’infâme bourreau de Louis XVII, demande grâce avec un accent plus doux que celui qu’il prenait quand il disait naguère à sa royale victime: lra te coucher, louveteau (1). O Providence ! que tes décrets sont justes ! Si ta vengeance est lente, du moins elle est certaine !
Pendant que ces choses se passaient à ITlôtel-de-Ville, et que Barras, investi du commandement général , assurait sur tous les points de Paris la victoire au parti conventionnel, les représentants restés dans la salle des séances siégeaient en proie à une vive • anxiété. Il existait beaucoup d’incertitude, et les plus perspicaces avouaient que le succès dépendrait des fautes commises par les Jacobins.
Tout à coup, un message annonce la défaite de la Commune. Chalier, qui présidait, dit à ses collègues :
« Citoyens, on vient d’amener Robespierre mutilé, mais vivant. Il est là, ne voulez-vous pas qu’il entre ? »
(1) Simon, cordonnier, gouverneur du Dauphin, attendait que cet auguste enfant fût endormi: alors il l’éveillait en sursaut par d’horribles blasphèmes, le faisait venir à lui; et quand le jeune prince lui demandait avec douceur ce qu'il voulait :— Rien, répondait Simon , et lui appliquant un fort coup de pied, que la sainte victime n’esquivait pas toujours, il ajoutait constamment: Va te coucher, louveteau. * L. L. L.
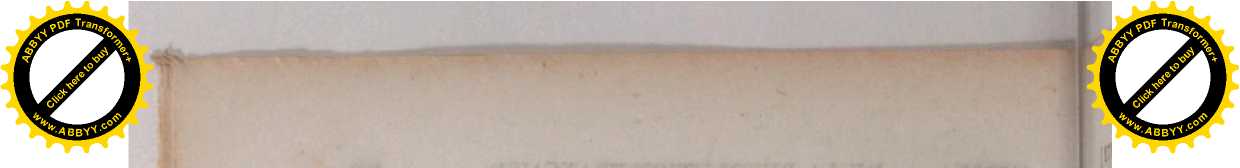
lío HISTOIRE [1794.1
Maximilien à la Conciergerie pour y attendre l’heure de l’exécution, et afin qu’on ne pût pas égarer, à l’aide de spn nom et de sa ressemblance, ces badauds toujours si nombreux et si faciles à tromper; le juger était d’ailleurs inutile, car lui et ses complices ayant été mis hors la loi, il ne s’agissait pour légaliser leur exécution que de vérifier l’identité des individus.
Tout se préparait pour le dernier châtiment de ces grands coupables. Ils comparurent le même jour devant le tribunal révolutionnaire, pour y constater, comme je viens de le dire, leur identité. On observa qu’à leur approche Fouquier-Thinville, malgré ses efforts pour se dompter, pâlit et rougit tour à tour, tremblant sans doute de frayeur et de désespoir. Voici les noms de ceux qui périrent ce jour-là sous la hache que la mort de tant de pures victimes n’avait pas émoussée.
Maximilien Robespierre, député, âgé de 35 ans. — Couthon, député, 38 ans. —Lavalette, ex-noble, exgénéral , 40 ans. — Henriot, ex-commis, ex-général, 32 ans. — Dumas, président du tribunal révolutionnaire , 37 ans. — Saint-Just, député, 26 ans. — Payan, juré au tribunal révolutionnaire, agent municipal de la commune de Paris, 27 ans. —Viviers, juge au tribunal civil de la Seine, dernier président dés Jacobins, 50 ans.—Gobaud, magistrat, officier municipal de la Commune, 26 ans. —Fleuri ot-Lescot, exsubstitut au tribunal révolutionnaire de Paris, maire de la ville , 39 ans. — Robespierre jeune , député, 34 ans. — Bernard, prêtre, 34 ans. —Genus, tonnelier, 33 ans. — Simon, geôlier, bourreau de son roi, et ex-conseiller municipal, 38 ans. — Laurent, fondeur, 39 ans.—Varene, idem, 29 ans.—Fores-
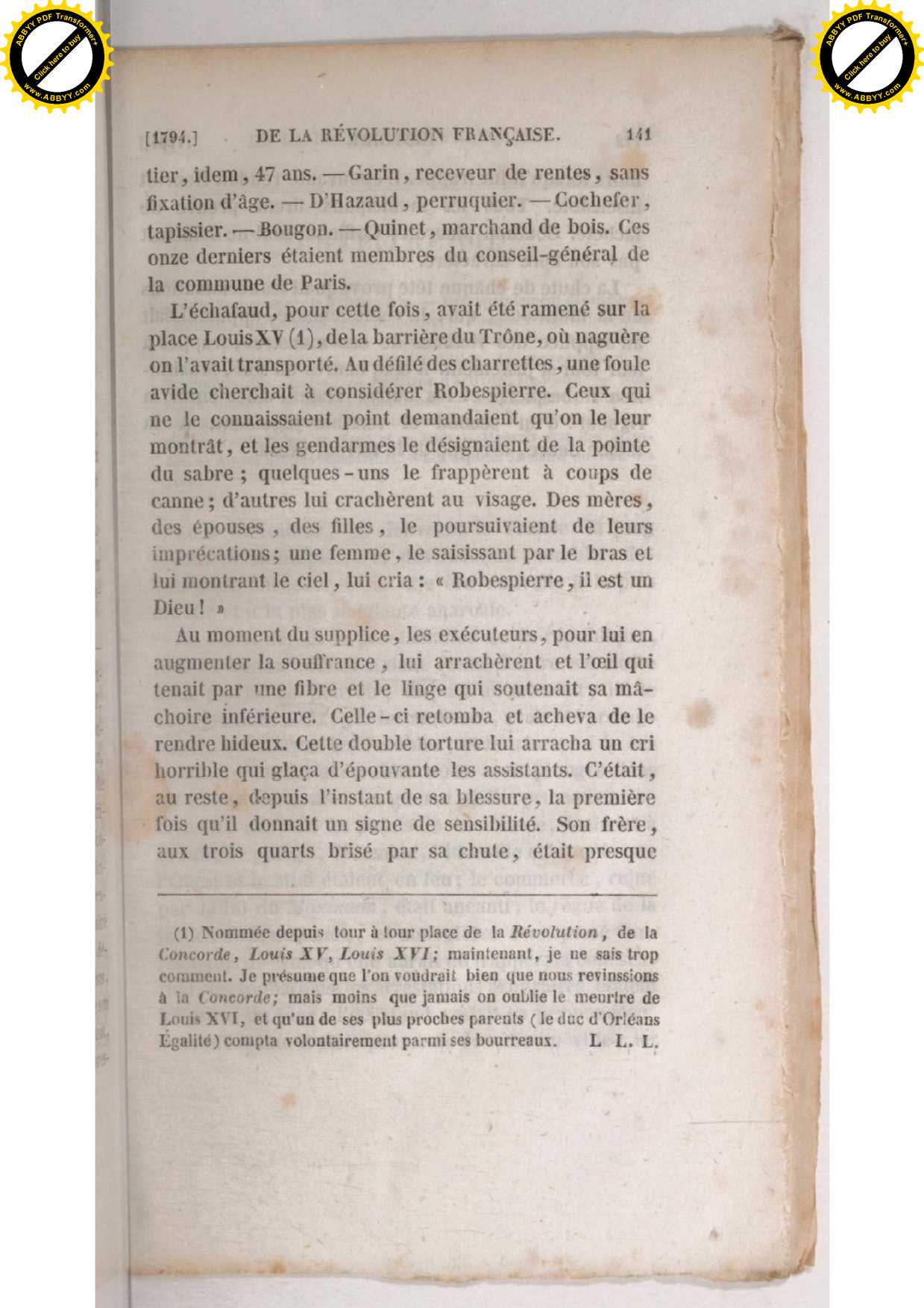
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 141 lier, idem, 47 ans. —Garin, receveur de rentes, sans fixation d’âge. — D’Hazaud, perruquier. —Cochefer, tapissier.—Bougon.—Quinet, marchand de bois. Ces onze derniers étaient membres du conseil-général de la commune de Paris.
L’échafaud, pour cette fois, avait été ramené sur la place Louis XV (1), de la barrière du Trône, où naguère on l’avait transporté. Au défilé des charrettes, une foule avide cherchait à considérer Robespierre. Ceux qui ne le connaissaient point demandaient qu’on le leur montrât, et les gendarmes le désignaient de la pointe du sabre; quelques-uns le frappèrent à coups de canne ; d’autres lui crachèrent au visage. Des mères, des épouses , des filles, le poursuivaient de leurs imprécations; une femme, le saisissant par le bras et lui montrant le ciel, lui cria : « Robespierre, il est un Dieu !» .
Au moment du supplice, les exécuteurs, pour lui en augmenter la souffrance , lui arrachèrent et l’œil qui tenait par une fibre et le linge qui soutenait sa mâchoire inférieure. Celle-ci retomba et acheva dele rendre hideux. Cette double torture lui arracha un cri horrible qui glaça d’épouvante les assistants. C’était, au reste, depuis l’instant de sa blessure, la première fois qu'il donnait un signe de sensibilité. Son frère, aux trois quarts brisé par sa chute, était presque
(1) Nommée depuis tour à Jour place de la dévolution, de h Concorde, Louis A K, Louis XVI; maintenant, je ne sais trop comment. Je présume que Fou voudrait bien que nous revinssions à la Concorde; mais moins que jamais on oublie le meurtre de Louis XVI, et qu’un de ses plus proches parents ( le duc d'Orléans Égalité) compta volontairement parmi ses bourreaux. L L. L.

LÍO
HISTOIRE
Maximilien à la Conciergerie pour y attendre l’heure de l’exécution, et afin qu’on ne pût pas égarer, à l’aide de spn nom et de sa ressemblance, ces badauds toujours si nombreux et si faciles à tromper; le juger était d’ailleurs inutile, car lui et ses complices ayant été mis hors la loi, il ne s’agissait pour légaliser leur exécution que de vérifier l’identité des individus.
Tout se préparait pour le dernier châtiment de ces grands coupables. Ils comparurent le même jour devant le tribunal révolutionnaire, pour y constater, comme je viens de le dire, leur identité. On observa qu’à leur approche Fouquier-Thinville, malgré ses elTorts pour se dompter, pâlit et rougit tour à tour, tremblant sans doute de frayeur et de désespoir. Voici les noms de ceux qui périrent ce jour-là sous la hache que la mort de tant de pures victimes n’avait pas émoussée.
Maximilien Robespierre, député, âgé de 35 ans. — Couthon, député, 38 ans. —Lavalette, ex-noble, exgénéral, 40 ans. — Ilenriot, ex-commis, ex-général, 32 ans. — Dumas, président du tribunal révolutionnaire , 37 ans. — Saint-Just, député, 26 ans. — Payan, juré au tribunal révolutionnaire, agent municipal de la commune de Paris, 27 ans.—Viviers, juge au tribunal civil de la Seine, dernier président des Jacobins, 50 ans.—Gobaud, magistrat, officier municipal de la Commune, 26 ans. —Flcuriot-Lescot, cx-substitut au tribunal révolutionnaire de Paris, maire de la ville , 39 ans. — Robespierre jeune , député, 34 ans. — Bernard, prêtre, 34 ans.—Genus, tonnelier, 33 ans. —Simon,geôlier, bourreau deson roi, et ex-conseiller municipal, 38 ans.— Laurent, fondeur, 39 ans.—Varene, idem, 29 ans.—Fores-
[1794.]
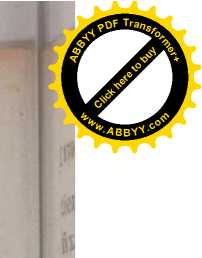
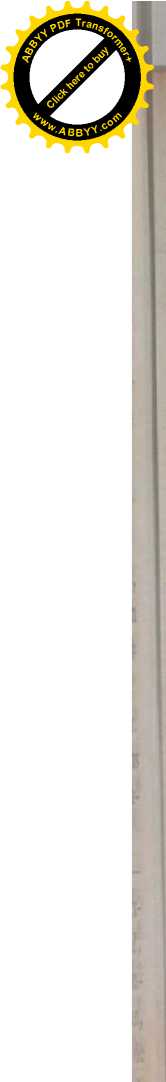
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 141 lier, idem, 47 ans. —Garin, receveur de rentes, sans fixation d’âge. — D’Hazaud, perruquier. —Cochefer, tapissier. — Bougon.—Quinet, marchand de bois. Ces onze derniers étaient membres du conseil-général de la commune de Paris.
L’échafaud, pour cette fois, avait été ramené sur la place LouisXV (l),dela barrière du Trône, où naguère on l’avait transporté. Au défilé des charrettes, une foule avide cherchait à considérer Robespierre. Ceux qui ne le connaissaient point demandaient qu’on le leur montrât, et les gendarmes le désignaient de la pointe du sabre; quelques-uns le frappèrent à coups de canne; d’autres lui crachèrent au visage. Des mères, des épouses , des tilles, le poursuivaient de leurs imprécations; une femme, le saisissant parle bras et lui montrant le ciel, lui cria : « Robespierre, il est un Dieu! »
Au moment du supplice, les exécuteurs, pour lui en augmenter la souffrance , lui arrachèrent et l’œil qui tenait par une fibre et le linge qui soutenait sa mâchoire inférieure. Celle-ci retomba et acheva dele rendre hideux. Cette double torture lui arracha un cri horrible qui glaça d’épouvante les assistants. C’était, au reste, depuis l’instant de sa blessure, la première fois qu’il donnait un signe de sensibilité. Son frère, aux trois quarts brisé par sa chute, était presque


(1) Nommée depuis tour à tour place de la Révolution, de la Concorde, Louis A3', Louis XVI; maintenant, je ne sais trop conunent. Je présume que fou voudrait bien que nous revinssions à la (oncorde; mais moins que jamais ou oublie le meurtre de Louis XVI, et qu'un de ses plus proches parents ( le duc d'Orléans Égalité) compta volontairement parmi ses bourreaux. L L. L.
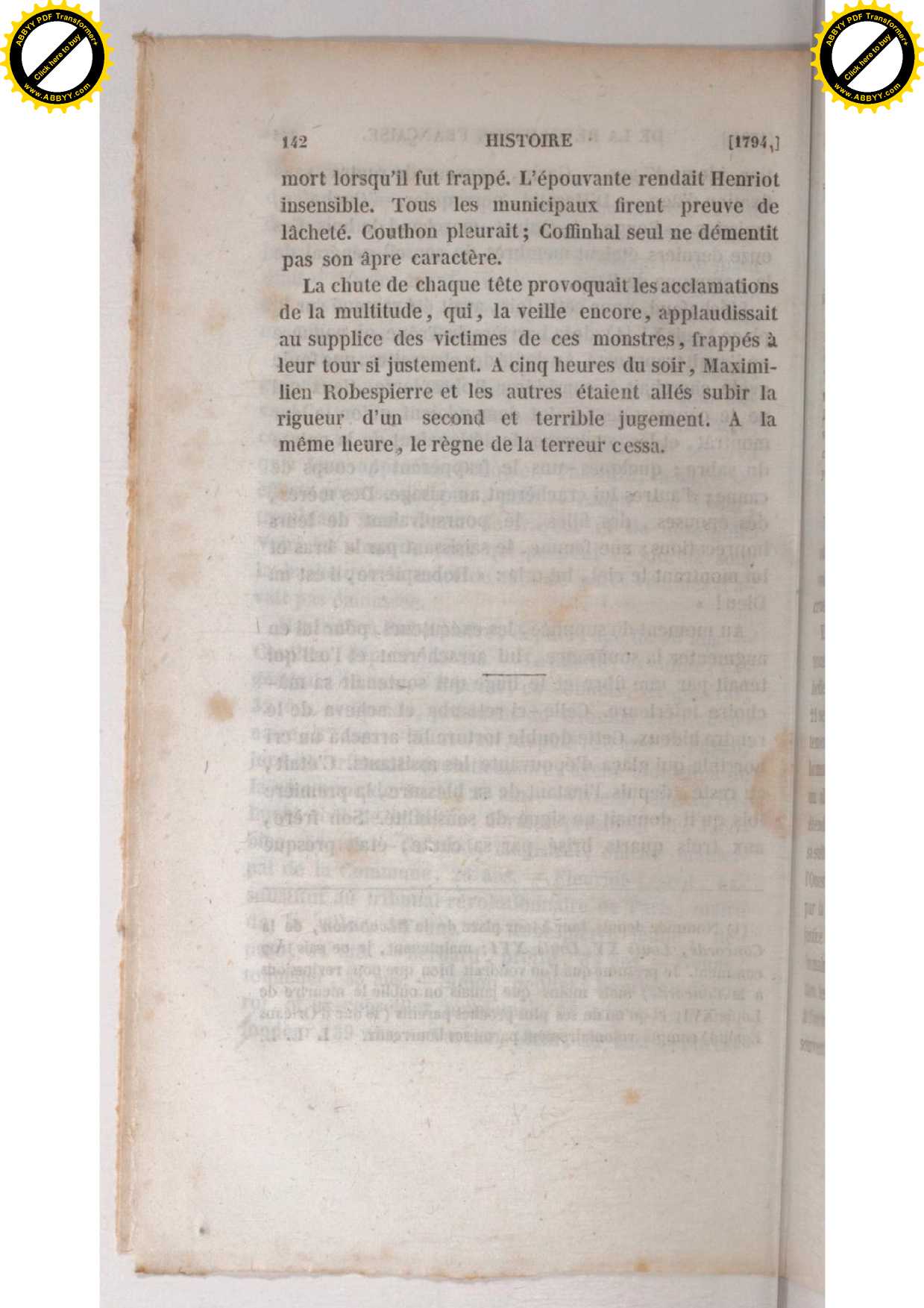
} hlj t'JÍ
mort lorsqu’il fut frappé. L’épouvante rendait Henriot insensible. Tous les municipaux tirent preuve de lâcheté. Couthon pleurait ; Coflinhal seul ne démentit pas son âpre caractère.
La chute de chaque tête provoquait les acclamations delà multitude, qui, la veille encore, applaudissait au supplice des victimes de ces monstres, frappés à leur tour si justement. A cinq heures du soir, Maximilien Robespierre et les autres étaient allés subir la rigueur d’un second et terrible jugement. A la même heure, le règne de la terreur cessa.
HISTOIRE
[1794J
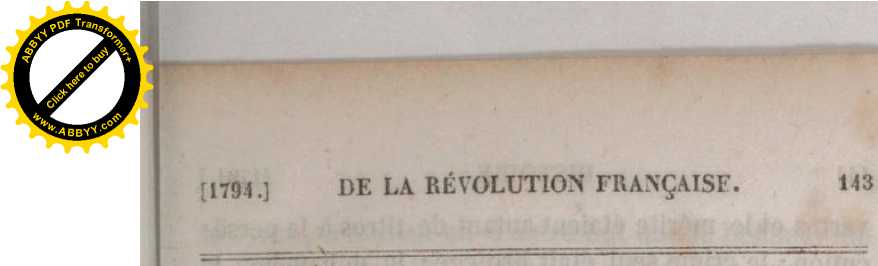
État delà France après le 9 thermidor. — Désappointement des meneurs Jacobins. — Le tribunal révolutionnaire. — Fouquier-Tliinville respectant la lettre de la justice. — Joie de la France à la nouvelle du supplice de Robespierre. — Recomposition du gouvernement. — Triomphes des armées. — Prodiges d’activité française. — Nouvelles victoires. — Décrets réparateurs. — Suppression du club des Jacobins. — Supplice de Carrier. — Noyade de quarante et une victimes. — Victoires au Nord et au Midi. — .Mauvais état des finances. — Autres décrets réparateurs. — Les députés Jacobins ouvrent les yeux.
Le 9 thermidor, en délivrant la France du joug odieux de Robespierre et des Jacobins, semblait devoir faire succéder enfin une ère nouvelle à la plus cruelle et à la plus sanglante anarchie.
En elTet, depuis la proclamation de la république , tous les fléaux réunis étaient venus fondre sur notre belle patrie. Le pouvoir, disputé un moment, dès le 21 septembre 1792, par les modérés, avait été promptement envahi par les Jacobins, et le triomphe de ces hommes à jamais exécrables nous avait plongés dans un abîme de maux. La guerre civile promenait son étendard sur tous les points de la France, traînante sa suite le pillage, la famine, l’incendie et le meurtre ; l’Ouest et le Midi étaient en feu; le commerce , ruiné par la loi du Maximum, était anéanti; le règne de la justice était suspendu, et son glaive avait passé dans les mains de ceux qu’elle aurait dû frapper; la confiscation. les spoliations,les arrestations arbitraires, étaient à l’ordre du jour ; l’échafaud restait en permanence. souvent même il était promené de ville en ville; les
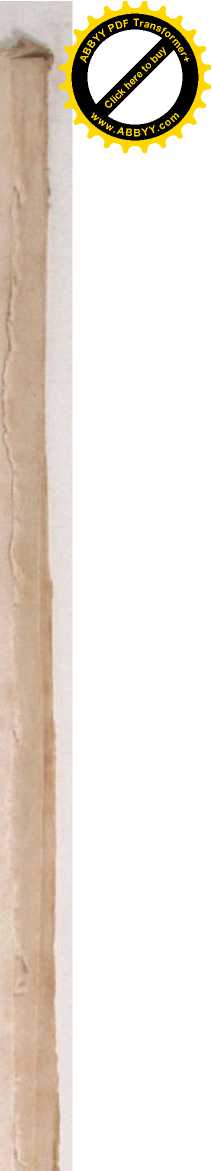
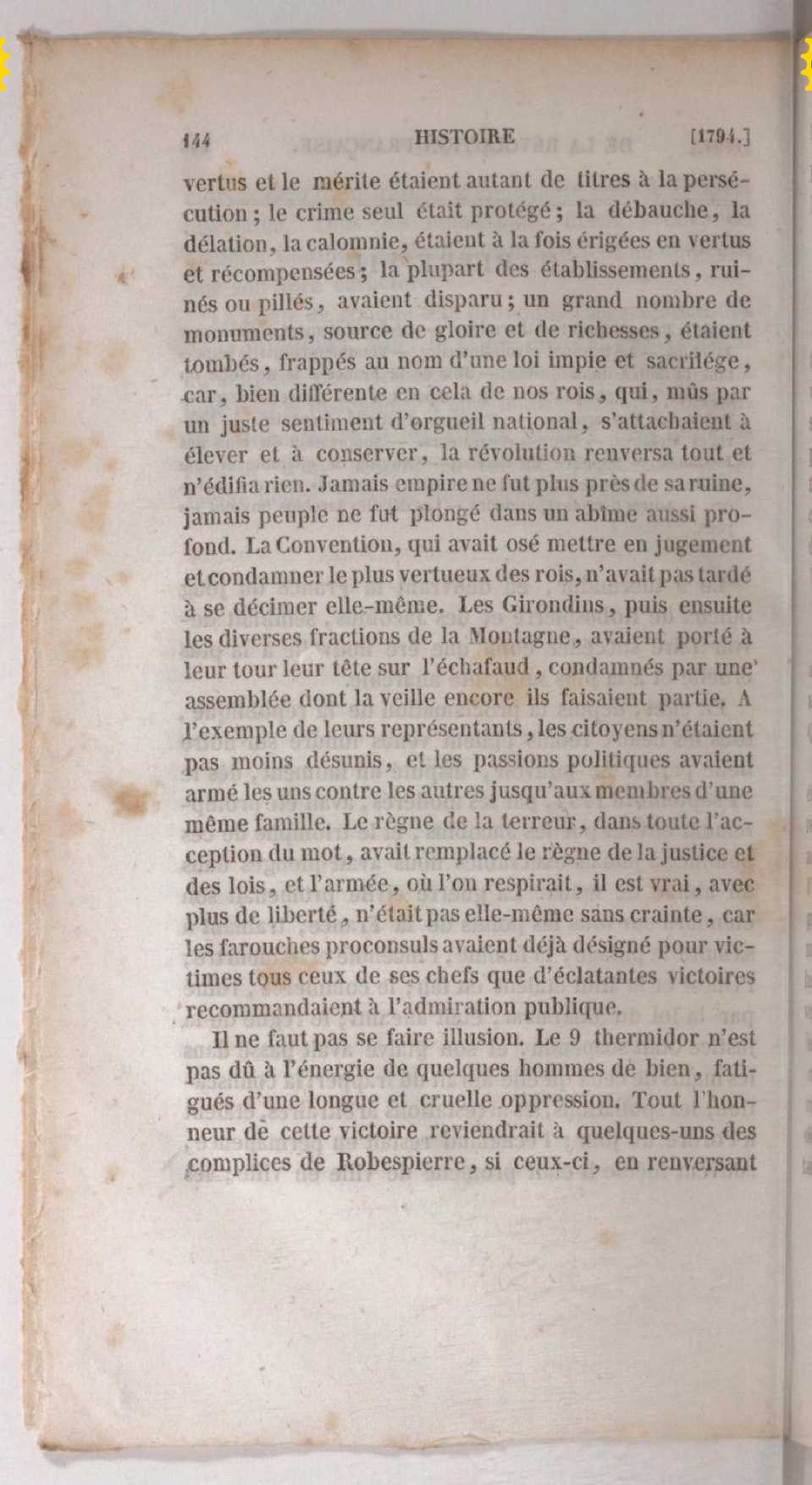
vertus et le mérite étaient autant de titres à la persécution ; le crime seul était protégé; la débauche, la délation, la calomnie, étaient à la fois érigées en vertus et récompensées ; la plupart des établissements, ruinés ou pillés, avaient disparu; un grand nombre de monuments, source de gloire et de richesses, étaient tombés, frappés au nom d’une loi impie et sacrilège, car, bien dilïérente en cela de nos rois, qui, mus par un juste sentiment d’orgueil national, s’attachaient à élever et à conserver, la révolution renversa tout et n’édifia rien. Jamais empire ne fut plus près de sarnino, jamais peuple ne fut plongé dans un abîme aussi profond. La Convention, qui avait osé mettre en jugement et condamner le plus vertueux des rois, n’avait pas tardé à se décimer elle-même. Les Girondins, puis ensuite les diverses fractions de la Montagne, avaient porté à leur tour leur tête sur l’échafaud, condamnés par une’ assemblée dont la veille encore ils faisaient partie. A l’exemple de leurs représentants, les citoyens n’étaient pas moins désunis, elles passions politiques avaient armé les uns contre les autres jusqu’aux membres d'une même famille. Le règne de la terreur, dans toute l'acception du mot, avait remplacé le règne de la justice et des lois, et l’armée, où l’on respirait, il est vrai, avec plus de liberté, n’était pas elle-même sans crainte, car les farouches proconsuls avaient déjà désigné pour victimes tous ceux de ses chefs que d’éclatantes victoires recommandaient à l’admiration publique.
Il ne faut pas se faire illusion. Le 9 thermidor n’est pas dû à l’énergie de quelques hommes de bien, fatigués d’une longue et cruelle oppression. Tout l'honneur dè cette victoire reviendrait à quelques-uns des .complices de Robespierre, si ceux-ci, en renversant
HISTOIRE
[179L]

{1794.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 145 I
le tyran, n’avaient eu d’autre but que le bonheur de la France ; mais ils ne s’étaient armés que pour défendre leur propre vie, menacée par l’ambition du dictateur, Aussi, loin de chercher à faire succéder des jours de paix et de calme aux jours de deuil et de sang, ils se hâtèrent, aussitôt après la victoire, de faire pressentir, par leurs paroles et leurs actes, que, vainqueurs de Robespierre, ils en continueraient le système. Et si l’on doutait de cette vérité, il subirait, pour se convaincre, de considérer quels furent les acteurs de cette fameuse journée. Aucun royaliste, aucun modéré ne se montra; on ne vit que Collot-d’Herbois, Billaud - Varennes , Bourdon de l'Oise, Fouché, Amar, Thuriot, Léonard Bourdon, Delmas, Legendre, Fréron, Barras, Barrère, Vadier, Goupil-laud,Élie Lacôte, Merlin de Thionville et quelques autres. Tous ces hommes, souillés de crimes, avaient aussi fait répandre le sang du juste et de l’innocent. Que pouvait-on espérer de tels vainqueurs ?
Mais la Providence eut pitié de la France. La corde était trop tendue, et ceux qui voulaient seulement la relâcher la rompirent malgré eux. La réaction fut aussi forte que l’avait été l’impulsion anarchique, et l’énergie qu’avaient montrée les brigands passa aux gens de bien. Du reste, les meneurs, tous hommes médiocres, n’eurent que peu d’influence. Le peuple, las d’adorer des idoles qu’on lui enlevait si souvent, ne voyait plus ses députés qu’avec indifférence. Les Jaco- * bins, quoique nombreux, avaient donc encore à lutter contre la force de l’opinion: aussi trouvèrent-ils une résistance énergique toutes les fois qu’ils essayèrent de replacer la France sous leur joug. Écrasés plus tard sous un bras de fer, ils dormirent du sommeil de
H. 7

146 , ’ HISTOIRE [1794.] la mort, jusqu’à l’époque fatale où la fausse politique de la Restauration leur rendit l'existence.
• C’est une chose digne de remarque, que le premier corps constitué qui, le lendemain de la victoire, vint complimenter la Convention, fut l’infâme tribunal révolutionnaire, dont la plupart des membres devaient bientôt monter à leur tour sur l’échafaud. « Nous ve-« nous nous glorifier de notre inébranlable constance, « dit 1’o:ateur du tribunal, et cette constance sera « toujours la même, malgré quelques traîtres glissés « dans notre sein.».. Nous venons prendre vos ordres « pour le jugement des conspirateurs. » Fouquier-Thinville, ce monstre que réclamait le glaive de la justice, ajouta : « Il est une difficulté qui arrête la « marche du tribunal. Parmi les grands coupables que « vous avez mis hors la loi, se trouvent les officiers « municipaux. Il ne s’agit plus pour exécuter l’arrêt « contre les rebelles, que de constater l’identité « des personnes. Mais, à cet égard, je ferai obser-« ver qu’un décret exige que cette identité soit « constatée en présence de deux officiers muni-« cipaux de la commune des prévenus ; or , il « nous est impossible de satisfaire à cette formalité, « puisque les municipaux sont tous frappés eux-« mêmes. »
Fouquier-Thinville, observateur religieux de- formes légales ! ! ! Ce respect, à la fois tardif et subit, devait sembler étrange à l’assemblée; mais telle était l’ivresse causée parla victoire, que personne ne songea à demander à Fouquier s’il avait toujours, en d’autres circonstances, agi avec le même scrupule. On se contenta de lui répondre que plusieurs municipaux étaient restés fidèles, et que trois d’entre eux étaient venus,
1 I


[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. HT le 9 au soir, à la barre de la Convention, protester de leur dévouement.
La nouvelle de la chute et du supplice de Robespierre se répandit avec rapidité dans les provinces', et fit renaître l’espérance et la joie dans tous les cœurs. Les modérés, dans un grand nombre de communes, chassèrent des administrations les terroristes et les sans-culottes. Les prisons furent ouvertes, et l’échafaud que les partisans de Robespierre avaient fait élever si souvent pour d’innocentes victimes dont ils convoitaient les dépouilles, devint l’instrument du supplice infligé à ces monstres. Les fils de ceux qu’avait frappés la hache révolutionnaire poursuivirent à leur tour les meurtriers de leurs parents. Une vaste association, dont le seul but était la vengeance, fut organisée dans presque toutes les provinces du Midi, sous le nom de Compagnie des Fils du Soleil. K Nantes, à Lyon, dans la Provence, le Languedoc, le Dauphiné et la Guyenne, presque tous ceux qui avaient répandu le sang innocent et s’étaient enrichis de rapines trouvèrent dans une mort violente le juste châtiment dû à leurs crimes.
A Paris, on renouvela les comités, et les amis de Robespierre furent mis en prison. Le peintre David, qui, la veille du 9 thermidor, avait juré de boire la ciguë avec le tyran, loin d’être fidèle à son serment, monta à la tribune; il pleura, il promit que désor-• mais il ne serait plus la dupe de son engouement pour des hommes trompeurs, et qu’il ne s’attacherait qu’aux principes : celte rétractation ne sauva David que du supplice. On donna une nouvelle organisation au tribunal révolutionnaire, dont plusieurs membres ne quittèrent leurs sièges que pour porter leur tête sur l’échafaud. Fouquier-ThinvilRfut arrêté , cl ce mons-
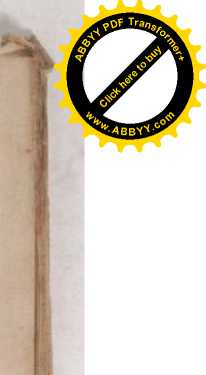


<48 HISTOIRE [1794.]
tic péril plus tard du supplice qu'il avait tant de fois requis contre l’innocence et la vertu. On rendit les défenseurs aux accusés, on ouvrit les prisons, on diminua le nombre des maisons d’arrêt, et le bourreau eut enfin quelques jours de relâche !
Barrère avait déclaré que les royalistes ne gagneraient lien à la chute de Robespierre : telle était l’intention de Barrère et de ses amis ; mais, je le répète, le pouvoir leur échappait. On demandait à grands cris le châtiment des vainqueurs du tyran. De toutes parts on s’étonnait que les Collot-d’Herbois, les Billaud, les Va-dier, les Bourdon, les Tallien, les Fréron, les Fouché ; que Barrère surtout, Carrier, Lebon et tant d’autres n’eussent pas encore suivi Robespierre à l’échafaud. Ils avaient, il est vrai, renversé le dictateur, mais cette victoire leur avait été commandée par la nécessité ; on ne devait leur en tenir aucun compte et la justice réclamait un prompt et sévère châtiment. Aussi l’expiation la plus douloureuse pour ces grands criminels fut sans contredit l’énergique manifestation de l’opinion publique. Repoussés par les honnêtes gens, ils tentèrent vainement de se rapprocher de ceux qu’ils avaient renversés et de relever leur puissance ; abandonnés de tous, ces Jacobins, jusque-là triomphants, ne purent se soustraire au juste supplice que méritaient leurs forfaits. Les uns périrent sur l’échafaud ; les autres traînèrent misérablement sur la terre de la déportation une vie aux souffrances de laquelle les remords et les regrets ajoutaient encore.
Tandis que Paris délivre la France de ses tyrans. les années triomphent des ennemis de la République. Le général en chef Pichegru, et Schérer sous ses ordres , mettent le siège devant Valenciennes, qui ca-
[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 149 pilule le 27 août, abandonnant aux vainqueurs deux cents pièces de canon, des provisions considérables et toute sa garnison. Cette victoire consterne et humilie l’Autriche, dont lé drapeau flottant sur la ville désignait Valenciennes comme une conquête et une propriété de l’Empire. Landrecies, Le Quesnoy, Condé, éprouvent bientôt le même sort.
Tous ces succès raffermissaient la Convention. Des revers, en ébranlant sa puissance, lui auraient fait perdre tous les fruits de sa victoire sur les Jacobins. Aussi, dans leur rage, les sans-culottes mirent le feu à la poudrière de Grenelle. Ce nouveau crime, commis le 31 août, coûta la vie à plus de deux mille personnes, et leurs auteurs n’y gagnèrent que d’être mieux appréciés et plus hais.
Le même jour, un décret, rendu sur la proposition de Grégoire, vint arrêter le zèle impie des vandales et des iconoclastes de l’époque : il fut défendu de toucher à aucun monument, de mutiler aucune statue. Hélas ! ce décret arrivait trop lard. La France était couverte des ruines de ses monuments les plus admirables; tous les chefs-d’œuvre, tous les tableaux des grands maîtres, de précieux manuscrits (1), avaient été livrés aux flammes. Telle avait été la rage aveugle des démolisseurs, que la commune de Paris n’eut pas honte de délibérer sur la motion de Simon, qui de-

( 1) A Toulouse, les Annales de la ville furent brûlées. Cet admirable ouvrage était orné des portraits des capitouls depuis le commencement du XIIIe siècle jusqu'à 1789 ; tous ces portraits, accompagnés d'armoiries, étaient peints à l'huile, ainsi que les événements les plus remarquables survenus sous chaque capiloulat.
L. L. L.
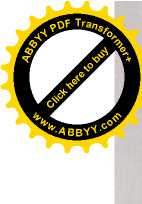
150
HISTOIRE
[1794.]

mandait que les livres de la Bibliothèque nationale fussent brûlés en niasse, parce que la Bibliothèque avait été appelée Royale, et que tous les volumes portaient l’empreinte du sceau de la monarchie. Cette motion n’avait été rejetée qu’à la majorité d t^E voix ! ! !
Poursuivant sa marche victorieuse, Pichegru rencontre le 14 septembre, à Boxtel, le duc d’York, chef des coalisés, qu’il met en pleine déroule; il lui enlève huit pièces de canon et fait deux mille prisonniers. Le 16 et le 17, Bernadette, à l’armée de Sambre-et-Meuse, bat le général autrichien Tkray, le contraint à fuir jusque sous les murs de Maëstricht, où il le poursuit, et investit la place. Non moins heureux, Du-gommier, Pérignon et Augereau soutiennent dans le Roussillon l’honneur du nom français : le 18, les Espagnols nous abandonnent le fort de Belle-garde, la seule place qui leur restât, et quittent notre territoire. Le 22, Jourdan occupe Aix-la-Chapelle, où il trouve un parc d’artillerie considérable appartenant à la coalition.
Tandis qu’à l’extérieur les armées remportent d’é-clatantes victoires, a l’intérieur on travaille avec activité à leur fournir les approvisionnements de vivres et les munitions de guerre dont elles manquent. La science ajoute encore aux merveilles qu’enfante le patriotisme. Dans le court espace de neuf mois,Chaptal, Berthollet, Monge, Haüy, tirent de la terre douze millions de livres de salpêtre, tandis que jusqu’alors, à peine dans toute une année, en avait-on retiré la douzième partie. Quinze fonderies en activité fournissent annuellement sept mille bouches à feu, de tous calibres, et trente fonderies de fer liv rent treize mille canons.

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
151
Vingt manufactures d’armes blanches soin établies : une seule, à Paris, produit dans une année 140,000 fusils, nombre prodigieux et beaucoup plus considérable que celui donné avant la révolution par toutes les fabriques reunies ; cent quatre-vingts ateliers de réparations sont fondés; les carabines, jusqu’alors tirées de l’étranger , sont désormais fabriquées dans les manufactures nationales; l’art de renouveler la lumière des canons est porté au plus haut degré; le télégraphe et les aérostats deviennent pour le Gouvernement et pour les armées d’importants auxiliaires ; à l’aide de savantes théories, l’art militaire est simplifié et perfectionné jusque dans ses moindres détails ; dans un établissement fondé secrètement à Meudon, des expériences sont faites tour àtoursurla poudre de muríate, sur l’oxygène de potasse, sur les boulets incendiaires, les boulets creux et les boulets à bague ; en cherchant à remplacer les matières premières ou peu abondantes, à multiplier le salin et la potasse, on crée un approvisionnement considérable de munitions de tout genre ; enfin, le cuir, qui exigeait auparavant plusieurs années de travail, est désormais taimé au bout de quelques jours. Pourquoi faut-il qu'àcôlé de cette importante découverte, nous en placions une autre qui lui doit naissance, et que nous oserions à peine rapporter, si notre qualité diiis-torien ne nous en faisait un devoir. Qui le croirait? la peau des cadavres, celle des suppliciés, passèrent au tan à Meudon, et Philippe-Égalité fut le premier qui se para sans pudeur d’une culotte de peau humaine ! !
De nouvelles victoires ajoutaient encore aux triomphes des armées françaises. Le 2 octobre, Jourdan, ayant sous scs ordres Bernadette, Kléber, Schérer,
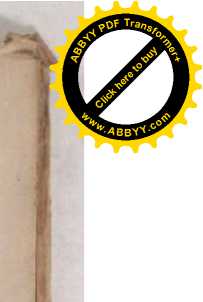

152 HISTOIRE [1794.]
rtflB^Bftí
Lefèvre et Ilatry, gagne sur les Autrichiens, commandés par le prince de Cobourg, la bataille d’Alan-hoven. La ville de J uliers est soudain investie; Berna-dotte, à la tête de neuf mille hommes, contraint vingt-cinq mille Autrichiens à lui livrer le passage de la Roër, et s'empare ensuite de la place, où soixante-dix pièces de canon et tous les équipages de l’armée ennemie tombent au pouvoir du vainqueur. C’est ainsi que Bernadotte préludait avec gloire à cette haute fortune militaire, à cette réputation si méritée qui le conduisirent quelques années plus tard sur le trône de Suède. Le 7 octobre, Moreau, commandant par intérim l’armée du Nord, s’empare de Bois-le-Duc, où s’étaient réfugiés quatre cents émigrés condamnés à mort par la Convention. Moreau, qui devait lui-même tourner ses armes contre sa patrie, fit amener sur le glacis ses malheureux compatriotes et les fit fusiller devant lui, jusqu’au dernier!!! Après avoir vu cet acte de froide barbarie, est-il permis de croire aux vertus de Moreau?.... Enfin, Cologne ouvre ses portes à Jourdan , et l’Électeur, perdant sans retour ses états, prend la fuite et abandonne au vainqueur un arsenal très-riche et de fortes provisions de munitions de tout genre.
Fidèle au système réparateur qu’elle avait adopté, la Convention rend successivement plusieurs décrets qui sont accueillis avec joie. Lyon reprend le nom qu’il avait toujours porté, et quitte la dénomination ridicule de Commune affranchie, que les démolisseurs et les hommes de sang lui avaient imposée; le Conservatoire des arts et métiers est établi, et l’école normale , instituée le 30 octobre, reçoit pour professeurs Lagrange, Charles Bonnet, Gasat, Bernardin de St-
F /


[1794.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 153
Pierre, Daubenton, Thouin et Sale. Sur la proposition de Grégoire, sont interdites les affiliations, ag-grégations, fédérations ou correspondances en nom collectif entre sociétés, quelles qu’elles soient, fie décret, motivé par la nécessité de pourvoir à la sûreté de la République, tendait indirectement à la destruction des clubs ; mais ce n’était réparer et prévenir le mal qu’à demi. Le berceau du Jacobinisme était encore debout : les tyrans qu’avait renversés le 9 thermidor s’y assemblaient régulièrement; et ne pouvait-on pas craindre qu’ils n’en sortissent un jour pleins de force et de vigueur? Le public s’indignait, les honnêtes gens se demandaient pourquoi l’asile infâme des plus vils scélérats était encore ouvert, quand soudain une foule considérable se porte vers le club et en fait le siège. Les assaillis, dans une sortie, sont complètement battus. Ils pouvaient vaincre ! ! ! On comprit le danger, et le 17 novembre, sur la proposition de Rewbell, les séances des Jacobins furent suspendues. Bientôt après, imitant Legendre au 10 thermidor, Fréron, suivi de la Jeunesse dorée, entre au club, en chasse les membres, brise tous les meubles et emporte les clefs, aux applaudissements d’un peuple oublieux qui ne voit plus en cet homme le bourreau du Midi. Quelques jours plus tard, le 16 décembre, le digne émule de Fréron , Carrier, l’inventeur des plus horribles tortures, des fusillades générales, des noyades et de ce qu’il appelait les mariages républicains, Carrier alla recevoir sur l’échafaud le juste mais trop tardif châtiment dû à ses forfaits.

De nouveaux décrets réparateurs viennent témoigner de la fidélité des gouvernants au système d’amélioration qu’ils se sont prescrit. La loi du Maximum est 7.


I5Ï HISTOIRE [179 5.)
abrogée, et le tribunal révolutionnaire, organisé comme les tribunaux ordinaires, offre aux accusés pour garantie l’observation de toutes les formes tutélaires de la justice. N’oublions pas de dire quece tribunal ne fut pas plutôt reconstitué, qu’il eut à juger l’adjudant* général Lefèvre et le capitaine de marine Massé, accusés, le premier d’avoir ordonné, le second d’avoir exécuté, à Paimbeuf, la noyade de quarante-et-une personnes à la fois. Ces quarante-et-une personnes se composaient de deux hommes, l’un infirme, l’autre aveugle depuis sa sixième année, et alors âgé de 72 ans; de douze femmes , de douze jeunes filles, de dix enfants de 5 à 10 ans, enfin de cinq enfants à la mamelle. L’ordre de cette exécution exécrable était ainsi conçu :
« Bourgneuf, 5 ventôse an II ( 23 février 1795 ).
« Il est ordonné à Pieire Masse, capitaine du bâti-« ment appelé le Destin, de faire remettre à terre la « femme Niclet, et le surplus sera conduit par lui à la « hauteur de Pierre-Noire ; la il les fera jeter a la « mer, comme rebelles à la loi. Après celte opération, « il retournera à son poste.
« Signé, Lefèvre. »
Français ! tels étaient les fruits de la République ; l’arbre qui les a portés peut repousser avec vigueur.
Mais détournons de notre esprit le souvenir de ces atrocités, et suivons nos armées à la trace des routes qu’elles viennent de se frayer, et de la nouvelle gloire qu’elles se sont acquise.
Tandis que Dugommier, commandant l'armée des Pyrénées-Orientales, dispute et enlève aux Espagnols leur première conquête et les repousse de notre sol, le général Moncey, à la tête de l’armée des Basses-

[1794.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
155
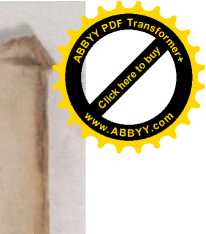
Pyrénées, envahit le territoire espagnol, gagne la bataille du Val-de-Roncevaux, et repousse douze mille Espagnols qui le laissent alors s'emparer des belles fonderies d Obaïas etd’Eguy, estimées trente millions, et brûler la manufacture royale d’Iraty. Après ces actions glorieuses, Moncey, se sentant trop faible, repassa la Bidassoa et se tint en observation.
Le 23 octobre, sur la frontière opposée, Jourdan, à la tête de l’armée de Sambre-et-Meuse, s’empare d’Andernach et de Coblentz, le petit Versailles de l’électeur de Cologne ; il met le siège devant Maastricht et s’en rend maître au bout de onze jours ( 4 novembre) ; Venloo, après quatre jours de tranchée, ouvre ses portes à Pichegru, et un immense butin ajoute à l’éclat de cette victoire : trois cents bouches à feu de tout calibre, sept mille prisonniers et des munitions considérables de toute nature sont abandonnés au vainqueur. Nimègue se rend au général Souham. Grâce aux dispositions savantes du général de génie Dejean. une armée de trente mille Anglais, destinée à défendre la place, avait pris précipitamment la fuite, la terreur de son chef, le duc d’York, ayant passé dans l’âme des soldats. Cette lâche désertion ne laissa aux Hollandais que la faculté de capituler : 90 pièces de canon et un riche butin devinrent la proie des vainqueurs. •
Partout les armées françaises se montrent triomphantes. Dugommier ayant perdu la vie le 18 novembre à Escola, sur la Montagne Noire, dans une attaque contre les Espagnols, commandés par La-Union , est remplacé par le général Pérignon. Celui-ci venge bientôt la mort de son prédécesseur sur le commandant de l’armée espagnole, il qui succède le gé-


156 HISTOIRE 11794.]
lierai Las Morillas. La victoire est disputée avec acharnement pendant cinq jours. Enfin nous demeurons maîtres du champ de bataille. Les généraux Victor et Augereau se couvrirent de gloire dans cette campagne. Nous n’étions que trente mille environ contre quarante-cinq mille Espagnols. L’ennemi perdit dix-huit mille hommes , dont huit mille furent faits prisonniers, et trente pièces d’artillerie.
Le résultat de cette brillante journée fut la reddition de la place forte de Figuières. Le 27,1e commandant espagnol Torres, effrayé de six jours de tranchée, demanda une capitulation qui, outre la place, nous valut deux cents canons, deux cents milliers de pou dre, dix mille prisonniers et un approvisionnement considérable de munitions de tout genre.
Tels furent les événements glorieux qui terminèrent cette campagne. De plus éclatants devaient les suivre. et bientôt allait apparaître un grand capitaine qui, après avoir fait quatre campagnes en quelques mois, et marché de triomphe en triomphe, fatiguerait les bouches de la Renommée.
L’état des finances était loin d’égaler l’étal prospère des armées. Un rapport de Cambon, qui ne disait même pas la vérité, dans la crainte de faire naître le découragement, nous apprit que la masse des assignats en circulation était de six milliards quatre cents millions. Cependant on possédait pour douze milliards de propriétés nationales; en les vendant avec habileté on pouvait se procurer des fonds suffisants. On ne le fit pas, et le déficit s’accrut avec une rapidité effrayante.
Sur la proposition de Cambon, on cessa la fonte de l’argenterie des églises. On en avait attendu des milliards ; le tout ne dépassa pas trente millions de livres.

Les réquisitions furent régularisées, restreintes et étendues aux seuls cas d’urgence. On leva le séquestre mis sur les propriétés françaises des Belges et des Hambourgeois. On rapporta le décret qui mettait hors la loi ceux des contumaces condamnés à la peine capitale; ils rentrèrent dans le droit commun. Cet acte d’une sage politique rappela de l’exil une foule d’infortunés frappés par une loi révolutionnaire. On rendit aux suspects, quoique détenus, l'administration de leurs biens. Les villes de Bordeaux, de Caen, de Sedan, les départements du Nord , de l’Ain, du Pas-de-Calais, de Ja Somme, reçurent des soulagements aux maux qui les avaient désolés. On rappela delà Vendée les féroces représentants Hentz et Francastel, et le général Thu-riot, accusé d’y maintenir la terreur. On remplaça les proconsuls par Ruelle et Richard, et Thuriot, par les généraux Hoche et Vimeux : c’était annoncer que désormais la Convention aspirait à rapprocher, et non à diviser. Soixante-treize députés, prisonniers, exilés, déportés ou fugitifs, condamnés pour avoir signé la fameuse protestation contre les conséquences du 31 mai, furent rappelés ; ils demandaient des juges : Chénier obtint la réintégration de ceux de ses collègues punis comme Girondins. Ce fut à cette époque que l’on vit reparaître à la tribune un homme qui l’avait désertée depuis l’Assemblée Constituante, l’abbé Sieyès: frappé de terreur, il s’était tu devant Robespierre, qui ne l’en méprisa et ne l’en haït pas moins.
La rentrée des députés Girondins échappés à la proscription divisa les membres de la nouvelle majorité. Tous ceux de l’ancienne majorité qui, plus ou moins, avaient pris part aux excès révolutionnaires, comprenant qu’ils étaient menacés par cet acte de justice,
[1794.]
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
158 HISTOIRE [1794.}
passèrent dans les rangs des Jacobins. Ils avaient pour chefs Lesage,Ténault, Thuriot, Lecointre de Versailles, homme léger et sans caractère. La majorité nouvelle ne s’effraya pas de ce changement et renvoya à l’examen du comité de Sûreté la conduite de Bouchotte, Garat et Pache, tous trois accusés, non sans raison, d’avoir . coopéré activement à tous les actes inconstitutionnels
de Robespierre.
On aurait dû les punir, on leur pardonna ; ce lut un tort. Les hommes de ce parti ne se convertissent jamais. Napoléon les connaissait bien. Lors de son second mariage, il disait à Cambacérès :
« Les royalistes finiront par revenir à moi de bonne foi, car ils aiment avant tout la monarchie ; les Jacobins, au contraire, en me cajolant davantage, me haïront un peu plus, car ce qu’ils préfèrent par-dessus tout, c’est l’anarchie avec son cortège, la famine, la guerre civile et l’échafaud. »
œliq fł M pib ..* . -
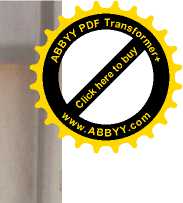

CHAPITRE VIII.
Paris est menacé de la Tamin-». — Fausse mesure de Roissy d’Anglas. — Elle protomie une insurrection. — Décret sévère. — Insurrection du 1er germinal an Hl. —Séance orageuse. — Insurrection du 12 germinal. — Laconisme de Pichegru et de Thibaudeau. — Insurrection du 1er prairial. — Détail» des événements de cette journée. — Assassinat de Ferraud.—Sublime énergie de Boissy d’Anglas.—Fin de l’insurrection.— Suicide des députés condamnés à mort. —Événements militaires et diplomatiques qui précèdent la dissolution de la Convention nationale. — Constitution de l'an 111.
Jamais année ne commença sous d’aussi tristes auspices que l’année 1795. Le commerce, depuis longtemps ruiné, et l’agriculture, privée de ses bras, n’avaient pu se relever assez promptement pour satisfaire à tous les besoins. Aux rigueurs de la saison se joignaient les privations nécessitées par une disette véritable ou préparée. L’inquiétude était générale, et les pressentiments fâcheux que faisait naître un état aussi déplorable ne semblaient pas éloignés de se réaliser. En effet, la récolte prochaine se présentait on ne peut plus défavorablement. Les habitants aisés, dans la prévision d’une famine éventuelle, faisaient des approvisionnements considérables et peu en rapport avec leurs besoins. Le peuple, trop pauvre pour imiter les familles opulentes, était irrité de ces accaparements. Des menaces avaient succédé aux murmures, et, habiles à saisir toutes les occasions de fomenter l’insurrection, les terroristes s’étaient hâtés de souiller le feu de la discorde.
Boissy d’Anglas, député aussi recommandable par ses vertus et son mérite que par celte force de carac-

160 HISTOIRE [1795]
1ère si précieuse dans les moments difficiles, crut apporter un remède au malaise général et prévenir une crise orageuse, en demandant à la Convention qu’il ne fût permis à chaque citoyen de ne consommer qu’une livre de pain. Cette mesure, bonne tout au plus pour un collège ou une communauté religieuse,était inexécutable il Paris. Cependant elle fut adoptée, toutefois avec un amendement du jacobin Homme, qui, pour se concilier les bonnes grâces de la multitude, obtint que les ouvriers auraient droit à une demi-livre en sus de la quantité fixée par la loi. Cet amendement constituait un privilège ; mais il fut motivé et il était justifié par l’état précaire de cette classe intéressante de la société, état si misérable'que l’ouvrier ne pouvait jamais, dans ses repas, ajouter à son pain de la viande ou toute autre nourriture substantielle. Romme fut applaudi par les agitateurs; mais l’auteur du décret se vit bafouer et ridiculiser par le surnom de Bnûsy-Famine.
Cependant ce décret ne calma pas l’irritation des esprits. Les Jacobins, qui, alors qu’ils étaient au pouvoir, avaient rejeté la constitution de 1793 , la demandèrent à grands cris, et, pour mettre la Convention dans une fausse position, firent réclamer cette constitution par la populace. Mais l’assemblée ne répondit que par un projet de nouvelle loi martiale dont certains passages prouvaient assez l’intention de la Convention de se défendre et de se prémunir contre de nouvelles attaques. En voici quelques passages : « L’insulte faite « à un représentant entraîne la déportation ; l’outrage « avec violence, la mort;.... si la Convention venait à « être dissoute, ou gênée dans sa liberté, ses membres « devront quitter Paris, se rendre à Châlons-sur-
« Marne, où tous ses suppléants se réuniront à elle;... « les généraux, en envoyant quelques troupes vers a l’assemblée, feront marcher toutes leurs forces contre « Paris. »
Sieyès , qui avait recouvré la parole depuis qu’il ne craignait plus pour sa vie, fut nommé rapporteur de ce projet de loi, dont tout le monde comprenait l’opportunité. Mais les séditieux, afin d’en prévenir les effets, préparèrent un soulèvement. Dutrein, Maribon-Montaut, Léonard Bourdon, Romme, Duquesnoy et Soubrany travaillèrent à irriter les esprits. Ils avaient avec eux Amar, Labadie et quelques autres chefs des nouveaux Jacobins, et, pour marcher sur les traces de leurs aînés, ils engagèrent les sectionnaires à pétitionner.
Le 1er germinal (21 mars), jour choisi par Sieyès pour la lecture de son rapport, les sectionnaires de Montreuil et des Quinze-Vingts parurent à la barre de l’assemblée, accompagnés de sans-culottes armés et criant: Vive la constitution de 93 l À bas les aristo-eratw/Thibaudeau présidait. Sa réponse fut énergique, mais il ne ditrien qui rappelât l’homme d’autrefois. Prenant la parole après lui, Tallien se moque de ceux qui réclament l’exposition, dans un lieu apparent, de la Déclaration des droits de l’homme. Ensuite Sieyès monte à la tribune, fait son rapport, et la pétition est rejetée. Alors une lutte terrible s’engage aux portes de la salle de l’assemblée, entre les Jacobins furieux et les jeunes gens de Fréron accourus du Palais-Royal, aux cris de : Vivent les représentants ! A bas les Jacobins l Ceux-ci, d’abord repoussés, reprennent l’avantage , et chassent à coups de bâton les perturbateurs, dont quelques-uns viennent se réfugier jusque dans

102
HISTOIRE

la salle même des séances. Le tumulte est à son comble: le président se couvre. On demande à grands cris la loi martiale, on vote celle dont je viens de citer plusieurs articles, et les sans-culottes, mis en fuite, vont dans les faubourgs semer l’alarme et communiquer leur exaspération.
A la séance suivante, Barrère, Billaud-Varennes, Gollot-d’Herbois et Vadier, complices avoués de Robespierre , demandèrent à se justifier. Les efforts inouïs» les tentatives désespérées et les intrigues des terroristes, jaloux de sauver ces députés si chaudement accusés, causèrent une nouvelle anarchie qui dura plusieurs jours. Tout fut misen œuvre; récriminations, attaques, dénonciations au sein de l’assemblée, mouvements séditieux, tentatives de révolte, provocations au meurtre dans Paris; rien ue fut oublié. A chaque instant de nouvelles craintes se répandaient dans la capitale; mais les comités attentifs, restés en permanence, veillaient à la sûreté générale en préparant d’énergiques et prudentes mesures.
On vécut ainsi jusqu’au 12 germinal, jour que l’insurrection avait choisi pour promener son étendard plus hardiment que jamais. Dès le matin, la générale est battue dans la cité; le tocsin fait entendre ses sons lugubres, et la Conventicn voit marcher contre elle toute la populace des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, des quartiers du Temple et de la Cité, conduite par des hommes portant, pour la plupart, cette inscription sur leur chapeau : Du pain et la constitution de 931
La Convention était en séance. Déjà une attaque violente avait eu lieu contre la majorité, et le calme était a peine rétabli , que des hurlements venant de

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
163

1
l’extérieur couvrent la voix de Boissy d’Anglas, qui lisait alors un rapport sur les céréales. Boissy s’arrête; mais le bruit augmente, et la nature de ce bruit fait comprendre qu’une lutte est engagée dans la salle voisine, celle des Pas-Perdus. Enfin lagarde ordinaire de l’assemblée, forcée de céder au nombre, livre le passage, les portes s’ouvrant avec fracas, et l’enceinte de la Convention est envahie par une horde impure de femmes ivres, d’enfants couverts de haillons, agitant leurs bonnets et vociférant: Du pain! du pain! Les députés de l’extrême gauche et les tribunes applaudissent, mais l’immense majorité de l’assemblée ne répond que par le cri de : Vive la République! Merlin de Thionville, par un de ces mouvements de versatilité si communs à cette époque, passe tout à coup dans les rangs de la multitude et lui donne l’accolade fraternelle. Sur l’injonction qui lui est faite de retourner à sa place, Merlin répond que « sa place est au milieu a du peuple, et que les citoyens lui assurent qu’ils < n’ont aucune mauvaise intention. » Il poursuit, et chaque phrase de son discours légitime la révolte et respire l’anarchie. Les députés jacobins, Gaston, Du-roy, Decamp, Huguet, Homme et Sou brany, occupent tour à tour la tribune, et parlent dans le même sens. Enfin, de nouvelles hordes viennent se joindre aux révoltés en pénétrant aussi dans la salle. Huguet saisit ce moment de désordre pour demander la mise en liberté des députés patriolesetla constitution de 1793.
Mais la Convention, à qui l’on fait violence, n’oppose pour toute réponse que le plus impassible silence. Alors un homme, enfant chéri de l’émeute, celui qui, au 31 mai, commandait la section de la Cité, s’élance rapidement à la tribune et s’écrie :

« Représentants, vous voyez devant vous les hommes « du 14 juillet, du 10 août, du 31 mai! » (Les membres de l’extrême gauche applaudissent à outrance. ) « Ils ont juré de vivre libres ou de mourir ; ils ob-« tiendront la constitution de 93 et les droils de « l’homme ; il est temps que la classe indigente ne « soit plus la dupe de l’égoïsme des riches et de la cu-« pidité des marchands. Mettez un terme à vos divi-« sions; elles déchirent la patrie, et la patrie ne doit « pas souffrir de vos haines. Faites justice de l’armée « de Fréron, de ces messieurs à bâtons. Les hommes « qui, au 14 juillet, ont renversé la Bastille, ne pen-« saient pas que, dans la suite, on en élèverait mille « autres pour incarcérer les patriotes. N’espérez « pas ramener le calme et l’abondance, sans punir les « égoïstes. Et toi, Montagne sainte, qui as tant com-« battu pour la République, les hommes du 20 juin, « du 10 août, du 31 mai, te réclament dans ce mo-« ment de crise ; tu les trouveras toujours prêts à te « soutenir, prêts à mourir pour la République. Les « citoyens au nom desquels je parle veulent la con-« slitution de 93.....La section de la Cité n’est pas « accoutumée à vous faire perdre un temps précieux, « à se servir du langage adulateur des courtisans de « Versailles; aussi vous ai-je parlé énergiquement en « son nom.....» Le peuple applaudit avec fureur ce langage audacieux. Quelques députés, à son exemple, battent des mains, et Chondréa, montrant le fauteuil de la présidence, occupé par Pelet de la Lozère, ne craint pas de dire : Le royalisme est là.
Cependant les chefs de l’insurrection s’aperçurent bientôt que leur tentative n’aurait pas les résultats qu’ils en avaient espérés. Les bons citoyens, accourus
HISTOIRE
[1795.1
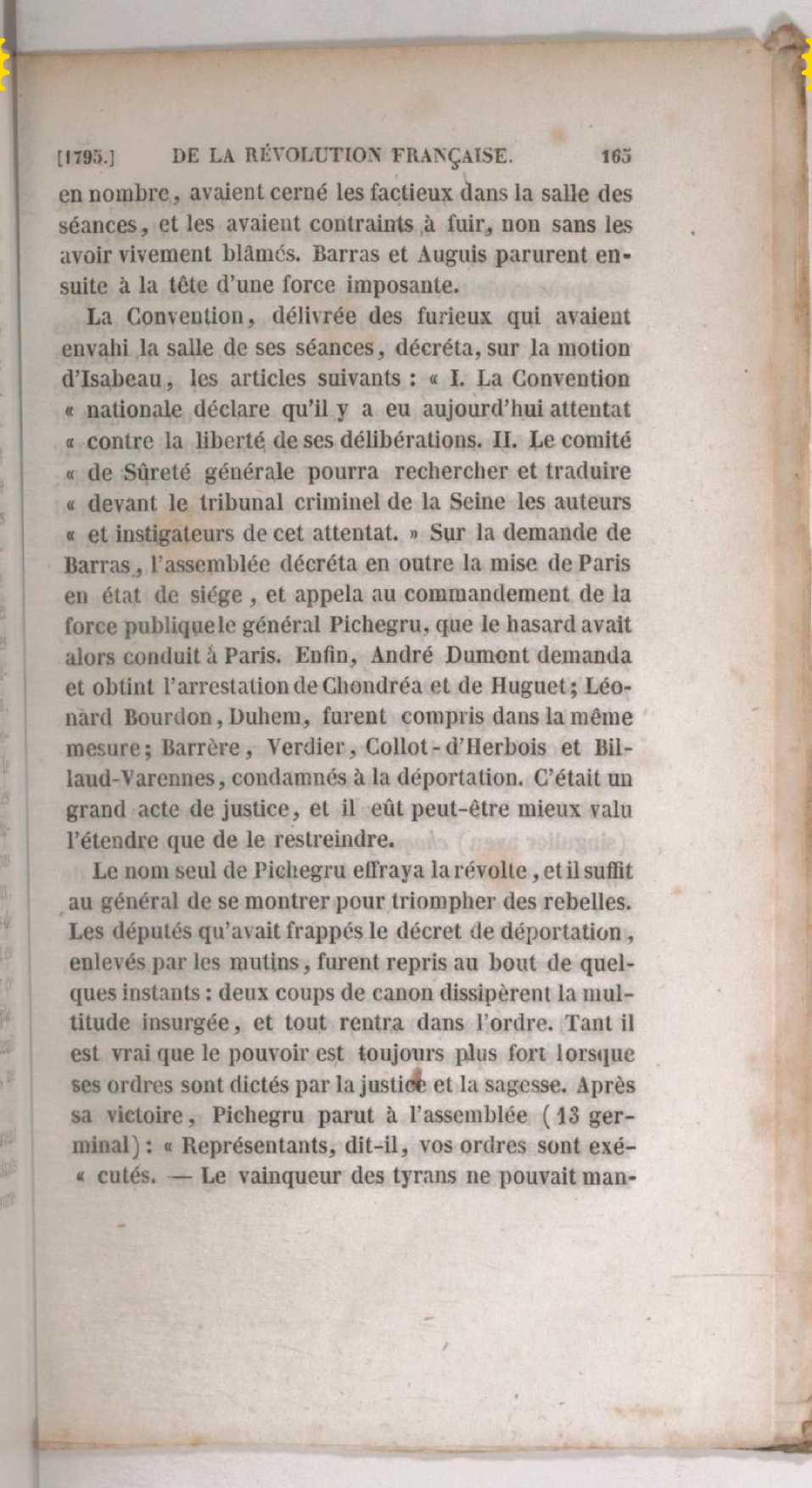
[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 165 en nombre, avaient cerné les factieux dans la salle des séances, et les avaient contraints à fuir, non sans les avoir vivement blâmés. Barras et Auguis parurent ensuite à la tête d’une force imposante.
La Convention, délivrée des furieux qui avaient envahi la salle de ses séances, décréta, sur la motion d’isabeau, les articles suivants : « L La Convention « nationale déclare qu’il y a eu aujourd’hui attentat a contre la liberté de ses délibérations. II. Le comité « de Sûreté générale pourra rechercher et traduire « devant le tribunal criminel de la Seine les auteurs « et instigateurs de cet attentat. » Sur la demande de Barras., rassemblée décréta en outre la mise de Paris en état de siège , et appela au commandement de la force publiquele général Pichegru. que le hasard avait alors conduit à Paris. Enfin, André Dumont demanda et obtint l’arrestation de Chondréa et de Huguet; Léonard Bourdon, Duhem, furent compris dans la même mesure; Barrère, Verdier, Collot-d’IIerbois et Bil-laud-Varennes, condamnés à la déportation. C’était un grand acte de justice, et il eût peut-être mieux valu l’étendre que de le restreindre.
Le nom seul de Pichegru effraya la révolte, et il suffit au général de se montrer pour triompher des rebelles. Les députés qu’avait frappés le décret de déportation , enlevés par les mutins, furent repris au bout de quelques instants : deux coups de canon dissipèrent la multitude insurgée, et tout rentra dans l’ordre. Tant il est vrai que le pouvoir est toujours plus fort lorsque ses ordres sont dictés par la justice et la sagesse. Après sa victoire, Pichegru parut à l’assemblée (13 germinal): « Représentants, dit-il, vos ordres sont exé-« eûtes. — Le vainqueur des tyrans ne pouvait man-


166 HISTOIRE [1795.]
« quer de triompher des factieux, » répondit, avec une concision non moins énergique. Thibaudeau, président du jour.
Après avoir décrété l’augmentation de la force publique, l’assemblée ordonna l’arrestation des députés Cambon, Thuriot, Crallou, Lesage, Senault, Lecointre de Versailles, Maignet, liante, Levasseur de la Sarthe et Granet de Marseille. La nécessité d’un prompt et sévère châtiment était enfin comprise : aussi, le même jour , vit-on monter sur l’échafaud Fouquier-Thinvllle; Sallier, président du tribunal révolutionnaire ; Foucaud et Delauuay-Garnier, juges; Leroi, qui avait changé son nom contre celui de Dix-Aolt; Renaudin, Vil-latle, Prieur, Chautecet, Girard, Doyenval, jurés; Benoît, agent du pouvoir exécutif; Lainé , Vernay, porte-clefs au Luxembourg ; Dupaumier; Hermann, exprésident du tribunal révolutionnaire.
Ce juste supplice porta l’épouvante dans les rangs des .Jacobins , qui reprirent les armes. Dans la proclamation qu’ils répandirent, ils demandaient du pain, l’abolition du gouvernement révolutionnaire, dont (singulier aveu) chagüe faction abusait tour à tour pour affamer, ruiner et asservir le peuple, la constitution de 93, le renversement du pouvoir existant, l’arrestation de tous les comités, la convocation des assemblées primaires, et une assemblée nationale législative qui remplaçât la Convention.
Le l'r prairial (20 mai) était le jour désigné par l’insurrection pour l’essai de ses forces. Dès le point du jour, Paris offrait le douloureux spectacle d'une ville en proie à toutes les horreurs de la guerre civile. La générale et le rappel battaient sur tous les points; les cloches faisaient entendre le son lugubre du toc-

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 167 sin, et le bruit des armes à feu, le sou du cauou, se succédant à courts intervalles, portaient au loin la terreur et la crainte, tandis qu’une cloche d’alarme, placée aux Tuileries, appelait par ses tintements aigus tous les sectionnâmes à la défense de la représentation nationale. Les places des Vosges (place Royale), de la Bastille, de Grève, Mauberl, du Panthéon et celle de Notre-Dame, où était situé leur quartier-général, appartenaient aux insurgés. Enfin , la Cité tout entière s’ébranla; Aussitôt les Champs-Elysées, les rues, les places et les quais furent couverts de factieux, et la Convention, cernée de toutes parts, put à peine compter sur le dévouement de la garde nationale, qui hésitait encore!
La séance de l’Assemblée fut ouverte à onze heures, sous la présidence de Vernier; mais , au bout de quelques instants, celui-ci, plein de frayeur, abandonna honteusement son poste, et fut remplacé par André Dumont, qui lui-même ne tarda pas à imiter Vernier dans son lâche abandon et dans sa fuite. Le périlleux honneur de la présidence revint à Boissy d’An-glas.
Il semblait que le courage du président eût ranimé celui de tous les membres de l’Assemblée. Quelques factieux, placés dans les tribunes, manifestent des intentions hostiles, et aussitôt les députés, se levant en masse, s’écrient avec énergie : « Nous saurons mourir à notre poste ! » Plusieurs décrets foudroyants sont lancés contre l’insurrection ; un appel est fait à tous les bons citoyens pour les engager à concourir à la défense de leurs représentants; la Commune de Paris et les citoyens qui refuseraient de se rendre à l’appel fait par l’Assemblée sont déclarés responsables de tous

«68 HISTOIRE [1795.]
les événements qui menacent la Convention ou compromettraient sa dignité ; tout individu marchant à la tête de vingt personnes est déclaré chef d’attroupement, tout chef d’attroupement est mis hors la loi, et il est enjoint aux bons citoyens de saisir ces fauteurs de révolte; enfin l’Assemblée se déclare en permanence, et arrête que plusieurs de ses membres iront, dans les diverses sections, éclairer le peuple sur ses véritables intérêts, et le rallier à ses représentants.
Mais l’insurrection a gagné du terrain. Déjà elle est maîtresse des tribunes, quelques femmes ont pénétré dans la salle des séances, et ces femmes insultent les représentants et leur président. C’est en vain que les portes sont aussitôt fermées, elles céderont bientôt à la violence des efforts.... Enfin, tandis qu’à coups de fouet un général fait évacuer les tribunes, la porte de la salle de la Liberté tombe avec fracas, et une bande de brigands, armés de sabres et de poignards, fond avec impétuosité dans l’enceinte de l’Assemblée, menaçant de la voix et des gestes les représentants, qui demeurent impassibles.
La séance est suspendue. Chaque minute voit augmenter les dangers qui menacent la Convention. Sa garde et un bataillon viennent en vain à son secours. Féraud, à qui le destin réserve une mort terrible, est frappé par les rebelles. Doué d’un courage héroïque , l'infortuné combat pour le maintien des lois, en employant le langage de la persuasion et tous les moyens qui sont en son pouvoir. Le jeune Mailly, victime du zèle qui le porte à défendre le président Boissy d’Anglas, tombe frappé d’une balle, et meurt sur les degrés mêmes de la tribune. La vue du sang, loin d’assouvir la rage de ces cruels assassins, les anime d’une fureur

——*

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
169

nouvelle. Féraud, que ses amis n’ont pu encore emporter hors de la salle, est impitoyablement massacré ; un des brigands lui coupe la tète et la présente à Boissy d*Anglas. Celui-ci la contemple et la salue en s’inclinant!!! Que cet hommage muet, rendu dans un pareil moment, est éloquent et sublime !
Boissy d’Anglas ne dut la vie qu’à son intrépidité et à son courage. En présence de tant de vertus, les poignards s’arrêtèrent, car il y a loin, a dit Mathieu Molé, du poignard d'un méchant au cœur d'un honnête homme.
Cependant l’insurrection est triomphante. Les députés, ses complices, ramènent par leurs décrets le règne odieux de la terreur; la constitution de 93 est proclamée. C’en est fait de la France ; les amis de Robespierre, toujours animés de l’esprit de leur chef, sont victorieux! !.... Mais les Jacobins ont mal pris leurs mesures. Les comités de gouvernement existent et agissent; la garde nationale, d’abord timide ou indécise , a honte de sa conduite ; les sections Lepelletier, des Moulins et des Filles Saint-Thomas accourent les premières, et sont bientôt suivies de la Jeunesse dorée de Fréron. Minuit sonne ; Boissy d’Anglas reparaît. Vernier lui cède avec joie le fauteuil de la présidence. Les meneurs s’étonnent de ce retour..... Duroy, Du-quesnoy, Bourbotte vont prendre les rênes du pouvoir; Soubrany est avec eux. Mais à peine ont-ils fait deux pas hors de la salle, qu’un détachement de la force armée les arrête et pénètre dans l’enceinte profanée par la sédition.
« A moi, sans-culottes ! » s’écrie Prieur ; mais c’est en vain qu’il provoque au meurtre. La baïonnette en avant, les bons citoyens chassent et les insurgés elles
IL
8


170
HISTOIRE
[1795.]
députés rebelles, qui promptement cherchent leur salut dans la fuite ; la salle est dégagée, la Convention est libre, et autour d’elle on crie avec force : A bas les Jacobins, les égorgeurs et les factieux! rivent la répu-bligueet les représentants ! Le pouvoir légitime poursuit au dehors le cours de son triomphe. Des patrouilles dissipent les attroupements, s’emparent des chefs de l’émeute, et, au jour naissant, le calme est presque entièrement rétabli.
La Convention, se montrant alors sévère, décréta, séance tenante, la mise en accusation des députés Romme, Duquesnoy, Goujon, Bourbotte, Sou br in y . Reyssart, Duroy, Prieur de la Marne, Binet l’aîné, Doriès, Payant, Rhiel, Forestier, Lavallée, Polrigel, Sergent, Baudouin, Lacoste, Allard, Le Jame, Sa-vogner , Dartigoyte, Mallarmé, Monestier, Maure, Lescudier, Laignelot.
Mais le 2 prairial, les rebelles, reprenant courage, s’armèrent de nouveau, s’emparèrent de la majeure partie de la ville et étendirent leurs avant-postes jusque sur les places du Carrousel et de la Révolution. Les canons étaient braqués, et la guerre civile paraissait imminente. La Convention donne alors tout pouvoir au général Menou. Celui-ci marche contre le faubourg Saint-Antoine, le cerne sur tous les points et somme les insurgés de se rendre si mieux ils u’aiment se voir bombarder et incendier par des boulets rouges. La rébellion tremblante cède ; et, en moins d’une heure, les chefs de l’insurrection et l’assassin de Féraud, que la populace avait délivré des mains du bourreau, sont remis au vainqueur. Les armes et les munitions sont livrées, et tout rentre dans Tordre.
La plupart des députés arrêtés subirent, le 17 juin,

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 171 la peine que réclamaient la justice et la sévérité des lois. Des charges suffisantes firent condamner à la peine capitale Romme, Duquesnoy, Goujon, Duroy, Bour-botte et SGubrany; Forestier fut acquitté; Reyssart, déporté. Leurs complices avaient pris la fuite. Décidés à ne pas monter sur l’échafaud , les députés condamnés devaient se donner la mort, à l’aide d'un couteau et d’une paire de ciseaux qu’ils avaient conservés. En descendant du tribunal, Romme se frappa le premier ; Goujon et Duquesnoy se donnèrent aussi la mort ; Duroy, Bourbotte et Soubrany , quoique grièvement blessés, purent être conduits au supplice.
Le trépas de ses chefs anéantit à jamais le parti de la Montagne. Dans toutes les villes de France où cette faction odieuse essaya de relever la tète, on l’écrasa en rétablissant la garde nationale sur ses premières bases, en désarmant les prolétaires, en comprimant l’esprit d’anarchie et de sédition, et en permettant le libre exercice des cultes.
Cette année, la république data d’une ère nouvelle; éclairés par l’expérience, convaincus de l’impossibilité de gouverner la France comme une seule ville, les représentants, sans l’avouer, revinrent à la monarchie tempérée. Un nouvel acte constitutionnel fut préparé, et cet acte ne proclamait rien autre chose qu’une royauté déguisée, dont le chef se cachait sous le manteau àecinq Directeurs; la chambre haute des monarchies était remplacée par le Conseil des Anciens, et la chambre des Communes par le Conseil des Cinq-Cents. Toutes les autres dispositions de celte nouvelle constitution , dite de l’an III, se rapportaient au maintien et à la conservation de la forme donnée au gouvernement ; quant au peuple, on ne lui laissait que ce qui ne
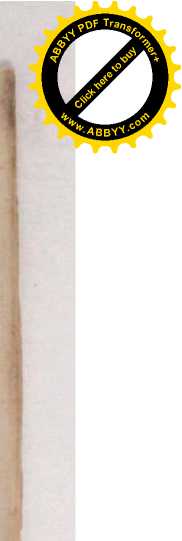

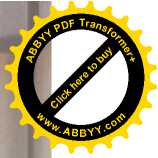
HISTOIRE
[1795. j
pouvait lui être retiré. Le 13 fructidor (30 août), la Convention promulgua cette nouvelle constitution, et arrêta que les deux tiers des membres envoyés au corps législatif par les assemblées électorales seraient choisis seulement dans le sein de la Convention; les assemblées electorales, toutefois , restaient libres de fixer ce choix sur les députés de leur département, ou sur tout autre représentant.
Mais avant de raconter les faits dont le développement termina l’existence de la Convention nationale, je dois remettre sous les yeux des lecteurs l’ensemble des événements qui eurent lieu depuis le commencement de l’année jusqu’à la mise en activité de cette troisième constitution.
Dès le mois de janvier, la conquête de la Hollande, commencée par Pichegru, est rapidement achevée. La Hotte hollandaise, retenue dans le Texel par la glace, est attaquée et vaincue par les hussards français. Le 4 février, prise du port de Roses par Pérignon. Le 9, un traité de paix lie la Toscane à la France : c’était la première puissance qui reconnût la République. Paris est divisé en douze arrondissements municipaux, et cette division , en rompa! l’unité de la Commune, anéantit sa puissance.
Au commencement de mars, huit armées sont mises en campagne : l’armée duïYbrd, commandée par Moreau; de Sambre-et-Meuse, par Jourdan; de Bhin-et-Mosellc, par Pichegru; des Alpes et d’Italie, par Kel-lennann; des Pyrénées-Orientales, par Moncey ; ¿tes Côtes-du-Nord, par Caudaux ; des côtes de Brest et de Cherbourg, par Hoche. Le 21 mars, création de l’École Polytechnique; les premiers professeurs qu’on lui donne sont Lagrange, Prony, Monge, Hassenfratz,

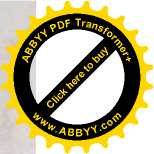
[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
Fourcroy, Guitón de Morveaux, Bertholet, Vauque-lin et Chaptal, tous hommes du plus grand mérite et regardés comme l’élite des savants de l’Europe.
Le 5 avril, un traité de paix, conclu à Bâle entre Barthélemy et le baron de Hardemberg, nous unit à la Prusse. Le 7, est décrété le système décimal des poids, des mesures et des monnaies. Le 9, les terroristes sont désarmé*,. Le 18, une commission est chargée de rédiger et de proposer une nouvelle constitution. Cette commission se compose des citoyens Cambacérès, Merlin de Douay, Siéyès, Thibaudeau, La Réveillère-Lépaux, Boissy d’Anglas, Berlier, Daunou , Le Sage d'Eure-et-Loir, Creuzé - Latouche, Louvet du Loiret.
Le 16 mai. paix entre la France et la Hollande; bannissement du stathouder; le 17, décret qui ordonne la destruction du couvent des Jacobins.
Le 7 juin, Jourdan entre dans Luxembourg, après huit mois de siège. Le 8, meurt, au Temple, Louis XVII, victime des plus atroces traitements....
Le inonde apprit sa fin, la tombe sait le reste !...
Le 12, décret qui défei à toute autorité de se qualifier de révolutionnaire. Le 23, combat naval sur la côte du Morbihan, entre la flotte française, commandée par le vice-amiral Villaret-Joyeuse, et une flotte anglaise. Le 27, débarquement à Quiberon.
Le 14 juillet, emprunt d’un milliard au taux de trois pour cent. Le 16, exécutions sanglantes à Quiberon. Le 22, l’Espagne signe la paix avec la république française, qui acquiert la partie espagnole de Saint-Domingue.
Le 3 août, établissement du Conservatoire de mu-


171 HISTOIRE [1795.]
sique. Le 22, la constitution dite de l’an III est adoptée. Le lendemain, dissolution des clubs et assemblées populaires.
Le 6 septembre, Jourdan passe le Rhin et prend Dusseldorf. Le 20, Pichegru force Manheim à capituler. Le 21, décret qui exclut des fonctions publiques les parents et alliés des émigrés et les prêtres réfractaires. Le même jour, promulgation de la nouvelle constitution.
Le 1er octobre, décret de réunion à la France de nos conquêtes en deçà du Rhin, de la Belgique, du pays de Liège et du Luxembourg; ces provinces, divisées, forment neuf départements. Le 4, abrogation de la loi des suspects, œuvre de Merlin de Douay. Le 5, insurrection du 13 vendémiaire, dont je parlerai dans le chapitre suivant. Le 25, création de l’Institut en remplacement des quatre académies. Le 26, lin de la Convention.

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

Pourquoi les royalistes n’agissaient-ils pas? — Mort de Louis XVII.— Atroce propos de Mathieu. — Comité royaliste de Paris. — Noms des membres qui le composent. — La section Lepelletier, voyant le mécontentement universel, s’insurge avec la majeure partie des sections. — Leur arrêté.— 12 vendémiaire.—Conduite du général Menou. — Il est destitué.—Nomination du général Bonaparte. — Ses dispositions.— 13 vendémiaire. — Danican. — Combat. — Bonaparte victorieux. — Sa réponse à Cambacérès. — La Convention. — Jugement. — Deux seules condamnations. —Constitution de l’an III.— Son analyse. — La Réveillère-Lépaux. — Rcwbell,— Barras. — Le Tourneur. — Carnot. — Merlin de Duuay. — Charles Lacroix. — Aubert Dubayet. — Blevillc de Bellay. — Faypoult. — Benezech.
Depuis le commencement de la révolution, c’est à peine si quelquefois, dans le cours de ce torrent dévastateur , les royalistes avaient été vus luttant à main armée contre l’anarchie et le despotisme. Opprimés ou dispersés, frappés de terreur ou emprisonnés, les hommes de ce parti, vraiment national, ne pouvaient qu’implorer le secours du Ciel et former des vœux ardents pour le triomphe d’une cause que d’autres plus heureux défendaient au prix de leur sang à l’armée du prince de Condé, dans la Vendée et sous les murs de Lyon et de Toulon. Poursuivis par la rage des Jacobins et par la haine des ennemis de la royauté, ils se contentaient de souffrir en silence et de répandre des larmes de désespoir sur les journées exécrables des 5 et 6 octobre, du 20 juin, du 10 août, des 3 et 6 septembre, du 21 janvier, du 16 octobre et du 16 mai; journées qui avaient vu la majesté royale avilie, le sang de l'innocent couler à grands îlots et les têtes les plus augustes rouler sur l’échafaud.
Il était donc permis de croire à l’anéantissement ou
►

17C. HISTOIRE [1795.]
à la faiblesse du parti royaliste. Depuis la proclamation de la république , on parlait , il est vrai, très-souvent des royalistes, mais on ne les voyait que sur l’échafaud. Cependant leur faiblesse et leur anéantissement n’étaient qu’apparents. Fidèles à leur Dieu et à leur roi, ils attendaient, pleins d’espérance et de vie, le moment favorable pour prendre leur revanche avec avantage, et ramener la légitimité triomphante. L’objet unique de leurs vœux, de leurs affections, était Louis XVII. Mais ce jeune prince, qui, dans sa royauté de quelques mois, n’eut pour palais qu’une prison, pour courtisans que des geôliers, ce digne rejeton du roi martyr, dont le sort préoccupait vivement ses fidèles sujets et que de nombreuses tentatives ne purent délivrer de sa captivité, avait peu tardé à laisser sur la terre une couronne périssable pour aller partager celle de son père dans le ciel. Je ne veux pas rechercher ici les causes d’une mort aussi prématurée; mais est-il permis de douter d’un crime, quand on se rappelle ces paroles du féroce représentant Mathieu : Nous savons comment on tue íes rois., mais nous ignorons comment on les élève..,, !
Louis XVII descendait dans la fombv au moment où les royalistes, depuis longtemps en observation , voyaient enfin luire un rayon d’espérance. En effet, les horribles forfaits des Jacobins, la marche incertaine de la Convention après leur chute, l’aveu d’impuissance qui résultait implicitement de la proclamation d’une constitution nouvelle, et surtout d’une constitution monarchique, avaient achevé de faire déprécier le gouvernement républicain. Toute la partie saine de Paris, toutes les classes de la société, les hommes de loi, les littérateurs, les propriétaires, les
[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 177 marchands, les industriels et les ouvriers, commençaient à comprendre ce dont on s’est montré convaincu en 1830, savoir que la république, loin d’assurer la prospérité de la France, ne peut que plonger notre patrie dans un abîme de maux.
Il existait alors à Paris un comité royaliste, dont les chefs étaient le marquis de Clermont Gallerande. l’abbé de Montesquiou-Fezensac et AL de La Harpe, de l’Académie française. MM. Becquey, Royer-Collard. Richer, Serisy, M. de Desament, auteur de l'Accusateur public, ouvrage périodique, causant alors autant de sensation que, de nos jours, les pamphlets politiques du vicomte de Chateaubriand ; M. de Vau-blanc, l’abbé Lemaître, MM. Brottier, Morellet, Suard, Quatremère de Quincy, Dupont de Nemours, Dani-can, Marchena, Mirandre, etc.; l’excellent de Rip-pert, fondateur de la Quotidienne; M. Michaud, aujourd’hui de l’Académie française; M. Charles de Lasot, que l’on a vu siéger avec tant d’éclat dans nos assemblées délibérantes ; M. Mathieu de Montmorency, déplorant alors ses courtes erreurs ; M. de Nouilles. dont les Bourbons ont toujours apprécié la fidélité; Fiévée, l’aimable auteur et le profond publiciste; Lacretelle le jeune, qui depuis.... et une foule de braves et spirituels jeunes gens, faisaient partie de ce comité. La Jeunesse dorée de Frérou, composée tout entière de fils et de parents des victimes de la tourmente révolutionnaire, était le noyau qui devait diriger la garde nationale de Paris, lorsque ,lasse complètement de la révolution, elle voudrait en finir avec les anarchistes. n .
Lanouvelle constitution, dont un article appelait aux deux conseils du corps législatif les deux tiers de
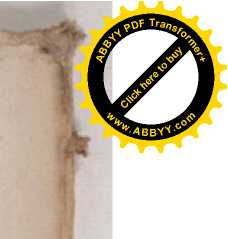

178 HISTOIRE [1795.]
la Convention nationale, indigna tous les bons citoyens. Chacun avait hâte de rejeter les hommes qui avaient répandu le sang du juste et de l’innocent, et de repousser les lâches et cruels oppresseurs de leur patrie. Aussi vit-on généralement avec indignation les conventionnels s’imposer à la France, au lieu d’imiter l’abnégation des membres de la Constituante. On s’irrita delà ténacité de ces farouches représentants, et puisqu’ils ne voulaient pas s’exécuter eux-mêmes, on résolut de s’en défaire et de les chasser de vive force.
Les royalistes, profitant avec habileté du mécontentement général et de l’irritation des esprits, créèrent plusieurs comités sous la direction immédiate du comité que Louis XVIII avait investi des pouvoirs les plus étendus. Ces comités se composaient d’hommes de l’ancien et du nouveau régime, de militaires, de littérateurs, de magistrats, cl’artistes, etc.
La section Lepelleticr piit l’initiative. Réunie aux sections du Mail, de la Butte-des-Moulins, des Champs-Elysées et du Théâtre-Français (FOdéon), elle déclara « que la Convention restreignait Je libre exer-« cice de la souveraineté du peuple, » et répandit un projet d’acte d’association, portant en substance « que tout citoyen avait le droit d’émettre librement < son opinion : 1“ sur la constitution présentée à l’ac-« ceptation du peuple français; 2° sur le décret du 5 < fructidor, concernant la réélection de cinq cents « membres de la Convention nationale; 3° sur toutes « les mesures de salut général... Que pour garantie de « ces droits, chaque citoyen en particulier, et tous les « habitants de Paris en général, étaient placés sous « la protection spéciale et immédiate de leurs assem-
[1795.] DE I A RÉVOLUTION’ FRANÇAISE. 179 « blées primaires respectives et des quarante-sept « autres assemblées primaires de la capitale. » Cet acte, présenté aux quarante-sept autres sections de Paris, fut accueilli avec empressement par celles-ci , qui en obtinrent un semblable pour chacune d’elles. Enfin, sur la proposition des sectionnaires Lepelletier, un comité central fut établi. Ce comité, qui n’était rien moins qu’une puissance nouvelle, élevée contre celle de la Convention, tarda peu à se poser en adversaire redoutable, et, le 10 vendémiaire an III (1er octobre 1795), il lança un arrêté foudroyant, véritable déclaration de guerre, auquel adhérèrent trente-deux sections sur quarante-huit.
Chaque parti courut aux armes. Les sections, mal conseillées, appelèrent à leur tête le général Danican. qui se trouvait alors à Rouen. C’était un officier fort ordinaire, un homme sans mérite, un chef sans science, un soldat sans bravoure. Il perdit un temps précieux à passer des revues, poser des sentinelles et établir des postes, et son apathie compromit la cause qu’il était chargé de défendre.
La Convention, de son côté, veillait et se préparait à soutenir l’attaque. Elle donne au général Menou. commandant de la force armée, l’ordre d’opérer le désarmement de la section Lepelletier et des sections qui, à l’exemple de celle-ci, se sont soulevées. Le 12 vendémiaire (3 octobre), à huit heures du soir, Menou entre en campagne. Le général de brigade Verdier cherche à occuper la partie gauche de la rue des Filles Saint-Thomas, et deux heures après, Menou débouche par celles Vivienne et Notre-Dame-des-Victoires.
Le quartier-général de la section était abandonné. Mais les insurgés, conduits par M. Charles de Lasot. rc-

—^ÎB

ISO
HISTOIRE
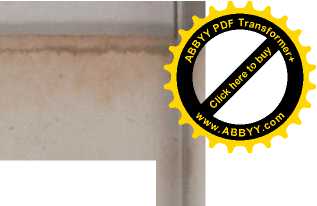
[1795.]
viennent en nombre et proposent au général Menou une transaction que celui-ci accepte, de concert avec le représentant Laporte. Il est arrêté que, de part et d’autre, on mettra bas les armes. Fidèle à sa parole, Menou se retire avec ses troupes ; mais à peine quelques instants se sont-ils écoulés que les sectionnaires se montrent plus nombreux et mieux armés que jamais.
Furieuse de cette équipée, la Convention destitua le général Menou, décréta son arrestation. et confia à Barras le soin de faire respecter ce qu’elle appelait la dignité de la représentation nationale. Barras . investi tout à coup du commandement, sentit la nécessite de s’adjoindre un homme capable de diriger ses troupes et de partager sa responsabilité. Ses souvenirs se portèrent alors sur un jeune officier dont les dispositions savantes avaient amené la reddition de Toulon, et qui, sur les Alpes maritimes, s’était couvert de gloire en présentant un plan de campagne dont l’exécution avait été couronnée d’un plein succès. Cet officier était le général Bonaparte. On le cherche, on te trouve dans Paris, on attache à son habit les insignes de son grade, on lui prête un cheval, et Barras, en se l’adjoignant, mil le jeune liéros sur la route de cette fortune brillante qui le plaça sur le premier trône du monde.
Aussitôt que le commandement lui eut été confié, Bonaparte conçut, dressa et fit exécuter son plan de campagne avec la rapidité de l’aigle. Un parc d’artillerie était aux Sablons, les insurgés pouvaient s’en rendre maîtres; il y envoie Murat, qui arrive assez tôt pour devancer les sectionnaires. 11 visite les troupes. assigne à chacun son poste et parcourt la ligne de dé-
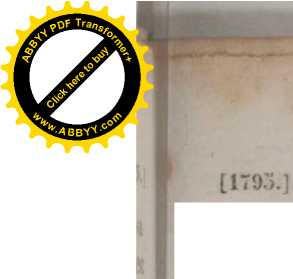
DE LA RÉVOLUTION' FRANÇAISE.
LSI
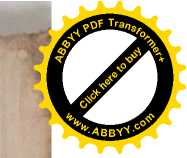
fense de la Convention. Cette ligne s’étendait seulement de la place de la Révolution au Pont-Neuf par le Carrousel et les quais. Tous les autres quartiers étaient occupés par les sectionnaires.
Enfin, le 13 vendémiaire (4 octobre),à midi, toutes les dispositions sont prises, et cependant on parlemente encore. Mais vers quatre heures, quelques coups de fusil se font entendre ; ils partent de la cour du restaurateur Venuca, dont les sectionnaires se sont emparés : un soldat est tué. Bonaparte donne le signal. Soudain les canons placés rues du Dauphin et de l’Échelle vomissent des milliers de projectiles; le combat s’engage sur toute la ligne. Les sectionnaires opposent une résistance héroïque, principalement dans les lieux qui avoisinent Saint-Roch et le théâtre de la République (les Français). Mais le jeu formidable de l’artillerie porte une telle confusion dans leurs rangs, qu’ils sont bientôt forcés de céder au nombre, à la vivacité de l’attaque et aux manœuvres de Bonaparte. Des détachements sont envoyés sur tous les points occupés par les sectionnaires. Partout les insurgés sont défaits, et, au bout de quelques heures, le jeune héros, qui a eu son cheval tué sous lui, parvient à comprimer entièrement l'insurrection.
Au premier coup de feu, Danican, général en chef des sectionnaires, s’enfuit honteusement. Plus habile à s’assurer une retraite qu’à tenter la victoire, il échappa à toutes les recherches et parvint à se réfugier en Angleterre. Son infâme lâcheté ne contribua pas peu à jeter le découragement parmi ceux qui s’étaient si imprudemment placés sous ses ordres.
Le 14 vendémiaire, la Convention, rentrée en séance, entendit le rapport de Barras sur les événements de la
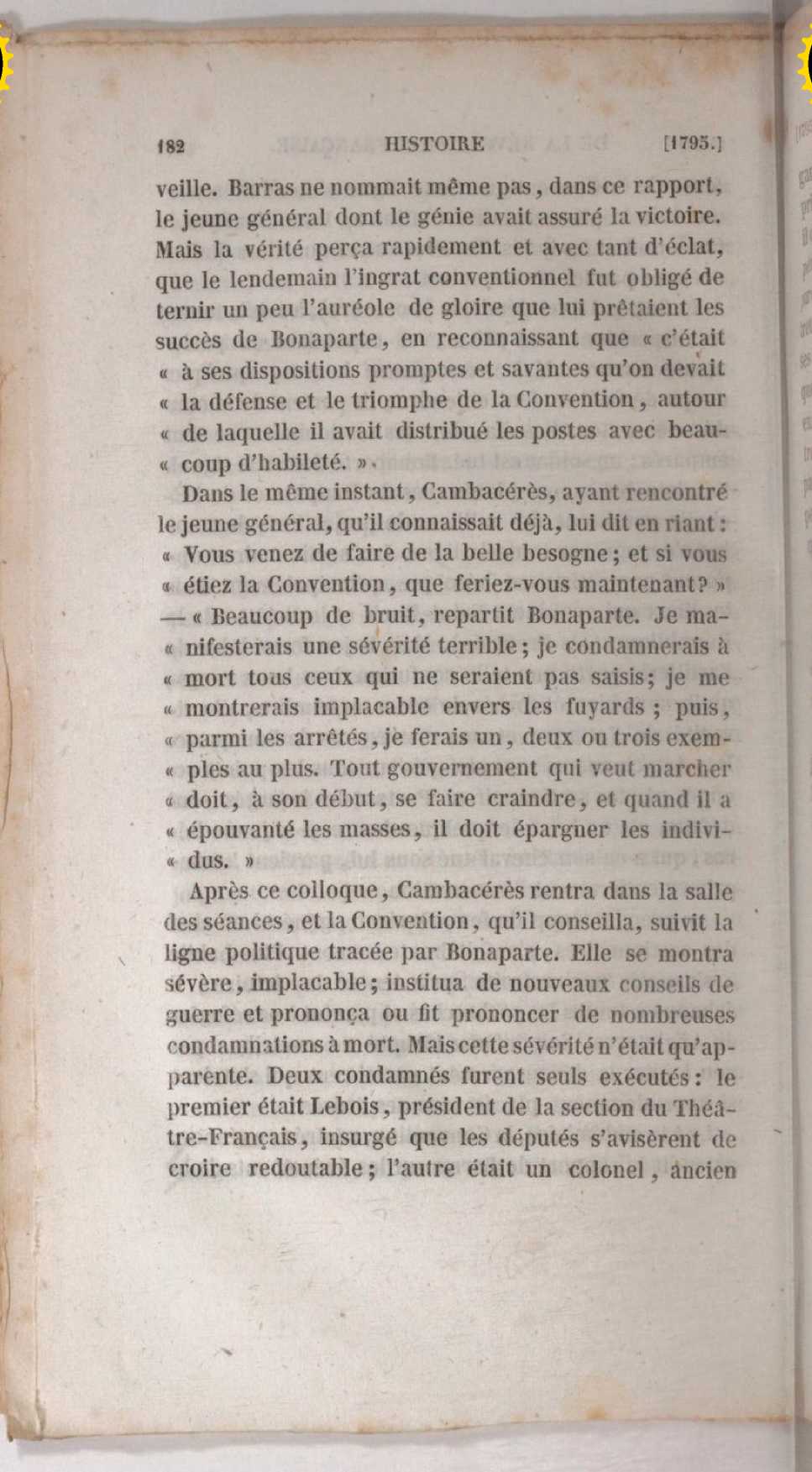
veille. Barras ne nommait même pas, dans ce rapport, le jeune général dont le génie avait assuré la victoire. Mais la vérité perça rapidement et avec tant d’éclat, que le lendemain l’ingrat conventionnel fut obligé de ternir un peu l’auréole de gloire que lui prêtaient les succès de Bonaparte, en reconnaissant que « c’était « à ses dispositions promptes et savantes qu’on devait « la défense et le triomphe de la Convention, autour « de laquelle il avait distribué les postes avec beau-« coup d’habileté. »•
Dans le même instant, Cambacérès, ayant rencontré le jeune général, qu’il connaissait déjà, lui dit en riant : « Vous venez de faire de la belle besogne ; et si vous « étiez la Convention, que feriez-vous maintenant? » — « Beaucoup de bruit, repartit Bonaparte. Je ma-« nifesterais une sévérité terrible; je condamnerais à « mort tous ceux qui ne seraient pas saisis; je me « montrerais implacable envers les fuyards ; puis, « parmi les arrêtés, je ferais un, deux ou trois exem-« pies au plus. Tout gouvernement qui veut marcher a doit, à son début, se faire craindre, et quand il a « épouvanté lésinasses, il doit épargner les indivi-« dus. »
Après ce colloque, Cambacérès rentra dans la salle des séances, et la Convention, qu’il conseilla, suivit la ligne politique tracée par Bonaparte. Elle se montra sévère, implacable ; institua de nouveaux conseils de guerre et prononça ou fit prononcer de nombreuses condamnations à mort. Mais cette sévérité n’était qu’apparente. Deux condamnés furent seuls exécutés: le premier était Lebois, président de la section du Théâtre-Français, insurgé que les députés s’avisèrent de croire redoutable ; l’autre était un colonel, ancien
HISTOIRE
[1795.]
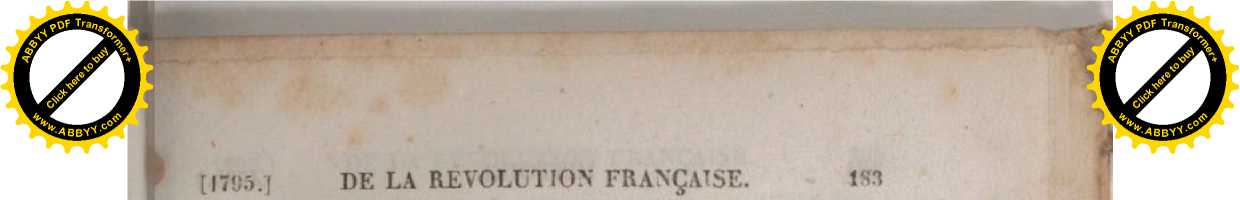
garde du corps, nommé Lafont-Soulès ou Soudés, pris les armes à la main à l'affaire du Pont-Royal, où il commandait en sous-ordre. Au reste, celui-là n’a péri que par sa faute. Scs juges firent tout ce qu’ils purent pour le sauver. Mais aveuglé par une opiniâtreté qu’il crut être de l’héroïsme, il répondit lors de ses interrogatoires et se conduisit de telle manière. que l’on fut forcé de le condamner et de le laisser exécuter. C’est donc à tort que tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans l’affaire du 13 vendémiaire ont parlé des dangers qu’ils auraient courus. Mieux que personne ils savent que ces dangers n’ont jamais été qu’imaginaires. Ils ne furent ni poursuivis ni dénoncés, et cela est si vrai, que le comte de Castellano, un des condamnés à mort, avait contracté l’habitude de répondre la nuit au cri des sentinelles: Castellano, mi; hors la loi! Il ne fut pas même arrêté. La Convention se montra véritablement clémente.
En somme, jamais triomphe ne fut plus complet, jamais vainqueurs n’usèrent de plus de modération. La Montagne aurait fait couler des flots de sang et décrété la permanence de l’instrument du supplice. Deux condamnés, je le répète, furent seuls exécutés. Le nombre de ceux qui périrent en combattant ne dépasse pas quinze cents. Les journaux anglais l’élevèrent à dix mille; mais ce chiffre est complètement exagéré , et je donne le mien pour exact.
Voici l’analyse delà constitution dite de l’an III, qui, en donnant à la France un gouvernement quasi-monarchique , devait la conduire insensiblement de la république à la royauté.
Le pouvoir exécutif résidait en un conseil appelé Directoire, composé de cinq Directeurs choisis et nom-

mes par le corps législatif. — Les directeurs devaient être âgés de quarante ans au moins ; ils étaient renouvelés chaque année par cinquième et par la voie du sort, et ils ne pouvaient être réélus qu’après cinq ans. —Le Directoire nommait et révoquait à son gré les ministres et les ambassadeurs, avait une garde d’honneur de deux cent quarante hommes , donnait audience aux ministres étrangers, et représentait la République dans les cérémonies et les fêles publiques; il ne pouvait se séparer du corps législatif.
Lit législature résidait en deux conseils, appelés collectivement Corps législatif. Le premier, celui des./h-ciens, était composé de deux cent cinquante membres; le second, celui des Cinq-Cents, était ainsi nommé du nombre des députés qui en faisaient partie. — Le conseil des Anciens acceptait ou rejetait les lois proposées par celui des Cinq-Cents, et, dans le premier cas, il les renvoyait au Directoire chargé de les faire exécuter ; il avait seul le droit de décréter en cas d’urgence la translation du gouvernement dans une autre commune de ki République, et ses membres ne pouvaient être âgés de moins de quarante ans. Les deux conseils ne pouvaient se séparer. La permanence de leur session était de droit ; cependant ils pouvaient s’ajourner. Leurs séances étaient publiques, mais elles devenaient secrètes sur la demande de cent membres. Aucun corps de troupes ne pouvait être envoyé par le Directoire dans un rayon de six myriamètres de la commune où siégeait le corps législatif, sans le consentement des deux conseils.
Les membres du corps législatif étaient choisis par des électeurs, nommés eux-mêmes par les assemblées primaires. Tout Français âgé de vingt ans au moins et
HISTOIRE

DE LA REVOLUTION FRANÇAISE.
185
payant un impôt de la valeur de trois journées de travail était membre des assemblées primaires. Les électeurs devaient être âgés de vingt-cinq ans et payer en impôt la valeur de cent cinquante à deux cents journées de travail. Ils nommaient les représentants, le tribunal de cassation, les hauts jurés, les administrateurs de départements, les président, juges, accusateur public et greffier du tribunal criminel, et les juges des tribunaux civils.
La justice, dont l’administration était gratuite, était rendue par une seule Cour de cassation pour toute la République, par une haute Cour de justice composée de sept juges du tribunal de cassation, dont deux remplissaient les fonctions d’accusateur public. Chaque département comptait un tribunal civil, trois tribunaux correctionnels au moins et six au plus, un tribunal criminel, un jury d’accusation et un jury de jugement. ,
La force armée, à qui toute délibération était in-lertiite, se divisait en garde nationale active et en garde nationale sédentaire. La garde nationale active constituait l’armée de terre et de mer.
Enfin le palais du Luxembourg était affecté au logement du Directoire. Le Conseil des Anciens eut pour ses séances la salle (celle de spectacle) occupée aux Tuileries par la Convention, et le conseil des Cinq-Cents, l’ancienne salle du Manège. Les cinq Directeurs, choisis par les Anciens sur la présentation des Cinq-Cents, furent Laréveillère-Lepaux, Rewbel, Letour-neur, Barras et Carnot.
Laréveillère-Lepaux, mauvais avocat d’Angers, était un homme à vues étroites, sans talents, envieux et mesquin. Il n’était guère connu que par son jacobi-


186 HISTOIRE [1795 ]
nisme et son mysticisme philosophique. C’est lui qui a inventé le culte des Théophilanthropes, dont il était le pontife, culte extravagant et impie qu’ont renouvelé de nos jours, sous un autre nom, les Châtel et les Auzou.
Rewbel, de Colmar, moins Français qu’Allemand, était un avocat instruit, mais verbeux et diffus, un homme avare, grossier, criard, infatué de son esprit, quoiqu’il ne fut pas bossu comme son collègue Laré-veillère. Du reste, il fut constamment entouré de fripons; il y en avait jusque dans sa famille, et sa ré putation n’a jamais été bien nette.
Letourneur, de la Manche, ingénieur obscur, ne s’est rendu célèbre que par la plus sordide avarice. Il vint de Calais à Paris sur une charrette de sa ferme, amenant avec lui la plus grande partie de sa basse-cour, qu’il établit au Luxembourg.
Barras était né gentilhomme. Les Burros, dit-on sur les bords de la Méditerranée, sont aussi anciens t/ue les rochers de la Provence. Il avait servi et fait ses premières armes dans l’Inde. C’était un homme courageux et apathique tout à la fois, mais par-dessus tout voluptueux. Son ambition n’avait d’autre but que celui de contenter ses passions. Ses prodigalités étaient celles d’un grand seigneur ; il en aurait eu les manières s’il avait pu retrancher de sa conversation les jurons qui lui étaient familiers. Il aimait les petits soupers et les orgies. Au Luxembourg il étala un faste princier et . avait établi une étiquette d’autant plus ridicule, que
son entourage se composait des plus vils personnages. Curieux à l’excès, il aimait les causeries, les commérages. La versatilité de son caractère et de ses principes lui permettait de jurer haine à la royauté et d’entrer en négociation pour placer un souverain sur le trône

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 187 dont il occupait une partie. Au demeurant. Barras n’était pas un homme de sang. Son cœur était accessible à la reconnaissance et à l’amitié. Il eut des amis, les obligea et sut les conserver. Il aimait et servait tous les membres de sa famille avec un désintéressement d’autant plus digne d’éloge, qu’il en était haï à l’excès.
Carnot dut sa nomination au refus de Sieyès, qui avait éprouvé un si vif dépit d’être nommé le second, qu’il déclara ne pouvoir accepter et persista dans son refus. On jeta alors les yeux sur Cambacérès. Mais l’ombrage qu’il causait à Larévcillère et il Rewbel fit que ceux-ci, dans leur jalousie, lui opposèrent Carnot, qui l’emporta.
11 est peut-être difficile à un royaliste de juger Carnot avec impartialité. Je vais le faire cependant , et je ne dirai de lui rien qui ne soit juste et vrai. Carnot était un homme d’honneur, de mœurs irréprochables et d’une probité à toute épreuve. Mais toutes ces vertus ne sauraient racheter son vote régicide quand il siégea parmi les prétendus juges du saint roi Louis XVI, ou faire oublier qu’il a été membre des comités de Salut public et de Sûreté générale. Les signatures qu’il dit avoir apposées de confiance au bas de tous les arrêts sanguinaires de ses collègues sont des crimes. Il devait se retirer ou combattre : il ne céda que pour qu’on le laissât maître dans le département de la guerre. Sa mémoire ne pourra jamais être lavée de ces faits; mais la postérité, en les reprochant à Carnot, lui tiendra compte de son amour de la patrie et de la gloire nationale. Carnot possédait au plus haut degré cette supériorité de talents à l’aide de laquelle on prévoit et on dirige les événements, cette fermeté qui triomphe des obstacles, cette patience qui assure le succès. Il pos-

188 HISTOIRE [1795.? I
sédait ces rares qualités qui font les grands citoyens; pour lui la France était tout, le reste rien. Son désintéressement ne peut être comparé qu’à celui de Fabri-cius. Carnot est un type isolé, placé très-haut parmi ses contemporains; c’est, si je puis me servir de cette expression, un Romain jeté au milieu de notre époque. Il n’appartient précisément à aucun parti, car il les a tour à tour tous combattus, et, par une exception bien rare, quoiqu’on l’ait blâmé quelquefois et qu’il ait mérité de l’être, personne n’a pu lui refuser ces égards, cette considération dont rendent souvent indigne des actes répréhensibles. Aussi à l’époque de ses disgrâces, et de quel gouvernement n’en a-t-il pas éprouvé? il a toujours conservé l’estime de tous, et trouvé des ami'» et des protecteurs parmi les rois eux-mêmes.
En somme, les cinq Directeurs avaient trempé dans tous les crimes de la révolution. Ils étaient tous les cinq couverts du sang de Louis XVI. Aussi les royalistes exaltés , au lieu d’applaudir à cette royauté déguisée, reçurent la nouvelle constitution avec horreur et épouvante.
Une fois installé, le Directoire composa son ministère. Celui de la justice fut confié à .Merlin de Douay, jurisconsulte de premier ordre, mais qui, hors de son cabinet, n’a fait que des sottises. Sa poltronnerie avait passé en proverbe. Au reste, c’était un ardent révolutionnaire, un régicide comice les directeurs, et ce ne pouvait être qu’un ministre très-partial.
Charles Lacroix eut le portefeuille des relations extérieures. L’un des actes de son ministère fut d’inviter, en 1796, les ambassadeurs de Prusse et d’Espagne à la fête sacrilège du 21 janvier. Peu de talents, des passions et de la suflisance, composaient l’ensemble de cet ex-jacobin.
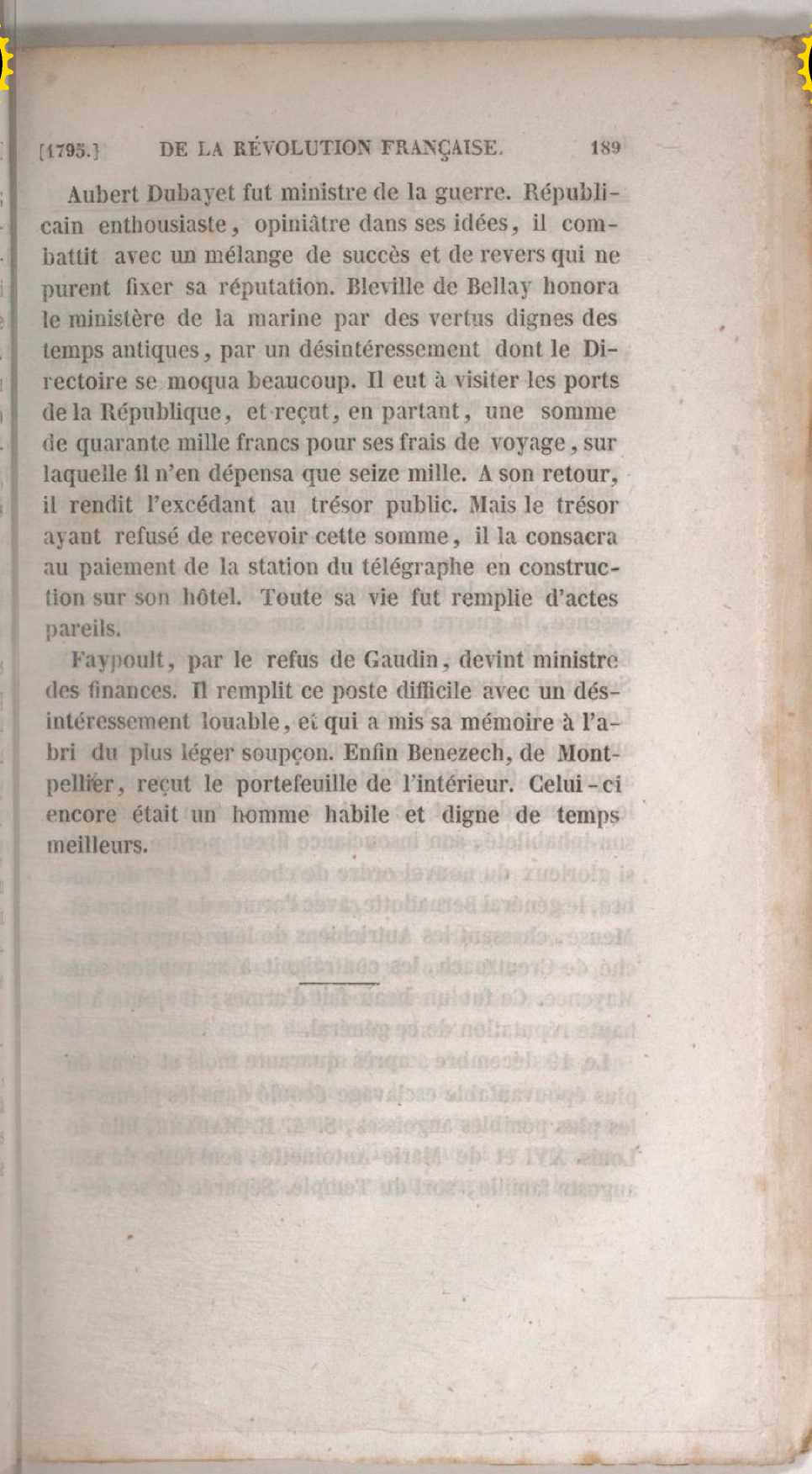
Aubert Dubayet fut ministre de la guerre. Républicain enthousiaste, opiniâtre dans ses idées, il combattit avec un mélange de succès et de revers qui ne purent fixer sa réputation. Bleville de Bellay honora le ministère de la marine par des vertus dignes des temps antiques, par un désintéressement dont le Directoire se moqua beaucoup. Il eut à visiter les ports de la République, et reçut, en partant, une somme de quarante mille francs pour ses frais de voyage, sur laquelle il n’en dépensa que seize mille. A son retour, il rendit l’excédant au trésor public. Mais le trésor ayant refusé de recevoir cette somme, il la consacra au paiement de la station du télégraphe en construction sur son hôtel. Toute sa vie fut remplie d’actes pareils.
Faypoult, par le refus de Gaudin, devint ministre des finances. Tl remplit ce poste diflicile avec un désintéressement louable, et qui a mis sa mémoire à l’abri du plus léger soupçon. Enfin Benezech, de Montpellier, reçut le portefeuille de l’intérieur. Celui-ci encore était un homme habile et digne de temps meilleurs.
[1795.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

190 HISTOIRE . [1795.]
Victoires d • nos ai ruées. — Échange de S. A. R. Madame. — Prise de Manheim.—Trahison de Pichegru.— Loi relative aux assignats. — Année 1796. — Création du ministère de la police. — Bris de la planche aux assignats après une émission de plus de quarante milliards de ce papier-monnaie. — Installation des douze municipalités parisiennes. — Touasaiul-Loaverlure. — Hauts faits des années du Rhin et de Sambre-et-Meuse. — Déroute de Jourdan. — Caricature. — Retraite de Moreau. — Mort de Catherine IL — Rupture des négociations avec l’Angleterre. — Mauvais succès de l’expédition d'Irlande.
Taudis que le gouvernement était changé dans son essence, la guerre continuait sur certains points. Le général Masséna, ayant sous ses ordres les généraux Serrurier, Augereau, Victor, gagna la bataille de Loano, les 23 et 24 novembre. Ce triomphe aurait amené les Français au cœur de l’Italie, si Scherer, auquel on fit quitter l’intérieur, n’était venu prendre te commandement de cette année. Son impéritie, son inhabileté, son insouciance tirent perdre ce fruit si glorieux du nouvel ordre de choses. Le 1er décembre. le général Bernadotte, avec l’année de Sambre-et-Meuse, chassant les Autrichiens de leur camp retranché de Creutznach, les contraignit à se replier sous Mayence. Ce fut un beau fait d’armes ; il ajouta à la haute réputation de ce général.
Le 19 décembre, après quarante mois et demi du plus épouvantable esclavage écoulé dans les pleurs et les plus pénibles angoisses, S. A. R. Madame, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, seul reste de son auguste famille, sort du Temple. Séparée de ses ser-

[1795.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 191 vitcurs, ignorant la mort de sa mère, de son frère, de sa tante, réduite à raccommoder son linge, passant l’hiver sans feu, mal nourrie, avilie par d’infâmes traitements et par les plus odieux projets de mariage, elle, sœur, uièce de victimes, qui mieux qu’elle a Idû inspirer plus de respect et de pitié? Depuis longtemps les puissances étrangères sollicitaient sa mise i en liberté ; enfin, le Directoire signala son installation par cet acte louable. On ne put néanmoins enlever aux Jacobins cette belle proie sans leur présenter un dédommagement. En conséquence, on demanda qu’en retour de cette princesse, l’Autriche rendit les représentants du peuple Camus, Banuel, Quinette, Drouet, Beurnonville , et les citoyens Marel et Sémon-ville, que celte puissance retenait dans les fers : les premiers avaient été arrêtés par Du mou riez, elles deux derniers enlevés «àleur passage, lorsqu’ils se rendaient en Toscane.
Partez, noble princesse, partez; notre amour vous suit, nos vœux vous redemanderont à la Providence ; mais que de temps encore s’écoulera avant qu’il vous soit permis de revenir parmi nous ! bien que l’ingratitude doive une autre fois vous en éloigner.
Un grand revers signala la fin de l’année. La ville de Manheim, où nous avions une forte garnison, qui fut faite prisonnière, céda à la violence d’un très-long bombardement, et, le 21 décembre, le général autrichien AVurmser entra dans cette place. Bonaparte devait peu tarder à venger la France de ce revers, en prenant Manione défendue par le môme Wurmser.
L’armée française, comme frappée de terreur, abandonna le terrain conquis en Allemagne et se retira sur Landau et Strasbourg. Cette retraite parut être la cou-
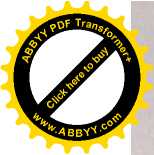
l'Jï
HISTOIRE
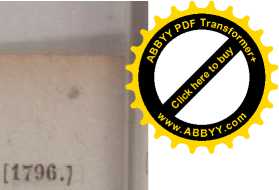
séquence d’une déroute, tandis que Pichqgru, alors en correspondance avec le prince de Coudé, par l’entremise du Neufchâtelois Fauche-Borrel, avait ordonné ce mouvement. Son plan était de désorganiser l’armée ou de la tourner contre la Convention. Il ne put y réussir. Les Autrichiens, par jalousie, empêchèrent que Pichegru ne relevât, dès 1796, le trône des Bourbons.
Le 23 du même mois, une loi impolitique apprit que la création du papier-monnaie s’élevait ou allait s’élever à la somme énorme de quarante milliards. Elle disait que l’émission parvenue à cette somme, les planches seraient brûlées.... Quelle dérision ! ! De plus on fabriquait en Angleterre de faux assignats, dont la France était inondée. L’Europe, heureusement pour elle, ne voulut jamais accepter cette prétendue monnaie.
Le 31 décembre, sur la proposition du général en chef Pichegru, vendu secrètement à LouisXVIII, un armistice fut conclu ; on s’imagina sans motifs qu’il annonçait une paix prochaine ; les succès de Bonaparte pouvaient seuls la décider.
Une nouvelle année commençait, année pendant laquelle la victoire devait jeter un si vif éclat sur les armées françaises, où devait prendre naissance la haute fortune d’un jeune général, encore perdu dans la foule, et sur qui, dès l’année suivante, se fixeraient les regards de l’univers entier. Mais avant de raconter ses exploils, je vais suivre le cours des événements civils ou militaires de toute cette année , en laissant en arrière le récit des prodiges opérés par l’armée d’Italie.
Cette année cependant commença sous de tristes aus-

0796.] DE la révolution française.
193

h
pices, par la création du ministère de la Police, qui fut donné provisoirement à Merlin de Douai. Le21, on célébra la fête du sang ; des paroles de cannibales sortirent de la bouche de Treilhard, président du Conseil des Cinq-Cents. Le 30 janvier, on brisa enfin la planche des assignats. On sut alors que la somme totale de leur émission dépassait quarante-cinq milliards. Tel fut le budget de la république ; elle qui avait si amèrement reproché six ou sept millions de dettes contractées par l’un de nos princes, alors qu’il était jeune et entouré de flatteurs. Ce même jour ou le lendemain, un louis d’or de vingt-quatre livres coûtait cinq mille trois cents francs en assignats. En même temps cessèrent les distributions gratuites de pain et de viande, que les Jacobins faisaient tous les jours à la populace de Paris, et que les représentants n’avaient pas encore osé supprimer.
Le 2 février, installation des douze municipalités parisiennes, qui, en morcelant cette terrible unité, rendirent impossibles la résistance de la Commune et les insurrections qu’elle fomentait. Là expira l’anarchie. Au 1" mars, le louis d’or s’échangeait contre sept mille deux cents francs d’assignats. Mais tandis que dans l’espoir d’abuser la nation, on renonçait à ce papier-monnaie , on créait deux milliards quatre cent mille francs de mandats territoriaux , destinés à rembourser les assignats, à raison de trente capitaux pour un. Ce moyen trompeur n’eut aucun succès; la matière seule desdits mandats les lit repousser dès le jour de leur naissance, et le Directoire se trouva dans un grand embarras.
On apprit plus tard que la révolte continuait dans file Saint-Domingue. Le nègre Toussaint-Louverture s'était emparé du pouvoir; il régularisa l’insurrection,
u.
9
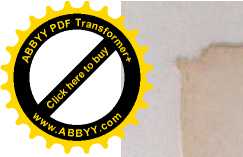

194
HISTOIRE
[1796.]
ramena ses compatriotes au travail, sut trouver des ressources, appela le commerce des neutres, et, créant une nation au lieu de perpétuer une lutte séditieuse , il fit perdre aux anciens colons l’espérance de rentrer jamais dans leurs propriétés. Toussaint avait à lutter contre Rigaud, son rival ; il finit par l’emporter, attendu que l’égalant en courage il possédait de plus des talents administratifs et une politique habile.
Au 1er juin, les Autrichiens, dont les divers corps d’armée s’étendaient, sur la rive droite du Rhin, de Bâle à Manheim, et à la gauche jusqu’à la Sieg, dénoncent l’armistice conclu le 31 décembre précédent avec Pichegru, et que leurs grands revers en Italie leur avaient fait maintenir jusque-là. Ils entrent en campagne sur ce point avec cent trente-six mille fantassins et plus de quarante mille cavaliers. Nous étions en mesure de leur opposer soixante-dix mille hommes d’infanterie et dix mille de cavalerie, sous les ordres du général Jourdan, et formant ce que l’on appelait l’armée de Sambre-et-Meuse ; plus celle du Rhin, forte de soixante-dix mille fantassins et de six mille cavaliers, commahdés d’abord par Pichegru, puis par Moreau, quand on soupçonna la trahison du premier.
Ce nombre était suffisant pour que nos soldats combattissent avec avantage, mais on se défiait de Pichegru. Le Directoire, sous prétexte de le consulter, le fil venir à Paris, l’y retint, et par ce moyen paralysa ses desseins secrets. Pichegru cependant assura le prince de Condé qu’en son absence Moreau tiendrait à la coalition les promesses que lui, Pichegru, lui avait faites. Cela n’empêcha pas qu’à l’armée de Sambre-et-Meuse , Jourdan , secondé par Lefebvre , Soult et d’Hautpoul, ne battît, le 21 juin, à Altenkirchen, en
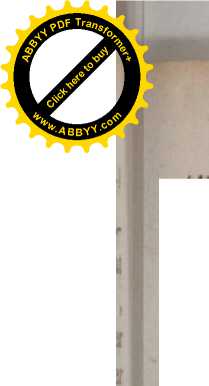
11796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
J 93
Franconie, les Autrichiens, auxquels il fit trois mille prisonniers et prit dix pièces de canon.
L’armée de Rhin-et-Moselle, sous les ordres du brave Desaix, tenta le 24 juin dépasser le Rhin à Kehl, malgré la vive résistance des ennemis. Moreau, bien que le passage ne fût pas dirigé par lui, en retira sa part de gloire, comme général en chef. Les vaincus étaient commandés par le prince Charles, héros, quoique capitaine quelquefois malheureux. Ce prince, en effet, perdit encore le 5 du mois suivant la bataille de Rastadt, où les généraux Lecourbe, Gouvion-Saint-Cyr et Decaen ajoutèrent à leur réputation militaire.
Le 14 juillet, Jourdan occupa Francfort-sur-le-Mein ; le 18, Gouvion-Saint-Cyr entra dans Stuttgart, à la suite d’un engagement si décisif que les Autrichiens furent rejetés sur le côté droit de la Forêt-Noire. La prise de Wurtzbourg nous procura trois cents bouches à feu; et à Bamberg, Jourdau trouva d’abondantes provisions de bouche. Tant de succès déterminèrent le roi de Prusse à signer à Berlin, le 5 août, un traité qui assura la neutralité du nord de l’Allemagne, ce qui nous délivra de la crainte d’être pris eu flanc inopinément, far les mêmes motifs, l’Espagne rechercha une alliance qui lui répugnait d’autant plus que, par un traité, elle s’engageait à nous fournir en auxiliaires quinze vaisseaux de ligne, six frégates, quatre corvettes, dix-huit mille hommes d’infanterie, six mille chevaux , et l’artillerie nécessaire à ce corps d’armée.
Tandis que l’archiduc Charles, battu le 5 juillet à Rastadt et le il à Neresheim, par Moreau, était allé surprendre et malmener Jourdan à Neumark Je 22 et le 24, Moreau, franchissant le Lech, sur-
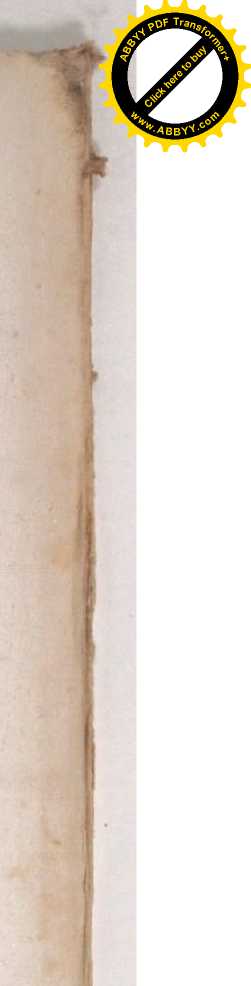


196 HISTOIRE [1790.]
montait tous les obstacles et envahissait la Bavière. Mais Jourdan, qui reculait, fut encore atteint par l’archiduc à Wurtzbourget tellement mis en déroute, qu’abandonnant la Franconie et Francfort, il ne se crut en sûreté qu’à Dusseldorf. Certes, les malheurs de cette armée eussent été plus considérables si le général Bernadotte n’eût employé tous les talents d’un grand capitaine à se rendre redoutable lors meme qu’il paraissait fuir. La Convention, imitant mieux le sénat de Carthage que celui de Rome, destitua Jourdan et • nomma à sa place Beurnonville.
A la nouvelle de ces désastres, les Parisiens, qui rient de tout, représentèrent Jourdan à cheval sur une écrevisse. Au bas de la gravure, étaient ces mots, tirés d’un psaume : Et tu Jordanis quia conversus es re-trorsum.
Moreau venait d’imposer à l’électeur de Bavière un armistice à des conditions rigoureuses ; mais le malheur de Jourdan ne lui permit pas de conserver sa position, et, le 8 septembre, il commença cette retraite vantée d’abord comme celle des Dix mille, (‘I à laquelle depuis on a reconnu moins d’importance : Sic transit (jloria mundi. Toujours poursuivie, souvent attaquée, jamais battue, plusieurs fois triomphante (1), l’armée française, accablée de fatigue et couverte de gloire, après avoir, par une marche rapide, traversé en quarante jours une étendue de cent lieues, parvint sur les bords du Rhin à Kehl et à Ilu-ningue, conservant les ponts du Haut-Rhin et les postes les plus importants sur la rive droite.
1) Notamment à Bibcrach, 2 octobre , et à Scblieogen.
L. L. L. 1

[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
197

Tous ces revers lurent un peu adoucis par la nou-ve lie de la mort de l’impératrice Catherine II, frappée d’une attaque d’apoplexie foudroyante. Cette grande princesse, implacable dans sa haine contre la République française, et constante dans son attachement pour notre famille royale et nos émigrés, termina le cours de sa vie au moment où, pour susciter de nouveaux ennemis aux Jacobins, elle allait s’allier avec l’Angleterre. Nous verrons son fils, Paul Ier, continuer à nous faire la guerre, et son général, le fameux Souvarow. causer souvent un vif effroi à nos meneurs.
D’une autre part, la France et l’Angleterre avaient paru vouloir se rapprocher. C’était à Paris, et non à Londres, que les conférences devaient se tenir. On vit en effet arriver dans la première de ces villes le lord Maimesbury. Les préliminaires occupèrent pendant deux mois les négociateurs. Un moment on eut l’air de s’entendre ; mais comme ni l’une ni l’autre des puissances ne voulait la paix, les notes devinrent aigres, inintelligibles, et d’amères récriminations suivirent. Cette tactique, plus adroitement suivie par l’Angleterre, amena un éclat qui dégénéra en querelle ouverte. Le ministre des Relations extérieures en déféra au Directoire, qui, le 22 décembre, répondit par la remise des passe-ports au lord Maimesbury. A la rupture de l’armistice , la France mécontente se plaignit ; les hostilités tardèrentpeuà recommencer, et,vers le 24 décembre, le général Morard de Galles, commandant en chef une expédition destinée à séparer l’Irlande de l’Angleterre , partit de Tow, à la tête d’une flotte forte de dix-neuf vaisseaux de ligne , dont un rasé , de douze frégates, de six corvettes, de plusieurs bâtiments de transport et de dix-huit mille soldats sous les ordres
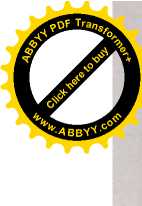
IM HISTOIRE [1796.]
du général Hoche. Une suite de coups de vents, de tempêtes et de fausses mesures, empêcha le succès de cette entreprise , où nous perdîmes plusieurs vaisseaux, sans avoir pu effectuer le débarquement.
Ce fut par ce malhem ©u a fait d’armes que se termina l’année militaire de 1796. A part les actes du pouvoir que j’ai racontés, les faits qui occupèrent la France furent ceux dont je vais présenter pareillement le tableau rapide. Les Jacobins ne pouvaient se croire vaincus : actifs, intrépides .ils se mirent à tramer d’autres complots, et celui do» ; l’exécution avait été fixée au 21 floréal (10 mai) fut sur le point de réussir.
Les conjurés devaient se répandre durant la nuit dans Paris, et, nouveaux septembriseurs, égorger dans leurs demeures les membres des deux Conseils, l’état-major de l’intérieur, les autorités constituées et les chefs du Gouvernement, livrer la ville au pillage, et proclamer la constitution de 1793.
De faux frères vendirent les conspirateurs, qui avaient à leur tête Drouet, le maître de poste qui avait arrêté Louis XVI à Varennes, Babœuf, Félix Lepelletier, Vadier, Amar, Ricord, Choudieu, An tonnelle, tous députés ou ex-représentants; les généraux Fyon, Lamy, Rossignol; le limonadier Chrétien, et l’ancien juré au tribunal révolutionnaire Didier. Ces hommes de sang, outre la première table de proscription, avaient arrêté (pie l’on mettrait à mort instantanément les nobles, les
1 prêtres et tous les hommes opulents. Une fois arrêtés,
les conjurés furent interrogés séparément. Dronet nia tout ; mais Babœuf répondit que tous les moyens étaient légitimes pour renverser des brigands. Une haute-cour fut organisée pour le jugement des accusés, et, par mesure de prudence, on la fit siéger à Vendôme,
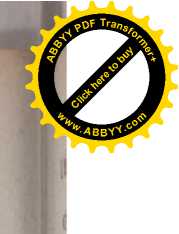

il
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
199»
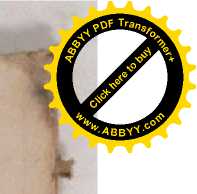
^ 1
où les soulèvements populaires n’étaient pasà craindre. Cochon, alors ministre de la Police, fit preuve d’une grande habileté ; l’œil vigilant de cet administrateur devina tout ce qu’on ne vint pas dire à son oreille, et assurément la France lui dut de la reconnaissance.
La nuit où l’on devait transférer Babœuf et ses complices arrêtés, leurs amis tentèrent un coup de main pour les délivrer. Afin de donner le change à la police , ils répandirent de faux bruits sur une prétendue conspiration royaliste ; mais la police ne tomba pas dans le piège: elle sut déjouer le complot. Cependant, furieux et ne se tenant pas pour battus, ceux des conjurés qui étaient restés libres tentèrent d’entraîner dans leur parti le camp militaire de Grenelle, placé sous les ordres du général Latour-Foissac. Ils se portèrent donc sur ce point à force ouverte ; mais, après un engagement où quelques coups de fusil seulement furent échangés , les insurgés furent complètement battus, et un grand nombre faits prisonniers. Parmi ces derniers on remarquait Hugues, Cusset et Javo-gues, membres de la Convention , enragés sans-culottes, le nommé Bonbon, qui se tua pour n’être pas jugé, et Gagnant, secrétaire de Drouet.
Une commission militaire fut instituée à Paris pour juger les fauteurs de cette insurrection. Cent trente-quatre accusés passèrent devant elle : trente-un furent condamnés à être fusillés au camp de Grenelle ; trente à la déportation ; vingt à la prison à temps; quarante-huit acquittés. Gagnant, en route pour Grenelle, brisa ses liens en face des bains Chinois, et chercha son salut dans la fuite; poursuivi par les gendarmes, il fut bientôt atteint et expira frappé à coups de sabres et de baïonnettes.
i
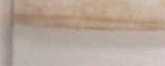

200 HISTOIRE [1796.]
Le jugement de Vendôme ne fut rendu que vers le milieu de l’année suivante. Six accusés furent condamnés à la peine capitale : au nombre de ceux-ci étaient Babœuf et Darthé, qui se poignardèrent en entendant prononcer leur arrêt. Germain et le Florentin Buonaroti furent condamnés à la déportation avec cinq de leurs co-accusés. Tous les autres furent absous.
Dès ce moment, on comprit la différence qu’il fallait établir entre les Jacobins et les royalistes. Tandis donc que l’on décimait si vigoureusement les premiers, les seconds tentèrent de rappeler les Bourbons. Duverne de Presles, l’abbé Brottier, Neveu et Laville-beurnois, conseiller au parlement de Paris, cherchèrent à gagner un chef de brigade nommé Malo ; celui-ci feignit de les écouter, capta leur confiance et les livra à la police.
On arrêta les chefs en flagrant délit de conspiration; les plans furent trouvés sur Lavilleheurnois ; c’était un complot bénévole. Le nec plus ultrà de rigueur que voulaient employer les conspirateurs consistait dans la mise aux arrêts des autorités; le reste devait être gagné à prix d’or ; enfin on composait un ministère de huit honnêtes gens , Vauvilliers, Bénin , Cochon , Portalis, Benezech, Desgranges, Feurieux et Barbé-Marbois.
Jugés militairement, les accusés furent remis en jugement par le tribunal de cassation. Enfin, une décision intervint ; la peine de mort prononcée contre les trois chefs fut commuée en deux ans de détention. Lavilleheurnois, l’un d’eux, en fut quitte pour un an.
Tels furent les événements qui troublèrent la tranquillité de l’intérieur, outre les agitations de la Ven-
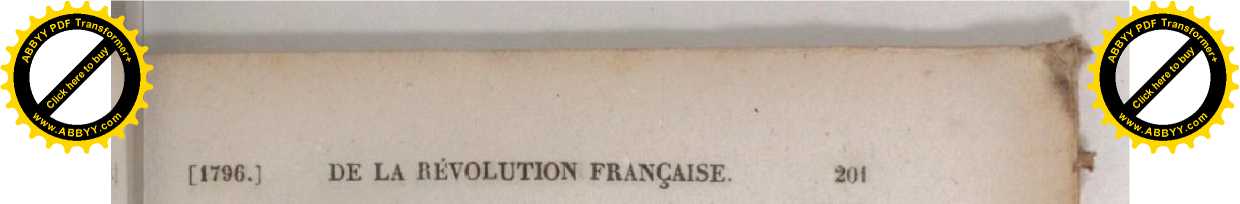
dée, sur laquelle je reviendrai avant de raconter les faits importants de la journée du 18 brumaire, dont certes nous sommes loin encore, puisque je dois auparavant parler des campagnes d’Italie et d’Égytpe, et de la journée du 18 fructidor.
I I
9.
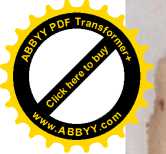
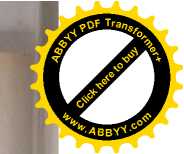
202 HISTOIRE [1796]
Quelques grands capitaines.'—Napoléon en tête.— Origine des Bonapartes. — Un trait dans leur famille. — Charles Bonaparte. — Lætiüa Ramo-lino.—Joseph.—Napoléon. — Lucien. — Élisa. — Louis. — Pauline.— Caroline. — Jérôme. —Napoléon à Brienne.— Opinion de ses maîtres sur son compte. —A l’École Militaire.—Sous-lieutenant d’artillerie. — L'évêque de Valence. — Mot de Napoléon. — Détails de sa vie jusqu'au siège de Toulon.—Part qu'il prend à ce siège. — Général de brigade.—Sa campagne d'Italie en 1795. —Ce qu'il fait jusqu'au 13 vendémiaire.— De ce jour à sa nomination à l'armée d'Italie, 1796.—État-major des onze armées de la République.
La nature, avare d’hommes véritablement grands, a placé de loin en loin quelques-uns de ces génies supérieurs pour commander aux nations, et dont la réputation domine les siècles. Ce ne sont point de simples vertus ou d’habiles faits d’armes sur un terrain de quelques lieues carrées qui procurent cette qualification de grand homme; il y a pour condition absolue d’avoir attaché un pouvoir démesuré à une bravoure gigantesque, de s’être mis en mesure de soulever, d’ébranler le monde. Beaucoup l’ont tenté, très-peu y sont parvenus.
Je citerai un seul nom dans les temps héroïques, celui d’Hercule ; aucun autre ne l’a dépassé ni même imité de loin. Le fameux Achille borna tous ses exploits à ravager l’île de Lcmnos et à combattre pendant dix ans autour d’une ville imprenable. Puis vient Sémira-mis, reine d’Assyrie, vivant l’an du monde 2164. Sé-sostris, non moins célèbre, aussi peu connu, qui, selon les Égyptiens, a vaincu l’univers, et dont la trace ne se retrouve nulle part : il vivait l’an 1722 avant Jésus-Christ. Cyrus, conquérant persan, l’an 529. Alexandre
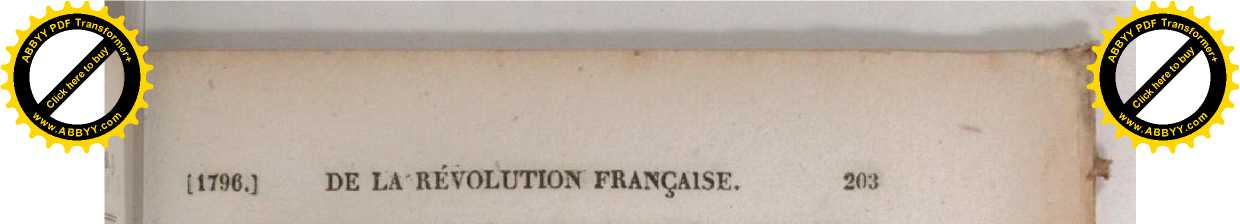
le Grand, roi de Macédoine, vainqueur de l’Asie et de l’Afrique, mort 336 ans avant Jésus-Christ. Jules César, à Rome, assassiné l’an 43 avant Jésus-Christ. Attila,
surnommé le Fléau de Dieu, mort 453 ans après Jésus-Christ. Mahomet, Arabe, prophète conquérant, mort en 632. Charlemagne, roi de France, empereur d’Occident, mort en 814. Gengis-khan, Tamerlan, tous deux khans des Tartares, tous deux célèbres par leurs conquêtes, l’un mort en 1227, l’autre en 1445. Charles-Quint, empereur d’Allemagne, enlevé à l’Empire en 1556. Louis XIV, décédé en 1715. Thamas Nadir, Persan et victorieux , mort en 1747.
Celui qui va clore cette liste, où je ne place pas plusieurs héros qu’on me reprochera d’omettre ; celui-là , dis-je, venait de naître : son génie avait tout à coup fait explosion, il le conduisit rapidement au faîte de la gloire. Je dois ici commencer à faire connaître cet homme, qui parut avec tant d’éclat sur la scène du monde, et qui, tour à tour, a passé des prospérités les plus grandes aux infortunes les plus inouïes.
La famille de Bonaparte a toujours tenu le premier rang parmi les plus illustres de la Corse. Son origine se perd dans cette nuit reculée et complète qui seule établit les grandes maisons. On a dit à tort qu’elle se rattachait aux Comnènes; cela n’est point (1). Il paraît
(1) Je ne peux admettre comme sérieuse cette descendance des Bonapartes qui remonterait aux Comnêues. L'iilustre écrivain qui le premier l'a fait connaître a cédé à un orgueil bien naturel, celui de rafraîchir la vieille pourpre impériale de ses pères parcelle si fraîche et si resplendissante de ceux qui eux-mêmes n’avaient pas de blason des Césars d’Orient. Aucune pièce du blason des Bona-

204 HISTOIRE [1796.]
certain que, Français d’origine et même d’origine royale, si l’on peut avoir foi à des actes incertains, les premiers de cette race s’établirent à Trévise, dont ils eurent la pleine souveraineté; ceci est prouvé. Plusieurs branches descendirent vers l’Italie méridionale, à Florence, à Naples, à Rome, à San-Miniato, toujours produisant des hommes illustres par leur bravoure, leur mérite, leur sainteté (1), et ne s’alliant qu’à des maisons de haute noblesse.
Au seizième siècle, un Bonaparte ou Buonaparté, peu importe au fond, puisque l’origine italienne est const atée, traversa la Méditerranée et vint chercher une nouvelle patrie en Corse. Là ses descendants eurent toujours rang parmi les nobles et furent toujours reconnus tels sur le continent par les étrangers ; tout cela est prouvé d’une manière irréfragable par l’envoi, comme député noble de la noblesse de Corse, de Charles Bonaparte, en 1779, et par l’admission de
partes ne se rapporte non plus à celui des Comnèncs. Je ne sais d’où l’on a tiré que l'armorial desBouapartesse composait pour meubles d’un râteau et de (leurs de lis. Celui d’Élisa, que j’ai copié sur le livre héraldique et manuscrit de Saint-Cyr, porte des gueules aux deux barres d’or, accompagnées en chef et en pointe d’une étoile de même, l’écu accosté extérieurement des deux lettres B et P, sommet d’une couronne comtale. L. L. L.
(1) Uu capucin du couvent de Bologne, frère Bonaventnre Bonaparte, mourut au dix-septième siècle. Ses miracles l’ont fait canoniser. Les restes de ce saint personnage existent à Bologne, en la chapelle de Saint-Jérôme , dans l’église de Santa Maria délia Vita. Sur l’urue qui les renferme, on a gravé les deux vers latios suivants :
Urna Bonaparte corpus tenet istn beatl; Multos sanavit et sanctum esse probnvlt.
Cette urne contient le corps du bienheureux Bonaparte; il guérit beaucoup de malades et fui réputé saint. L. L. L.

[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 205

deux de ses fils à l’École Militaire, et de sa fille aînée Élisa, depuis grande-duchesse de Toscane, à Saint-Cyr, lieux où jamais n’étaient reçus des enfants roturiers. Charles Bonaparte, beau, gracieux, spirituel, mourut de maladie à Montpellier, où il avait été chercher la santé en 1785.
Il s’était marié à Laetitia Ramolino, issue des comtes de Collatto : ceci est encore prouvé ; cette femme forte, aussi belle qu’énergique, est devenue l’objet de l’admiration de l’Europe, lorsqu’elle a dû lutter contre l’infortune dont sa vertu triompha (1). De ce mariage si bien assorti naquirent : Io Joseph, ex-roi de Naples et d’Espagne , grand-connétable de l’Empire français, qui a pris maintenant le titre de comte de Survilliers. Il vint au monde le 7 janvier 1768.
2“ Napoléon, né le 15 août 1769, d’abord lieutenant, puis capitaine , chef de bataillon d’artillerie, général de brigade, de division et en chef, membre de l’Institut de France, première classe, section de mécanique, et de celui d’Égypte ; premier consul à temps et à vie, empereur des Français, roi d’Italie, etc., protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse, prince de File d’Elbe , grand-maître des ordres de la Légion-d’Honneur, de la Couronne de Fer, de la Réunion, des Trois Toisons, etc., mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821.
3° Lucien Bonaparte, membre et président du Conseil des Cinq-Cents, ministre de ITntérieur, ambassa-
(I) Cette illustre et respectable dame, d’abord tant calomniée, et tant honorée sur ses vieux jours, principalement après la chute desa famille, est morte à Rome en 1837. L. L. L.


206 HISTOIRE [1796.]
deur en Espagne, sénateur, prince français, prince de Canino, pair de l’Empire, né le 25 du mois de mai 1775.
4U Marie-Élisa, née le 3 janvier 1777, femme de M. Bacciochi, noble italien, princesse souveraine de Lucques et Piombino, grande-duchesse de Toscane, etc., morte en 1820.
5° Louis Bonaparte, né le 2 septembre 1778, élève de l’École Militaire, chevalier de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, colonel, général, sénateur, prince français, grand-électeur, roi de Hollande, grand-maître de l’ordre de l’Union, connu aujourd’hui sous le titre de comte de Saint-Leu.
6° Pauline, née le 20 octobre 1780, femme en premières noces du général Leclerc, et en secondes, le G novembre 1803, du prince romain Aldobrandini Bor-ghese, duchesse de Guastalla, gouvernante-générale du Piémont; morte à Rome, en 1825, le 9 du mois de juin.
7° Marie-Annonciade-Caroline, née le 25 mars 1782, femme du général, maréchal, grand-amiral Murat, depuis grand-duc de Berg et de Clèves, roi de Naples; elle est tour à tour aussi grande-duchesse et reine. Elle vit encore aujourd’hui sous le nom de comtesse de Lipano.
8° Jérôme Bonaparte, né, comme tous ses frères et sœurs, à Ajaccio, le 13 novembre 1784, capitaine de vaisseau, roi de Westphalie, grand-maître de l’ordre de ce nom, marié à la princesse Catherine, iille du roi de Wurtemberg. Il a pris le titre de prince de Montfort.
Napoléon fut placé à l’école préparatoire de Brienne le 29 avril 1779. Les notes sur son compte, pour déterminer son admission à l’École Militaire, étaient ainsi conçues : « Taille de quatre pieds dix pouces dix
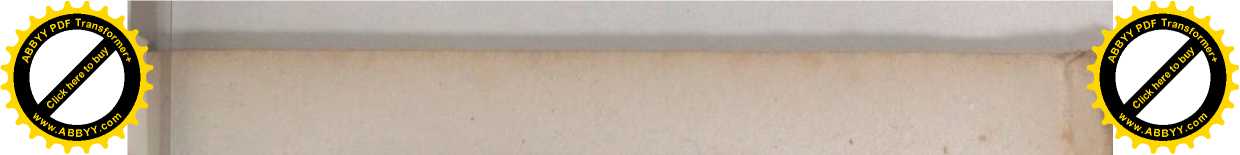
[1796.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 207 j
« lignes ; a fait sa quatrième ; bonne constitution » U 1 « santé excellente; caractère soumis, honnête, recon-
« naissant; conduite très-régulière ; s’est toujours distin-« gué par son application aux mathématiques ; il sait très-• « passablement son histoire et sa géographie ; il est assez
a faible pour les exercices d’agrément et pour le latin, où il « n’a fait que sa quatrième. Ce sera un excellent marin ; « mérite de passer à l’École Militaire, Keralio RO-« BERT (1). »
Un autre de ses professeurs (celui d'histoire, M. d'É-guilles) écrivit en parlant de lui : Corse de naissance, il ira loin, si les circonstances le favorisent. Celui-là ne pronostiqua pas en vain. Opiniâtre au travail, particulièrement à ce qui se rapportait à la carrière des armes, il fit du Plutarque d’Amyot sa lecture favorite. Il resta près de cinq ans à Brienne, en sortit le 17 octobre 1784, et entra à l’École Militaire. Là commença cette suprématie qui ne fit que s’accroître ; il eut de . l’influence sur ses amis, sur ses alentours, et devint le centre d’un cercle dont la circonférence a fini par s’étendre sur le monde entier. Le 1er septembre 1785, à la suite d’un examen soutenu avec honneur, il fut nommé lieutenant en second du régiment de La Fère, mais il y resta peu de temps, et passa lieutenant en premier au régiment d’artillerie caserne à Valence en Dauphiné.
.---
(I) Le chevalier Keralio Robert, Louis-Philippe Guinnement, né à Rennes en 1751, embrassa l’état militaire; il fut appelé à Parme en 175G pour, de concert avec l’abbé de Condillac, diriger l’éducation du prince infant. Plus tard, rentré en France, il devint professeur à l'École Militaire. Il était membre de l’académie des Inscriptions. Il a laissé plusieurs ouvrages et est mort en 1793. Sa fille, qui portait son nom, a publié et traduit des ouvrage» très-estimes. * L. L. L.


208
HISTOIRE
[1796.]
Parmi ses camarades il distingua bientôt les braves qui furent depuis les savants généraux Sorbier et Lari-boissière. A Valence il fut accueilli par l’évêque, M. de Graves, vieillard aimable, tolérant, persuadé que les qualités des jeunes officiers ne pouvaient être celles des séminaristes. Il possédait cette piété douce qui attire, ces vertus qui donnent le désir de les imiter. Un jour, le jeune Napoléon lui ayant parlé de son parent le bien-beureux Bonaparte: « Mon enfant, dit l’évêque, voilà « un bel exemple à suivre... un trône dans le ciel. — « Ah ! monseigneur, repartit Bonaparte, si en attendant « je pouvais passer capitaine. »
La mort de son père, en 1785, lui causa une vive et sincère douleur ; mais son affliction fut pour lui une nouvelle source de science. En cherchant dans la lecture une utile distraction , il acquit une connaissance profonde de l’histoire. C’est de Valence que Napoléon envoya à l’abbé Raynal l’histoire delà Corse, qu’il venait de composer. On sait la réponse flatteuse que lui adressa le philosophe : Vous êtes appelé à écrire rhistoire. Raynal se trompait : Bonaparte devait fournir d’amples matériaux à l’histoire.
Il vint à Paris; Raynal lui fit connaître Beaumarchais, La Harpe, Fontanes, Rivarol, Bernardin de Saint-Pierre, le maréchal duc de Broglie, qui lui demanda s’il avait vu la cour. —J’ai été me promener à Versailles, repartit-il vivement. Le maréchal sourit et le traita avec bonté.
La révolution survint; l'émigration fit peu de partisans dans l’artillerie et le génie. On envoya aux ofli-ciers qui étaient restés des fuseaux et des quenouilles, mais ils répondirent à cet outrage par la conquête de l’Europe. Bonaparte, après avoir hésité, se détermina à
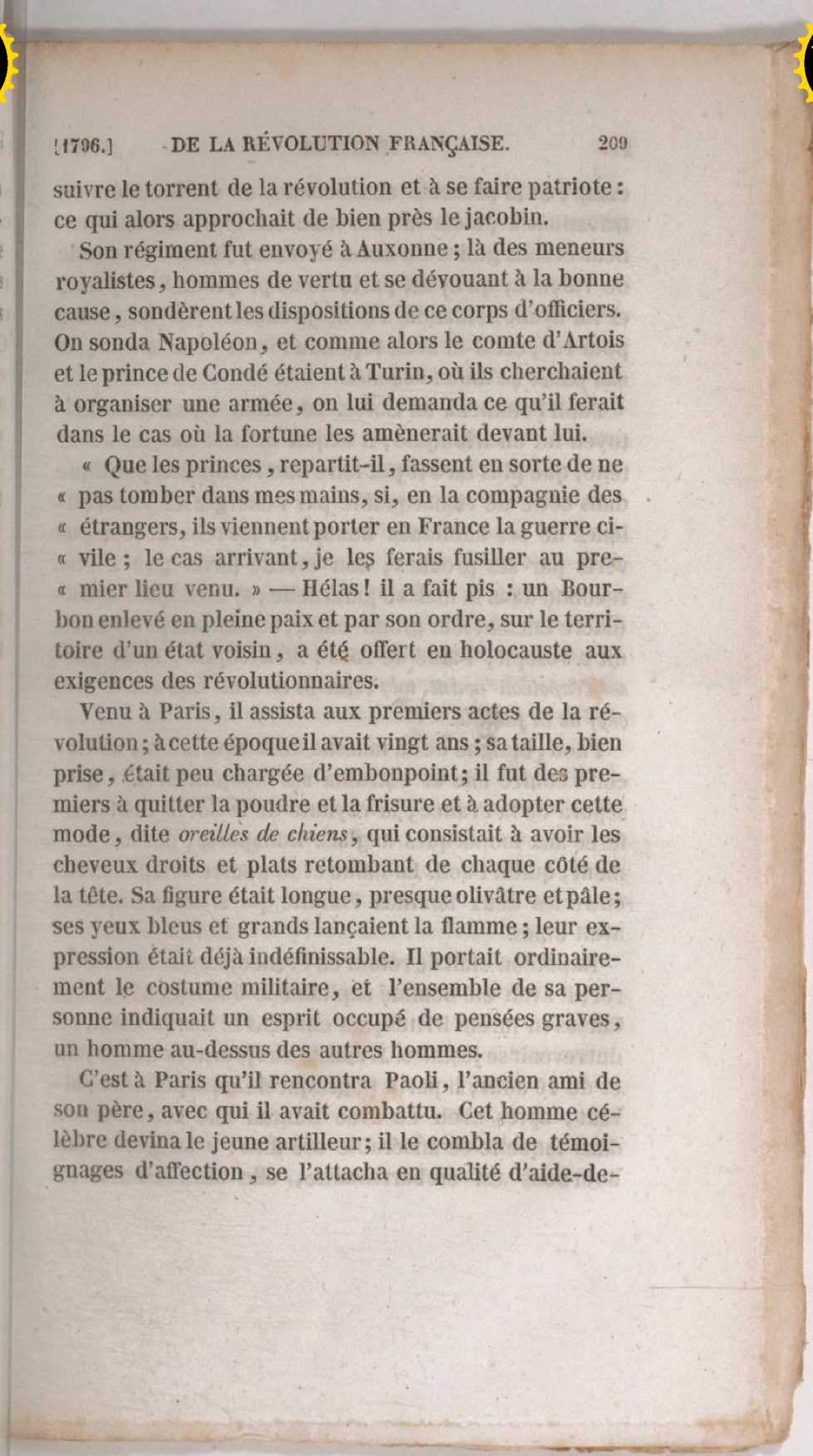
J796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 209
suivre le torrent de la révolution et à se faire patriote : ce qui alors approchait de bien près le jacobin.
Son régiment fut envoyé à Auxonne ; là des meneurs royalistes, hommes de vertu et se dévouant à la bonne cause, sondèrent les dispositions de ce corps d’officiers. On sonda Napoléon, et comme alors le comte d’Artois et le prince de Condé étaient à Turin, où ils cherchaient à organiser une armée, on lui demanda ce qu’il ferait dans le cas où la fortune les amènerait devant lui.
« Que les princes, repartit-il, fassent en sorte de ne « pas tomber dans mes mains, si, en la compagnie des « étrangers, ils viennent porter en France la guerre ci-« vile ; le cas arrivant, je les ferais fusiller au pre-« mier lieu venu. » — Hélas ! il a fait pis : un Bourbon enlevé en pleine paix et par son ordre, sur le territoire d’un état voisin, a été offert en holocauste aux exigences des révolutionnaires.
Venu à Paris, il assista aux premiers actes de la révolution ; à cette époque il avait vingt ans ; sa taille, bien prise, était peu chargée d’embonpoint; il fut des premiers à quitter la poudre et la frisure et à adopter cette mode, dite oreilles de chiens, qui consistait à avoir les cheveux droits et plats retombant de chaque côté de la tète. Sa figure était longue, presque olivâtre et pâle; ses yeux bleus et grands lançaient la flamme ; leur expression était déjà indéfinissable. Il portait ordinairement le costume militaire, et l’ensemble de sa personne indiquait un esprit occupé de pensées graves, un homme au-dessus des autres hommes.
C’est à Paris qu’il rencontra Paoli, l’ancien ami de sou père, avec qui il avait combattu. Cet homme célèbre devina le jeune artilleur; il le combla de témoignages d’affection, se l’attacha en qualité d’aide-de-
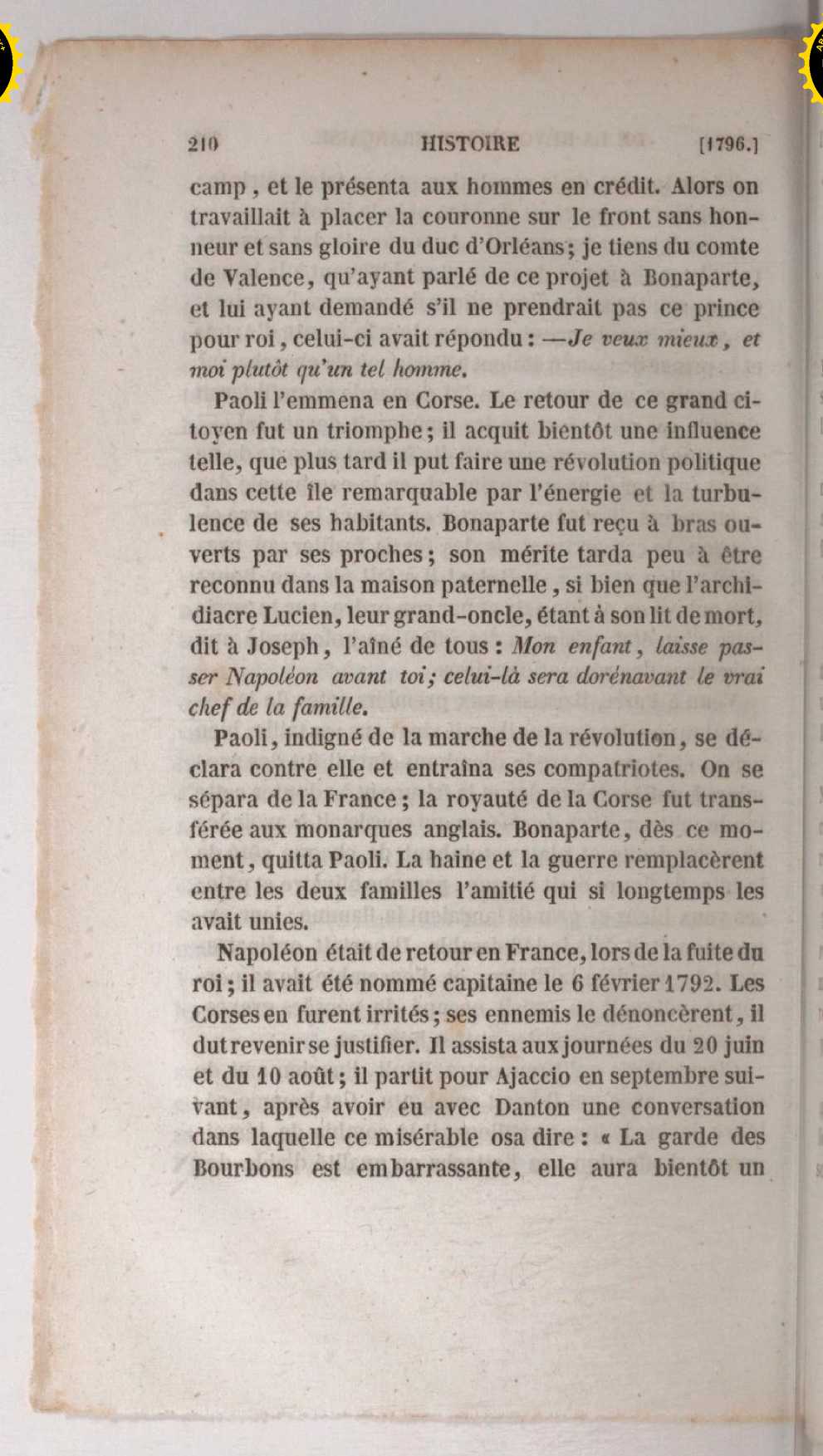
camp , et le présenta aux hommes en crédit. Alors on travaillait à placer la couronne sur le front sans honneur et sans gloire du duc d’Orléans; je tiens du comte de Valence, qu’ayant parlé de ce projet à Bonaparte, et lui ayant demandé s’il ne prendrait pas ce prince pour roi, celui-ci avait répondu : —Je veux mieux, et moi plutôt qu'un tel homme.
Paoli l’emmena en Corse. Le retour de ce grand citoyen fut un triomphe; il acquit bientôt une influence telle, que plus tard il put faire une révolution politique dans cette île remarquable par l’énergie et la turbulence de ses habitants. Bonaparte fut reçu à bras ouverts par ses proches ; son mérite tarda peu à être reconnu dans la maison paternelle, si bien que l’archidiacre Lucien, leur grand-oncle, étant à son lit de mort, dit à Joseph, l’aîné de tous : Mon enfant, laisse passer Napoléon avant toi; celui-là sera dorénavant le m'ai chef de la famille.
Paoli, indigné de la marche de la révolution, se déclara contre elle et entraîna ses compatriotes. On se sépara de la France ; la royauté de la Corse fut transférée aux monarques anglais. Bonaparte, dès ce moment, quitta Paoli. La haine et la guerre remplacèrent entre les deux familles l’amitié qui si longtemps les avait unies.
Napoléon était de retour en France, lors de la fuite du roi ; il avait été nommé capitaine le 6 février 1792. Les Corses en furent irrités ; ses ennemis le dénoncèrent, il dutrevenir se justifier. Il assista aux journées du 20 juin et du 10 août ; il partit pour Ajaccio en septembre suivant, après avoir eu avec Danton une conversation dans laquelle ce misérable osa dire : « La garde des Bourbons est embarrassante, elle aura bientôt un
211)
HISTOIRE
[1796.1

11796.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 211
« terme. — Les exilerez-vous ? demanda Bonaparte. « —Ce serait folie; nous les tuerons, cela vaudra « mieux.— Quoi ! en masse, les femmes et les enfants ? a —Alors répondit Danton, avec un sourire horrible: a Lorsque je fais une omelette, je casse tous les oeufs pour « qu'il n'y manque rien. » Napoléon indigné baissa les yeux ; le silence était alors un acte de courage, car on suspectait quiconque ne prouvait pas son dévouement à la faction par des actes ou tou t au moins par des paroles.
L’assassinat juridique du roi amena la séparation définitive de la Corse d’avec la France. Bonaparte courut aux armes; mais la majorité ne le secondant pas, lui et sa famille durent abandonner sans retour leur patrie. Les vainqueurs impitoyables brûlèrent les maisons et ravagèrent les terres des Bonapartes, qui arrivèrent à Marseille ruinés. La famille Clary les accueillit et se montra pleine de bienveillance pour eux. Joseph épousa une des filles de cette nombreuse et noble maison, l’autre est aujourd’hui reine de Suède.
Le 19 octobre 1792, Napoléon Bonaparte , étant à Nice, reçut son brevet de chef de bataillon ; ce fut dans ce moment-là que soixante-dix départements se séparèrent de la Convention : ils l’auraient renversée, mais un centre d’unité leur manquait; Lyon, Marseille et Toulon se signalèrent plus particulièrement par leur résistance. La première, attaquée par cent cinquante mille hommes, succomba : les vainqueurs s’y baignèrent dans le sang et démolirent de fond en comble les principaux édifices échappés au canon et à l’incendie.
La Provence, le Bas-Languedoc, envoyèrent dix mille gardes nationaux au secours de Lyon. Les Jacobins leur opposèrent un corps de deux mille cinq cents soldats de ligne et de cinq cents artilleurs, qui battit

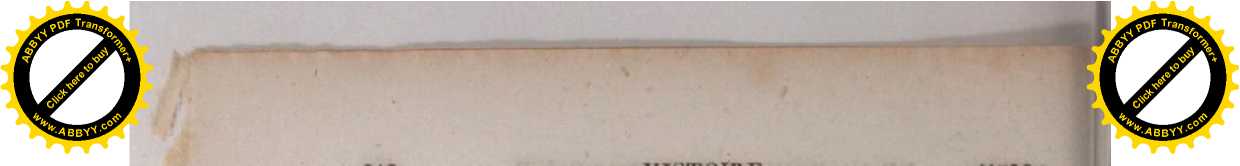
212 1115W1KŁ (1796.1
à Orange les insurgés de Marseille et au Pont-Saint-Esprit ceux de Mmes.
Cartaux commandait au nom de la république : c’était un ignorant, un homme sans génie et sans mérite, qui, de colonel indigne, passa en moins de quinze jours général de brigade et de division, de mauvais peintre en bâtiments qu’il était d’abord. On le prit pour un autre Catinat, et comme la poltronnerie des Marseillais lui livra l’entrée de leur ville, on le crut un homme de talents. En conséquence, on lui confia le soin de conquérir Toulon et de le faire rentrer au pouvoir des Jacobins.
Fréron et Barras, en mission dans le Midi, réservèrent une portion de l’armée de Nice pour renforcer celle de Cartaux, et le siège commença. Mais l’artillerie manquait de chef capable; Bonaparte était alors à Paris : Carnot, qui le connaissait, l’appela, le questionna et l’envoya en Provence; il partit le soir même, n’entra pas à Marseille pour embrasser sa famille, et le 12 septembre 1793, il arriva au quartier-général.
Là il dut tout créer, tout établir, tout diriger ; mais en attendant il reçut l’ordre de Cartaux de venir voir quelque chose de bon .-c’était une batterie placée par ce général à deux mille toises de la mer, disséminée sur une largeur d’une lieue et destinée, suivant lui, à incendier la flotte anglaise ; tout auprès, des soldats faisaient chauffer des boulets avec le secours de soufflets de cuisine.
Dès ce moment il s’établit une lutte entre l’impéritie du chefet la sagacité du subordonné. Cette lutte retarda la prise de Toulon. Les représentants , convaincus de l’ignorance du général jacobin , le remplacèrent par Doppet; celui-ci, mauvais médecin et méchant homme,
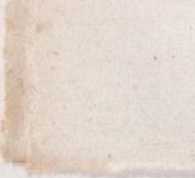

{1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
213

était si convaincu de son incapacité que le génie d’autrui lui était insupportable; il débuta par des sottises. Il en fit tant, que peu de jours après il reçut l’ordre de se rendre à l’armée des Pyrénées-Orientales. Le 20 novembre, le célèbre Dugommier lui succéda; c’était un homme plein de vaillance, de talents, de prudence et de sagacité. Incapable de jalousie, alliant la franchise à la simplicité, de mœurs pures, ce général était tout à la fois un héros et un sage.
Dugommier ne mit aucun obstacle aux savantes dispositions de Bonaparte. Le promontoire du Caire fut occupé ; les batteries foudroyèrent la Hotte anglaise et amenèrent l’évacuation de la place par les coalisés. Le 19 novembre, les Français entrèrent dans foulon, abandonné à tarage des sans-culottes. Barras et Frérou se souillèrent de sang et de crimes. J’ai déjà parlé autre part de leurs atrocités : passons-les sous silence.
Des calomniateurs, des faussaires, ont osé présenter Bonaparte comme complice de ces infamies! Sa conduite à celte époque leur répond, le justifie et les condamne.
Au lieu de récompenser le véritable vainqueur de Toulon , les meneurs l’envoyèrent inspecter les côtes de la Méditerranée que l’on mettait en état de défense. Le 6 février 1794, il reçut sa nomination de général de brigade à l’armée d’Italie ou des Alpes, créée dès 1792 par le général Monlesquiou-Fézensac, et commandée depuis par le général Anselme, qui s’empara sans coup férir de la ligne du Var et de tout le comté de Nice. Villefranche, Oneille, Montalban , furent aussi conquis ; on pouvait espérer mieux, mais des pillards environnèrent Anselme, il s’arrêta, perdit
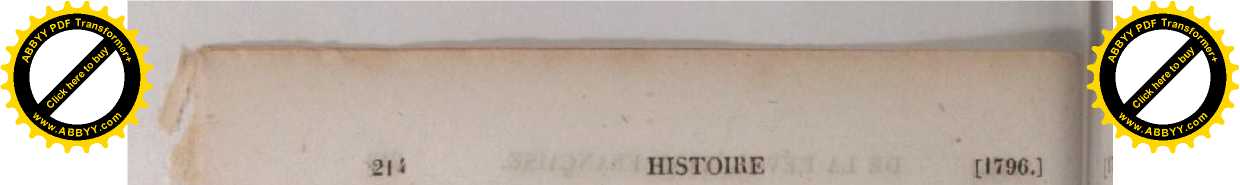
sa réputation, et, accusé de concussion par les Niçards, fut rappelé.
Byron prit sa place, ne fit que passer et courut à l’armée du Nord, tant il semblait pressé de rencoutrer la mort que lui réservait cette république à laquelle il s’était si stupidement dévoué. Alors cette armée fut scindée : une moitié devint Vanné des Alpes, et l’autre, Vannée d’Italie.
Après la prise de Toulon, et en remplacement du général Brunet, qui paya de sa tête un revers, vint le vieux général Dumerbion, goutteux, morose, rempli de zèle, au cœur chaud, au corps miné. Ge général commandait déjà en second; Vial dirigeait le génie, et Gassendi, l’artillerie. Les généraux de brigade étaient Dallemagne , Macquart, Masséna, et quelques autres; et cependant les opérations étaient nuiles.
Tout changea à l’arrivée de Bonaparte; il s’empara de l’esprit de Dumerbion et lui fil exécuter un plan d’attaque si heureusement conçu qu’en peu de jours nos victoires multipliées firent trembler le roi de Sardaigne, les Autrichiens et les Génois. Déjà la Haute-Italie voyait flotter le drapeau tricolore, lorsque la révolution du 9 thermidor vint arrêter ce commencement de prospérité.
Bonaparte , qualifié de jacobinisme par ses envieux , fut arrêté. Les députés Albitte et Saliceli mirent de la passion à faire exécuter les ordres venus de Paris. Cependant on eut honte des rigueurs dirigées contre celui qui déjà avait fait un pacte avec la victoire. On lui rendit la liberté ; il en profita pour aller voir sa famille à Marseille, puis il se rendit à Paris pour solliciter du service, car il était comme destitué.
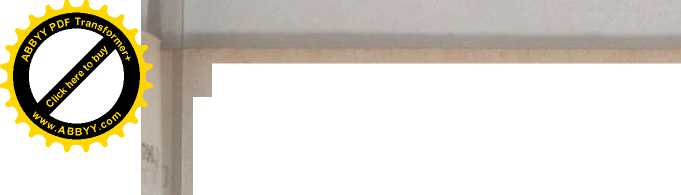
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 215
Le ministre de la Guerre, Aubry, qui n’avait rien fait, détestait qui savait faire. En apercevant Bonaparte, il lui dit : Vous êtes trop jeune pour commander l’artillerie. Citoyen, on vieillit vite sur le champ de bataille, et j'en arrive, répondit Bonaparte. Aubry u’avait jamais vu le feu; il s’indigna de répigramme et devint invisible.
A cette époque, Bonaparte éprouva de grandes contrariétés ; il sollicita sans succès : il voulait passer en Orient, aller chercher du service à Constantinople, lorsque le député Pontécoulant, depuis préfet, sénateur, et aujourd’hui pair de France , fut nommé directeur du comité de la guerre par suite de la destitution d’Aubry. Cet homme d’état (1) ne connaissait de Bonaparte que sa réputation ; il l’appela au lieu d’attendre ses sollicitations, et l’attacha provisoirement au bureau de topographie.
Il occupait cet emploi lors de l'insurrection de prai-
(1) Lecomte Charles-Gustave Doulcet de Pontécoulant, né en 1764, fut en 1785, le H décembre, nommé sous-lieutenant des gardes-du-ccrps, dont son père était major-général. Député à la Convention nationale, son vote, non entaché du sang royal, tendit à sauver le monarque. Girondin, il ne succomba pas avec la Gironde. Il entra en 1795 au conseil des Cinq-Cents. Le 18 fructidor ne pesa pas sur lui. Au 18 brumaire, il fut nommé préfet de la Dyle. Le 1er février 1805, Napoléon l’appela au sénat et le nomma commandant de la Légion-d’Honneur, dont il est aujourd'hui grand'eroix. Pair sous le gouvernement impérial et sous Louis XV1I1, il rentra dans la chambre royale eu mars 1819; il y siège encore. Homme de bien, homme sage, digue d’étre ministre , ce qui l'en éloigne peut-être. La France l’aurait vu avec joie appelé au conseil, où sa modération, sa prudence, son mérite, lui auraient valu un grand crédit. Cet éloge est d'autant moins suspect, que je suis peut-être le seul qui ait eu à m'eu plaindre. L. L. L.

216 HISTOIRE ' (1796.] rial. Le député Romme avait voulu l’entraîner dans le parti des Jacobins ; sur son refus, il lui dit, comme les exagérés qui portent tout à l’extrême: « Vous voulez donc les Bourbons? — Je veux, repartit vivement Bonaparte , un gouvernement stable au lieu d’une anarchie perpétuelle ; je veux que chacun se lève aussi tranquillement de son lit qu’il s’y était couché la veille; je veux la paix intérieure, la prospérité du commerce, de l’agriculture, des arts, pas de maximum; je veux enfin qu'on batte monnaie aux dépens des étrangers et non plus sur la place de la Révolution. »
Cette dernière phrase était une allusion sanglante au mot si connu de Barrère. Ce fut ainsi que Bonaparte arriva au 12 vendémiaire. On sait la maladresse de Menou. La Convention recourut encore à Barras dans cette circonstance ; dès que celui-ci eut été investi de la dictature qu’on lui avait confiée, il eut peur de sa responsabilité, il en parla à Carnot, qui lui dit : «Adjoins-toi un bon général qui agira pendant que tu ordonneras. — Lequel ?—Il y en a trente.—Noinmes-en trois. — Brune, Verdier, Bonaparte. — Ah ! celui qui a pris Toulon ? — Qui sait, répliqua Carnot en riant, s’il n’est pas destiné à enlever au pas de charge le couvent des Filles-Saint-Thomas (chef-lieu de l’insurrection ) ? »
Ce propos frappe juste. Barras venait de rencontrer Bonaparte dans la salle de la Convention, il l’envoie chercher, on le trouve, il arrive. Barras le prend à part et lui demande s’il veut commander sous lui la défense de la Convention ? Lui, tout étonné, désire réfléchir ; Barras lui accorde. .. . trois mimaos.


[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 217
Voici ce qu’il rapporte dans ses Mémoires, écrits à Sainte-Hélène : « Je me mis à peser le pour et le
«
« «
a
« «
a a a
«
■
«
a
contre. Je me dis : Une guerre à mort éclate entre la Convention et Paris; est-il sage de se déclarer, de parler au nom de toute la France ? qui osera descendre seul dans l’arène pour défendre la Convention ? La victoire même aura un côté odieux, et la défaite rendra exécrable aux yeux de la postérité celui qui n’aura pas réussi.
« Mais, d’un autre côté, si la Convention succombe, que devient le résultat de la révolution : nos victoires, notre sang versé, ne seront plus que des actions imputées à crime ; l’étranger, vaincu par nous, triomphera, et nous serons accablés de son mépris : alors la honte, l’humiliation, la ruine, l’esclavage, seront notre lot. Non, je n’y consentirai pas. Avec les seotionu aires la révolution est arrêtée, avec les représentants le champ de l’avenir reste illimité. » Ces considérations le déterminent; Barras attendait,
il sc tourne vers lui. «J’accepte; mais je vous préviens que l’épée une fois hors du fourreau n’y rentrera que lors du parfait rétablissement de l’ordre. »
On sait ce qui arriva ; avec cette promptitude qui distingue l’homme de génie, Bonaparte écrasa les sections. On a prétendu qu’à la suite de celte sanglante journée, il aurait dit : Je viens de mettre mon cachet sur la France. Ce qu’il y a de certain, c’est que la chose eut lieu. Le cachet fut si bien posé et l’empreinte si profonde, que. l’affaire terminée, la Convention victorieuse et l’autorité provisoire de Bonaparte expirée. on ne reconnaissait cependant plus que lui. A l’état-major de la place, c’était à qui prendrait ses ordres et marcherait sous sa direction. Oui. dès ce jour-là.
10 '
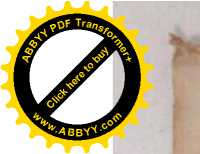

21K -HISTOIRE [1796.1
un grand nombre de citoyens de toutes les classes se tournèrent vers son étoile, la saluèrent avec transport et la prirent pour guide.
La destinée est étrange! La Convention avait ordonné le désarmement des sections, et la nécessité de faire exécuter cette mesure fut la cause du premier mariage de Bonaparte. Un enfant rempli de grâce, de noblesse et d’ingénuité, vient réclamer l’épée de son père, le général Alexandre de Beauharnais, égorgé par les Jacobins : c’était Eugène. Napoléon la lui remet. Madame de Beauharnais croit devoir une visite de remercîment; elle fait la conquête du héros, dont l’âme neuve venait de s’ouvrir à l’amour.
La calomnie a conté autrement ce mariage, mais voilà comment il s’est fait ; j’en ai mille preuves. Il convient de dédaigner les mensonges de ceux qui, semblables au serpent de la fable, tentent de ronger la lime, sachant bien qu’ils ne pourront l’entamer. Ce mariage ne s’accomplit que le 9 mars 1796 , et dès le 26 octobre 1795, Bonaparte avait reçu en récompense de ses services au 13 vendémiaire le commandement de l'armée de l’intérieur.
C’était beaucoup, mais le général dédaignait ce service, qui n’était que lucratif; il se mit à solliciter le commandement de l’armée de Nice. Barras, qui voulait se perpétuer au pouvoir, ne se souciait plus de lui être utile. Carnot, véritable patriote, espérant d’ailleurs le diriger, le prit sous sa protection.
MM
Voici quel était alors l’état militaire de la république : onze armées étaient sur pied, trois des quatorze précédemment établies ayant été supprimées. Celle du NORD : général en chef. Moreau ; généraux divisionnaires: Depeau, Desjardins, Dubois, Landremont, Macdonald.

S »
à
I-
■I
A
Je
a i
fiM k*
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 219
Souham et Songis. De Sambre-et-Meuse : général en chef, Jourdan; généraux divisionnaires: Bernadotte, Bonnard, Collaud, ChampionneL Dumas, Ernouf, Grenier, Harville, Haty, Kléber, Lefèvre, Marceau, Micas, Montaigu, Marlot, Picot-Barras, Poncet, Tilly. De Rhin-et-Moselle : général en chef, Pichegru; généraux divisionnaires: Humbert,Beaupuy, Bussière, Boursier, Courlot, Delmas, Desaix, Dufour, Ferraud, Férine, Gouvion, Laborde, Lapuns, Liébert, Mengaut, Mi-quelet, Michaud, Montagne, Renaud, Schauenbourg, Scuhas, Tamponnier. Des Alpes : général en chef, Kel-lermann ; généraux divisionnaires : Berthier , Ghapsal, Moulin, Pallaprat, Petit-Guillaume, Mont-Choisy, Joseph-Marie, Casablanca. De l’OüEST : général en chef, Hoche ; généraux divisionnaires : Beauregard , Gaffin , Chalbos, Dambarrère, Dessein, Durepaire, Grouchy, Guyot, Marbot, Vimeux, Willot. Côtes de Brest: général en chef, Pérignon ; généraux divisionnaires : Chabot, Dubois-Crancé, Duchéne, Rey, Tunq. Côtes de CHERBOURG : général en chef, Berrichon ; généraux divisionnaires : Dumesn'ú, Du^ua., G\]\ot, Kau, Muller, Piloté-la-Basrollier. Intérieur : général en chef, Bonaparte ; généraux divisionnaires : Berruyer, Châteauneuf-Randon, Dupont-Chaumont, Favereau, Foissac-La-tour, Huet, Kricy, Laubardère, Leclerc, Pillet, Vial. Du Midi : général en chef, N......; général divisionnaire : Haquin. D’Italie : général en chef, Schérer ; généraux divisionnaires: Augereau, Charlet, Fonbonue, Freytag, Gautier-Kervegan, Gentilly, Haquin, Kil-maine , Labayette , La Harpe , Mocquart, Puget-Barbantane, Masséna, Meynier , Serrurier, Stengel.
Parmi ceux qui sollicitaient le commandement de l’armée d’Italie, Bonaparte avait d’illustres concur-

i

220 HISTOIRE [1796.]
rents : le vertueux, l’héroïque Marceau, dont la belle ligure était le miroir de son Ame; Championne!, général d’avant-garde, téméraire, entreprenant, et compensant par l’audace et l’intrépidité de l’attaque ce qui lui manquait en génie et en conceptions supérieures; Bernadotte, leur émule en vaillance, leur supérieur en habileté, et aussi grand administrateur que bon général.
C’étaient, comme on voit, des rivaux redoutables. La nonchalance de Barras, la vivacité de Carnot, décidèrent enfin le choix en faveur de Bonaparte. Sa nomination, qui date du 23 février 1796, ouvre la carrière de la gloire à ce grand homme, comparable aux plus célèbres de l’antiquité.
fri o H ' ., r. i u f (Kf
-& nnyC^-^ jłwbrml

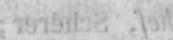
¿ThboJ ,3*. in.
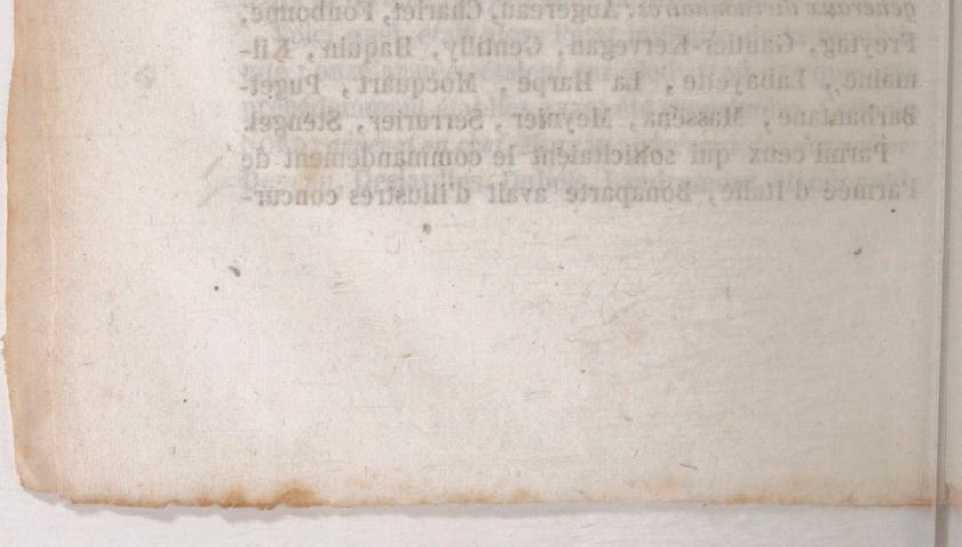
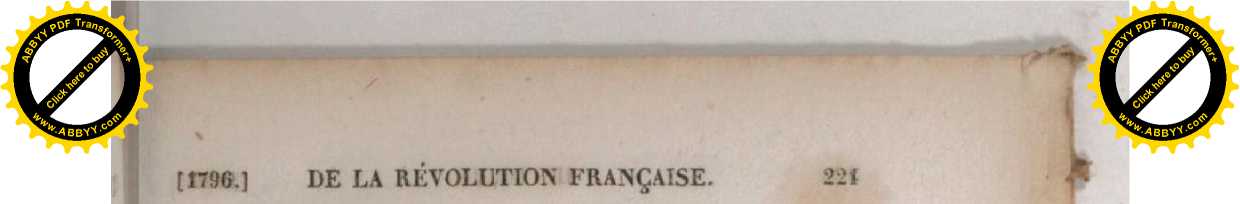
Départ de Bonaparte pour l’armée d'Italie.— Par qui il est accompagne.— Pénurie de celte armée. — Son effectif. — Les Austro-Sardes. — Le Piémont.— Le Milanais.—Venise — Gènes.— Panne.— Modène.— La Toscane.—Lucques.—Rome.— Sainl-.Marin.— Naples.— Malte. — Entrée eu campagne. — Proclamations. — Victoires de Montenotte, de Mdle-simo; de Dego (double), de Ceva. — Lannsse.— Latines.— L’Italie montrée aux Français. — Proclamation de Napoléon. — Armistice avec le roi de Sardaigne. — Première campagne finie en moins d’un mois. — Seconde campagne.— Autres victoires. — Paix avec les ducs de Parme et de Modène. — Un tableau et trois millions. —Conquête du duché de Milan. — Fin de la deuxième campagne et» quinze jours. — Révolte de Pavie. — Conquête des trois légations. — Le homard et vade retío Sotanas, anecdote. — Le chevalier Azzara. — Traité avec Pie VI.
Napoléon Bonaparte, appelé, le 23 février !796, au commandement en chef de l’armée d’Italie, marié le 8 mars suivant , impatient de cette renommée que son génie et la victoire lui montraient en perspective, quitta Paris le il mars. Il avait donné trois jours au bonheur et à l’amour, car il adorait sa femme ; mais le devoir parlait encore plus haut que la passion.
La pénurie du trésor national était telle, que Bonaparte ne put emporter avec lui que quarante-huit mille francs en or et un million en lettres de change : c’était toute la caisse de l’armée. Ses aides-de-camp étaient Louis, son frère, Junot, son ami, Marmont, Lemar-rois, Muyron. Le général Leclerc le suivit; le père Patraud, oratorien, était son secrétaire ; plus tard il lui adjoignit Bourricnne, et ce ne fut pas sans avoir à s’en repentir.
Six divisions composaient cette armée : quatre din-fanlerie aux ordres de Masséna , Augereau. La Harpe^

¿■2i
HISTOIRE

[1796.]
Serrurier; deux de cavalerie, ayant pour chefs Sten-gel et Kilmaine. Trente mille hommes au plus étaient présents, et les états du ministère de la Guerre portaient un effectif de cent six mille hommes. Cette énorme différence avait aidé aux dilapidations de Schérer et des fournisseurs.
Dès la première revue, on effaça d’un trait de plume trente mille morts, prisonniers ou déserteurs et vingt mille disséminés en Provence. Des cinquante mille restants, cinq mille étaient dans les hôpitaux, huit mille aux dépôts; le reste était épars dans des bicoques appelées places de guerre. Restaient donc vingt-cinq mille fantassins, deux mille cinq cents cavaliers de toute arme et le même nombre d’artilleurs, désorganisés, timides, incertains, manquant de vêtements, de chaussure, souvent de vivres, n’ayant en réserve ni canons, ni munitions de guerre, disposés à la mutinerie et bien convaincus de la perfidie et de la friponnerie de leurs chefs.

Deux armées nous étaient opposées, celle*du roi de Sardaigne et celle de l’Empereur, ayant une parfaite connaissance des lieux et soutenues par le bon vouloir des populations. Quatre divisions, dont une d’artillerie, composaient l’armée piémontaise, forte de vingt-cinq mille hommes et de soixante canons ; Latour et Provera lacommandaientsous la direction suprême du vieux général autrichien Beaulieu. L’autre armée était divisée en quatre corps de quarante-deux bataillons, de quarante-quatre escadrons formant quarante-cinq mille hommes, avec cent quarante bouches à feu ; ses généraux étaient Mercy-d’Argenteau , Mêlas, Wulkassowich , Lyptay et Sebalters-Dars, plus un corps de Napolitains auxiliaires et d’émigrés. Ces forces
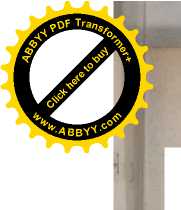
[1790.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
223
li
réunies ne formaient pas moins de soixante-dix à quatre-vingt mille hommes, bien tenus, opposés à trente mille sans discipline et sans munitions. Mais Bonaparte arrivait : sa présence vaudrait une armée.
L’Italie, à cette époque, était divisée de la manière suivante : Le royaume de Piémont, ayant quarante millions de revenus et soixante raille hommes de bonnes troupes, et pour places fortes La Brunette, Suze, Fénestrelle, Bard, Tortone, Gherasco, Turin, Alexandrie, et environ trois millions d’habitants ; son roi Vic-Lor-Aroédéeétait économe, pieux, énergique et plein de courage.
A l’est du Piémont et au nord de l’Italie s’étendait le Milanais, possédé par la maison d’Autriche (1). Milan était la capitale de ce beau duché, où vivaient douze cent mille âmes et où l’on attendait les Français comme des libérateurs. François II, empereur d’Allemagne, roi de Bohême, de Hongrie, etc., était le souverain de cette belle province , défendue, ainsi que je l’ai dit, et gardée par les Autrichiens.
Assise à l’ouest, sur le littoral de l’Adriatique, et sa capitale au milieu des eaux, la république de Venise. riche de trois millions de sujets, essayait une neutralité désarmée qui la perdit. Plus avant, et sous le duché de Milan, le Piémont et les états de terre ferme appartenants à Venise, on trouvait à l’ouest la république oligarchique de Gênes, où cinq cent mille habitants obéissaient à un petit nombre de nobles. Là, non plus
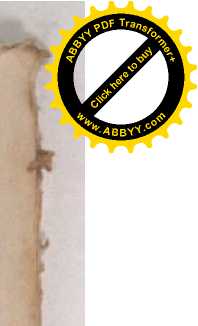
(I) La France avait des prétentions sur ce duché à cause du mariage de la fille de Louis XII avec Galéas Visconli. Charles— Quint occupa cet état, devenu sa propriété par droit de succession.

HISTOIRE
[1796J

qu’à Venise, point d’année, là encore une neutralité, et de plus des sympathies en faveur des Français, dont Bonaparte sut profiter. •
A côté de Gènes étaient les duchés de Panne et de Plaisance; là régnait un Bourbon , arrière-petit-fils du duc de Bourgogne et petit-fils de Philippe V, roi d’Espagne. Cinq cent mille habitants, point d’armée, peu d’énergie, une soumission promise d’avance au vainqueur ; telle était la situation de ces états.
Après ces principautés venait le duché de Modène, gouverné par le dernier prince de la maison d’Este. L’AutriAæ allait recueillir cette succession en nu tu du mariage de l’archiduc Ferdinand avec la princesse Beatrix, fille du duc régnant. Ce prince , énormément riche, avait mis ses trésors à couvert ; son armée était de six mille hommes, et le nombre de ses sujets s’élevait à cinq cent mille.
A Lucques, petite république, quarante à cinquante maisons nobles gouvernaient cent cinquante mille bourgeois ou paysans.
La Toscane, au centre de l’Italie, admirable par sa fécondité, peuplée de douze cent mille âmes .avait pour souverain l’archiduc autrichien Ferdinand - Jean-Joseph, prince habile, sage, éclairé , libéral et économe. Adoré de son peuple, il n’avait également point d'armée.
Venaient ensuite les États du pape, peuplés de deux millions six cent mille âmes. Pie VI, père commun des fidèles, régnait alors; la fatalité le contraignit à combattre la France ; il lui eu coûta cher.
Perdue au milieu des États romains, la république démocrate de Saint-Marin ne comptait pas ; ses sept à huit mille citoyens, tous égaux, tous libres,
[1706.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 225 vivaient dans une heureuse et obscure médiocrité.
Enfin, à l’extrémité de l’Italie , on rencontrait le royaume uni de Naples et de Sicile, habité par six millions d’individus, dont quinze cent mille Siciliens. Là régnait un autre Bourbon, Ferdinand II. frère du roi d’Espagne Charles IV, marié à l’archiduchesse, sœur de l’infortunée Marie-Antoinette. Son armée était de soixante mille hommes de mauvaises troupes, bonnes pour la parade en temps de paix et promptes à fuir au moment du danger.
Plus avant dans la mer Méditerranée, s’élevait au-dessus des flots Pile de Malte, où cent mille habitants reconnaissaient pour prince le grand-maître de l’ordre hospitalier et religieux de Saint-Jean de Jérusalem. S. F. Don Ilompeche était le souverain de cet ordre, que sa lâcheté perdrait bientôt après.
Telle était la division de l’Italie, où les nobles, les prêtres verraient entrer les Français avec effroi, mais où les appellerait le reste de la population, et même, il faut l’avouer, la portion la plus éclairée.
Bonaparte, pour assurer sa droite, et plus tard ses derrières, épouvanta le gouvernement génois, qui n’agit plus que d’après son impulsion. Il était arrivé à Nice le 17 mars, et dès le premier jour, pour rompre des habitudes de paresse, il transporta le quartier-général à Albenga, manda les fournisseurs ordonnateurs, commissaires des guerres, gardes-magasins, leur signifia ses intentions, leur parla de probité, mot nouveau à leur oreille, et pour le leur mieux inculquer, il lit fusiller les premiers fripons qui furent pris en flagrant délit. Ce même jour qu'il employa si bien, il adressa à l’armée la proclamation suivante : .

*

226
HISTOIRE
[1796.1

a Soldats !
« Vous êtes nus, mal nourris; le Gouvernement vous « doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre pa-« tience, le courage que vous montrez au milieu de « ces rochers, sont admirables ; mais ils ne vous pro-« curent aucune gloire ! Aucun éclat ne rejaillit sur « vous. Je veux vous conduire dans Les plus fertiles « plaines du monde; de riches provinces, de grandes « villes, seront en votre pouvoir : vous y trouverez « honneur, gloire et richesse! Soldats d’Italie, man-« queriez-vous de courage et de constance !
« Bonaparte. »
Les effets répondirent aux paroles. Trompés par une tactique savante, les Austro-Sardes crurent que Bonaparte marcherait sur Gênes; ils firent des dispositions en conséquence, mais ils eurent à s’en repentir. Le 10 avril, la campagne s’ouvrit. Le 12, la victoire de Montenotte, à laquelle Augereau, Masséna, Cer-voni, La Harpe, prirent part avec le colonel Ram-pon, ouvrit la route du Piémont. Le général autrichien , Mercy-Argenteau, y perdit deux mille prisonniers, cinq pièces de Canon, quatre drapeaux, laissant le champ de bataille jonché de cadavres.
Le 14, Bonaparte battit à Millesimo le général sarde Provera, et à Dego, Beaulieu; outre les morts restés sur le Champ de bataille, six mille prisonniers, deux généraux, vingt-quatre officiers supérieurs, trente canons, soixante caissons et quinze drapeaux tombèrent en notre pouvoir.
Ces trois combats décidaient déjà la campagne. Les Piémontais fuyaient d’un côté, les Autrichiens conster-

nés se reliraient de l’autre. Le 15 du même mois, une
nouvelle affaire eut lieu qui compléta ce beau ré- -
sullat.
Dans cette journée, un chef de bataillon déploya une bravoure héroïque et une intelligence supérieure. « Comment te nommes-tu? lui dit Bonaparte. — Lannes. — Je te fais colonel. — Grand merci, général, quoique je le mérite ; je n’en continuerai pas moins à agir comme si j’avais ma réputation à faire. — Tu es Gascon. — Un peu, et je m’en vante. »
Tel fut le début militaire de l’illustre maréchal de France, duc de Montebello.
Le 17, Colli fut vaincu dans le camp retranché de Ceva. Les divers corps français, conduits par Bonaparte, escaladèrent les sommets de Montezemote.... Un cri de joie, d’admiration, d’orgueil, leur échappa : la belle Italie se développait devant eux en ce moment. Habile à mettre à profit les circonstances, Bonaparte, -élevant la voix, dit anx braves qui l’environnaient :
« Soldats, voilà l’Italie : Annibal a jadis forcé les « Alpes, nous venons de les tourner ; il ne put faire « ce que nous avons fait. Maintenant nous ne serons « plus arrêtés que par des hommes ; ce ne sera pas « un obstacle pour nous. >
Après un peu de temps donné au repos, à l’allégresse, aux fanfares, aux acclamations, aux chants de triomphe , le signal de descendre le revers de la montagne est donné ; nous franchissons le Tanaro. Serrurier, le 22, bat Colli à Mondovi; mais cette victoire nous coûte le brave général Steingel. Tant de succès répandent au loin la terreur ; la ville forte de Cherasco pouvait se défendre ; elle ouvre ses portes : cette ville n’est qu’à dix lieues de Turiu. La frayeur gagne .


la capitale, et Bonaparte, qui la menace, adresse à son armée la proclamation suivante :
« Soldats, vous avez en quinze jours remporté six « victoires, pris vingt-un drapeaux, cinquante-cinq « canons, plusieurs places fortes.... fait quinze mille « prisonniers, tué ou blessé plus de dix mille hom-« mes.....Vous avez gagué des batailles sans canons, « passé des rivières sans ponts, fait des marches for-« cées sans souliers, bivouaqué sans eau-de-vie et « surtout sans pain.... Mais, soldats, vous n’avez rien « fait puisqu’il vous reste encore à faire. Ni Turin ni « Milan ne sont à vous.... Les vainqueurs de Monte-« notte, de Millesimo, de Dego, de Ceva, de Mondovi, a brûlent de porter au loin la gloire du nom fran-« cais.... Toits veulent, en rentrant dans leur village, « pouvoir dire avec fierté : J’étais de Calmée conqué-« rante d'Italie.
« Amis, je vous la promets, cette conquête ; mais il < est une condition qu’il faut que vous juriez de rem-« plir : c’est de respecter les peuples que vous déli-« vrez, c’est de ne pas vous livrer au pillage..... Vos « victoires, votre courage, vos succès, le sang de vos « frères morts au combat, tout serait perdu, même « l’honneur et la gloire..... Je ne souffrirai pas que < des brigandages souillent vos lauriers ; les pillards « seront impitoyablement fusillés.....
« Peuples de l'Italie, l’année française arrive pour « rompre vos chaînes.... Venez avec confiance au-de-« vaut de nos drapeaux ; vos propriétés, votre croyance < et vos usages seront religieusement respectés....
« Bonaparte. »
A Turin, la cour tremblait ; le cardinal archevêque Costa supplia le roi, au nom du peuple, de faire la
[Hí)«.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 229 paix. Victor-Amédée dépêcha vers Bonaparte le ministre dirigeant Latour, qui, tout en voulant la guerre, fut contraint de signer un armistice qui nous livra les citadellesdeCeva, de Goni, de Tortone et d’Alexandrie; d’après ees préliminaires, les routes militaires seraient ouvertes dans le Piémont entre la France et l’année d’Italie, Valenza, évacuée par les Napolitains, nous serait remise, et le roi enverrait sur-le-champ un ambassadeur à Paris, à l’effet de transformer en traité de paix cet armistice; il s’engagerait, en outre, à rompre subitement et pour toujours avec la coalition. Le Directoire ajouta à ces conditions celle de la démolition prompte et complète des fortifications de Suze, de La Bru-nette et d’Exiles : c’était ouvrir le Piémont à la France. Ce traité fut signé le 17 mai.
Cette brillante campagne, achevée avec tant d’éclat et de gloire, n’avait pas demandé trente jours, du 27 mars au 24 avril. Bonaparte, dans ce laps de temps , avait battu et séparé deux armées défaites en sept rencontres, conquis presque en entier un royaume, et ce royaume n’existait plus que par sa volonté. La terreur planait sur tout le Piémont; Gênes était effrayée. la Haute-Italie stupéfaite, l’Allemagne attentive à ce que nous allions faire : tels étaient les grands résultats de nos triomphes.
Un général ordinaire se serait reposé après tant de victoires ; mais Bonaparte ne les regarda que comme le premier échelon de sa renommée. Le 7 mai, les troupes françaises, traversant le Pô, commencèrent la deuxième campagne> et nos troupes, stimulées par leur général en chef, après une marche forcée. arrivèrent en trente-six heures devant Plaisance. Le Pô franchi, libre de tout ennemi, malgré sa largeur


230
HISTOIRE
[1796.]

de deux cent cinquante toises, ses grosses eaux et sa rapidité, on atteignit le lendemain, 8 mai , la division autrichienne de Liptay. Lannes, Lanusse et Dalle-magne la battirent à plate couture et lui enlevèrent deux mille cinq cents prisonniers, trois drapeaux et son artillerie. Liptay se réfugia sous la forteresse de Pizzighettonc.
Un combat à Rombio vint encore ajouter à nos succès; il nous coûta cher : le vaillant général La Harpe y perdit la vie. La veille de ce jour fatal, La Harpe s’était montré triste, abattu, découragé, tout autre qu’il n’était, et au moment du combat, il ne put donner aucun ordre ; incapable de lâcheté, le pressentiment de sa lin prochaine semblait le dominer.
L’infant duc de Parme , apprenant l’entrée des Français dans ses états, demanda la paix ; il l’obtint aux conditions suivantes : « Payer deux millions comp-« tant; fournir dix-sept cents chevaux, deux mille « bœufs, dix mille quintaux de blé, cinq mille quin-« taux d’avoine; nous livrer vingt tableaux de sa col-« lection, au choix des commissaires français. »
Parmi ces chefs-d’œuvre des arts était la célèbre Communion de saint Jérôme, du Corrége. L’infant lit offrir à Bonaparte, en retour de ce chef-d’œuvre qu’il voulait garder, deux millions ostensibles, et. un autre million, qui serait versé dans la caisse privée du général en chef, pour les besoins de l'armée. Bonaparte répondit : « La République n’a pas besoin de deux mil-« lions de plus; s’ils lui étaient nécessaires, elle les « exigerait de ses ennemis, et non d’un prince qui « s’allie avec elle. Deux millions seraient bientôt dis-« sipés; le chef-d’œuvre du Corrége demeurera en « témoignage des conquêtes de la’France. »

[1796.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
231

Bonaparte ne daigna pas mentionner le million qu’on lui offrait d’une manière détournée.
La frayeur gagna le duc de Modène ; il se sauva à Venise, et de là lit négocier la paix par son frère naturel. Elle lui coûta dix millions et vingt tableaux précieux.
Cependant la guerre continuait activement contre la maison d’Autriche. Le 10 mai, Bonaparte remporta la célèbre bataille du pont de Lodi, sur l’Adda. Beaulieu vaincu se retira sur Mantone et dans les états de Venise , dont il força la neutralité, et le duché de Milan tout entier devint notre conquête.
Les Milanais allèrent avec des lauriers, des palmes et des guirlandes, au-devant du vainqueur. La députation , composée des principaux habitants de la ville, avait à sa tête le comte François Melzi d’Eril, à qui Bonaparte, digne appréciateur de son mérite, fit faire une si belle fortune. Milan , en signe d’union avec la France, adopta trois couleurs, le vert, le rouge et le blanc. Le duc Serbelloni commanda la garde nationale. Cette conquête, commencée le 7 mai, fut complétée le 15 par l’occupation de la capitale. •
Six jours de repos furent accordés à l’armée; le septième, elle était en marche. Mais lorsqu’on crut Bonaparte éloigné, Pavie s’insurgea, le tocsin sonna dans Milan même; les fanatiques s’armèrent, attaquèrent nos blessés, nos malades et nos soldats isolés ; le sang français coula. Aussitôt, chargé d’ordres terribles, l’intrépide Lannes marcha contre les Pavésans ; le bourg de Bcnasco, sur la route, avait fait périr dans des supplices affreux un grand nombre des nôtres. Huit cents hommes qui le défendaient furent passés au fil de l’épée, et Bcnasco, livré tout entier aux


232 HISTOIRE [1796.] flammes, devint un exemple terrible de la juste vengeance des vainqueurs.
Pavie s’humilia; les insurgés l’évacuèrent, mais ils furent taillés en pièces dans la campagne. Bonaparte pardonna, à la vue des notables de la ville et des municipaux, qui, tous la corde au cou, vinrent implorer sa pitié; il se contenta d’exiler cent nobles Pavé-sans à Paris.
Poursuivant le cours de ses succès en dépit des Autrichiens, Bonaparte se saisit de Brescia, ville faisant partie des états vénitiens. Le doge voulut, par ses ambassadeurs, réclamer la neutralité; on leur répondit par du persilïlage, et on ne tint aucun compte de leur lâche démarche. Le 30 mai, Borglietto, défendu par les Autrichiens, fut enlevé par une charge brillante, qui commença glorieusement la réputation de Murat. Le combat de Volcgio, gagné par Gardanne, augmenta l’avantage de notre position. Enfin, Vérone, ville des États vénitiens, fut occupée militairement le 3 juin : ici recommencèrent les doléances du gouvernement de cette république; le vainqueur n’en tint aucun compte.
Pendant que l’armée poursuivait Beaulieu, en pleine retraite pour sortir de l’Italie, Bonaparte faisait investir Mantoue et commencer le siège de celle place forte, qui était la clef principale de la Haute-Italie. D’un autre côté, il faisait marcher des troupes afin de s’emparer des trois légations romaines, Bologne. Ferrare et Rimini (1).
(1) Augereau commandait coite dernière expédition; il la conduisit avec tant de promptitude, que le cardinal L. G., gouverneur

(1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 23»
Cependant l’épouvante qui s’emparait tour à tour des souverains italiens gagna le Saint-Père. Ce vénérable vieillard, voulant, lui aussi, la paix à tout prix, j. I ------------------------------------------------------------------!----- de Bologne, n’ayant pas eu le temps de se sauver, attendit le général avec une frayeur difficile à exprimer. Résigné au martyre, il s’était mis eu grand costume épiscopal; sou clergé autour de lui récitai t les prières des agonisants, lorsqu’Augereau, entrant dans la salle d'audience, s’écria, à la vue de ce pieux spectacle :
« Mille tonnerres ! est-ce qu'ici c'est la mode de dire la messe à < cinq heures du soir? Eh! citoyen cardinal, vous aurez demain < tout loisir de dépêcher vos oremos. Maintenant parlons d’affaires. « Et vous autres gamins, poursuivit-il en s'adressant aux jeunes ■ clercs, fichez le camp avec ces vieux pères; j’ai besoin de dire un < mot tête à tète au citoyen cardinal.... Allons donc, rats d’église, « détalez; avez-vous peur queje mange à moi seul le homard? * C’était „on Éminence en robe rouge qu'il qualifiait ainsi. Persuadé que tout Français non royaliste était un anthropophage, altéré de la pose toute militaire qu'avait prise Augereau pendant le défilé sacerdotal, le cardinal, de plus en plus mal à son aise, répétait à mi-voix : Va.de retro, Sotanas, paroles qui surprirent Augereau , sans qu’il en comprit le sens. Enfin, quand le prince de l’Église se vit seul avec cet ogre féroce, il éleva la voix, poussa un long soupir, et, faisant un signe de croix, il dit ; In inanus tuas, Domine.
« Ah! tu es dominé, repartit le général; ch bien! citoyen cardinal, c’est aussi pour cela que les Français sont venus : vous autres avez assez fait vos farces, il est temps que le peuple fasse les siennes. En attendant, je viens te demander.... poliment.... là.... comme il convient à de bons enfants, d’engager tout ton bataclan de prêtres, de prétraitions, de moines et moinesses, de prier Dieu eu public pour la bonne santé de la République française. Je crois bien que cela ne lui fera ni froid ni chaud; mais ici il y a des imbéciles qui s’imaginent qu’un cautère sur une jambe de bois est bon à quelque chose.
« —Il faut prier Dieu pour les pécheurs, repartit le cardinal. de plus en plus terrifié d’un pareil langage.
« — Et pour les militaires français, dit Augereau, pour les braves

Î34 ' HISTOIRE [17%.]
dépêcha à Bonaparte le chevalier Azzara, ambassadeur d’Espagne près la cour de Rome. Il n’avait pu choisir un négociateur plus habile, plus aimable et

troupes de terre; car quant à la marine, je m’en..... tourmente comme.... (Je ne peux transcrire la comparaison.)
« — Et si je donne l’ordre que vous exigez , eccellenza généralissime, me laisserez-vous rentrer à Rome, auprès du pape, sain et sauf?
« —Pour sain, c’est tou affaire de deux façons; pour sauf, c’est la mienne, et si en route on arrache un poil de ta moustache, quoique tu n’en aies pas, je passerai au fil de ce sabre cinq cents maraudeurs. Allons, houp! conte ta drôlerie; je veux demain tout plein de grand'messes, de vêpres, de processions et le reste, afin que les Bolonais sachent que nous sommes amis comme des grillons avec le Ciel. »
Augereau avait certainement ajouté quelques bouteilles de vin à sa grossièreté ordinaire. C’était au reste, de toute l’armée, le militaire le plus grossier de formes et de paroles, et si n’était que cette anecdote peint les hommes de l’époque ( les Jacobins ), j’aurais rougi de la rapporter.
Le cardinal, toujours effrayé, fit ce que le général voulut, et partit ensuite. Augereau, de retour auprès de Bonaparte, et croyant avoir donné â l’Éminence une haute opinion de son urbanité , termina sa narration en disant :
« Je n’ai compris que la moitié du latin de cuisine de ce vénérable homard (il tenait au mot), car lors de mon entrée ü marmottait un vade retro. Sotanas, ce qui signifie certainement quelque chose d’honnête. Peut-être en latin cela veut-il dire : Bonjour, citoyen général.
a —C’est, répondit malignement Bonaparte, que le cardinal te disait en douceur : Va-t’en au diable, fils de Satan. — Morbleu, s’écria Augereau courroucé, si je m’en fusse douté, j’aurais ni outré la politesse A ce rougeot mal élevé, au moyen d’une fenêtre ouverte ou de toute autre semblable douceur.... Mais qu’il retombe sous ma patte, je lui ferai voir.... Moi, diable’.... moi, le meilleur enfant du faubourg Saint-Marceau!.... Citoyen général, ajouta-t-il, j’aime tant les prêtres, que s’il n’y avait au monde qu’un abbé et moi, le monde finirait. ( Mémoires de Napoléon, tome II. )
L. L. L.
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 255 qui plût davantage. Azzara se faisait chérir de tous ceux qui le voyaient (1).
Bonaparte, qui vénérait Pie VI, laissant de côté les instructions sévères, les insinuations haineuses du Directoire conseillé et influencé par la jalousie de Laré-veillère-Lepaux, dicta les conditions suivantes, qui. acceptées, devinrent la base du traité de Tolentino, signé le 19 février 1797. En attendant, la conclusion d’un armistice tranquillisa momentanément le Saint-Père.
Les clauses principales de cet armistice étaient :
« L’occupation de Bologne, de Ferrare et de Ri-« mini, par l’armée française. — Une garnison dans « la citadelle d’Ancône. — Le pape paierait en muni-« tions, chevaux, vivres et argent, une contribution « de vingt-un millions. — Il céderait au Musée de « Paris cent tableaux ou statues, au choix des commis-« saires de la République. — Enfin, il enverrait très-« prochainement un ministre plénipotentiaire à Paris, « pour traiter de la paix définitive. »
C’était agir en vainqueur sage. La France applaudit, le Directoire murmura. Laréveillère, qui avait élevé ses tréteaux de théophilanthrope , aurait voulu que le chef de la chrétienté fût immolé à sa ridicule religion , prétendue morale.
Bonaparte, en traitant si rapidement avec la cour de
( 1) Bonaparte, dont il avait les bonnes grâces, lui dit un jour, dans une explosion d’enthousiasme : a Chevalier, vous vous feries aimer de Salant
» — Hélas ! -epartil Azzara, il est malheureux, je le plaindrais, je tâcherais de le raccommoder avec Dieu le père, et pour peu qu’il voulût être honnête homme.... Vous riez, mais enfin Satan est bien ué et a dû être très-bien étevê. » L. L. L.
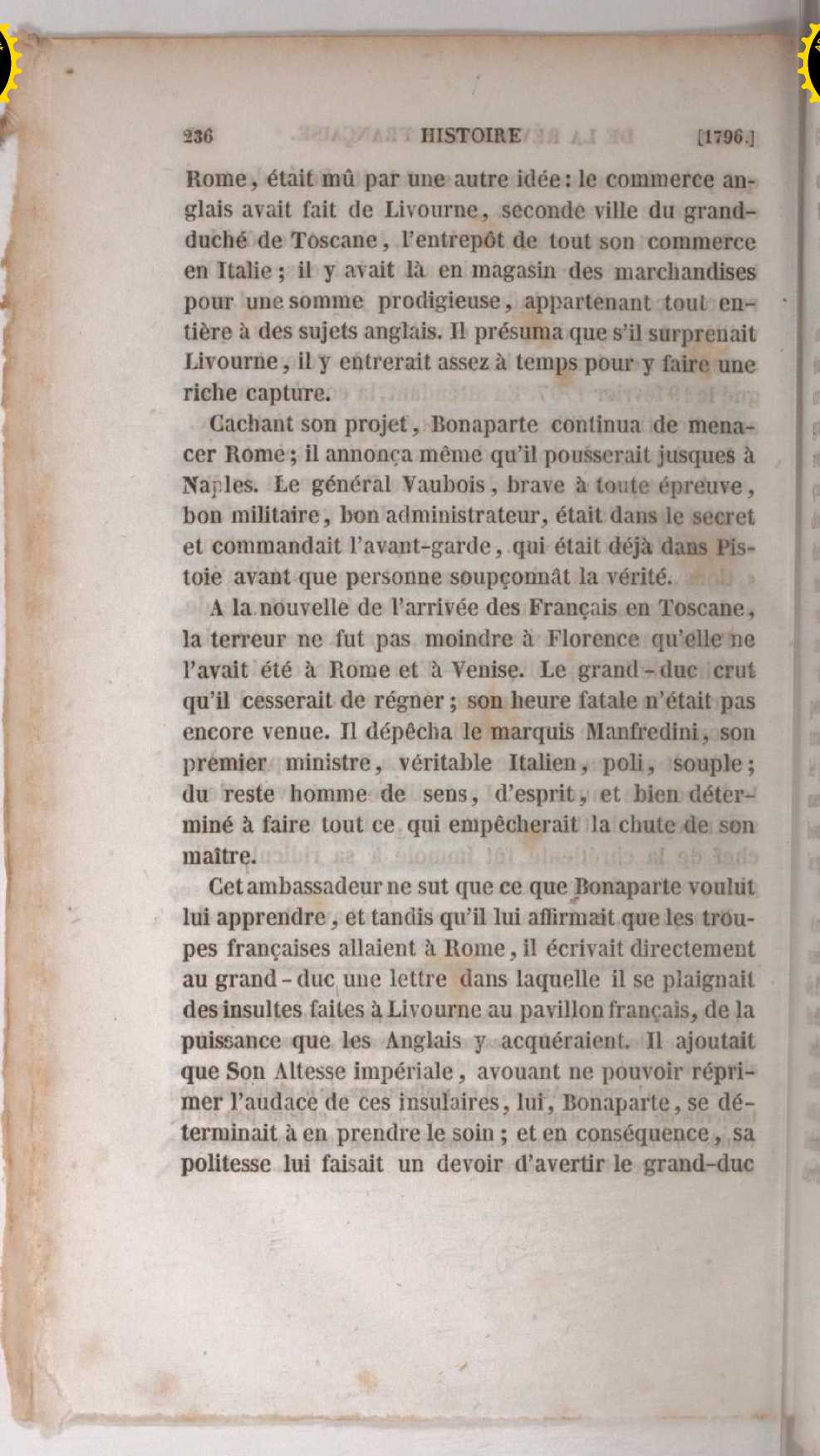
Rome, était mû par une autre idée: le commerce anglais avait fait de Livourne, seconde ville du grand-duché de Toscane, l’entrepôt de tout son commerce en Italie ; il y avait là en magasin des marchandises pour une somme prodigieuse, appartenant tout entière à des sujets anglais. Il présuma que s’il surprenait Livourne, il y entrerait assez à temps pour y faire une riche capture.
Cachant son projet, Bonaparte continua de menacer Rome ; il annonça même qu’il pousserait jusques à Naples. Le général Vaubois, brave à toute épreuve, bon militaire, bon administrateur, était dans le secret et commandait l’avant-garde, qui était déjà dans Pistole avant que personne soupçonnât la vérité.
A la nouvelle de l’arrivée des Français en Toscane, la terreur ne fut pas moindre à Florence qu’elle ne l’avait été à Rome et à Venise. Le grand-duc crut qu’il cesserait de régner ; son heure fatale n’était pas encore venue. Il dépêcha le marquis Manfredini, son premier ministre, véritable Italien, poli, souple ; du reste homme de sens, d’esprit, et bien déterminé à faire tout ce qui empêcherait la chute de son maître.
Cet ambassadeur ne sut que ce que Bonaparte voulut lui apprendre, et tandis qu’il lui ailirniait que les troupes françaises allaient à Rome, il écrivait directement au grand-duc une lettre dans laquelle il se plaignait des insultes faites à Livourne au pavillon français, de la puissance que les Anglais y acquéraient. Il ajoutait que Son Altesse impériale, avouant ne pouvoir réprimer l’audace de ces insulaires, lui, Bonaparte, se déterminait à en prendre le soin ; et en conséquence, sa politesse lui faisait un devoir d’avertir le grand-duc
HISTOIRE
[1796]
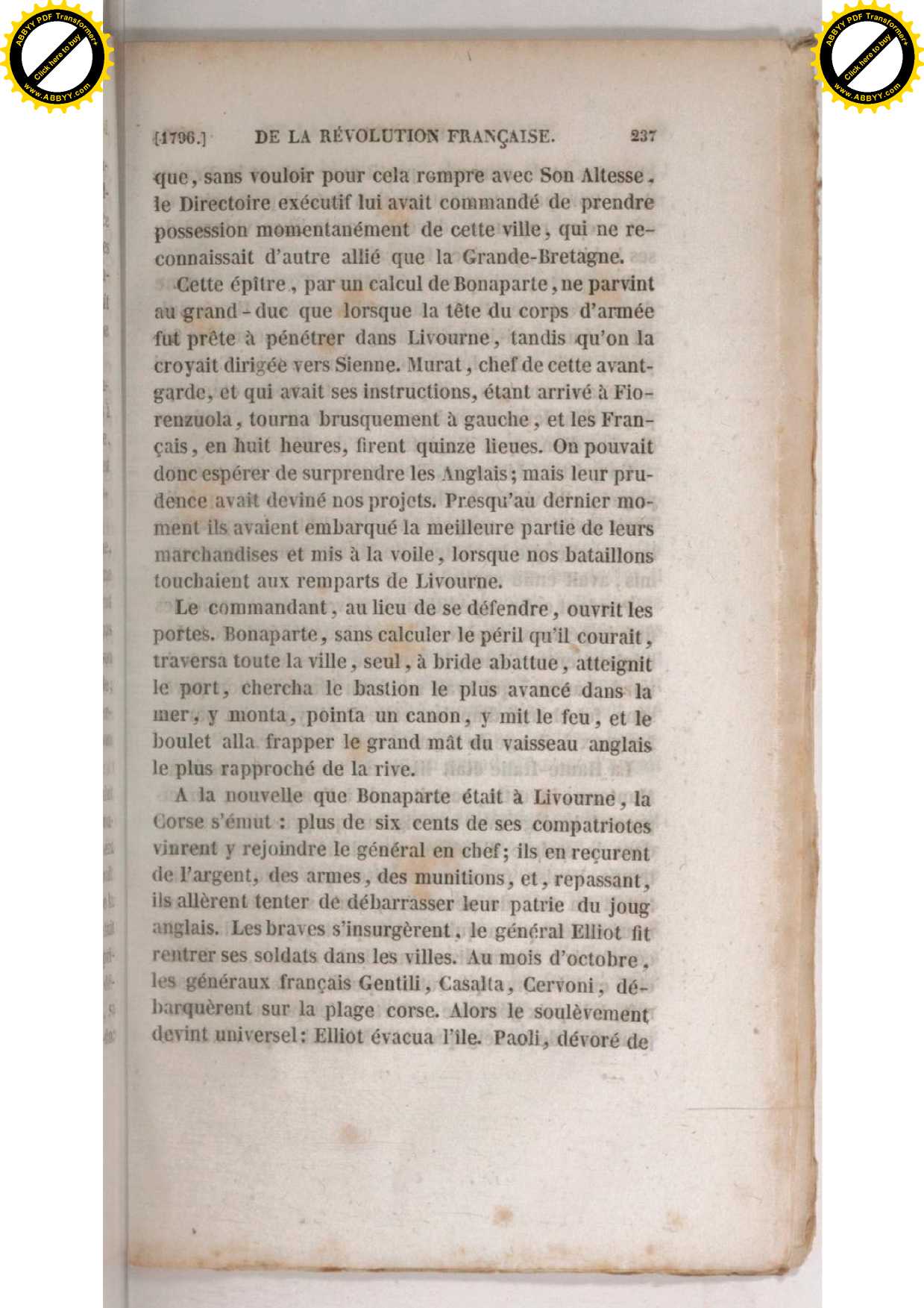
que, sans vouloir pour cela rompre avec Son Altesse, le Directoire exécutif lui avait commandé de prendre possession momentanément de cette ville, qui ne reconnaissait d’autre allié que la Grande-Bretagne.
Cette épître, par un calcul de Bonaparte, ne parvint au grand-duc que lorsque la tête du corps d’armée fut prête à pénétrer dans Livourne, tandis qu’on la croyait dirigée vers Sienne. Murat, chef de cette avant-garde, et qui avait ses instructions, étant arrivé à Fio-renzuola, tourna brusquement à gauche, et les Français, en huit heures, firent quinze lieues. On pouvait donc espérer de surprendre les Anglais; mais leur prudence avait deviné nos projets. Presqu’au dernier moment ils avaient embarqué la meilleure partie de leurs marchandises et mis à la voile, lorsque nos bataillons touchaient aux remparts de Livourne.
Le commandant, au lieu de se défendre, ouvrit les portes. Bonaparte, sans calculer le péril qu’il courait, traversa toute la ville, seul, à bride abattue, atteignit le port, chercha le bastion le plus avancé dans la mer, y monta, pointa un canon, y mit le feu, et le boulet alla frapper le grand mât du vaisseau anglais le plus rapproché de la rive.
A la nouvelle que Bonaparte était à Livourne, la Corse s’émut : plus de six cents de ses compatriotes vinrent y rejoindre le général en chef; ils en reçurent de l’argent, des armes, des munitions, et, repassant, ils allèrent tenter de débarrasser leur patrie du joug anglais. Les braves s’insurgèrent, le général Elliot fit rentrer ses soldats dans les villes. Au mois d’octobre. les généraux français Gentili, Casaba, Cervoni, débarquèrent sur la plage corse. Alors le soulèvement devint universel: Elliot évacua Tile. Paoli, dévoré de
{1796.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
237
238 HISTOIRE [1796.]
chagrins et de remords, partit avec lui, et la France dut à Bonaparte sa réintégration dans la possession de cet ancien royaume, devenu, par la libre volonté de ses habitants, province française.
Bonaparte, vainqueur, établit en Toscane , comme dans le reste de l’Italie, une police sévère. Il poursuivit avec une activité infatigable les fournisseurs, les fripons; mais c’était lutter contre forte partie. Ceux-ci ne se lassèrent pas non plus de le tromper, étant appuyés dans leurs extorsions par le Directoire, toujours dominé d’un esprit d’agiotage et de dilapidation.
Eu quittant Livourne, Bonaparte, assez mal accompagné, alla visiter à Florence le grand-duc, qui l’y avait invité. On soupait au palais Pitti, lorsqu’arriva la nouvelle que le château de Milan, non encore soumis, avait enfin capitulé.
Pendant cette expédition, la révolte avait gagné les fiefs impériaux, espèce de république fédérale de la Lu-négiane entre Gênes, la Toscane et les autres états du nord. Lannes, qui avait mis à fin l’insurrection pavé-sane, fut chargé d’apaiser celle-là ; il y parvint par un heureux mélange de fermeté et de douceur.
La Haute-Italie était libre de troupes étrangères : Mantoue, investie, restait seule à l’empereur; on en pressait le siège avec une vigueur qui prenait sa source dans la crainte d’événements ultérieurs. Pendant ce temps, Venise, par une conduite équivoque, se maintenait en état de neutralité; mais ses affections ne nous étaient pas acquises. Bonaparte, qui voulait déjà concourir à l’agrandissement de la France, avait décidé en lui-même que cette république fallacieuse serait, à la paix générale, offerte à l’empereur en compensation de la Belgique et du Milanais, qui venait de
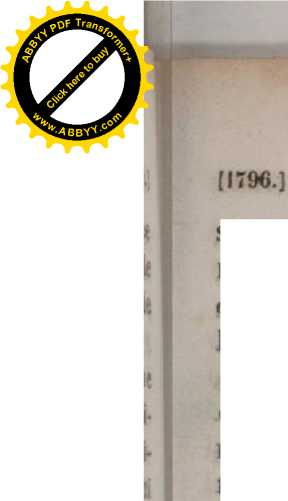
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
239
s’ériger en république sous le nom de Cispadane, nom qu’elle tarda peu à changer contre celui de Cisalpine, qu’elle garda jusqu’à l’érection de la Lombardie en royaume par Napoléon.
Bologne devint aussi momentanément le chef-lieu d’une république ; cela dura peu. Sa réunion au Milanais , qui eut lieu plus lard, fut uu acte de haute politique. Ce sont des événements de peu d’importance : aussi je ne fais que les indiquer. *
Les nouvelles successives de ces deux ou trois campagnes terminées en deux mois, la conquête du Piemout, du Milanais, de Gênes, de Parme, de Mo-dène, de Lucques, de la Romagne et de la Toscane, remplirent les Français d'un juste orgueil. Le nom du héros vainqueur fut dans toutes les bouches. On le porta aux nues; aussi le Directoire en devint-il jaloux : il eut dès lors autant d’ennemis à Paris que dans le reste de l’Europe. On lui imputa à crime ses grandes actions, et chaque palme qu’il ajoutait à son trophée le rendait d’autant plus suspect : on cherchait à l’entraver dans sa marche triomphale ; et c’eût été avec une joie mal déguisée sous une tristesse hypocrite , qu’on eût appris qu’un grand désastre l’aurait frappé.
D’une autre part, le cabinet autrichien se disposait à commencer une nouvelle campagne ; il cessa de porter le principal théâtre de la guerre sur le Rhin, comme il en avait eu d’abord l’idée. Il en retira Wurmser, son plus habile général, Français de naissance et Allemand de principes, d’habitude et d’affection; ce général accourut amenant avec lui trente mille hommes d’élite des meilleures troupes de son souverain. Ce renfort, combiné avec ce qui était renfermé
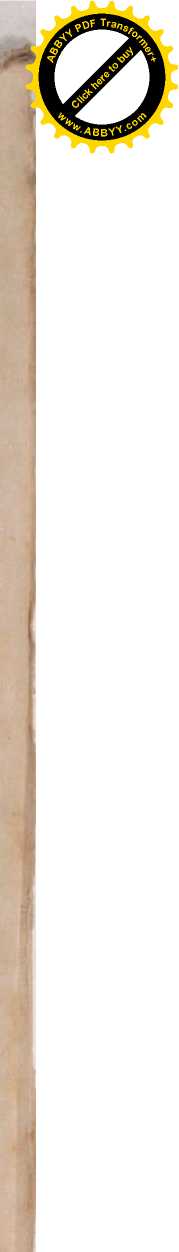
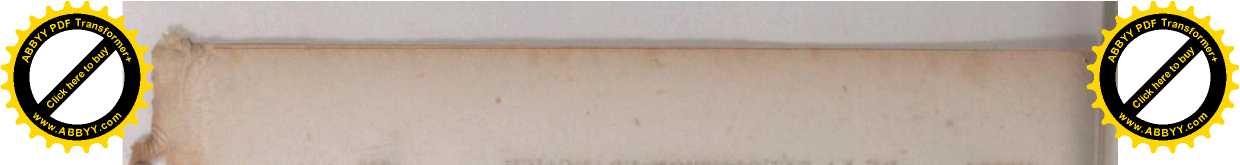
2Î0 HISTOIRE J [1796.]
dans Mantoue, avec le corps commandé par Beaulieu, augmenté des recrues levées dans les états héréditaires, présentait un effectif de quatre-vingt mille hommes: c’était le double de l'armée française, qui même n’était pas réunie en un seul lieu, mais disséminée dans (toute l’étendue des conquêtes récentes et des pays occupés. Avec ces quarante mille hommes, Bonaparte avait à surveiller le Piémont, le Milanais, les fiefs impériaux, Céneseles Légations, la Toscane, les états de Lucijues, de Modène, de Parme, à faire peur au roi de Naples et en imposer à Venise, qui si facilement pouvait connaître le chiffre minime des vainqueurs. Il est vrai qu’il commandait à des Français.
Tout autre que Bonaparte aurait été perdu; son coup d’œil d’aigle, en lui faisant apercevoir le péril, lui montra le remède. Soudain il appela tous les corps disponibles, ne laissant aux postes importants que l’effectif nécessaire pour empêcher un coup de main ; îl les dirigea sur FAdige et la Chiese.
La division Sauret, à Salo, couvrait le pays entre les lacs d’Idro et de Garda, interceptant la route de Trente à Brescia par la vallée de la Chiese. Masséna, placé à Bussalengo, occupait La Corona et Montebaldo avec la brigade Joubert; le reste de sa division campait I sur le plateau de Rivoli. La brigade Dallemagne, de la
division Despinois, gardait les ponts de Vérone; l’autre brigade de cette division, l’Adige jusqu’à Porto-Legnago ; la division Augereau, Porto-Legnago et le bas Adige. Le général Guillaume commandait à Pes-chiera, où six galères, sous les ordres du capitaine de vaisseau Lallemand, nous assuraient la possession du lac de Garda. Serrurier dirigeait le siège de Mantoue, qui tenait encore. Kilmainc avait sous ses ordres la cava-
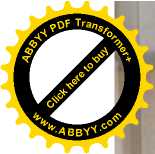
[1706.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 2M
lerie de l’armée; Doinartin commandait l’artillerie, et le quartier-général fut porté à Castelnuovo.
Tandis que Bonaparte faisait ainsi ses dispositions, de manière à pouvoir rassembler rapidement ses forces là où elles seraient nécessaires, le vieux, sage et habile Wurmser ralliait, de son côté, son armée dans le Tyrol italien et l’échelonnait de façon à envelopper les Français, si Bonaparte n’eût pas été là. Une de ses divisions devait déboucher par la vallée de l’Adige; une autre de trente mille hommes, commandée par le général en chef , s’avancer par Monlebaldo, laissant le lac de Garda à sa droite et l’Adige à sa gauche ; enfin, la troisième division forte de vingt mille hommes, sous le commandement du prince de Renss et d’Osekay, traversant la Chiese, devait arriver par Ruzena et couper la retraite aux Français.
Les hostilités commencèrent le 29 juillet par l’attaque de La Corona. Joubert y commandait ; mais après des prodiges de valeur, accablé par le nombre , il dut sc replier sur Rivoli, où Masséna campait. Ce premier fait d’armes, en indiquant à Bonaparte son péril, lui inspira une de ces résolutions que le génie seul trouve et qu'il fait tourner à sa gloire. Il fallait vaincre , n’importe comment : une augmentation de nombre devenait nécessaire : où la trouver?... à Mantoue... Soudain un ordre est transmis à Serrurier ; et malgré la défense expresse du Directoire, qui voulait emporter cette place à tout prix. le siège en es! levé, et des troupes fraîches accourent : elles vont décider la question. Le 31 juillet, elles se mettent en marche, et Bonaparte s’établit à Lonato.
Là commença cette suite de faits d’armes si extraordinaires que l’on désigna dans la suite sous le
H. 11



2« HISTOIRE [1790.] titre singulier de Campagne de quatre jours. A Donato, nous obtînmes un premier succès. Le 3 août, la trente-deuxième demi-brigade se distingua, selon son usage, par des prodiges de valeur. La brigade Dallemagne électrisée par la présence de Bonaparte, qui voulut la commander, se couvrit aussi de gloire. Le général Guieux avait déjà remporté un premier avantage, quand les généraux autrichiens Quasdanowich et Ockay battus se rallièrent à Guvarro.
Ce début promettait : AVurmser conservait la supériorité du nombre et peut-être celle des positions; il occupait tout l’espace entre l’Adige et le lac de Garda, et lui-même s’avançait déjà pour faire lever le siège de Mantoue ; il trouva la place libre. Étonné de l’absence des troupes françaises, il s’enquit où leur général en chef les avait envoyées : il tarda peu à l’apprendre à ses dépens.
Masséna, dès le 31 juillet, avait commencé à combattre ; il traversa nuitamment le Mincio à Peschiera, et courut à Brescia, où Napoléon lui avait donné rendez-vous, pendant que le général Digeon, à la tête des tirailleurs, empêcha l’ennemi de franchir le Mincio et de le poursuivre.
Le 31 juillet, avec les divisions Augcrcau et Masséna, Bonaparte marcha pour arriver à Brescia, qu’il atteignit le 1er août. Une faute du général Valette compromit de savantes dispositions, mais ne put empêcher le gain de la célèbre bataille de Castiglione, livrée le 5 août, qui était une suite de celle de Donato, du 3. Les Autrichiens, sous la conduite de Liptay, furent tournés et mis en déroute ; ils dûrent battre en re-Iraite, non vers le lieu d’où ils venaient, mais en s’enfonçant dans l'Italie du côté de Mautoue.

[1796.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
243
Ces succès consternèrent Wurmser ; ils arrivaient au moment même où il se glorifiait de la levée de ce siège, et ce qui lui avait semblé un résultat complet ne lui paraissait plus qu’une incertitude cruelle. Sa séparation d’avec le corps de Quasdanowich ne lui présageait rien de bon ; il se hâta de rappeler les troupes qu’il avait envoyées à la poursuite de Serrurier, mais il n’était plus temps. Quant à lui, avec tout ce qu’il put ramasser, il courut à Castiglione, qui déjà avait vu fleurir nos lauriers.
Instruit de l’inquiétude et de la démoralisation qui travaillaient l’armée ennemie, Bonaparte, pour achever de la vaincre, se rendit à Lonato avec douze cents hommes ; il voulait de ce point surveiller l’ensemble de ses opérations. Comme il y arrivait, une colonne errante d’Autrichiens, forte de cinq mille hommes, instruite que sur ce point se trouvait une poignée de Français, accourut, croyant remporter une victoire facile.
Cinq heures du soir sonnaient, lorsqu’on annonça un parlementaire. Bonaparte le fit avancer en sa présence et ordonna qu’on lui enlevât le bandeau dont on lui avait couvert les yeux. L’officier ennemi se vit alors en présence d’un très-nombreux état-major qui entourait le général en chef, auquel il osa intimer l’ordre de mettre bas les armes, lui observant qu’il était cerné.
«
«
« Monsieur, répondit Bonaparte, allez dire à votre général que c’est lui qui est enveloppé par l’armée française ; c’est donc à lui de poser les armes. Je lui donne huit minutes pour le faire ; ce délai passé, il
« n’y aura pas de quartier. »
La fermeté de ces paroles, la terreur qu’inspirait déjà le nom de Bonaparte, produisirent un effet étrange :
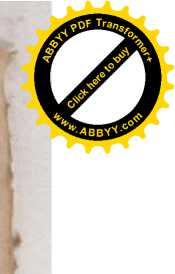


214 HISTOIRE [ 1796.]
les cinq mille hommes, sans tirer un coup de fusil, se rendirent à douze cents Français.
Après cela, Bonaparte se porta sur Castiglione avec vingt mille hommes et cinq mille autres que Serrurier amenait. L’action s’engagea, elle fut terrible. Mas-séna, Augereau, Fiorella, Verdier, Marmont, se signalèrent sous les yeux de leur général en chef. Wurmser, battu sur tous les points, accablé de tant de déroutes consécutives, se hâta de repasser le Mincio, afin de rester en communication avec Mantoue; il espérait d’ailleurs qu’à l’abri de cette rivière on le laisserait respirer. Bonaparte se garda bien d’en agir ainsi ; toujours infatigable, il envoya Augereau à Borghetto et Masséna à Peschiera. Sur ce point le colonel Súchel (depuis duc d’Albuféra) engagea l’affaire. Là encore nous triomphâmes ; chaque combat était pour nous un succès, et une défaite honteuse pour les Autrichiens. Ceci eut lieu sous les murs de Peschiera, où commandait le général Guillaume. Le 3 août, Bonaparte lui avait écrit :
« Vous devez avoir été témoin des batailles livrées « à l’ennemi aujourd’hui et ces jours derniers : nous « lui avons pris vingt mille hommes et tué une grande « quantité de monde. L’armée ennemie est en pleine a déroute, et demain ou après nous serons sous vos « murs. En attendant, quelles que soient les circon-« stances, ne vous rendez qu’à la dernière extrémité ; « la brèche faite, montrez la plus grande fermeté.... » Guillaume était digne de celte lettre, Peschiera fut conservé.
Bonaparte se mit à la poursuite de Wurmser, qui avait fui du côté de Vérone. Les Français, arrivés devant cette place, en enfoncèrent les portes à coups de

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 245 canon, sans s’embarrasser de la neutralité. Maîtres de Vérone, ils ne donnèrent aucun relâche à Wurmser ; partout ils le battirent, ils le réduisirent à fuir avec moins de la moitié de la belle armée qu’il avait amenée naguère en Italie, et encore les débris de cette armée n’avaient plus ni espérance, ni courage, ni énergie.
Le bruit de tant de victoires, aussi rapides que décisives, se répandit promptement dans toute l’Italie. Ceux qui attendaient avec impatience que Bonaparte fût accablé par Wurmser, alors réfugié à Roveredo et à Trente dans le Tyrol, furent saisis d’une morne stupeur lorsqu’ils apprirent qu’au contraire et en si peu de jours il avait refoulé hors de l’Italie et détruit en grande partie cette armée qui devait lui en arracher la conquête; la terreur fut complète à Naples, à Rome, à Florence et à Venise. Le sénat vénitien, dont on insultait la faiblesse, se laissait outrager sans oser recourir ouvertement aux armes. Il intriguait à Paris contre Bonaparte, et à Vienne il mendiait des secours. En attendant, il armait sous main et préparait l’insurrection de Vérone, qui lui devint si fatale, car elle détermina la chute de cette république.
D’un autre côté, il sollicitait le roi de Naples, qui, poussé par la reine sa femme, Acton son ministre, les Anglais, le Pape et l'Empereur, s’avançait vers Rome à la tête de quatre-vingt mille soldats. Le péril pouvait venir de ce côté, mais il était loin encore, et un danger bien plus pressant menaçait les Français.
Wurmser, réparant ses pertes, commandait encore à cinquante-cinq mille hommes, dont trente mille étaient avec lui, et vingt-cinq avec Davidowich ; il se préparait à rentrer en Italie ; mais Bonaparte ne lui laissa pas la liberté d’exécuter ses projets ; il prit avec

UBr^^ł—* ^SBr^Wai
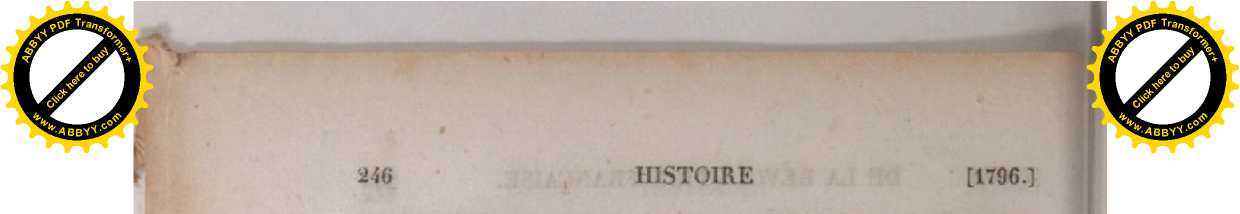
lui la division Vaubois, qu'il dirigea vers Trente, celle de Masséna, qui occupa la rive gauche de l’Adige, et celle d’Augereau, destinée à servir d’arrière-garde à cette division partant de Vérone.
Les Autrichiens, atteints, furent culbutés sans avoir eu le temps de se reconnaître. Le prince de Reuss ne put défendre Te pont de la Carra contre le général d’avant-garde Saint-Hilaire; le général Pigeon, de la division Masséna, malmenait pareillement Waschas-sowich à Sarra-Valla. Le 4 septembre, Bonaparte, ayant rencontré Davidowich et ses vingt-cinq mille hommes à Roveredo, remporta sur eux une victoire complète. Roveredo abandonné tomba en notre pouvoir; on poursuivit les vaincus vers la forte position de Cagliano. Ici des montagnes abruptes, entourant l’Adige, ne permettaient pas qu’on pût le tourner; des remparts crénelés, des fossés taillés dans le roc, des abîmes à pic, devaient arrêter des soldats valeureux ; les nôtres courent au pas de charge, habilement secondés par une batterie qu’a placée le général Do-martin ; neuf bataillons serrés en colonne triomphent de tous ces obstacles qu’opposaient la nature du terrain , les fortifications et le courage de l’ennemi.
Dans celte même journée, Vaubois enlève le camp retranché de Mori. Côtoyant la rivière, il s’empare de Trente le 5 septembre, et Davidowich, en pleine déroute, se trouve pour longtemps hors d’état de se remettre en ligne.
Un général moins habile, enivré de tant de victoires, se serait engagé dans le Tyrol. Bonaparte était incapable d’une pareille faute, mais il fit courir le bruit qu’il allait opérer ainsi. A cette nouvelle, Wurmser sent renaître l’espoir de réparer ses revers passés ; il prend

796.] ’ DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
247
avec lui deux divisions, et fait occuper Sala par une troisième pour cerner les Français. Mais tandis que l’Autrichien dresse ainsi son plan de bataille, fondé sur une vaine hypothèse, Bonaparte marche à lui avec la majeure partie de ses forces.
Le 8 septembre, commença une autre série de succès. Ce jour-là, Augereau et Masséna vainquirent l’ennemi sur les deux rives de la Brenta, et comme cette affaire eut lieu de grand matin, les soldats la nommèrent le déjeuner de Bonaparte. Wurmser fut sur le point d’être pris à Bassano ; il n’eut que le temps de rejoindre la division de son armée qui bivouaquait sur le chemin de Vérone; mais sa retraite vers l’Allemagne étant coupée, il tenta de prendre sa route à travers les États vénitiens. Il n’avait plus avec lui que seize mille hommes, reste de cinquante-cinq avec lesquels il avait naguère commencé cette troisième campagne; six mille cavaliers encore intacts formaient sa principale ressource. Augereau du côté de Padoue, Masséna entre cette ville et Venise, lui coupaient la retraite ; il était perdu, n’ayant pas d’équipage de pont, lorsqu’un chef de bataillon français abandonna le poste de Legnago, se croyant environné de toutes parts. Wurmser, instruit de cette faute, en profita pour passer, avec ses dix mille fantassins et ses six mille chevaux, sur l'autre rive de l’Adige.
Cet échec désespéra Bonaparte ; il s’était flatté de contraindre l’ennemi à mettre bas les armes sans combat, et à présent il fallait tenter encore la fortune. Il ne perdit pas de temps, et serrant de près Wurmser, il se flatta de le cerner encore aux environs de Ronco ; mais l’Autrichien, dans sa course rapide, marchant en colonne serrée, écrase à Cerca la quatrième légère,
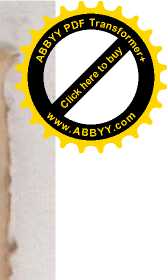
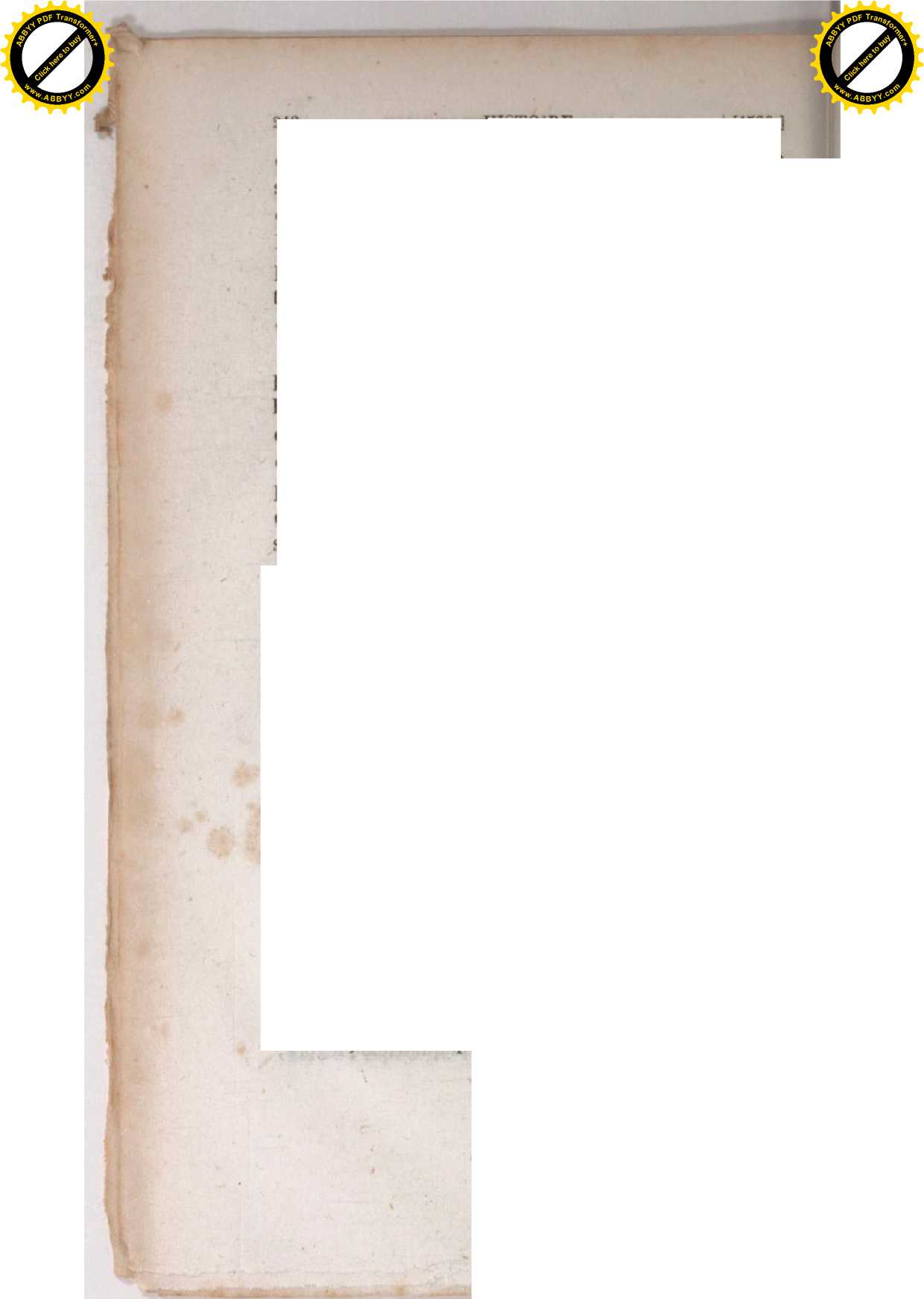
HISTOIRE
[1796.1
218
qui formait l’avant-garde de Masséna. A Villa, le 12 septembre, il enlève la garde d’un petit pont, taille en pièces cinq cents des nôtres, parmi lesquels était le brave et loyal Charton. Le 14, à Due-CasteHi, il fait prisonnier un bataillon d’infanterie. Ces légers avantages rendent l’espoir aux Impériaux et leur laissent espérer que Bonaparte ne sera pas toujours invincible.
Wurmser arrive à Mantoue, appelle à lui la majeure partie de la garnison ; il réunit ainsi vingt-cinq mille hommes et va revenir à Legnago, où il a laissé vingt-quatre canons tout attelés. Mais déjà le général Bon, excellent oflicier, avait dès le 13 pris Legnago, le parc d’artillerie, dix-sept cents hommes et délivré cinq cents Français. A cette nouvelle fâcheuse, AVurm-ser se détermine à tenter de nouveau le sort des armes, au lieu même où il campait, sous Mantoue, entre Saint-Georges et la citadelle.
Le 19, eut lieu cette dernière bataille , connue sous le nom de Saint-Georges ; elle commença mal pour nous. A notre gauche, le général Bon ne put se maintenir; Sahuguet, qui commandait la droite, plus heureux, soutint le choc avec avantage. Masséna, posté au centre, rompit les ennemis. Les derniers mouvements que Bonaparte ordonna déterminèrent le succès de la journée. AVurmser, complètement battu, se retira dans Mantoue et conserva le Serraglio t poste avancé de la ville, jusqu’au leP octobre, où Kilmaine, s’en emparant, contraignit les Autrichiens à se renfermer dans la place, dont le blocus commença rigoureusement.
Ainsi, dans l’espace d’un mois, fut terminée cette campagne, qui était la troisième de celte année. Dans celle-ci, l’ennemi perdit vingt-sept mille hommes,
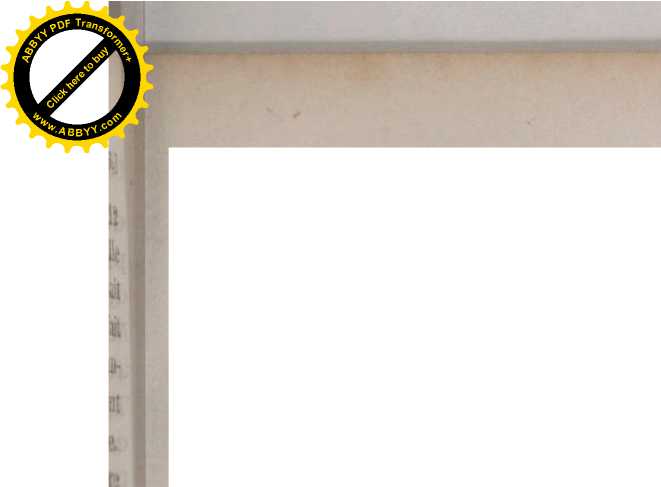
:■
(1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
249

1
dont trois mille tués, six mille blessés et dix-huit mille prisonniers, soixante-quinze pièces de canon, vingt-deux drapeaux, trente généraux et six mille chevaux. Mantoue contenait seize mille hommes de cette armée avec le général en chef; dix mille erraient dans le Tyrol et le Frioul. Nous eûmes à regretter dix-huit cents morts, quatre mille trois cents blessés et quatorze cents prisonniers.
Bonaparte envoya Marmont porter au Directoire les drapeaux ; on lui fit une réception brillante, tout en laissant percer une jalousie inquiète, et le projet d’enlever Bonaparte à une armée qui l’idolâtrait, pour lui donner le commandement de celle d’Allemagne.
En apprenant de si beaux triomphes, le roi de Naples parut moins belliqueux et signa avec le Directoire un traité de paix, qu’il ne tarda guère à rompre. Le siège de Mantoue continuait, et l’Autriche infatigable ne renonçait pas à rentrer dans la possession du duché de Milan. A Beaulieu et à Wurmser, tous deux très-âgés, ou donna pour successeur le baron Alvinzi, âgé de soixante-dix ans, homme de peu de réputation et qu’on allait opposer à un général de vingt-huit ans, ceint d’une auréole de gloire.
L’Autriche créa rapidement deux armées, l’une dans le Frioul, l’autre dans le Tyrol. L’ordre positif était de délivrer Mantoue. Ainsi, dans le cours d’une année, les Autrichiens, infatigables à réparer leurs revers, et comme l’hydre de Lcrne, renaissant de leurs désastres , se remettaient en ligne pour la quatrième fois.
La campagne s’ouvrit le 2 novembre. Le 5 , un premier succès sur la Brenta fut d’un bon augure pour la cause française ; mais le 7 , une terreur panique se manifesta parmi les soldats du général Vaubois, et
11*
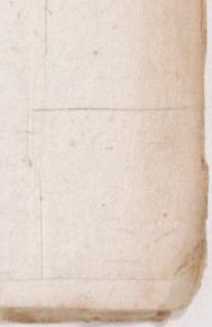
*50

[1706J
_ —
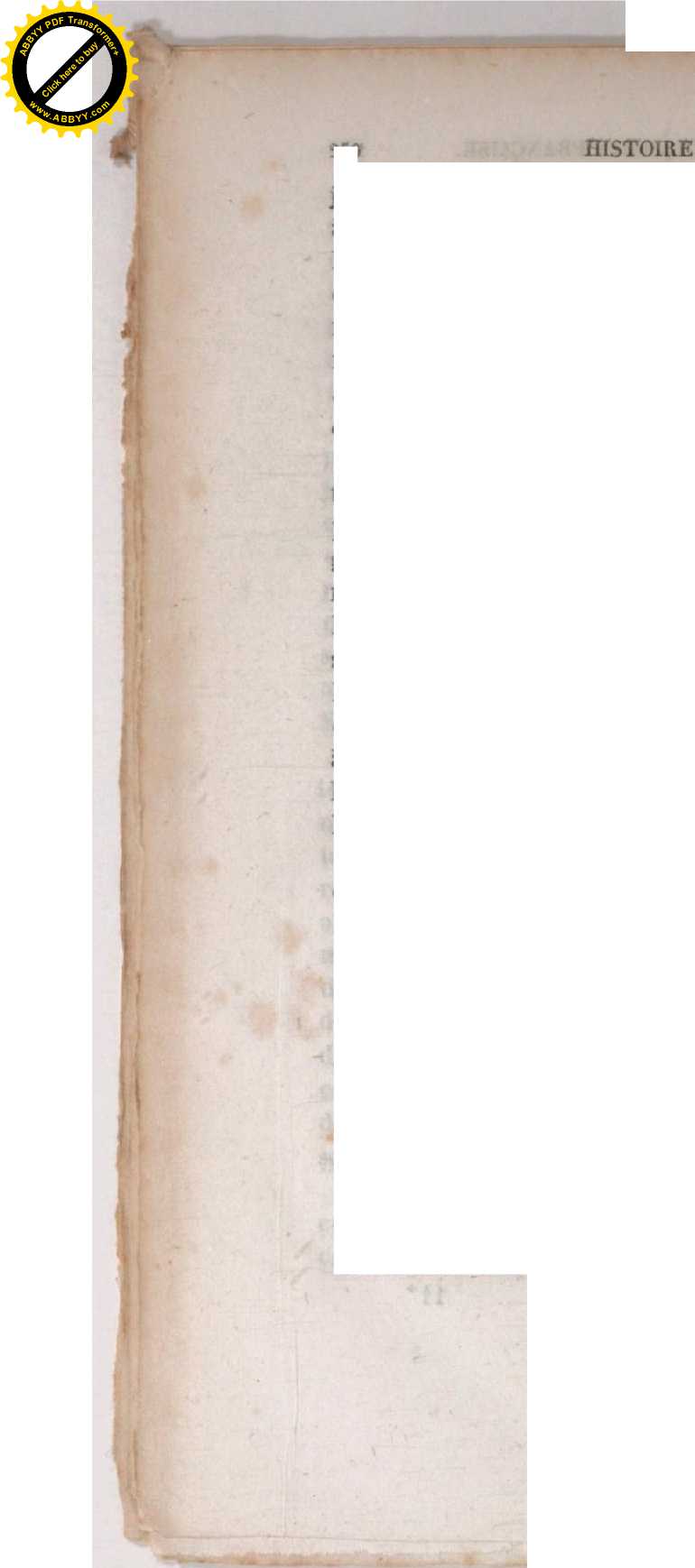
jeta la confusion dans notre année, qui se retira le 8 à Rivoli et à La Corona. Le 12, les Français prirent leur revanche et triomphèrent à Saint-Martin; dans cette journée, Bonaparte, cherchant à raffermir le moral ébranlé du soldat, fut interrompu dans sa harangue militaire par un grognard, qui lui dit : Allons, allons, c’est assez chanter vipres ; tu veux de la gloire, eh bien ! on t’en.... donnera. Le mot était plus énergique.
Alvinzi, par sa force numérique, était sur le point de triompher, le sort de l’Italie pouvait être compromis par la perte d’une bataille ; une nouvelle inspiration du génie rétablit l’équilibre et maintint la victoire sous nos drapeaux. En plaine, Alvinzi pouvait nous envelopper et nous battre; Bonaparte, pardos marches savantes et adroites, l’attire dans les marais d’Arcole; là on ne peut combattre que sur des chaussées étroites, et dès lors l’avantage du nombre disparaît. Alvinzi est à demi vaincu par le seul choix du lieu où se livre la bataille. Le courage des Français achève ce que l’habileté du grand général avait si bien préparé.
Le succès dépendait entièrement de la prise du pont d’Arcole, défendu par l’infanterie autrichienne et balayé par le feu de trente pièces d’artillerie. Rebutés par plusieurs attaques infructueuses, nos soldats hésitaient. Bonaparte saisit un drapeau et court au travers de la mitraille le planter au milieu du pont. Cet acte d’héroïsme décida cette affaire brillante qui durait depuis trois jours. Commencée le 15 novembre, elle se prolongea jusqu’au 17. Augercau et Masséna s’y couvrirent de gloire.
Douze mille morts, six mille prisonniers, dix-huit pièces de canon et quatre drapeaux furent le fruit de notre victoire. Alvinzi et ses divers corps, battus, pour-
■

[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

suivis de toutes parts, furent dans l’impossibilité de se rallier ; et cette quatrième campagne, dont les résultats étaient immenses, n’avait pas duré vingt jours.
Tant de triomphes exaspérèrent les ennemis de la France : ils tentèrent d’organiser un soulèvement général en Italie ; la perfidie vénitienne leva presque le masque. Bonaparte, pour déjouer ces complots, s’empara de Bergame, et par ses ordres un corps d’armée français se mit en route pour occuper Bologne et menacer Rome.
Pendant ce temps, l’Autriche faisait des efforts extraordinaires pour soutenir Alvinzi; des troupes, encouragées par des promesses, par le don de drapeaux que l’impératrice avait brodés, arrivaient à marche forcée; notre armée avait aussi reçu des renforts, mais en petit nombre, et trente-un mille Français auraient à combattre soixante-cinq mille Autrichiens.
Bonaparte, plein de confiance en ses soldats, marcha à l’ennemi. Le 13, la bataille de Rivoli-nous valut de nouveaux lauriers. Les détails de cette journée sont admirables ; généraux et soldats y rivalisèrent de bravoure. Cependant le fruit de la victoire faillit nous être enlevé par une fausse manœuvre d’Augereau, qui laissa le général ennemi, Provera, traverser l’A-dige avec un corps assez nombreux pour qu’il pût espérer ou de débloquer Mantoue, ou du moins de la ravitailler.

A la réception de cette mauvaise nouvelle, Bonaparte, qui s’attachait à poursuivre Alvinzi, confia ce soin à Masséna et à Joubert, et courut sur les traces du général Provera, qui, par malheur, avait sur lui vingt-quatre heures d’avance; c’était treize lieues qu’il fallait faire : avec des Autrichiens, Bonaparte y eût
--? -.r
ínSTOIRE
renoncé ; avec des Français, il espéra, et son attente ne fut pas déçue. Le général Provera, malgré l’avance qu’il avait sur nous, fut rejoint comme il arrivait à Saint-Georges ; déjà même à l’aide d’une surprise il avait tenté de s’ouvrir un passage ; mais un vieux sergent et un jeune tambour donnèrent l’alarme, et le combat qui s’engagea sur ce point donna à Bonaparte le loisir d’arriver à temps.
Le 16, l’affaire s’entama vivement. Les assiégés secondèrent l’attaque de Provera en faisant une sortie à deux heures après midi; mais Wurmser fut contraint de rentrer dans la ville , et Provera capitula : tout périt ou mit bas les armes, hors deux mille hommes demeurés de l’autre côté de FAdige. Tous les drapeaux, les canons, armes, bagages, munitions de guerre, devinrent la proie du vainqueur. La bataille s’appela du nom de la Favorite, maison de campagne située près de là : c’était l’ancienne demeure des ducs souverains de Mantoue.
Bonaparte en ce moment se tourna vers la ville assiégée , et dans le vif élan de sa joie : Tu es à moi, s’écria-t-il, à moi , et désormais l'Italie est à nous.
Tandis que ce dernier combat décidait du sort de Mantoue, Joubert et Masséna, poursuivant toujours Alvinzi, le menèrent battant au delà de Trente, lui prenant des divisions entières : cependant il s’échappa, mais presque seul et sans trouver aucune excuse pour pallier la honte de ses revers. Cette quatrième campagne coûta à l’empereur d’Autriche dix mille morts, vingt-cinq mille prisonniers, vingt-quatre drapeaux et soixante pièces de canon.
Enfin, le 2 février de l’année 1797, le général Wurmser perdant tout espoir de secours, et voyant la
[1796.}


«
a
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
253
garnison dépérir par la maladie qui la ravageait, signa une capitulation dont tous les avantages étaient pour les Français, qui accordèrent aux vaincus ces égards que l’on doit au courage malheureux. Bonaparte, à cette occasion, adressa la proclamation suivante à ses soldats : c’était l’analyse brillante de ces mois de grandeur et de gloire :
«
«
«
« « « «
a
«
«
«
«
«
K
«
« Soldats, la prise de Mantoue vient de finir une campagne qui vous a donné des titres éternels à la reconnaissance de la patrie.
« Vous avez remporté la victoire dans quatorze batailles rangées et soixante-dix combats ; vous avez fait plus de cent mille prisonniers, enlevé à l’ennemi cinq cents pièces de canon de campagne, deux mille de gros calibre ; quatorze équipages de pont. « Les contributions mises sur les pays conquis ont nourri, entretenu , soldé l’armée pendant toute la campagne; vous avez , en outre, envoyé trente millions au ministère des Finances pour le Trésor public.
« Vous avez enrichi le musée de Paris de trois cents chefs-d'œuvre de l’ancienne et de la nouvelle Italie ; il avait fallu plusieurs siècles pour les produire.
< Vous avez conquis à la République les plus belles contrées de l’Europe. Les républiques Lombarde et Cispadane vous doivent leur liberté ; les couleurs françaises flottent, pour la première fois, sur les bords de l'Adriatique , en face et à vingt-quatre heures de navigation de l’ancienne Macédoine. Les rois de Sardaigne et de Naples, le duc de Parme, se sont affranchis de la coalition, et vos ennemis ont brigué votre amitié ; vous avez chassé les Anglais de
« Livourne, de Gênes et de la Corse.....; mais vous



25 i HISTOIRE
K n’avez pas encore tout achevé ; une grande destinée « vous est réservée , c’est en vous que la patrie met « scs plus chères espérances : vous continuerez d'en « être dignes.
« De tant d’ennemis qui se coalisèrent pour étouf-« fer la République h sa naissance, l’Empereur seul « reste devant nous. Se dégradant lui-même du rang « d’une grande puissance, ce prince s’est mis à la « solde des marchands de Londres; il n’a plus de « politique, de volonté, que celles de ces insulaires « perfides.... il n’y a donc plus d’espérance pour la « paix qu’en allant la chercher dans le cœur des « États de l’empereur d’Autriche..., etc.»

CHAPITRE XIII.
Portrait de Bonaparte. — Les républicains et les royalistes. — Moreau su r le Rbln. —Le prince Charles opposé à Bonaparte.— Le général Ber-nadotle. —Masséna. — Campagne de trente-trois jours en Italie. —Propositions de paix faites par Bonaparte. —Refusées. —Acceptées. — Le marquis de Gallo. — Mot liardi de Bonaparte. — Traité de paix de Campo-Fonnio. — Les Véronais égorgent les Français. — Venise irrite Bonaparte. — Sa chute. — Changement de gouvernement à Gênes. — La guerre au Nord et sur le Rhin. — Nouvelle constitution. — Position du Directoire vis-à-vis de l’Europe. — Mouvement à l'intérieur. — Barthélemy.— Préludes du 18 fructidor. — Cette journée. — Mort de Hoche. — Affaire des papiers de Kinglin, et conduite de Moreau.—Paix avec l'Empereur. — Préliminaires signés à Rastadt. — Fêle donnée à Bonaparte.
[1796.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
255
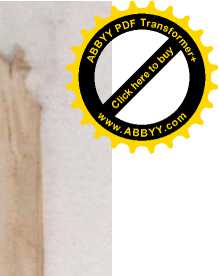
Il y a peu d’années dans l’histoire de France qui aient offert de si nombreuses victoires et de si grands résultats que celle de 1796, dont je viens de présenter le tableau. Un homme extraordinaire surgit tout à coup, et dès son début, il se place au rang des héros. Les premiers pas de ce génie supérieur font pressentir sa gloire future.
Général consommé, administrateur sage et éclairé, politique habile, il n’avait pas encore vingt-sept ans que l’armée qu’il commandait soumettait l’Italie, détruisait successivement quatre armées trois fois plus nombreuses que la sienne, et faisait trembler l’empereur d’Autriche dans sa capitale.
A la fois juste et sévère, son coup d’œil embrassait tout, surveillait tout, suffisait à tout. Il remplissait les coffres de l’État, dotait la France des chefs-d’œuvre qui faisaient l’orgueil de l’étranger et conservait une réputation méritée de désintéressement.
Veillant avec un soin particulier au bien-être de ses
256 HISTOIRE [1796.]
troupes, il poursuivait à outrance cette tourbe impure de fournisseurs si longtemps l’opprobre et la ruine de nos armées ; il leur faisait une guerre à mort. Aussi était-il adoré de ses soldats.
Il imposait aux peuples conquis les conditions qu’il jugeait convenables pour la gloire et l’intérêt de la France, et cependant il savait s’en faire aimer et respecter.
Il traitait directement avec les souverains, et son nom éclipsait ceux des cinq directeurs qui gouvernaient alors la République.
Les diplomates, les ambassadeurs, tous ceux enfin à qui leur rang, leur fortune ou leurs talents donnaient quelque importance, oubliaient le chemin de Paris; c’était à son quartier-général qu’ils se rendaient. Sous lui seul on voulait servir, avec lui seul on voulait régler, traiter et terminer. •
Le Directoire sentait si bien que la supériorité et l’ascendant de cet homme jetaient un éclat qui saperait son pouvoir et finirait par le réduire au néant, qu’il eût été charmé qu’il y eût quelques républiques de moins en Italie, et que Bonaparte ne fût pas venu l’écraser de sa supériorité, et le faire trembler sur son avenir.
La France, pleine d’admiration pour ce jeune héros, tournait vers lui des regards d’espérance. Lassée du règne sanglant, spoliateur et tyrannique de ceux qui s’étaient emparés du pouvoir, elle soupirait après un régime de force et d’équité qui ne se rencontre guère que sous un gouvernement monarchique. L’état affreux de l’Espagne, du Portugal, du Mexique et de toute l’Amérique méridionale, ne prouvent que trop combien les théories de quelques novateurs, de quel-


lig
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
qucs intrigants, qui croient changer la forme des gouvernements établis, au gré de leurs folles idées ou de leurs intérêts privés, sont nuisibles au bien-être des nations; elles n’engendrent que troubles, misère, ruine et démoralisation.
Ainsi, au commencement de cette année 1797, deux pouvoirs étaient en présence : l’un déjà usé, quoique jeune et en plein exercice, celui du Directoire; l’autre encore caché sous le manteau de la gloire, mais s'avançant à pas de géant, prenant cet accroissement rapide, démesuré, auquel on n’ose promettre de la durée, et qui cependant renverse tous les obstacles, celui de Bonaparte.
Dès ce moment la lutte s’engagea entre ces deux pouvoirs; elle continua jusqu’en 1799 au 18 brumaire , où Bonaparte, appuyé par la nation, chassa les directeurs abandonnés de tous leurs partisans.
Si la fortune, ou, pour mieux dire, la Providence, qui destinait Bonaparte à monter si haut, s’était complu en huit mois de temps à lui prodiguer tant de faveurs qu'on ne pouvait y croire même en en voyant les résultats, elle s’était montrée plus avare à l’égard des autres généraux de la République. Jourdan et Moreau , qui commandaient en chef sur le Rhin, et Pi-chegru sous leurs ordres, avaient plus ou moins éprouvé des revers. Aucun ne se présentait avec cette auréole de gloire intacte qui parait le front de leur jeune et habile rival. Nous ne triomphions pas sur le Rhin, et malgré l’hiver, l’archiduc Charles, qui avait forcé Moreau à une retraite mémorable, s’empara le 9 janvier du fort de Kehl, après une attaque de soixante-dix jours, dont quarante-huit de tranchée ouverte. Cette prodigieuse résistance, témoignage honorable de la

,258 HISTOIRE [1797.]
valeur de nos années, fut l’ouvrage des généraux Desaix et Gouvion-Saint-Cyr, (jui commandèrent tour à tour. Pour enlever cette place de second ordre, les Autrichiens l’investirent avec trente-cinq mille hommes, et la foudroyèrent avec quarante-trois batteries, qui tirèrent cent mille coups de canon et qui lancèrent vingt-cinq mille bombes. Nous n’avions là qu’une poignée de soldats. Les Autrichiens ne conquirent que des ruines; et le prince Charles, en s’opiniâtrant à cette conquête stérile, laissa Bonaparte s’atTermir en Italie.
Cette année encore, le Directoire et les Conseils célébrèrent le triste anniversaire du 21 janvier. Jean de Bry déclama contre la tyrannie des rois ; la France n’avait gémi que sous celle des démagogues.
Le mois de février vit la démonétisation des mandats territoriaux, renouvelés de la fraude des assignats; la reddition de Mantoue, le 2 ; la prise du fort d’Hu-ningue par les Autrichiens, le 5, après un siège de trois mois ; celle d’Ancône, le 9, par le général Victor ; la signature du traité de Tolentino, entre le Saint-Siège et la République française, le 17.
Dans le mois suivant, le cabinet de Vienne, voyant tous ses vieux généraux usés par Bonaparte, imagina de lui opposer le prince Charles, autre héros plus jeune que le nôtre de deux ans, et qui venait d’acquérir sur le Rhin un grand nom en repoussant Moreau, Jourdan et nos braves. Mais qui pouvait alors lutter victorieusement contre l’étoile de Bonaparte ? Celui-ci, dès le début de cette cinquième campagne, força le prince Charles dans scs retranchements : il en résulta que les états de Venise et le Tyrol restèrent à découvert. Bonaparte, vainqueur, franchit le Taglia-

[1797.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
259

mentó, le 16 mars, chaudement soutenu par Berna-dotte, son émule, et par Serrurier, Nestor moderne, parlant moins et se battant mieux que le Grec; on voulait retirer Bernadotte, mais Bonaparte lui dit : Non, restez; votre présence est nécessaire pour commander l’Italie.
C’était par une suite de brillants exploits que Bernadotte soutenait sa réputation, assez belle pour n’être pas éclipsée par celle du général en chef. Le 19 mars, ses efforts firent tomber en notre pouvoir la place forte de Gradisca; Joubert, le 22, s’empara de Botzen; le 24, Masséna, vainqueur à Tarvis (dix lieues sud-ouest de Klagenfurth), concourut à l’ensemble des opérations d’une manière héroïque. Cette journée préparait de grands résultats : aussi, le 29, l’enfant chéri de la victoire (Masséna, ainsi nommé par Bonaparte, si heureux dans le choix de ses épithètes) ayant battu les Autrichiens sous Klagenfurth, capitale de la Carinthie, entra triomphant dans cette ville.
Bernadotte, non moins heureux, non moins habile, sauvant par des manœuvres savantes l’armée française et son chef témérairement engagés, prenait possession de Trieste le 24, et de Laybach, capitale de la Car-niole, le 1er avril.
Trente-trois jours avaient suffi pour préparer, commencer et terminer cette campagne, qui portait nos avant-postes presqu’aux portes de Vienne. Déjà la famille impériale abandonnait cette capitale avec désespoir, bien que, par un de ces hasards fréquents à la guerre, le prince Charles, battu sur plusieurs points, eût délivré le Tyrol menacé, repris Botzen et Trente], reporté la lutte à Roveredo, à Torbole, et même à Vérone; là, peut-être, il se serait maintenu' avec
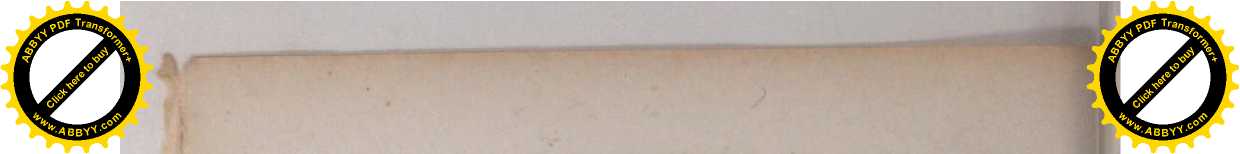
860 HISTOIRE [1797.]
l’appui des Vénitiens, qui, soulevant contre nous leurs états de terre-ferme, égorgeaient nos soldats à Vé-' rone et dans tous les lieux soumis à leur domination. Mais le cabinet de Vienne a peur; tant de défaites l’intimident : cinq années détruites, Milan conquis ainsi que la Lombardie, Mantoue remise au vainqueur, l’esprit républicain gagnant l’Italie, lui font craindre de plus grands malheurs, et il demande la paix.
Qui le croirait? cette paix dont tous les avantages devaient être pour le vaincu, le héros victorieux la proposa le premier au prince Charles, par une lettre du 31 mars; l’archiduc y répondit d’une manière évasive; et alors, pour contraindre l’Autriche à traiter, Bonaparte courut à de nouvelles victoires. Le 1er avril, Masséna vainquit à Frcybach, puis à Neumarkt, où l’archiduc accourut avec quatre divisions. Les soldats du deuxième léger, arrivant d’Allemagne, firent là des prodiges de valeur; ce baptême de sang et de gloire les associa dignement aux soldats vainqueurs de l’Italie. Ce fut alors que le prince Charles proposa une suspension d’armes. Napoléon répondit qu’on pouvait à la fois négocier et combattre, mais qu’il ne consentirait à un armistice que lorsque nous serions maîtres de Vienne, à moins que ce ne fût pour traiter de la paix définitive. Le 6 avril eut lieu l’affaire d’Uns-markt ; notre avant-garde était à Leoben, lorsque dans cette ville se présentèrent, le 7, comme ministres plénipotentiaires de l’empereur d’Allemagne, les généraux Bellegarde et Marfelt.
Quoique l’Autriche proposât la paix, elle ne la désirait pas; elle voulait voir venir le Directoire, qui, sentant son impuissance, cherchait à fixer l’attention des Français sur ce qui se passait à l’étranger. Bona-

[1797.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
261

parte seul désirait finir cette guerre si brillante et n’en pas compromettre les résultats.
Le marquis de Gallo, ambassadeur de Naples près la cour de Vienne, était au nombre des plénipotentiaires autrichiens. Cet homme d’État joignait à beaucoup d’habileté de vastes connaissances, une finesse peu commune et une grâce française entée sur la politique italienne.
On se mit à discuter les articles du traité. Par le
premier, l'Empereur reconnaissait la République française. « Qu'est-ce à dire? s’écria Bonaparte; qu’en-« tendez-vous par là? La République française ne veut u pas être reconnue; elle est en Europe ce qu'est le soleil « sur l’horizon : tant pis pour qui ne veut pas la voir et « en profiter! pour exister puissante et victorieuse, elle « na besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. » Ces mots, en confondant les plénipotentiaires, les rendirent plus souples.
Il paraissait difficile d'indemniser d’une manière convenable 1 Autriche de la perte de deux belles provinces, la Belgique et la Lombardie; mais Bonaparte, qui désirait une trêve prolongée, satisfit aux exigences de l’Empereur en lui abandonnant le territoire vénitien , en échange de ces deux riches fleurons de sa couronne.
Le gouvernement de Venise, à force de craindre l’ambition d’un de scs citoyens, avait tellement avili le corps de la noblesse, qu’il n’y avait plus en elle ni vertu, ni courage, ni patriotisme, et qu’elle ne comptait pas un homme capable de sauver sa patrie. Par une conduite équivoque, par une guerre sourdement déclarée à la France, qu’ils disaient leur alliée, par des secours secrètement fournis aux Autrichiens, les

2G2 HISTOIRE [1797.]
Vénitiens avaient irrité Bonaparte. L’affaire de Vérone perdit cette vieille oligarchie.
Le 17 avril, au moment où l’Autriche abandonnait le champ de bataille, les Véronais coururent aux armes, et égorgèrent tous les Français qui se trouvaient dans Vérone ou dans la campagne; leur lâche cruauté ne respecta pas même l’asile sacré des hôpitaux. Cet horrible massacre eut lieu au son du tocsin et aux cris de Vive saint Marc! mais la vengeance française tomba comme la foudre sur ces féroces et faibles ennemis. Le 23, tout était comprimé dans Vérone et en terre ferme. Venise , où déjà l’on avait assassiné en pleine paix le capitaine Laugier et son équipage, demeura seule exposée au courroux de l’aigle, qui n’hésita pas à fondre sur le lion de saint Marc et à le déchirer.
Bonaparte, indigné, déclara que le gouvernement pèrlide qui combattait par l’assassinat disparaîtrait; et pour rendre sa vengeance plus complète, il voulut que ce gouvernement se suicidât. Ailleurs il y aurait eu la résistance du désespoir; là il n’y eut que la soumission des âmes sans énergie. On pleura dans le grand-conseil , au moment de sa dissolution. Le doge Louis Manini, qui terminait en poltron la suite de tant d’illustres princes, vit s’évanouir son autorité en signant l’acte de son abdication ; mais aucune goutte de sang patricien ne tacha les lagunes pour la gloire de cette caste. Eu conservant ses biens et en perdant son nom, elle crut gagner plus qu’elle ne perdait réellement.
Ce fut le 12 mai que le grand-conseil fut dissous, que le doge rentra dans la vie privée, et que le gouvernement vénitien fut anéanti. Le fait accompli, chaque ville soumise à Venise se détacha violemment
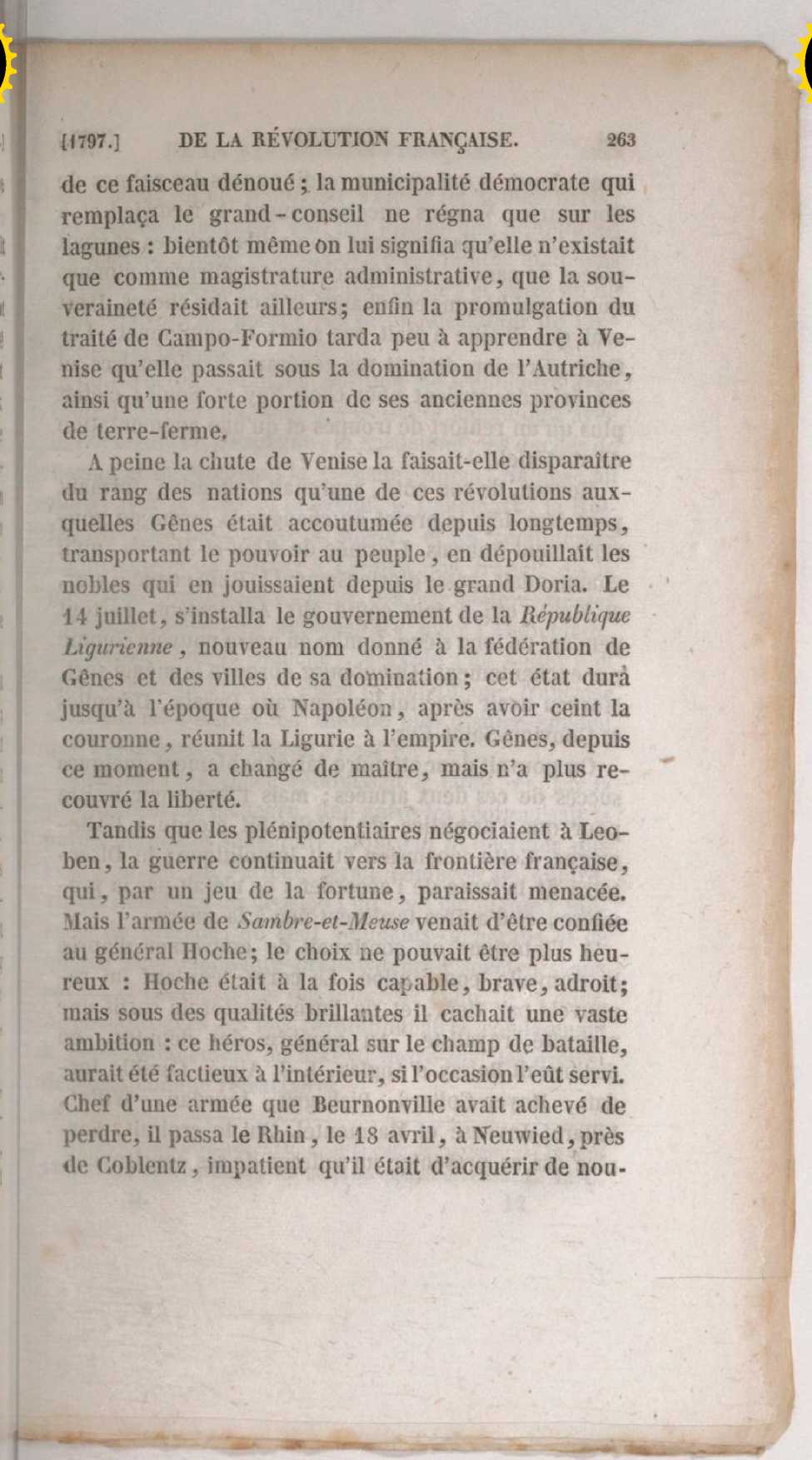
[1797.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 263 de ce faisceau dénoué ; la municipalité démocrate qui remplaça le grand-conseil ne régna que sur les lagunes : bientôt même on lui signifia qu’elle n’existait que comme magistrature administrative, que la souveraineté résidait ailleurs; enfin la promulgation du traité de Campo-Formio tarda peu à apprendre à Venise qu’elle passait sous la domination de l’Autriche, ainsi qu’une forte portion de ses anciennes provinces de terre-ferme.
A peine la chute de Venise la faisait-elle disparaître du rang des nations qu’une de ces révolutions auxquelles Gênes était accoutumée depuis longtemps, transportant le pouvoir au peuple, en dépouillait les nobles qui en jouissaient depuis le grand Doria. Le 14 juillet, s’installa le gouvernement de la République Ligurienne, nouveau nom donné à la fédération de Gênes et des villes de sa domination ; cet état dura jusqu’à l’époque où Napoléon, après avoir ceint la couronne, réunit la Ligurie à l’empire. Gênes, depuis ce moment, a changé de maître, mais n’a plus recouvré la liberté.
Tandis que les plénipotentiaires négociaient à Leo-ben, la guerre continuait vers la frontière française, qui, par un jeu de la fortune, paraissait menacée. Mais l’armée de Scunbre-et-Meuse venait d’être confiée au général Hoche; le choix ne pouvait être plus heureux : Hoche était à la fois capable, brave, adroit; mais sous des qualités brillantes il cachait une vaste ambition : ce héros, général sur le champ de bataille, aurait été factieux à l’intérieur, si l’occasion l’eût servi. Chef d’une armée que Beurnonvilie avait achevé de perdre, il passa le Rhin, le 18 avril, àNeuwied,près de Coblcntz, impatient qu’il était d’acquérir de nou-

264
HISTOIRE
[1797.]

veaux lauriers qui pussent verdir auprès des palmes de Bonaparte. Vaincus successivement à Neuwicd et à Diersdorf, où ils perdirent cinq mille hommes et vingt pièces de canon, les Autrichiens se retirèrent étonnés qu’un seul homme eût changé la face des choses. Il est vrai que Hoche n’était pas seul; Championne!, Lefèvre , Grenier, étaient ses généraux divisionnaires, et les brigades avaient pour chefs Ney et Soult : c’était plus qu’un renfort de troupes et qu’une augmentation de matériel.
Moreau, de son côté, reprenait l’offensive, formant peut-être déjà le projet de changer la forme du gouvernement français. L’armée de Rhin-et-Moselle 9 qu’il commandait, passe glorieusement le Rhin en plein jour, et Kehl, qui a tant coûté aux Autrichiens, surtout pendant un long siège, tombe en notre pouvoir comme par enchantement; Offenbourg éprouve le même sort. Moreau avait avec lui les généraux Desaix, Dessolles et Gouvion-Saint-Cyr.
On pouvait donc attendre raisonnablement quelques succès de ces deux armées ; mais l’Empereur insista pour que l’armistice de l’Italie fût étendu à l'Allemagne. Cette conclusion était impolitique ; le Directoire fit la faute de l’accorder : ce n’était pas la première , et d’autres tardèrent peu à la suivre.
A l’intérieur on continuait de gouverner d’après la nouvelle constitution. Le corps législatif fut renouvelé par tiers, et de l’urne électorale sortit une majorité royaliste. Au nombre des députés, on distinguait Boissy-d’Anglas, J.-J. Aimé, Camille Jordan , Royer-Collard, Pichegru. Jourdan, AVillot, Villaret-Joyeuse et Marmontel. Qui le croirait? Bar-rère osa se présenter au suffrage de ses concitoyens.
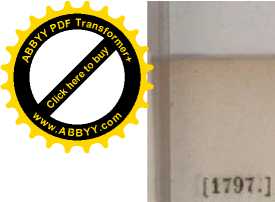
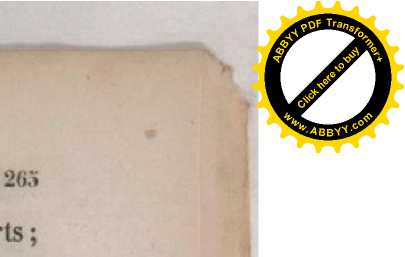
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
A ce nom, un cri d’horreur s’éleva de toutes pi un scrutin honorable eût fait justice des prétentions de Barrère, mais il se trouva que l’infâme était sous le poids d’une condamnation capitale, et cette lin de non-recevoir ne permit pas la manifestation de l’indignation publique.
Le Directoire était en position de s’entendre avec toute l’Europe : au midi, des traités le liaient déjà avec le Portugal (1), l’Espagne, la Sardaigne, les duchés de Parme et de Modène, la Toscane, Rome, Naples; au nord, avec la Prusse, la Suède, le Danemark, la Hollande ; plus bas, avec la Suisse, et les républiques Ligurienne et de Milan ; à Leoben, ou traitait de la paix avec l’Empereur ; à Lille, des négociations suivies existaient entre lord Malmesbury pour l’Angleterre, Letourneur (delà Manche), Berville (de Belley) et Moret pour la France ; enfin la République française semblait ne compter en Europe plus d’autre ennemi que l’empereur de Russie, Paul 1r.
Une loi réparatrice rétablissait le culte, et, sur la proposition de Pichegru,une autre loi réorganisait la garde nationale sédentaire. Jourdan lit décréter que l’état-major de l’armée serait composé de quatre-vingts généraux de division, de cent cinquante généraux de brigade, de cent adjudants-généraux et de quatre cent cinquante ordonnateurs-inspecteurs aux revues et commissaires des guerres; enfin, le 24 août, furent abrogées les lois révolutionnaires condamnant à l’emprisonnement ou à l’exil outre-mer les prêtres désignés comme réfractaires.
(1) Ce traité n'était récent que par la date des signatures ( 10 août
1797) : depuis longtemps, les bases en étaient arrêtées. L. L. L.
U.
12
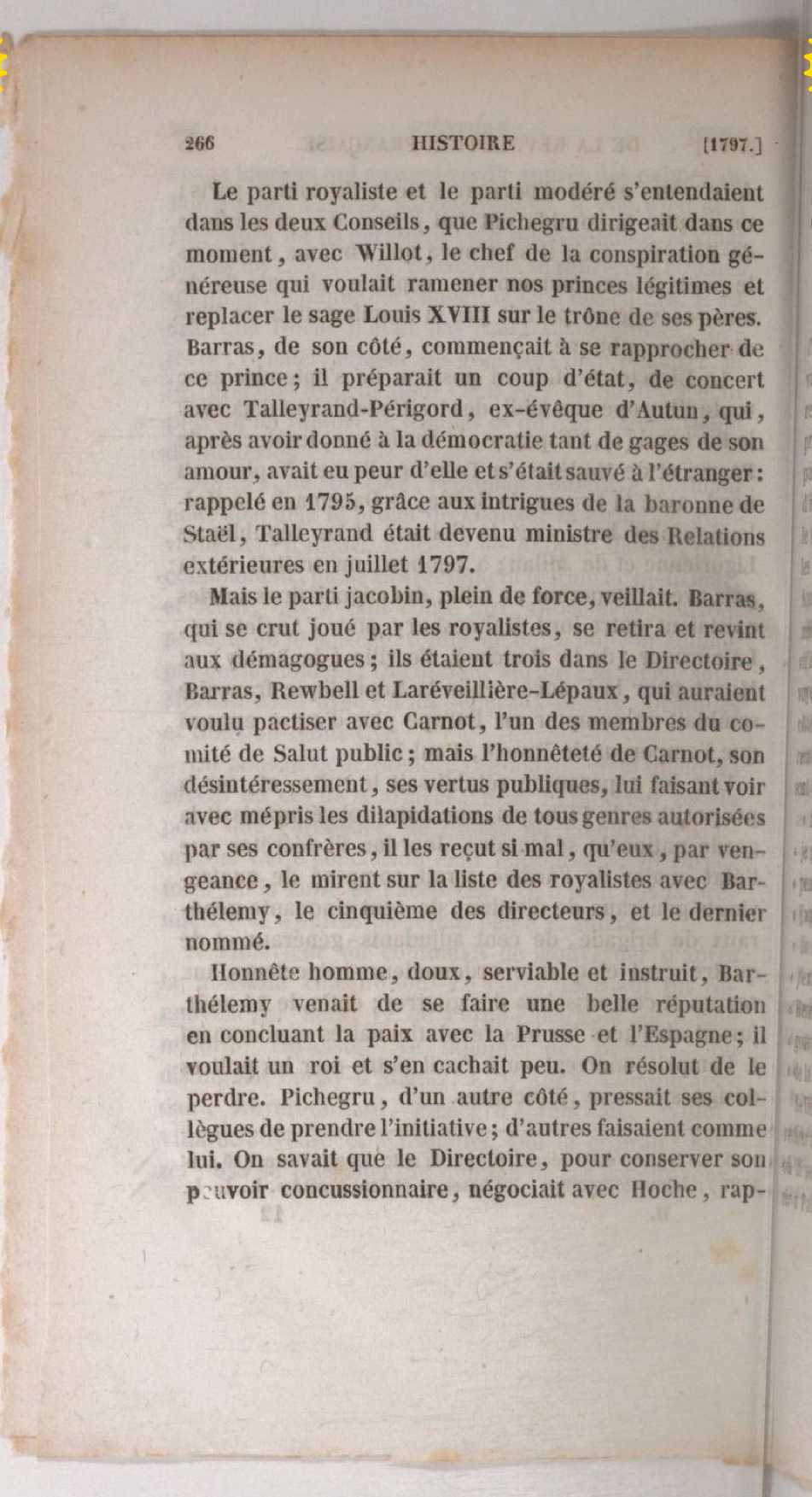
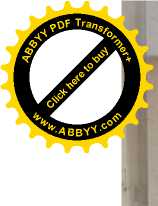

[1797.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
267
Al
n*
pelé de l’armée de Sambre-et-Meuse ; et que, joué par des intrigants, ce brave militaire consentirait sans peine à tout ce qui lui procurerait les moyens de se venger des directeurs.
Ceux-ci, instruits des secrets de Louis XVIII par l’indigne prince de Carency, fils aîné du duc de La-vauguyon, ami et ministre du roi de France, comprirent qu’il était de l’intérêt de leur conservation de prendre l’initiative. Barras écrivit à Bonaparte ce qui se passait. Bonaparte, qui déjà songeait à lui, avait trop d’intérêt à ce que l’inepte Directoire lui gardât encore le trône, caché sous un autre nom, pour souffrir que les Bourbons rappelés le lui enlevassent sans retour. Aussi parut-il dans cette circonstance républicain aussi zélé que les directeurs mêmes. On le vit montrer un vif intérêt à la cause commune Jusqu’à promettre d’envoyer trois millions pour payer le succès. D’un autre côté, il ne craignit pas de s’ouvrir à l’agent que le Directoire lui envoya, dont les mémoires autographes
sont en ma possession.
K
<
«
4
« Si les royalistes l’emportent, disait Bonaparte, je pars d’ici avec quinze’ mille hommes des mieux pensants, je marche sur Lyon au pas de charge, j’appelle les patriotes de tout l’Est de la France : ils sont nombreux; je pousserai vers Paris, et là j’exterminerai Pichegru, Willot, Imbert-Colomez, Henri Larivière, Camille Jordan, et je fonderai un gouvernement civique qui, dès le premier jour, aura de la solidité. »
Le Directoire, qui n’eût pas demandé mieux que de
retirer à Bonaparte le commandement de cette armée
où il se maintenait inexpugnable, lui proposa de venir à Paris soutenir un coup d’état. Il sentit le piège

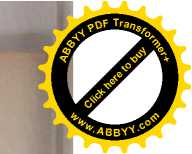
268 HISTOIRE [1797.]
et refusa. Un nouveau 13 vendémiaire l’aurait rendu trop odieux ; d’ailleurs il ne voulait faire de révolution que pour son propre compte.
Alors on lui proposa Moreau, dont il ne voulut pas; puis Beruadotte, qu’il accepta, dans l’espoir de le mettre dans une position embarrassante : mais Ber-nadotte, à qui ces voies détournées ne convenaient pas, se sauva du danger par un refus net, déclarant qu’il servirait toujours sa patrie, sans être jamais l’homme d’aucune faction (1),
Ne sachant à qui s’arrêter, on pensa à prendre Augereau; nul ne convenait mieux à Bonaparte; c’était à la fois un grand sabreur et un homme complètement nul. Jacobin pur à cette époque, et manquant de caractère, il devait être terrible le jour du coup d’état pour le conduire, et le lendemain son incapacité l’eût mis hors de ligne. Le 27 juillet, il partit pour Paris, où des affaires particulières exigeaient sa présence.
(1) Voici la copie de la lettre autographe par laquelle Bonaparte annonce au Directoire le départ du général Beruadotte.
Milan, 9 août <797.
« Citoyens Directeurs,
« Je vous ai annoncé après la bataille de Rivoli vingt-un dra-« peaux, et je ne vous en ai envoyé que treize ou seize. Je vous Irans-« mets par le général Beruadotte les autres drapeaux laissés par « mégardc à Pcschiera.
« Cet habile général, dont la réputation a commencé sur les rive* « do Rhin, est aujourd'hui l'un des officiers les plus essentiels i à la gloire de l'armée d’Italie. Il commande les trois divisions * stationnées sur la frontière d'Allemagne; je vous prie de vouloir » l ien le renvoyer à l’armée d’Italie le plus tôt possible... Le général « Bernadette est l'un des plus solides appuis de la France, aussi r incapable, par principe et par caractère, de capituler avec les a oca ar* dc la liberté que de transiger avec les lois de l'honneur. *


[1797.] DE IA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 260
Les royalistes ne comprirent pasque celui qui arrivait était la verge dont on allait les frapper. Fidèles au système de temporisation adopté par Pichegru, ils attendaient, craignant d’aller trop vite, et ne se doutant pas qu’ils allaient être prévenus. Le général Willot, seul, prévoyait tout et conjurait scs amis de ne pas perdre de temps; mais toute La valeur de Pichegru avait été épuisée sur les champs de bataille; il ne lui en restait rien pour la guerre civile.
Bonaparte , cependant, ne voyait pas sans une inquiétude vague approcher l’heure du coup d’état : il lui convenait bien que les royalistes fussent battus, mais il ne voulait pas que ce succès affermit tellement le Directoire, que désormais il n’eût plus besoin de son intervention. Le Directoire ne reçut jamais la somme qui lui avait été promise : sous différents prétextes, Bonaparte en retarda l’expédition et finit par lui dépêcher son aide de camp Lavalette, dont la légèreté faillit le brouiller avec le Gouvernement.
Le Directoire, ou pour mieux dire la majorité des directeurs, résolu à renverser l’échafaudage que ses adversaires élevaient si péniblement, donna l’ordre à divers corps de troupes de marcher sur Paris. Cet acte, contraire à la Constitution, souleva les Conseils : ils demandèrent des explications; le Directoire s’excusa sur l’ignorance d’un commissaire des guerres, et tandis que l’on discutait gravement sur le plus ou moins de distance de La Ferlé-Aleps à Paris, Augereau, de concert avec Barras, décidait de l’instant où le coup d’état aurait lieu.
Le ministère venait d’être changé et Tallcyrand-Pé-rigord faisait partie du nouveau ; cela seul annonçait une révolution. Alors on n*y fit pas attention; plus tard

270 HISTOIRE [1797.]
on n’eût pas manqué de soupçonner un bouleversement prochain.
Le Directoire, déterminé à ne pas se laisser prévenir, eut une dernière entrevue avec Augereau. Les troupes de l’armée de Hoche, qui étaient en marche pour les côtes de l’Ouest, reçurent l’ordre de se rendre rapidement à Versailles, où elles arrivèrent le 17 fructidor (3 septembre). Dès la nuit venue, elles achevèrent leur route sur Paris : là elles occupèrent les avenues, les barrières, les boulevards, les quais et les ponts ; elles protégèrent le Luxembourg et investirent les Tuileries où siégeaient les deux Conseils qu’il fallait surprendre.
Les avis de ce coup ne manquèrent pas aux députés. L’adjudant-général Ramel, qui commandait la garde des Conseils, en parla à Rovère, membre de la commission des inspecteurs, et qui était de garde cette nuit-là. Rovère répondit : A demain les affaires. Le lendemain, tout était dit. Vers trois heures du matin,le 18 fructidor (4 septembre), un envoyé du Directoire somme Ramel de livrer la porte du Pont-Tournant des Tuileries à une colonne de quinze cents hommes chargée d’une mission du pouvoir exécutif; il refuse et envoie prévenir Siméon, président des Anciens, La-fond-Ladebat, président des Cinq-Cents, et Pichegru. Celui-ci, qui avait couché rue Richelieu, chez un ami, accourt; mais déjà le Pont-Tournant a été forcé et les Tuileries sont prises.
Pichegru est arrêté ; malgré son allocution aux assaillants et sa résistance, WiRot l’est aussi ; puis on arrête encore Rovère, Berac, Tupinier, Jarry, La-méthrie, Delarue, D’Auchy, Fayole, Bourdon de l’Oise, et Ramel, qu’Augereau récompensa de sa fidélité par
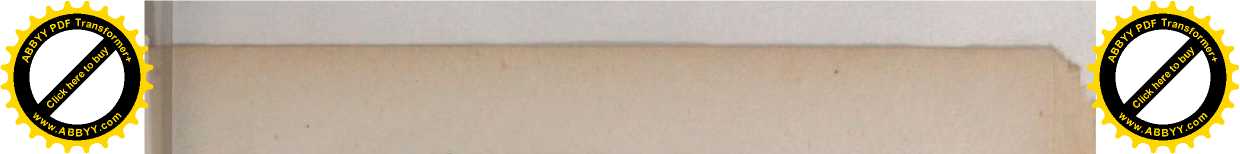
[1797.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 271
la prison. La force armée chasse le reste des Conseils
du lieu de leurs séances, et en attendant on prévient ceux des membres qui sont du parti des trois direc-Iteurs qu’un simulacre de représentation nationale s’installera provisoirement : le Conseil des Anciens à l’École de Médecine, et celui des Cinq-Cents au théâtre de rodéon.
Carnot, averti de ce qui se passe, trop tard pour y remédier, assez à temps pour sauver sa personne, s’évade , fâché de laisser son collègue Barthélemy, que l’on arrête couché. Pendant ce temps le canon du pont Neuf gronde, la générale bat, et on affiche au point du jour qu’un grand nombre d’émigrés, d’égorgeurs de Lyou, de brigands de la Vendée, ont attaqué les postes qui environnent le Directoire exécutif. La fausseté de cette assertion ne trompe personne: tous voient que ce sont les brigands à la solde du Directoire qui ont violé la souveraineté du peuple dans la personne de ses mandataires.
Lamarque, vendu aux vainqueurs, et Roger-Ducos, président les deux Conseils décimés. Les membres des Cinq-Cents et des Anciens, achetés ou frappés de terreur, privés de la moitié de leurs collègues, secondent la vengeance de Barras, Rewbell et Laréveillière; ils annulent les élections de quarante-neuf départements, suspendent presque partout les autorités administratives, révoquent les lois justes qui rappelaient aux Conseils quelques-uns de leurs membres, décrètent la peine de mort contre tout émigré rentré qui n’aura pas quitté Paris sous vingt-quatre heures, et la France sous quinze jours. Les radiations, faites depuis six mois, sont annulées ; il est décidé que tout parent d’émigré ne jouira des droits de citoyen que quatre ans après ia paix générale ; le serment de haine à la royauté

272 HISTOIRE [1797]
devient obligatoire pour quiconque voudra remplir des fonctions publiques ou salariées. Les réfugiés de Toulon sont repoussés du territoire; les Bourbons qui languissaient en France sont proscrits; les décrets qui avaient rendu leurs biens au prince de Conti et à la duchesse d’Orléans sont rapportés; une autorité quasi-illimitée est accordée au Directoire; il peut arbitrairement ordonner la mise en état de siège, destituer un fonctionnaire, ou déporter un prêtre. La garde nationale est épurée, on n’y laisse que les vieux jacobins ; les imprimeries des journaux de l’opposition sont abandonnées au pillage ; la liberté de la presse est suspendue : les propriétaires, éditeurs, rédacteurs de quarante-deux journaux, sont déportés arbitrairement et en masse, la peine du dernier supplice est portée contre plusieurs qui sont assez heureux pour s’y soustraire parla fuite ; enfin il est décrété qu’à l’avenir les troupes pourront entrer dans le rayon constitutionnel à la volonté du Directoire, à qui les Conseils donnent un bill d’indemnité pour tous ses actes antérieurs.
Le Directoire s’occupa ensuite du départ des proscrits. Des chariots, tels que ceux que l’on construit pour les bêtes féroces, conduisirent au port de mer désigné pour l’embarquement Barthélemy le directeur. Pichegru, Vil lot, Delarue, Bourdon de l’Oise, Ro-vère, Aubry, Lafond-Ladebat, Tronçon-Ducoudray, Barbé - Marbois, Murinais, Ramel, DossonviUe, La Villeheurnois, Broltier, Duverne de Presles, et tous ceux qui se trouvaient frappés par la même mesure.
Accablés de mauvais traitements, poursuivis par la haine active des méchants, les victimes du 18 fructidor, embarquées à Rochefort, allèrent trouver la

IH97.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 273 mort ou traîner une vie misérable sur les sables brûlants de la Cayenne, et dans le désert humide et dévorant de Sinamary. Plus heureux, Barthélemy, Pichegru, Willot et quelques autres purent fuir, avant qu’il fût permis à Bonaparte, au 18 brumaire, de réparer des maux auxquels il avait contribué.
Merlin de Douay et François de Neufchâteau remplacèrent au Directoire les deux exilés.
A la suite de cette révolution réelle, la terreur de 1793 plana de nouveau sur la France, surtout lorsqu’un décret du 15 septembre eut exclu les nobles de toutes fonctions et les eut privés de leurs droits politiques. Le 17, le Directoire, que la paix générale épouvantait, rompit les conférences de Lille ; lord Malmes-bury,ayant reçu ses passe-ports, partit immédiatement.
Le 17, Hoche mourut empoisonné. Joué par Barras, il n’avait pu lui pardonner : ses révélations auraient compromis le Directoire ; on jugea plus convenable de le réduire à un silence éternel. Moreau, dont la lâcheté morale ne se démentait pas, avait, peu avant le 18 fructidor, surpris dans les bagages du général autrichien de Kinglin toute la correspondance de Pichegru avec le prince de Condé , Louis XVIII et autres. Comme Moreau était déjà d’intelligence avec Pichegru pour faire une révolution royaliste, il n’eut garde d’en déceler le chef. Mais le coup d’état frappé, et les espérances des hommes de la droite anéanties. Moreau, sans honte, se tourna du côté des vainqueurs.
Le Directoire reçut la révélation de la prise de ces papiers et documents précieux : Moreau les lui envoya; mais il ne put éviter que de justes soupçons ne planassent sur lui.
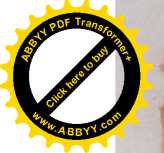

27ł HISTOIRE [1797.]
On était à une époque où le Gouvernement pouvait tout oser ; le Directoire en profita pour faire une banqueroute universelle. Le 20 septembre, parut une loi qui remboursait toutes les dettes nationales quelconques , de la manière suivante : les deux tiers furent payés en bons au porteur, à échanger contre des biens nationaux, et recevables en payement de la portion du prix payable avec la dette publique. C’était une véritable escroquerie, comme la suite le prouva bien. Le dernier tiers, représentant à l’avenir une valeur numérique, serait seul non remboursé, mais inscrit au grand-livre de la dette de l’État; on en payerait la rente à cinq pour cent, à perpétuité. La fraude était si flagrante que le jour même de l’émission des bons donnés en solde des deux tiers, ils perdirent de soixante-dix à quatre-vingts pour cent.
Certes, c’était là le moment où la nation tout entière aurait dû se lever contre d’aussi coupables spoliateurs; mais il n’y a parmi nous aucune force morale dans les classes aisées : elles seront toujours soumises à qui voudra les dominer. Les révolutions en France, depuis 1789, n’ont été faites que par les masses populaires. Celles auxquelles le peuple n’a point pris part ont été escamotées, si I on peut s’exprimer ainsi. Telles furent la journée du 9 thermidor, où la promptitude de l’attaque, de la part de la Convention, ne laissa pas à la populace le loisir de prendre les armes, et celle du 18 brumaire, que l’armée décida seule en apparence, mais qu’au fond elle n’eût pu accomplir si le peuple n’eût été à l’avance subjugué par la haute réputation de Bonaparte.
Pendant que le Directoire ruinait les rentiers, il ne rougissait pas de rétablir le jeu immoral de la loterie.
ł

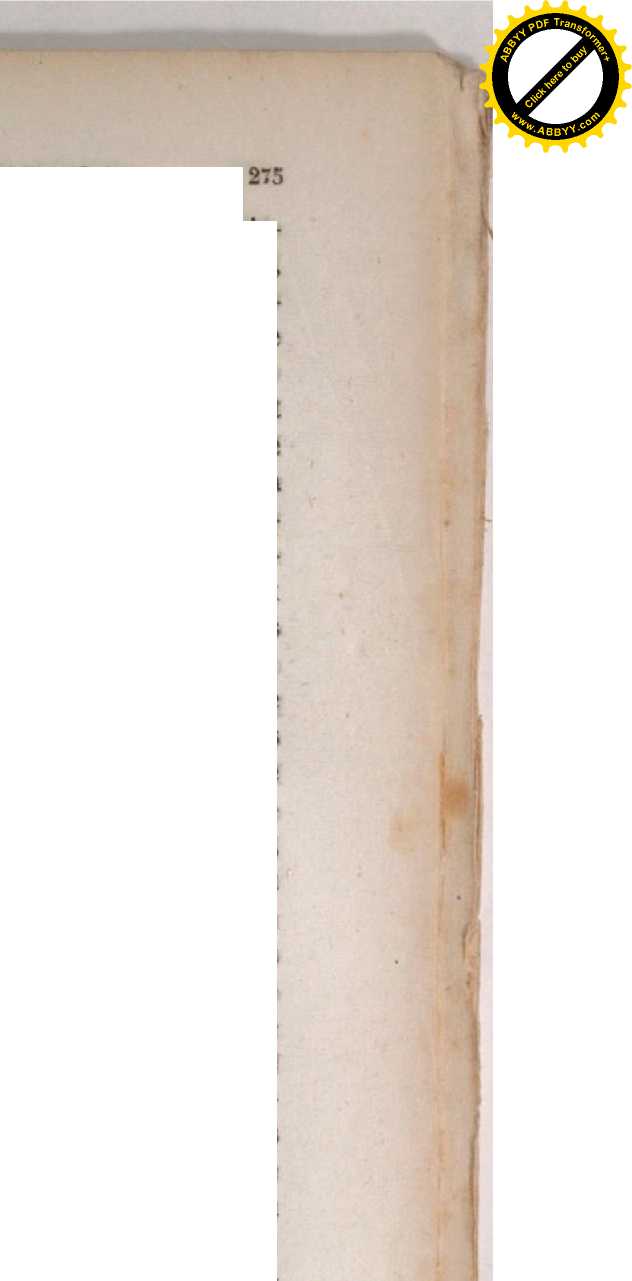
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
Ce que la Convention n’avait pas voulu laisser subsister, ce nouveau gouvernement, si pur, à l’entendre, si moral, ne craignait pas, en lui rendant l’existence , de rouvrir un abîme que l’on avait eu tant de peine à fermer.
Bonaparte, brouillé avec le Directoire qui l’accusait de lui avoir manqué de parole, voyant que la guerre serait trop favorable aux directeurs, se détermina à profiter des pleins pouvoirs qu’on lui avait oiTicielle-ment donnés, et, n’ayant aucun égard à la correspondance secrète, il signa enfin le fameux traité de paix dit de Campo-Fonnio f qui rétablissait les anciennes relations entre la France et l’Autriche.
Par ce traité, du 17 octobre, la maison impériale abandonnait la Belgique, le Luxembourg et toutes les provinces du Brabant qu’elle possédait avant la dernière guerre, pour être incorporées à 1? France, et elle cédait en outre la Lombardie, les territoires de Bergame, de Brescia, de Crémone et de Mantoue, Peschiera et la partie des États vénitiens à la gauche du lac de Garda, de l’Adige jusqu’à Porto-Legnago, et de là au Pô et à la mer. La réunion de ces États, soit qu’ils lui appartinssent, soit qu’ils dépendissent du domaine de Venise, devait en former un qui prendrait le nom de république Cisalpine; de plus elle consentait à abandonner sans trouble au pouvoir de la France les îles de Corfou, Xante, Céphalonie,Ithaque,etc., ainsi que tous les établissements vénitiens en Albanie, au delà du golfe de Ludrino, tels que Butvinto, L’Arta, Vonizza.
La France, en retour et pour indemniser l’Empereur de la perte de la Belgique et de la Lombardie, lui remettait le surplus des États vénitiens en Italie, l’Istrie, la Dalmatie, les îles de ce littoral et les Bou-

ches du Cattaro; Venise même entrait dans ce partage. Enfin, un congrès s’ouvrirait à Rastadt, où l’on traiterait de la paix générale avec l’Empire, bien que, par des articles secrets insérés dans le présent traité de Campo - Formio, l’Empereur consentît à ce que la France étendît ses limites jusqu’au Rhin , qui serait sa barrière naturelle, etc. Le comte Louis de Cobentzel signa pour l’Autriche, et la plume de Bonaparte sanctionna ce que son épée avait conquis si glorieusement.
Ce grand capitaine , nommé pour aller à Rastadt continuer les négociations, quitta, le 26 octobre, le commandement en chef de l’armée d’Italie ; il fut remplacé par Alexandre Berthier. Divers corps en lurent détachés pour former le noyau d’une armée, dite de la Manche, dirigée contre l’Angleterre, et dont le commandement était destiné à Bonaparte ; c’était un leurre : déjà on songeait à l’expédition d’Égypte. Le Gouvernement français avait pour but de se débarrasser d’un général pour qui l’opinion publique réclamait une haute place, et Bonaparte, de son côté , espérait que celte expédition accroîtrait tellement sa renommée, qu’il ne serait plus possible de lui refus er le souverain pouvoir.
Le 16 novembre, mourut à Berlin le successeur faible d’un grand homme, Frédéric-Guillaume II, qui avait remplacé Frédéric II sans le faire oublier. Après lui monta sur le trône Frédéric-Guillaume III, fils du dernier roi, monarque aujourd’hui régnant, prince sage, vertueux, cher à son peuple, et qui a su soutenir avec une noble constance sa bonne et sa mauvaise fortune.
Bonaparte, après avoir tout réglé en Italie, s’était
HISTOIRE
[1797.1

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 277 rcndu au congrès de Rastadt, où Bonnier d’Alco, exprésident ii la Cour des Aides de Montpellier, membre de la Con-vention nationale, et qui avait voté le meurtre de son roi, avait été également envoyé avec Treil-hard, autre régicide. Là, à la date du 1er décembre, le héros moderne se hâta d’échanger le traité de Campo-Formio avec le comte Louis de Gobentzel, qui venait de remettre Mayence aux Français et de faire rétrograder l’année autrichienne jusqu’à l’Inn et au Lech, limites désignées pour attendre la fin du congrès, qui s’ouvrit le 9 décembre.
Le 10 décembre, à Paris et dans la cour du Luxembourg. la remise solennelle du traité que Bonaparte avait conclu fut faite au Directoire de la république. On avait imprimé à cette solennité un éclat extraordinaire : Bonaparte y parut accompagné de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, des administrateurs du département de la Seine, et d’une suite si nombreuse d’officiers de tous gi ades et de soldats, que le même soir Barras ne put s’empêcher de dire à Ozun, membre des Cinq-Cents : « Que vous a semblé tantôt de l’armée de Bonaparte? — Qu’il lui reste une position à conquérir. — Soit, le monde est vaste : qu’il désigne le morceau qu’il en veut. »
Le bruit de l'artillerie, les fanfares de douze cents instruments à vent, furent couverts par le fracas des acclamations et des applaudissements qui annoncèrent Bonaparte ; il y eut un tel mouvement d’enthousiasme à se presser autour de lui, que la troupe dut croiser la baïonnette pour empêcher qu’on ne l’étoufTàt.
Par suite des conquêtes et de la réunion de la Belgique, le territoire français fut, à la fin de cette année, divisé en quatre-vingt-dix-neuf départements.

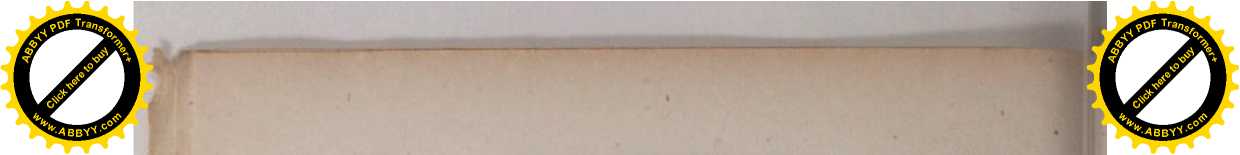
278 HISTOIRE [1797 ]
Le 28 décembre, dans une émeute comme il y eu a tant en Italie, le général français Dupliot périt assassiné à Rome. Le Directoire en profita pour retirer son ambassadeur, Joseph Bonaparte, et il tarda peu à recommencer la guerre contre le Saint-Siège.
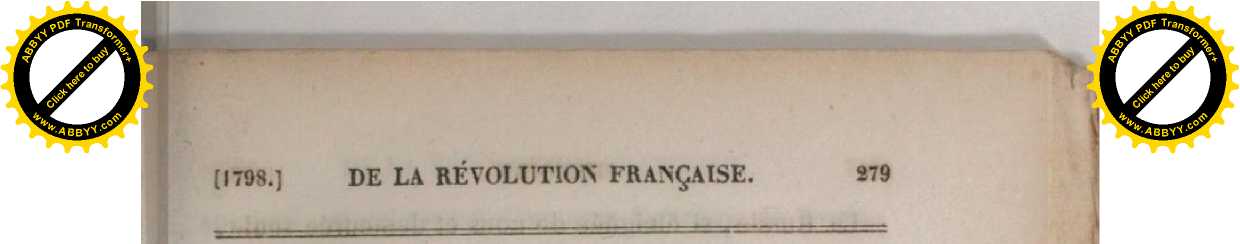
Situation de la France et de l'Europe, en 1798. — Lois relatives à l’intérieur. — Suites de l'assassinat de Dnphot. — Le pape Pie VI, chassé de Rome. — Réunion de Genève à la France. — Descente en Irlande. — La Porte déclare la guerre à la France. — Établissement de la conscription. —Position des armées françaises. — Situation de l'Italie. — Mack attaque les Français. — Il est vaincu par Championnet. — Prise de Naples. — Chute du gouvernement sarde.
L’Europe, au commencement de cette année, jouissait d’un calme qu’elle n’avait pas connu depuis l’aurore de la révolution : toutes les puissances continentales étaient en paix avec la France, ou ne tarderaient pas à l’être ; et, en attendant, une trêve y suppléait. Les conquêtes des deux années précédentes avaient fait disparaître du rang des nations la république vénitienne; à sa place était née la république Cisalpine. A Gênes le gouvernement avait passé des mains des nobles à celles du peuple. Le comté de Nice appartenait à la France, qui avait garnison à Livourne. Une portion des États du Pape avait été réunie à la république milanaise. L’ancien équilibre italien n’existait plus.
La Belgique était française ; les électorats ecclésiastiques de Mayence, de Trêves, de Cologne, appartenaient à la France par droit de conquête, et elle ne les rendrait pas. L’équilibre était donc rompu à l’est et au nord : la destruction du stathoudérat en Hollande avait fait de cette riche république l’un de nos avant-postes; par là, nous touchions au Danemark, à la Prusse, et dans un instant nous pouvions porter la guerre au cœur de cette dernière puissance.

280 HISTOIRE U 798.}
La Russie, si éloignée de nous et demeurée seule, n’était pas à craindre. L’Angleterre guerroyait, mais hors de l’Europe; elle soudoyait la Vendée, mais la Vendée expirait : encore un peu de temps, et cette héroïque contrée, lasse de tant de gloire et de tant de malheurs, accepterait la paix qu’un grand homme lui offrirait.
La France jouissait d’une tranquillité à peu près générale. A part la chouannerie, il n’y avait aucun pays insurgé; et pourtant il régnait un malaise universel; l’inquiétude et la désorganisation étaient partout. Les passions fermentaient ; les dilapidateurs, dominant, appauvrissaient la république ; le commerce était mort. Les hommes de toutes les nuances voyaient avec mécontentement l’impéritie, l’avidité et la nonchalance du Gouvernement : ils en désiraient un autre, et chacun prétendait que celui qu’il proposerait devrait être accepté.
Or, cet état de marasme politique dura près de deux ans, encore ne cessa-t-il qu’au 18 brumaire. En attendant cette époque mémorable, je vais tracer rapidement la série des faits qui composent l’histoire de ces deux années.
En représailles des mesures hostiles auxquelles l’Angleterre s’était livrée contre notre commerce, le Directoire ordonne à la date du 4 janvier la saisie des marchandises anglaises partout où Fou pourrait les atteindre ; il fait décréter un emprunt de quatre-vingts millions, pour «aider à la guerre contre le cabinet anglais. Le 28 du même mois, les Français entrent en Suisse, ils la pillent et la bouleversent : des hommes pervers, des Jacobins, entreprennent de renverser l’antique constitution de rilelvélic; le Directoire la


DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
SS|

soutient, et cela pour s’emparer du trésor de Berne. On envoie dans ce pays un fripon nommé Rapinat, parent de Rewbell, avec lequel il partageait sans doute ses rapines; ce misérable, par ses concussions et par ses arrêts de mort, mit à feu et à sang cette terre classique d’une sage indépendance. Le 29, Mulhouse, ville libre de la Suisse, fut réunie par force au département du Haut-Rhin.
A la nouvelle de l’assassinat du général Duphot, à Rome, le Directoire avait ordonné à Berthier, commandant en Italie, de se porter sur cette ville. Le 10 février il occupa le château Saint-Ange, que la faiblesse ou la trahison lui livra, et par ses proclamations il appela les Romains à renverser le trône pontifical. Cinq jours après, la révolution romaine eut lieu; Pie VI refusa noblement la cocarde tricolore que Berthier lui présentait ; il dit ; Je ne puis porter d'autres couleurs que celles de l’Église. Enlevé du Quirinal, conduit d’abord à Sienne, puis à la Chartreuse de Florence, il fut enfin traîné captif en France, emprisonné à Valence , où il mourut, ainsi que je le dirai en son temps.
Le 1er mars, les plénipotentiaires de l’Empereur au congrès de Rastadt reconnaissent à la France le droit de porter ses frontières sur le Rhin. Le 2, le pays de Vaud , occupé inopinément par nos troupes, est ravagé; il s’ensuit un soulèvement en Suisse : le sang coule, le bon droit cède, mais la gloire reste aux vaincus. et la France regrettera toujours que le Directoire ait employé ses braves à combattre les descendants de Tell. Après la prise de Berne et la spoliation de son trésor de douze millions, une constitution pareille à celle de la France fut imposée par le général Brune à la Suisse : elle eut son directoire, ses cou-

suis et ses dilapidateurs, qui successivement pillèrent les trésors de Lucerne, de Zurich, du Valais, etc. Le 12 avril, cette nouvelle constitution suisse fut mise en vigueur.
Le 26 du même mois, un décret réunit Genève à la France. Le 11 mai, le Directoire, prévoyant que les élections faites par les assemblées primaires et par les collèges électoraux lui seraient contraires, les fait casser despotiquement dans presque tous les départements de la République. Jamais la tyrannie n’est plus arbitraire, plus injuste que lorsqu’elle feint d’agir au nom de la liberté.
Depuis 1789, les États-Unis de l’Amérique septentrionale , remplis de vénération et de reconnaissance pour le vertueux Louis XVI, n’avaient eu qu’à se plaindre du nouveau gouvernement français. Les relations politiques en avaient souffert; enfin le mécontentement des Américains arriva à un tel point que le congrès, à la date du 24 juin, déclara en séance so-lenuelle que, dès ce jour, il suspendait tout rapport d’amitié ou d’intérêt avec la république Française, jusqu’à ce que celle-ci eût reconnu et réparé ses torts. Un tel acte blessa vivement le Directoire ; les plaintes d’une république lui étaient bien plus importunes que celles des rois.
Le Directoire, comprenant que la violence seule pourrait soutenir son autorité, se fait accorder par une loi, le 6 juillet, le droit de faire des visites domiciliaires pour arrêter les agents anglais, les émigrés rentrés, les prêtres réfractaires; il en revenait aux mesures arbitraires du comité de Salut public.
Le 5 septembre, une loi dont le général Jourdan est rapporteur établit la conscription militaire en
HISTOIRE
[1798.]
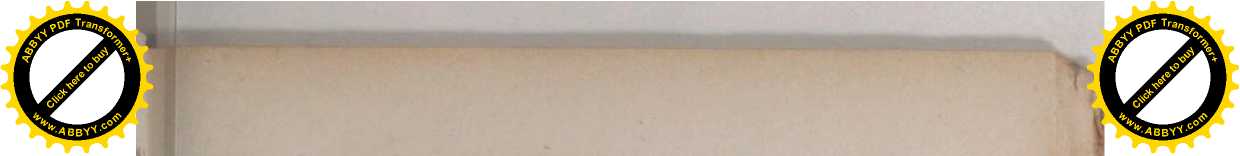
(1798.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 283
France, mesure pénible, mais juste, car il convient que tous concourent à la défense de la patrie. L’abus que l’on a fait de cette loi patriotique a pu la rendre odieuse; mais elle n’en est pas moins équitable, et elle le sera toujours quand elle sera appliquée d’après sa véritable institution et avec les adoucissements (font elle est susceptible.
Le 22 août, une expédition sous les ordres du général Humbert tenta de descendre sur les côtes de l’Irlande. Douze cents hommes seulement purent être mis à terre ; c’étaient des victimes envoyées aux Anglais, et non des soldats en mesure de conquérir le pays. D’ailleurs, la sympathie des naturels, sur laquelle on comptait, ne se manifesta pas. L’Irlandais, religieux et royaliste, ne se fiait pas à un gouvernement qui, après avoir tué son roi, emprisonnait le Pape et proscrivait la religion de Jésus-Christ. Le 8 septembre, le brave Humbert, avec ce qui lui restait de ses douze cents hommes, cerné par vingt-cinq mille Anglais, ayant à leur tête lord Cornwallis, fut obligé de capituler.
Le 12 septembre, la Porte ottomane déclara la guerre à la France en représailles de la conquête de l’Égypte que Bonaparte tentait à cette époque, comme je le dirai plus bas. Le 24, une loi appela deux cent mille conscrits sous les armes ; alors cessa l’ancien mode de recrutement, qui fut remplacé par la conscription et par des engagements volontaires.
Cette forte levée annonçait les inquiétudes du Directoire. La paix que Bonaparte lui avait conquise était prête à lui échapper. L’Empereur se montrait moins pressé de la conclure. Déjà les agents anglais parcouraient de nouveau l’Europe et poussaient les rois à se
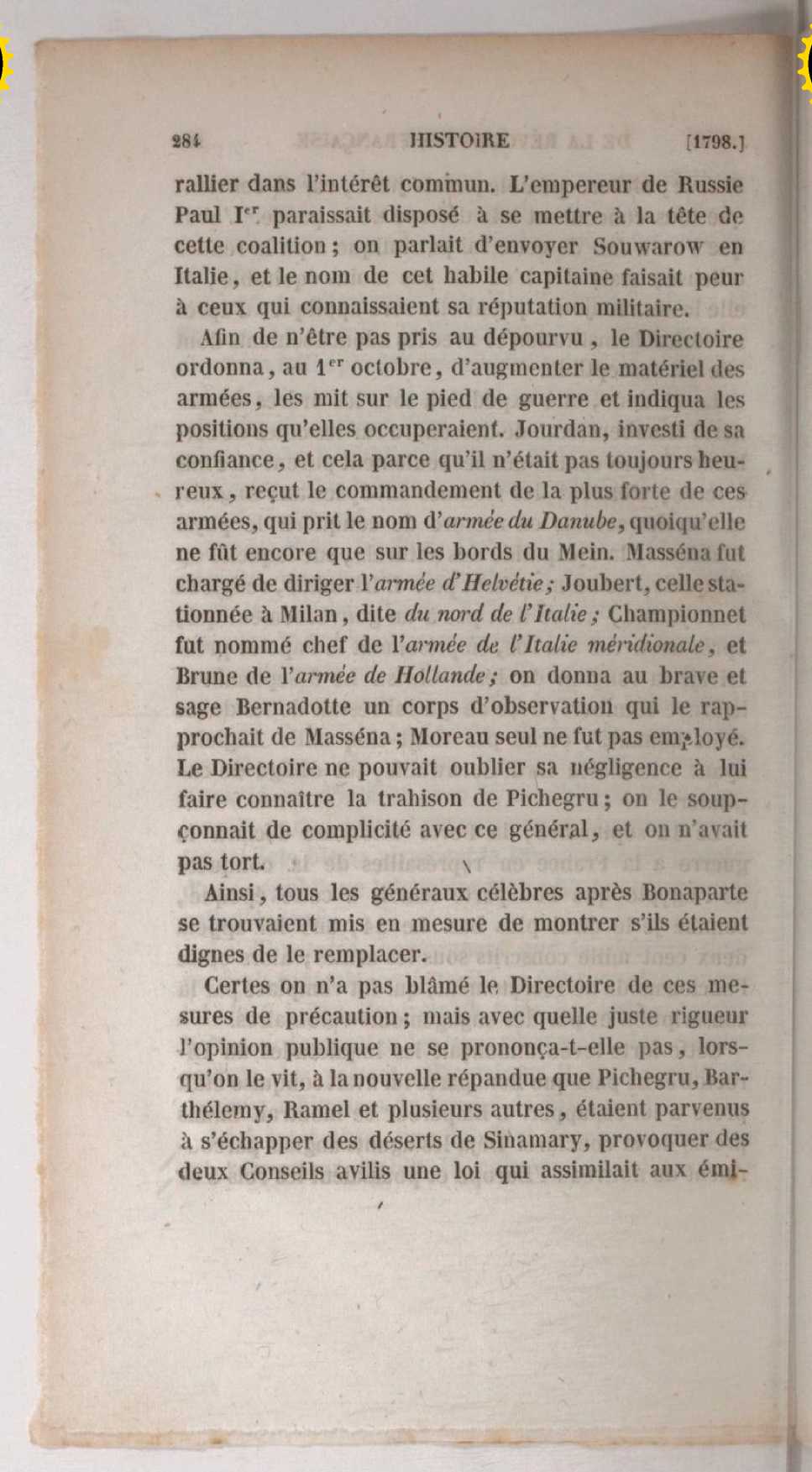
rallier dans l’intérêt commun. L’empereur de Russie Paul Tr paraissait disposé à se mettre à la tête de cette coalition ; on parlait d’envoyer Souwarow en Italie, et le nom de cet habile capitaine faisait peur à ceux qui connaissaient sa réputation militaire.
Afin de n’être pas pris au dépourvu , le Directoire ordonna, au 1er octobre, d’augmenter le matériel des années, les mit sur le pied de guerre et indiqua les positions qu’elles occuperaient. Jourdan, investi de sa confiance, et cela parce qu’il n’était pas toujours heureux , reçut le commandement de la plus forte de ces armées, qui prit le nom à’armée du Danube, quoiqu’elle ne fût encore que sur les bords du Mein. Masséna fut chargé de diriger Varmée d’Helvétie; Joubert, celle stationnée à Milan, dite du nord de l’Italie; Championnet fut nommé chef de Varmée de l’Italie méridionale, et Brune de Varmée de Hollande; on donna au brave et sage Bernadotte un corps d’observation qui le rapprochait de Masséna ; Moreau seul ne fut pas employé. Le Directoire ne pouvait oublier sa négligence à lui faire connaître la trahison de Pichegru ; on le soupçonnait de complicité avec ce général, et on n'avait pas tort \
Ainsi, tous les généraux célèbres après Bonaparte se trouvaient mis en mesure de montrer s’ils étaient dignes de le remplacer.
Certes on n’a pas blâmé le Directoire de ces mesures de précaution ; mais avec quelle juste rigueur l’opinion publique ne se prononça-t-elle pas, lorsqu’on le vit, à la nouvelle répandue que Pichegru, Barthélemy, Ramel et plusieurs autres, étaient parvenus à s’échapper des déserts de Sinamary, provoquer des deux Conseils avilis une loi qui assimilait aux émi-
HISTOîRE
[1798.]

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
285

grés les déportés qui rompraient leur ban! Cette infamie était bien digne de pareils gouvernants !
Les prévisions du Directoire étaient fondées : une coalition nouvelle se préparait contre lui ; Forage qui grondait éclata à l’extrémité de l’Italie. Ferdinand III, roi de Naples, entraîné par la reine Caroline, sa femme, et par son ministre Acton, se détermina le premier h déclarer la guerre à la France en attaquant sa nouvelle alliée la république Romaine; il mit à la tête de ses troupes le général autrichien Mack, homme de mince capacité, malgré sa haute réputation, plein de jactance dans un conseil, et poltron sur le champ de bataille, présomptueux comme un ignorant, et d’autant plus gonflé d’orgueil qu’il avait moins de mérite réel.
Le 21 novembre, Mack, à la tête de quatre-vingt mille Napolitains, attaqua les avant-postes de l’armée commandée par Championnet : ceci avait lieu presque au moment où l’on signait à Saint-Pétersbourg une alliance offensive et défensive entre l’empereur de Russie et le roi de Naples. Le 1er décembre suivant, et à Naples même, un autre traité était conclu entre Ferdinand lil et le roi d’Angleterre. Le but de ces divers traités était une guerre active dirigée centre la France.
Mats il fallait mieux que des signatures pour vaincre les Français. A Civita-Castellana, à dix lieues de Rome, Mack, avec quarante mille Napolitains, ayant livré bataille à Championnet qui n’avait à lui opposer que six mille hommes, fut entièrement rais en déroute. Le général Kellermann, fils de celui qui depuis fut maréchal de France, détermina, par une brillante charge (iavant-garde, le succès de cette journée. Cham-
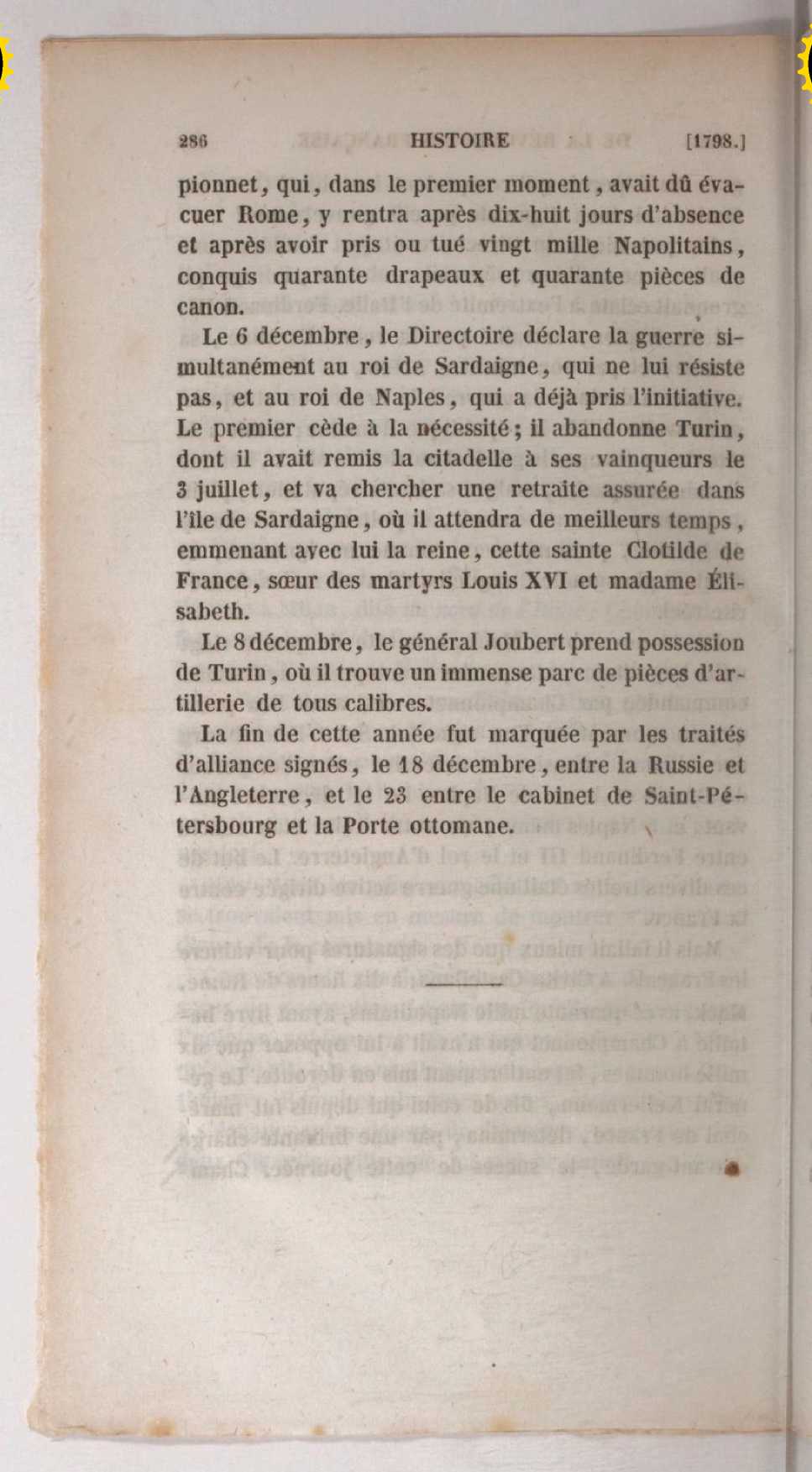
pionnet, qui, dans le premier moment, avait dû évacuer Rome, y rentra après dix-huit jours d’absence et après avoir pris ou tué vingt mille Napolitains, conquis quarante drapeaux et quarante pièces de canon. ,
Le 6 décembre, le Directoire déclare la guerre simultanément au roi de Sardaigne, qui ne lui résiste pas, et au roi de Naples, qui a déjà pris l’initiative. Le premier cède à la nécessité ; il abandonne Turin, dont il avait remis la citadelle à ses vainqueurs le 3 juillet, et va chercher une retraite assurée dans File de Sardaigne, où il attendra de meilleurs temps , emmenant avec lui la reine, cette sainte Clotilde de France, sœur des martyrs Louis XVI et madame Élisabeth.
Le 8 décembre, le général Joubert prend possession de Turin, où il trouve un immense parc de pièces d’artillerie de tous calibres.
La fin de cette année fut marquée par les traités d’alliance signés, le 18 décembre, entre la Russie et l’Angleterre, et le 23 entre le cabinet de Saint-Pétersbourg et la Porte ottomane.
¿86
HISTOIRE
[1798.]
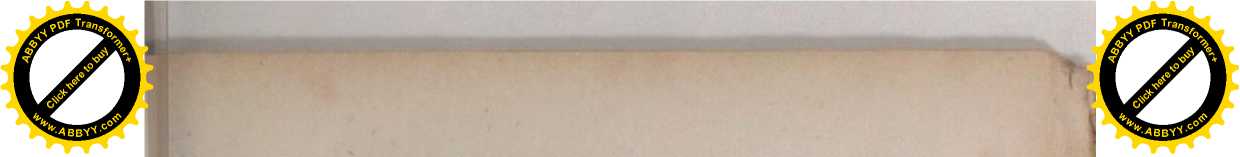
[1798.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 2S7
Expédition d’Égypte. — Détails de l’expédition. —Composition de l’armée.— Proclamation de Bonaparte. — Départ. — Prise de Malle.— Vue de l’Égypte. — Débarquement. — Prise d'Alexandrie. — L’Égypte. — Son gouvernement. — Ibrahim-Bcy. — Mourad-Bey. — Victoire des Pyramides. — Prise du Caire. — Administration française. — Lettre de Bonaparte. — Défaite d’Ibrahim. — Bataille d’Aboukir.— Le Sultan déclare la guerre à la France.—Expédition de Syrie.—Victoires du Tha-bor. de Nazareth. — Saint-Jean-d'Acre. — Proclamation de Bonaparte. — Combats dans In Haute-Égypte. — Révolte du Caire — Mourad-Bey encore vaincu. —Victoire remportée par les Français sur l'armée ottomane. — Retour de Bonaparte en France. — Assassinat de Kléber. — Menou. — Les Français évacuent l'Egypte.
Je n’ai pas voulu interrompre, par le récit de faits incidents, celui de la célèbre campagne d’Égypte dirigée par Bonaparte, et dont la conquête de Malte fut le brillant épisode. Maintenant que j’ai rapporté tout ce qui se passa en Italie et ailleurs jusqu’à la fin de l’année, je vais reprendre en peu de mots l’histoire rapide de cette grande expédition.
Bonaparte était encore en Italie, lorsque des voyageurs, et surtout des Grecs, lui représentèrent comme facile la conquête de l’Égypte, qui lui procurerait le moyen d’arriver plus aisément à détruire les propriétés anglaises dans les Indes. Cette idée enflamma son imagination brillante ; il rêva des conquêtes à la Gengiskhan, à la Tamerlan ; il vit l’Asie entière subjuguée, et un empire nouveau s’élevant au milieu de ces contrées fertiles, que nous connaissons à peine.
Il en écrivit au Directoire ; et celui-ci, charmé de se débarrasser du seul homme qui lui donnât de l’inquié-tale , se bâta de le satisfaire. Il y mit un tel empres-
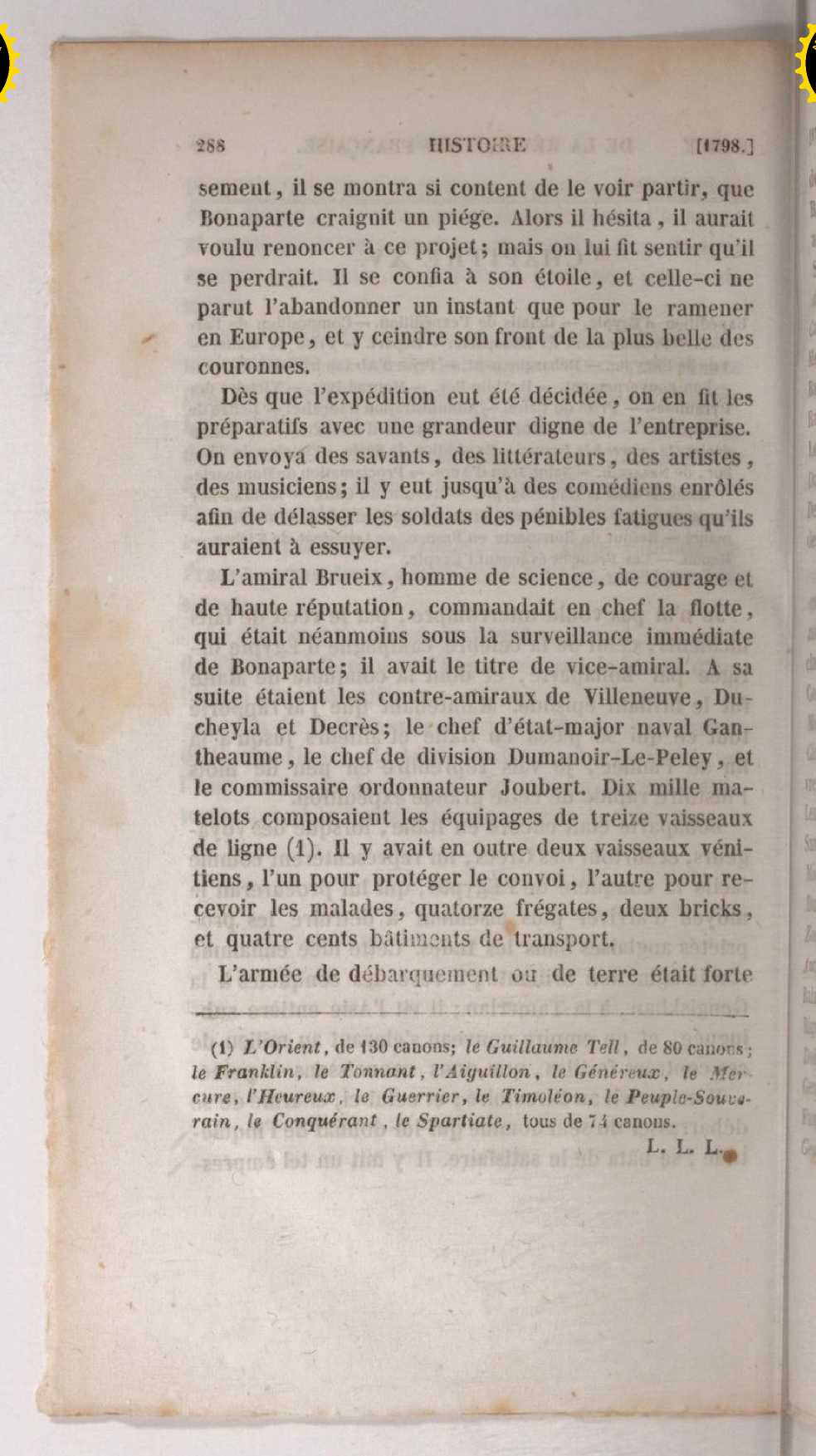
HISTOIRE
[1798.]
288
semeni, il se montra si content de le voir partir, que Bonaparte craignit un piège. Alors il hésita, il aurait voulu renoncer à ce projet; mais on lui fit sentir qu’il se perdrait. Il se confia à son étoile, et celle-ci ne parut l’abandonner un instant que pour le ramener en Europe, et y ceindre son front de la plus belle des couronnes.
Dès que l’expédition eut été décidée, on en lit les préparatifs avec une grandeur digne de l’entreprise. On envoya des savants, des littérateurs, des artistes, des musiciens; il y eut jusqu’à des comédiens enrôlés afin de délasser les soldats des pénibles fatigues qu’ils auraient à essuyer.
L’amiral Brueix, homme de science, de courage et de haute réputation, commandait en chef la flotte, qui était néanmoins sous la surveillance immédiate de Bonaparte; il avait le litre de vice-amiral. A sa suite étaient les contre-amiraux de Villeneuve, Du-cheyla et Décrûs; le chef d’étal-major naval Gan-theaume, le chef de division Dumanoir-Le-Peley, et le commissaire ordonnateur Joubert. Dix mille matelots composaient les équipages de treize vaisseaux de ligne (1). Il y avait en outre deux vaisseaux vénitiens, l’un pour protéger le convoi, l’autre pour recevoir les malades, quatorze frégates, deux bricks, et quatre cents bâtiments de transport.
L’armée de débarquement ou de terre était forte
(1) L’Orient, de 130 canons; le Guillaume Tell, de 80 canorit; le Franklin, le Tonnant, l’Aiguillon, le Généreux, le Mer cure, l’Heureux, le Guerrier, le Timuléon, le Peuple-Souverain, le Conquérant, le Spartiate, tous de 74 canons.
L. L. L.#

«7981. DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. «89 de près de quarante mille soldats de toutes armes. Bonaparte, qui en était général en chef, avait pour aides de camp Duroc, Louis Bonaparte, Croisier, Sulkousky, Julien, Eugène Beauharnais, Merlin, fils du directeur; les généraux de division étaient Berthier, Caffarelli.- Dufalga, Dammartin, Kléber, Desaix , Menou, Dumuy, Vaubois, Bon, Dugua, Reynier, Baraguay-d’Hiiliers; les généraux de brigade, Lannes, Rampon, Dumas, Lanusse, Andréossy, Murat. Vial, Leclerc, Verdièrvs, Fagières, Zayoncbech, Dupuy, Davoust, Belliard, Vaux. Deux médecins célèbres, Desgenettes et Larrey, étaient chargés de la direction des hôpitaux.
La commission des sciences et des arts, dont on composa depuis Y Institut d'Egypte, comptait un grand nombre de noms déjà connus, d’hommes habiles, classés de la manière suivante: Géométrie. Fourrier, Costaz, Coiancey etSay; Astronomie. Nouet, Quesnot, Méchain /ils; Mécanique, Monge, Hassenfratz jeu^e, Girot, Cassard, Adrien père. Conté, Dubois, Couvreur, Lenoir /ils, Adrien /ils, Cécile; Horlogerie, Lemaître ; ( himie, Berthollet„l’oHier, Champy /ils, Samuel Bernard, Descotils, Champy père, Regnaud; Minéralogie , Dolomieu, Cordier, Rozières, Victor, Dupuy; Botanique, NeltOOS, Delisle , Coquebert; Zoologie, Geoifroy-Saint-Hilaire, Savigny , Redouté ; Antiquités , Bourlier , Ripault ; Architecture . Norry, Balzac, Protain, Hyacinthe père; Dessin, Dutcrtre, Rigo , Dcnon, Joly ; Ponts et chaussées, Lepère aîné, Dodard, Faye, Martin, Duval, Gratien pere, Saint-Genis, Lancret, Fèvre, Devilliers, Jollois, Girard, Favier, Thévenot, Chabrol, Rappenau, Arnollet; Géographie, Jacotin , Lafeuillade. Greslie, Bertre,
IL ‘ 13

290 HISTOIRE il798.]
Lesœcr, Bourgeois, Leduc, Boucher, Pottier, Du- I lieu, Faurie, Lé vécue, Chaumont, Laroche, Jomard, Gorabœul ; Sculpture , Gastex ; Gravure , Fouquel ; Littérature^ Parseval-Grandmaison, Lerouge; l/u-sique : Villotteau, Rigel. Quatre élèves de l'école polytechnique : Viard , Aribert, Caristie, Duchamerois. Six interprètes : Venture, Magallon , Imbert, Raige, Belletéte, Laporte. Trois imprimeurs, Marcel, Puntis et G alianci.
Je n’ai voulu passer sous silence aucun de ces noms, bien assuré que les descendants de tous ces hommes de mérite en tireront la plus belle illustration de leur famille , et qu’ils me sauront gré de les avoir soustraits h l’oubli dans lequel les autres historiens les ont laissés.
On emmenait en outre une compagnie d’aréosta-tiers, chargée du service de deux ballons ; une bibliothèque complète ; des cabinets de physique, de chimie ; une grande quantité d’instruments de mathématiques, et plusieurs centaines d’ouvriers de toutes professions.
Le 6 mai, Bonaparte quitta Paris ; le 9, il était à Toulon, où, par sa proclamation pleine de l'énergie qui l’animait, il électrisait les soldats.
« Officiers et soldats , leur disait-il, il y a deux
« ans que je vins vous commander. A cette épo- « « que, vous étiez dans la rivière de Gênes et dans « la plus grande pénurie, manquant de tout, ayant « sacrifié jusqu’à vos montres pour votre subsistance | « réciproque. Je vous promis de faire cesser vos mi-
« sères, de vous conduire en Italie ; là, tout vous fut « accordé. Ne vous ai-je pas tenu parole? [Un en « général s’élève : oui, oui. ) Eh bien ! apprenez que « vous n’avez pas encore assez fait pour la patrie. et a qu*elle n’a pas encore assez fait pour vous.

1798.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 291
« Je vais vous conduire dans un pays où, par vos « exploits futurs, vous surpasserez ceux qui étonnent « aujourd’hui vos admirateurs, et vous rendrez à la « patrie des services qu’elle a droit d’attendre d’une « année d’invincibles.
« Je promets à chaque soldat qu’au retour de celte « expédition il aura de quoi acheter six arpents de « terre..... Habituez-vous aux manœuvres, devenez « l’effroi de nos ennemis de terre et de mer ; imitez « en cela les soldats romains, qui surent à la fois « battre Carthage en plaine et les Carthaginois sur « les flots. *
Dix jours furent consacrés à terminer les préparatifs de l’expédition , et, le 19 mai, la Hotte mil à la voile; au dernier moment, lorsque les troupes étaient encore sur le rivage, Bonaparte leur adressa ces mots :
« Vous êtes une des ailes de l’armée d’Angleterre : « vous avez fait la guerre de montagne, de plaine, de « siège; il vous reste à faire la guerre maritime. »
Un vent favorable conduisit la flotte à la hauteur du cap Corse; elle longea le détroit de Bonifacio, où elle alla louvoyer afin d’attendre le convoi d’Ajaccio, qui vint l’y rejoindre. Elle côtoya la Sardaigne pour attendre e convoi de Civita-Vecchia, s’approcha de Maz-zara, ville de Sicile, reconnut l’île de Pantelaria, et enfin elle entra dans le canal de Malte, le 10 juin, sans avoir vu une voile anglaise et sans imaginer oii Nelson pouvait être avec ses vaisseaux.
Malte est à deux cent soixante lieues de Toulon ; c'est un rocher de cinq lieues de longueur, sur deux à trois de large. Ses fortifications la rendent formidable. Bien défendue, elle triompherait des efforts de tout l’univers. Les petites îles de Gozzo, de Comino, de
292 HISTOIRE [1798.]
| . Gominetto, sont tout auprès. On a prétendu que Malte I
était File fabuleuse de Calypso. Elle fut tour à tour soumise à Cartilage, à Rome, aux Sarrasins, aux Normands de Sicile. L’empereur Charles-Quint, en 1539, la donna à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui venait de perdre File de Rhodes. Cet ordre religieux et militaire fut connu sous le nom de Malte, où le grand -maître régnait. La religion, c’est-à-dire Foi dre, gouvernait despotiquement cent mille habitants dispersés dans les quatre îles, et dont trente mille habitaient le chef-lieu.
Don Hompesch, Allemand de naissance, était grand-maître de Malte ; homme sans caractère et sans courage moral, il augmenta la honteuse liste des souverains de cette époque qui ne surent pas combattre en tombant, afin d’illustrer du moins une chute dont l’indigne lâcheté les a flétris sans retour.
Bonaparte avait fait débarquer de l’artillerie pour canonner les forts de Lavalelte. Les chevaliers répondirent an feu des Français, et voulurent tenter une sortie; mais un grand nombre furent pris, et quelques-uns d’eux , qui étaient Français, refusèrent de se battre contre leurs compatriotes.
Le désordre régnait dans l’intérieur de la place ; les habitants voulaient qu’en capitulât. Le grand-maître , qui était un homme sans énergie, et qui ne pensait qu’à son seul intérêt, se décida à se rendre.
Le traité fut bientôt conclu. La souveraineté de Malte, et des îles qui en dépendaient, fut abandonnée à la France. La France promit son intervention, au congrès de Rastadt, pour faire obtenir au grand-maître une principauté équivalente à celle qu’il perdait. A défaut, elle lui assurait une ¡ ension annuelle de trois

cent mille francs, et lui donnait six cent mille francs
»' comptant. en indemnité de son mobilier.
11 était accordé à chaque chevalier de. la langue française sept cents francs de pension, qui s’élevait à mille francs pour les sexagénaires.
Quant aux autres chevaliers, la France promettait également son intervention pour leur faire accorder la jouissance des biens que l’ordre possédait dans leurs pays respectifs.
En examinant ces formidables fortifications, Caifa- -relli-Dufalga dit à Bonaparte : Nous .sommes bien heureux qu’il y ait eu quelqu'un dans la place peur nous en ouvrir les portes.
Le 13 juin. Bonaparte entra dans Malte; il logea chez le marquis Parśi, noble maltais; il dédaigna d’aller voir Ilompesch ; il eut raison : qu’aurait-il pu dire à cet infâme ? Les commandeurs Dolomieu et Bosredon de Rauligeat. qui avaient si fort poussé le grand-maître à une pareille lâcheté, eurent tout l’odieux de cette affaire.
Un gouvernement provisoire fut établi : on mit à la tête le traître Bosredon ; Régnault de Saint-Jean- d’ An- . gély fut le commissaire du Gouvernement, le général Vaubois eut le commandement militaire.
Bonaparte, croyant avoir acquis à la France une position inexpugnable, se remit en mer le 19 juin, sans rencontrer encore les Anglais, qui. à leur tour, le cherchaient où il n’était pas. Le 1er juillet, la flotte française toucha la côte égyptienne. Le 2, les troupes débarquées occupaient Alexandrie et bivouaquaient aux ent irons des aiguilles de Cléopâtre et de la colonne de Pompée. Le gouverneur de cette ville, Seid-Mo-hamed - Koraïm, comptait parmi les descendants de
i

Í!M
-
HISTOIRE

Mahomet; homme simple, doux, sans génie, sans courage, il devait à sa nullité la confiance des beys, et, en cette circonstance, n’ayant pas su combattre, il céda lâchement.
L’Égypte, après la conquête des Sarrasins, était devenue province turque; puis elle tomba sous le joug réel des Mamelucks, bien qu’en apparence le sultan en fût le chef suprême. Ces Mamelucks étaient des Circassiens, des MingréHens, des Géorgiens, etc., enlevés jeunes à leur famille, à leur culte, à leur patrie. Amenés en Égypte presque dès leur enfance, ils servaient d’abord comme es laves,et leur avilissement n’avait pas de bornes. Mais, en avançant en âge, ces êtres, que leur beauté prostituait, devenaient eux-mêmes membres de la milice des Mamelucks, et d’as-servis ils passaient au rang des despotes.
Le grand-seigneur n’exerçait qu’une autorité de forme sur l’Égypte. Reçu avec respect et humble soumission , le pacha qu’il envoyait passait la durée de son gouvernement dans une prison brillante, le château du Caire ; on lui concédait le droit de se rendre odieux aux fellahs (le peuple), en ajoutant aux impôts dont les Mamelucks les surchargeaient, mais on lui interdisait tout acte d’autorité directe.
Par le fait, c’était donc moins contre le sultan que contre les usurpateurs de ses droits que les Français allaient combattre. Ceux-là obéissaient dans ce moment à Ibrahim-Bey et à Mourad-Bey, deux chefs reconnus et appuyés par celte milice turbulente et capricieuse. Le premier, vieux, rempli de finesse et d’astuce, de sagacité et d’intelligence, négociait beaucoup et se battait peu. Sa sagesse le rendait cher aux Arabes, aux Mamelucks, ajix fellahs; il possédait par sa pru
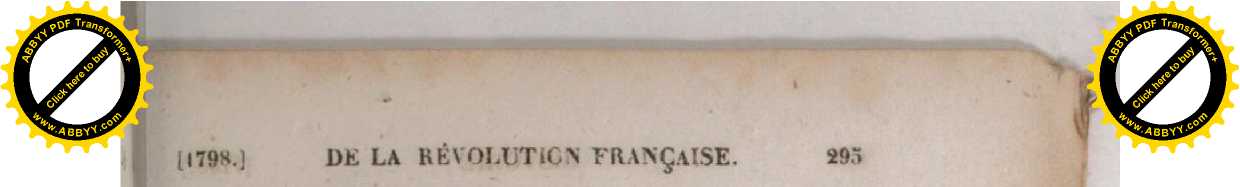
dence, sa mesure, sa réserve, un crédit énorme. Il ; voulait gouverner à la manière d’Ulysse.
Mourad-Bey, au contraire, ressemblait beaucoup à l’Achille grec : fier, impétueux, téméraire, brave, toujours le premier à charger l’ennemi, et le dernier à remettre le sabre dans le fourreau, il charmait les Ma-melucks par scs qualités brillantes, que du reste il ternissait par sa cruauté féroce, son ingratitude et sa duplicité. Sa mauvaise foi était insigne ; un traité accepté par lui couvrait une trahison prochaine; en négociant il était aussi redoutable que sur le champ de bataille.
Bonaparte, vainqueur dès son débarquement, passe la revue de l’année, en forme trois divisions et en donne le commandement aux généraux Bon, Kléber et Menou; il marche par le désert et par Demenhour vers Le Caire (ou Kaire), ayant à lutter contre une chaleur dévorante, l’aridité du sol et le manque d’eau. Arrivée à Demenhour le 8 juillet, l’armée y séjourne le 9, et le 10 elle se remet en marche. A la vue du Nil, q ne l’on rejoint enfin à Rhamanié, les soldats se croient à la fin de leurs travaux; ils courent s’y rafraîchir.... Le tambour roule, ils reprennent les armes; trois cents Mamelucks viennent les reconnaître, on les balaie avec quelques coups de canon. Un autre combat, une autre victoire, attendent nos braves à Chabreist. Ici quatre mille cavaliers musulmans sont rangés en bataille, ils ont juré de vaincre ou de périr, ils seront battus. Un feu terrible et bien nourri les accueille, jette le désordre dans leurs rangs; on ne les suit pas dans leurs évolutions rapides, on se forme en bataillon carré pour les recevoir; cette manœuvre leur est inconnue , ils n’en comprennent la force que par son terrible résultat Ceux que la mousqueterie épargne

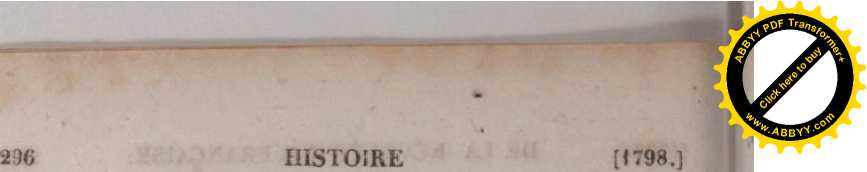
tombent percés de ces baïonnettes contie lesquelles ils se précipitent, entraînés qu’ils sont par leur furie et par l’élan de leurs rapides coursiers. Chabreistest pris, íes ennemis fuient vers Le Caire.
Cependant Mourad-Bey, à la tête de six mille Ma-meluckset des milices égyptiennes, au nombre de plus de vingt mille, se targue d’arrêter enfin notre heureux conquérant; il le rejettera dans la mer qui l’a apporté sur la plage de l'Égypte. Cinq ou six mille janissaires, spahis de la garde du pacha, renforcent celte armée, dont le camp est à la gauche du Nil et adossé au village d’Embabéh. On le fortifie , on attend le signal ; la bataille aura pour témoin Ibrahiin-Bey, le collègue de Mourad en pouvoir, et non son égal en bravoure. Il était resté sur la rive droite du fleuve, prêt à fuir si le succès ne répondait pas à son attente. Le 21 juillet, les Français qui s’avancent aperçoivent à la fois les minarets du Caire, les sommités des pyramides et les Mamelucks resplendissants d’or, de velours et de fer. Nos guerriers sont remplis d’admiration à la vue de ce spectacle imposant ; tous s’arrêtent par un mouvement spontané, et font éclater leur joie et leur enthousiasme. Bonaparte saisit cet instant, il parcourt au galop toute la ligne, et s’écrie :
Soldats! songez que du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent !
L’armée, impatiente de se signaler en face de ces plus anciens monuments de la civilisation, ne tarde pas à se ranger en ordre de bataille. Le générai en chef va donner le signal, il est prévenu par Mourad, et à la voix de celui-ci les Mamelucks menacent notre centre. Avec une impétuosité terrible, ils attaquent chacune des divisions de nos formidables carrés, que rien n’é-

1’ iï! .'1
■’i
[1798.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
297

branle et d’où part un feu roulant et continuel, qui les arrête dans leur course; là sont Desaix et Reynier, là on soutient le choc sans être entamé, et la charge impétueuse des enfants de Mahomet reste impuissante ; nul sur ce point ne la recommencera, car tous ou presque tous ont péri. Junot se signale par des traits de courage qui viennent ajouter encore à la réputation brillante qu’Il s’étaii laite en Italie.
Les divisions Bon et Menou , soutenues par celle de Kléber, alors malade, et commandée provisoirement par le vaillant Dugua, s’avancent lentement vers Emba-béh, dont elles s’emparent, à la suite d’un assaut opiniâtre, où quinze cents Mamelucks préfèrent la mort à la honte de se réndre. Ils périssent tous par le fer des Français, ou senoyent dans le Nil, qu’ils cherchent à passer à la nage; de tous les côtés l’affaire eut des résultats pareils. Les ennemis en pleine déroute, quarante pièces de canon, quatre cents chameaux et bagages, une immense quantité de vivres, des dépouilles aussi riches que nombreuses, furent les trophées de cette journée célèbre.
Une victoire aussi magnifique (l’épithète lui convient parfaitement) fut due à la tactique européenne. Des colonnes carrées que l’on ne pouvait entamer, forteresses vivantes quoique inertes eu apparence, devenaient des forces terribles dans leur savante inaction; l’impétuosité aveugle et téméraire de la cavalerie musulmane ne parvint jamais à rompre cet ordre de bataille; elle trouva toujours la défaite et la mort chaque fois qu’elle osa le tenter. Les Mamelucks. lassés, découragés, finirent par se disperser; Ibrihim gagna le désert de Suez. Mourad-Bey s’enfonça dans la Haute-Égypte. espérant, qu’on ne la loi disputerait pas.
13.

2$R
Histoire
(1798.]

Après avoir passé le Nil, les Français, parvenus à Gizéh, rencontrèrent la députation du Caire, composée de tout ce que cette ville renfermait de personnages éminents; ils venaient se mettre à la discrétion du vainqueur, selon la coutume de ces peuples barbares. Le général en chef leur ayant répondu que l’usage des Français était de respecter les vaincus, il leur fallut du temps pour concevoir cette maxime simple autant que belle, et surtout pour croire à sa persévérante exécution. La populace du Caire avait pillé les maisons des Mamelucks pendant leur absence : elle allait se porter à d’autres excès; mais les Français arrivèrent, et le bon ordre fut rétabli.
La reddition du Caire assura aux Français la possession de tout le pays. Le brave général Dupuy, de Toulouse, fut nommé gouverneur de la ville. Le pacha, malgré les prévenances de Bonaparte, ne voulut pas traiter avec lui, ni lui prêter le crédit de son acquiescement à la conquête. Se regardant non point comme allié, mais comme vaincu, il se hâta de partir, et l’Égypte sut que le sultan n’approuvait pas cette expédition ; ce fut un mauvais présage pour l’avenir.
Le premier soin du vainqueur se tourna vers l’administration; selon sa constante et habile coutume, il établit une municipalité et un conseil supérieur et général , que l’on nomma Divan, en conformité de l’usage du pays. On réprima les désordres, la maraude, le pillage; on veilla à ce que la police se fît avec exactitude et sévérité. Ceci étonna les naturels, qui croyaient n’avoir échangé un esclavage pesant que contre un autre plus lourd encore.
Ce fut vers cette époque que Bonaparte écrivit à

[1798 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

son ami Ozun une lettre inconnue à tous les historiens du grand homme; en voici la teneur :,
« Je n’ai pas perdu mon temps depuis notre sépara-« tion ; j’ai conquis Malte Vimprenable, j'ai traversé en « vainqueur Alexandrie et le désert, les pyramides « ont revu le drapeau français, Le Caire est à moi. la « puissance des Mamelucks est détruite, je n’ai pu « encore faire que cela..... Les voyageurs nous ont « trompés, la belle Égypte est un désert horrible où « l’on rencontre parfois des oasis (1) ; la terre est du « sable, et le ciel est de bronze ; les habitants, appelés « fellahs, sont au-dessous de la brute; la misère ne « peut se concevoir, on manque de tout...... Les sa-« vants y trouveront des sujets de recherche, d’étude « et de dispute.
« Je veille à ce qu’on n’écrase pas l’Égypte, je dote « Le Caire des établissements d’Europe : il y aura un « Institut, une salle de spectacle, une académie, des « administrations régulières, une comptabilité qui ne « sera pas oppressive; chaque province aura un divan « qui ressortira de celui de la capitale; les cadis cou-« doueront à exercer la justice, et je parviendrai à « rappeler aux Copines qu’ils étaient autrefois lesna-« turéis du pays. On s’amuse sans doute davantage à « Paris.....à Paris où l’on ne voudra voir que le grand « désastre qui vient de couper mes communications « avec la Franco. La perte de la bataille navale d’Abou-« kir est un malheur irréparable, la moitié de mon « plan en est détruite.....Mon cœur saigne d’une perte
1 i On appelle oasis , eu Égypte, des terrains fertiles perdus au milieu de sables; la plus célèbre était celle où s’élevait le temple de Jupiter Ammoo. L. L. L.
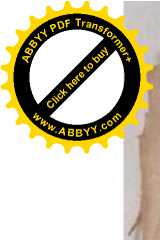
500
HISTOIRE
U
a
G
«
G a
aussi énorme. Brueix a payé de sa vie la faute qu’il avait commise, et il nous fait pleurer sa mort avec des larmes de sang; l’armée a été sur le point de tomber dans un découragement qui aurait renversé mes espérances; je vais lâcher de la distraire par des victoires. »
Ces victoires, qui en effet dédommagent les Français
[1798.]

à qui rien ne coûte pour les obtenir, il fallait aller les chercher soit dans la Syrie, soit vers la Haute-Égypte. Ibrahim-Bey, après la bataille des Pyramides, prit avec lui la moitié des débris de l’armée des Mame-lucks et se retira, à travers le pelta, vers l’isthme de Suez : quant à Mourad-Bey, il s’en était allé au delà de Thèbes, contre le Sennaar; il fallait donc poursuivre séparément les deux chefs. Ibrahim était en quelque sorte le chef civil de l'Égypte, et, moins guerrier que son collègue, il avait pourtant plus d’influence. Bonaparte se chargea du soin de marcher contre ce boy, qu’il voulait suivre en Arabie. Ceci rentrait peut-être dans son plan de conquérir l’Asie.
Après quatre jours de marche bien pénible, l’avant-garde fi ançaise atteignit Ibrahim à Salchiéh ; son arrière-garde était trois fois plus forte que notre corps avancé ; mais Bonaparte était là de sa personne. Le choc fut court; lesManaelucks,mis en pleine déroute, se dispersèrent dans le désert, un grand nombre se rendirent prisonniers ; Ibrahim s’échappa avec ses femmes, son trésor, ses principaux officiers.
Ce fut à cette époque qu’eut lieu la bataille d’Aboukir, livrée le Ie* août par Nelson, vice-amiral de la flotte anglaise, à Brueix, qui commandait la nôtre. Bonaparte, aussitôt après le débarquement, pressa, pria, ordonna à Brueix de s’éloigner. Ce marin opi
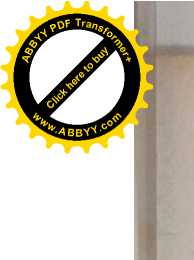
11798.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
50 í
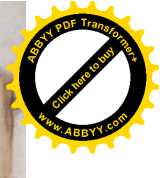
niâtre, ou se trompant dans ses calculs, se refusa toujours , sous divers prétextes spécieux, à une obéissance qui aurait épargné de grands désastres. La France saigne encore de la plaie qui fut le résultat de son obstination.
Une manœuvre savante de Nelson décida la victoire; il fit passer avec autant de témérité que de bonheur une division de sa flotte entre la nôtre et la plage, coupa ainsi la ligne française, et tout fut perdu, fors l’honneur. -
Brueix montait l'Orient, magnifique vaisseau; se voyant cerné, il se bat avec le courage du désespoir; blessé grièvement, il commande encore; on le prie de se retirer, il répond: Un amiral doit mourir sur son banc de quart. A peine a-t-il (ht ces mots, qu’un boulet le frappe et le coupe en deux; le feu prend au navire et le consume. Le. brave capitaine Casablanca , fidèle à l’honneur et au devoir, reste héroïquement au milieu des flammes; son fils, âgé de dix ans, refuse de quitter son père; il le serre dans scs bras, et tous deux attendent la mort, que l’explosion de l’Orient leur apporte.
L’escadre française, sans chef, ne recevait plus d'ordres de personne; nos vaisseaux, entourés d’ennemis, subirent noblement leur mauvaise fortune; l'Heureux se fit sauter; le capitaine du Timo/éon brûla son vaisseau et sauva l’équipage; l’héroïque Stanley, sur l'Jrtémise, se défendit jusqu’à la dernière extrémité : alors il y mil le feu et conduisit son monde à terre; mais la flamme ne faisant point de progrès, il retourna à rdrtémise, renouvela la mèche, et ne repartit que certain de ne laisser aux Anglais que des débris ardents. Le Timoleon fit comme lui; le capitaine
Thénard , commandant C Aquilon, mourut les armes à la main. •
< Le combat, dit Salgues, durait depuis trente-six heures, et le Tonnant continuait seul à soutenir cette lutte terrible et désespérée ; Dupetit-Thouars, homme d’une famille illustre, l’un des plus braves officiers de la marine, commandait ce vaisseau. Voyant tout perdu, il cherche une mort glorieuse ; écrasé par le feu de l’ennemi. lui et ses soldats ne cessent de crier : livent (es Français! vive la république! Un boulet coupe les deux cuisses au héros; il se fait mettre dans un tonneau rempli de son , et continue de régler la manœuvre; un autre boulet lui enlève un bras, alors il s’écrie : Equipage du Tonnant, ne vous rendez pas, et il expire ; fidèles à ses ordres, les Intrépides marins se montrent dignes de leur capitaine. Les vaisseaux anglais , épouvantés de leur résistance héroïque, n’osent s’approcher du navire qui les tient en échec pendant tout le reste de la nuit. Enfin le nombre et la mauvaise fortune triomphent de leurs efforts sublimes; les mâts sont brisés, la mort promène de tous côtés sa faux meurtrière . les batteries cesseut d’être servies; le bâtiment, sans officiers, sans pilotes, sans soldats ni matelots, est jeté sur la côte et devient la proie des vainqueurs.....iis n’y trouvent que des cadavres ! »
Le désastre d’Aboukir eut des suites immenses; le grand-seigneur n’avait pas encore déclaré la guerre à la France ; il se flattait que nous lui conserverions l’Égypte, et il patientait : mais, harcelé par les Anglais, à qui le Divan et le sérail étaient vendus, instruit des conséquences de la funeste journée d'Aboukir, il crut l’armée française perdue, la république sans ressource , et il entra dans la coalition européenne.

[1798.] DF. LA REVOLT TION FRANÇAISE. 503
Le sultan Sélim III, en signe de rupture avec la France, fait arrêter et conduire aux Sept-Tours, sui-11 vaut le vieil usage turc, notre chargé d’affaires à Constantinople. On arrête également nos consuls dans les diverses échelles du Levant, et on confisque les propriétés des négociants de notre nation : un nouveau grand-visii est nommé, c’est Jussuf-pacha, l’ami des Anglais; le mufty, soupçonné de s’intéresser à notre nation, est déposé, et la flotte russe, invitée à se joindre à celle de la sublime Porte, vient mouiller dans le port de Constantinople.
Bonaparte avait fait pourtant tout ce qui lui avait été possible pour convaincre le sultan du vif désir du Directoire de conserver son amitié, et de maintenir la bonne harmonie entre le drapeau turc et le drapeau tricolore. Les envoyés du grand-seigneur étaient comblés d’honneurs et de présents; on lui députait un Français ( Beauchamp ), pour lui faire connaître les sujets de mécontentement que le pacha de Saint-Jean-d’Acre ( Ahmed ) avait donnés au général en chef, et pour lui déclarer que le châtiment qu’on réservait à ce gouverneur, s’il persistait dans sa conduite hostile, ne devait en aucune manière donner de l’ombrage à l’empereur othonun. C'était ce même pacha que ses cruautés avaient fait surnommer Djezzar ( le boucher), 11 avait accueilli Ibrahim et les Mamelucks, il menaçait en outre les frontières de l’Égypte; Bonaparte le fit prier de se mieux conduire : il répondit avec arrogance , et fit emprisonner les Français qui résidaient à Saint-Jean-d Acre. Bonaparte se mit en mesure d’aller le punir. .
11 fallait auparavant consolider notre conquête; déjà se manifestaient des ferments de révolte. Les habitants
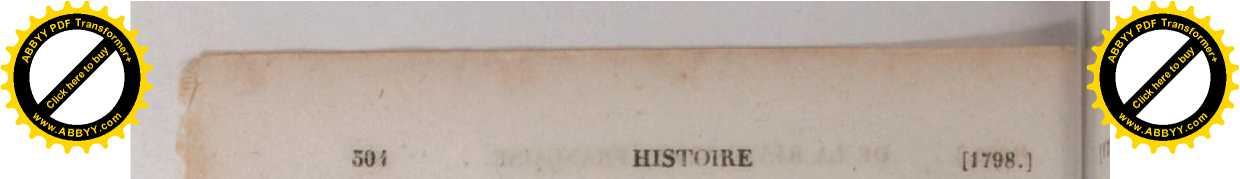
du Caire, revenus de leur premier effroi, comptaient notre petit nombre et l'immensité du leur, le fanatisme échauffait encore leurs mauvaises dispositions ; une partie des imans et des ulémas les poussaient secrètement à courir sus aux infidèles. Le 21 octobre , le peuple se soulève dans tous les quartiers, et particulièrement à la mosquée de Jemil-Azar; le général upuy, n’écoutant que son courage, se présente presque seul aux rebelles, il est assassiné. Les Arabes se montrent aux portes de la ville, où l’insurrection devient générale. Alors tous les Français courent aux armes, l’armée se forme en colonnes serrées ; elle poursuit, elle renverse, elle foudroie les Égyptiens, dont elle fait un massacre horrible. La grande mosquée, où ils se défendent encore, s’écroule sous le canon de la citadelle , qui ne cesse de tonner. L’incendie la consume et dévore en même temps plusieurs autres quartiers. La mort du brave Dupuy est vengée; le peuple révolté se trouve réduit à demander grâce au vainqueur.
Cet événement ne ralentit pas d’un instant l’activité de Bonaparte; il laisse les Anglais bombarder sans fruit les ruines d’Alexandrie; il visite à Suez le reste du canal qui joignit autrefois les deux mers, et de là court chasser Djezzar du fort d’El-Arrich, situé à dix lieues dans le désert. Cette forteresse était la clef de l’Égypte; le pacha s’en était emparé depuis notre débarquement L’armée marche sur la Syrie, que soixante lieues de désert séparent de l’Égypte. Les Français. avec des peines sans nombre, traversent cette vaste mer de sable; ils débouchent dans la plaine de Gazah, dont leur approche a fait fuir l’ennemi ; cette ville ouvre ses portes; de là on tourne vers Jaffa, qu’un espace

immense de pays aride et coupé de rochers nus isole de toute civilisation. Jaffa est emportée d’assaut; dix-sept cents Turcs ou Maugrabins qui se défendent sont passés au fil de l’épée. Les Égyptiens, ceux d’A-lep et de Damas, qui ne servaient qui par force, implorent la pitié de Bonaparte ; il la leur accorde et les renvoie libres et possesseurs de leurs biens.
L’expédition continue sa marche : Zète est soumis , aussi bien que Caïffa; on arrive enfin devant Saint-Jean-d’Acre, l’ancienne Ptolémaïs: cette place devait être le terme que Dieu avait marqué aux conquêtes de Bonaparte. Le Ciel ne veut pas que celui dont la politique par trop humaine a reconnu au Caire la divinité de la mission du fourbe Mahomet règne sur les contrées où son fils, cet autre lui-même, a pris naissance et a souffert la mort.
Le 9 avril 1799, la tranchée est ouverte devant Saint-Jean-d’Acre. On croyait cette place mal fortifiée, on était dans l’erreur ; un Français émigré ( de Phélip-peaux), officier d’artillerie dans l’ancien régiment de Bonaparte, s’était naguère sauvé de Paris, où il était prisonnier au Temple avec le commodore sir Sidney Smith. Tous deux ont volé à la défense du boulevard de la Syrie. L’Anglais est sur la flotte, le Français dirige l.i résistance de la ville; il force d’en venir à un siège régulier, lorsqu’on se flattait de n’avoir à forcer qu’une vieille muraille.
Pendant ce temps, une armée turque a passé le Jourdain ; Kléber et Murat vont à sa rencontre, Bonaparte les suit. Kléber, avec deux mille hommes, soutient le choc de vingt-cinq mille cavaliers, et réalise les prodiges de l’antique chevalerie. L’action eut lieu au pied du mont Thabor, dont cette brillante
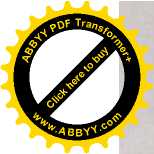
506
HISTOIRE
bataille prit le nom. Juuots’y signala par des prodiges de valeur incroyables : avec trois cents fantassins, il chargea trois mille hommes à cheval; c’était le délire du courage. Le camp des Mamelucks nui Ae combattent pas encore est à Naplous, près de deux lieues en arrière de l’emplacement du dernier champ de bataille. Bonaparte fait ses dispositions. Un coup de canon donne le signal de l’attaque : les diverses colonnes françaises s’ébranlent; Kléber prend l’offensive et culbute tout devant lui. Il enlève le village de Fouli, passe au fil de l’épée des escadrons-entiers, que les généraux Vial et Rampon avaient mis en déroute sur un autre point, tandis que la cavalerie française, guidée par le général Leturq, surprend et pille le camp des Mamelucks. La victoire est complète ; Bonaparte se flatte que la prise de Saint-Jean-d’Acre en sera le résultat.
[1793.]
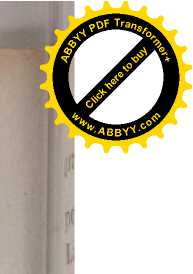
Mais une force supérieure lui est opposée : la main de celui qui crée et soutient les mondes se déclare le défenseur de la ville assiégée; Bonaparte ne la prendra pas. Les tranchées ne produisent aucun résultat, les attaques les plus vives sont impuissantes, la grosse artillerie manque, et les pièces de campagne ne font que de faibles trouées dans ces murailles formidables. Cependant le temps s’écoule, l’Égypte est agitée de nouveau par le fanatisme : un imposteur qu’on appelait l’ange El-Modhy, qui prétendait être envoyé par Mahomet pour chasser les Français, mais qui n’était en réalité qu’un agent débarqué par les Anglais à Dcméh, avait réuni plusieurs milliers d’insurgés ; ses proclamations ranimaient les fellahs, excitaient les Arabes. Il entre à Démenhour, où il égorge deux cents de nos soldats de la légion nautique. On lui croit dès lors un
[1799.] DE LA REVOI LTIGN FRANÇAISE. 507
pouvoir divin; des provinces entières s’insurgent; Lannes et La misse tentent d’arrêter ce mouvement; ils y parviennent en partie. El-Modhy, battu, perd son crédit ; abandonné du Ciel, il n’est plus qu’un homme. Il se sauve, disparaît, et la mission divine s’en va en fumée. Toutefois, la présence de Bonaparte est indispensable en Égypte ; il faut abandonner le siège de Saint-Jean-d’ Acre qui lutte encore. Cette détermination fait perdre à Bonaparte l’espoir de conquérir l’Asie ; il devra se contenter de la terre des Ptolémées. C’est un revers pénible , humiliant; la force d’âme de Bonaparte l’aide à le supporter : si l'Orient lui échappe, il l’échangera contre l’Europe, et son génie est consolé. Il prépare les soldats à cette retraite par une de ces proclamations, chefs-d’œuvre d’éloquence militaire , qui assureront toujours à celui qui les composa un rang distingué parmi les orateurs.
17 mai 1799.
« Soldats ! vous avez traversé l’Afrique et le désert « avec plus de rapidité qu’une armée d’Arabes.
« L’armée, naguère en marche pour envahir l’É-« gypte, est détruite; vous avez pris son général, ses « équipages de campagne, ses bagages, ses outres, « ses chameaux.
« Vous vous êtes emparés de toutes les places fortes « qui défendent les puits du désert.
< Vous avez dispersé aux champs du mont Thabor « cette nuée d’hommes venus de toutes les parties de « l’Asie pour piller l’Égypte.
« Les trente vaisseaux que vous avez vus arriver dans « Acre, il y a douze jours, portaient l’armée qui devait

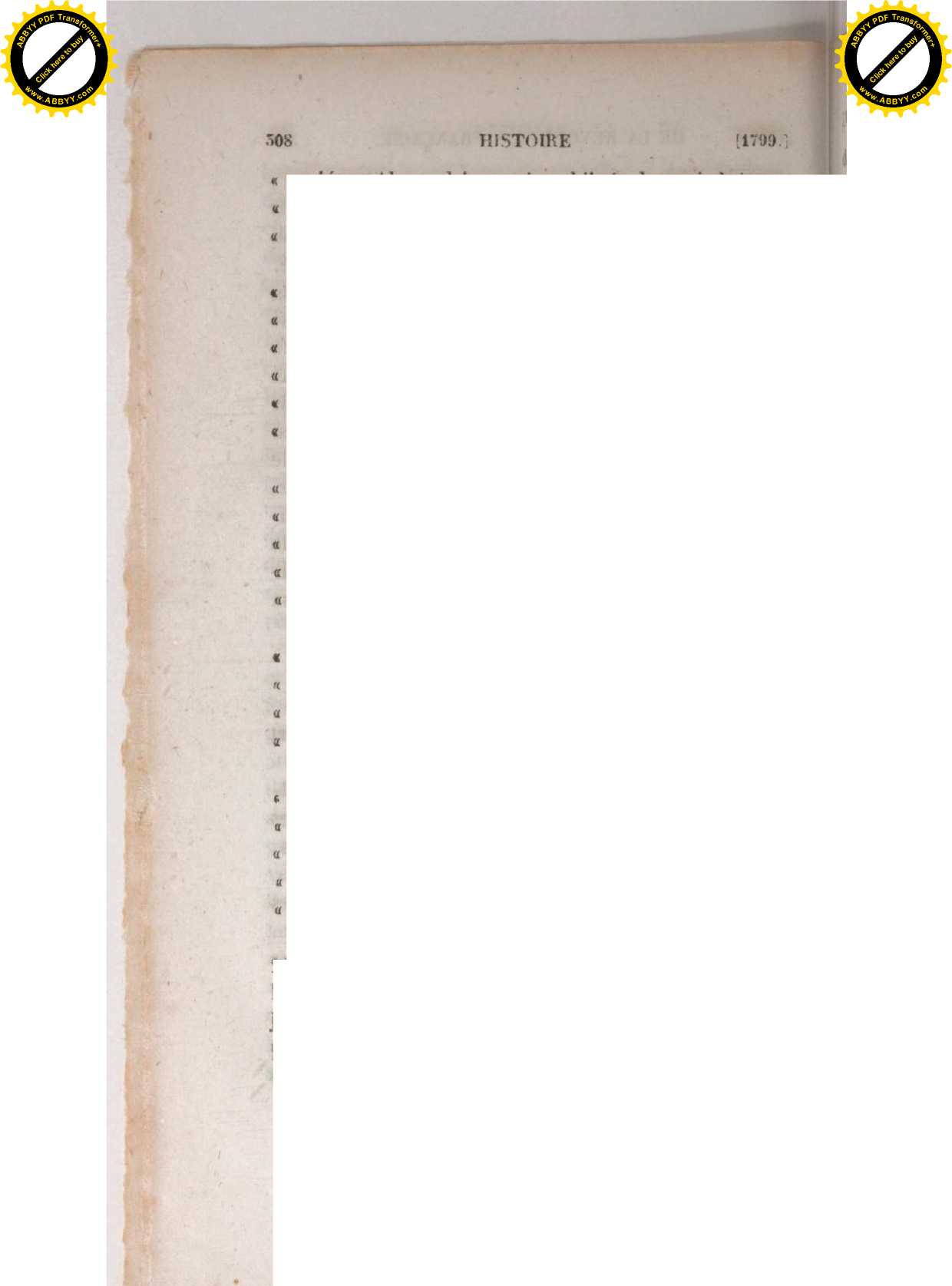
20 mai, à neuf heures du soir, on bat la générale, et le siège de Saint-Jean-d’Acre est levé, après soixante jours de tranchée ouverte. L’armée s’éloigne et reprend le chemin de l’Égypte. Ainsi sont renversées toutes les espérances d’un nouvel empire à élever
assiéger Alexandrie; mais, obligée de venir à Acre, elle a fini ses destins : une partie de ses drapeaux ornera votre rentrée en Égypte.
« Enfin, avec une poignée d’hommes, après avoir pendant trois mois nourri la guerre en Syrie, pris quarante pièces de campagne, cinquante drapeaux, fait six mille prisonniers, rasé les fortifications de Gazah, Jaffa, Caïffa, changé la ville d’Acre en un monceau de ruines, nous allons rentrer en Égypte ; la saison des débarquements m’y rappelle.
« Encore quelques jours, et vous aviez l’espoir de prendre le pacha même au milieu de son palais ; mais dans cette saison la chute du château d’Acre ne vaut pas la perte de quelques jours; les braves que cela nous eût coûtés sont aujourd’hui nécessaires pour des opérations plus essentielles.
« Soldats! nous avons une carrière de fatigues et de dangers à courir; après avoir mis l’Orient hors d’état de rien faire contre nous de cette campagne, il nous faudra peut-être repousser les efforts d’une partie de l’Occident.
« Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire; et si, au milieu de tant de combats, chaque jour est marqué par la mort d’un brave, il faut que de nouveaux braves se forment et prennent leur rang parmi ce petit nombre qui donne l’élan dans les dangers et maîtrise la victoire. »
Cette proclamation est le signal de la retraite. Le

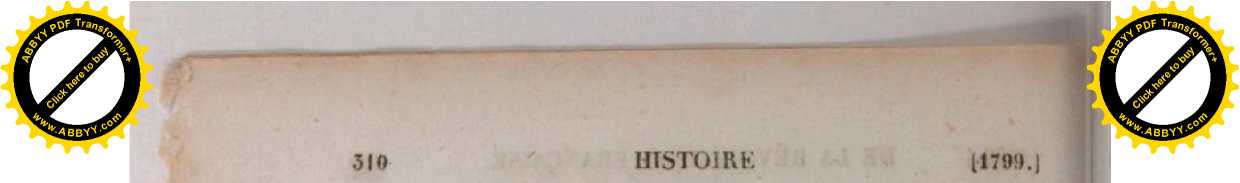
se livre a ¿es recherches utiles, à des travaux intéressants; enfin, sur tous les points, la main agissante, l’esprit de Bonaparte, dominent et montrent l’étendue de sa capacité.
A son retour en Égypte, il a fondé le port de Kénéh aux portes du désert. Il laisse des troupes à Sala-hiéh. Enfin, après une absence de quatre mois, Bonaparte rentre au Caire, n’ayant à regretter, après une aussi grande expédition, que dix-huit cents soldats, dont douze cents morts au champ d’honneur et six cents enlevés par la pesie.
Les délices du Caire firent oublier à l’armée les désastres et les fatigues du désert. A peine Bonaparte jouissait-il de quelque repos, qu’un ennemi, infatigable aux combats, aux marches, aux défaites, Mourad-Bey, qu’on croyait errant vers le Darfour et le Sen-naar, descend , suivi de forces considérables, vers la Basse-Égypte : en évitant la poursuite des généraux Desaix, Belliard, Davoust et Donzelot, il manœuvre à l’entour de la grande pyramide, qui avait été témoin de sa première défaite. Bonaparte s’élance vers lui, et comme il va l’atteindre, il apprend qu’une armée turque, portée par cent vaisseaux de haut-bord . se montre sur la plage fatale d’Aboukir et menace Alexandrie; les Anglais protègent cette descente, dont ils sont l’Ame : ils fournissent tout l’attirail nécessaire, les munitions de guerre, les instructions. Cette armée est sous le commandement de Seidman - Mustapha, pacha de Homélie, appuyé, d’un côté, parla troupe de Mourad-Bey et, de l’autre, par celle d’Ibrahim. Repoussé devant Alexandrie, il fut plus heureux vers Aboukir, oü Marmont, avec douze cents hommes contre quarante mille, ne put l’empêcher de débarquer.
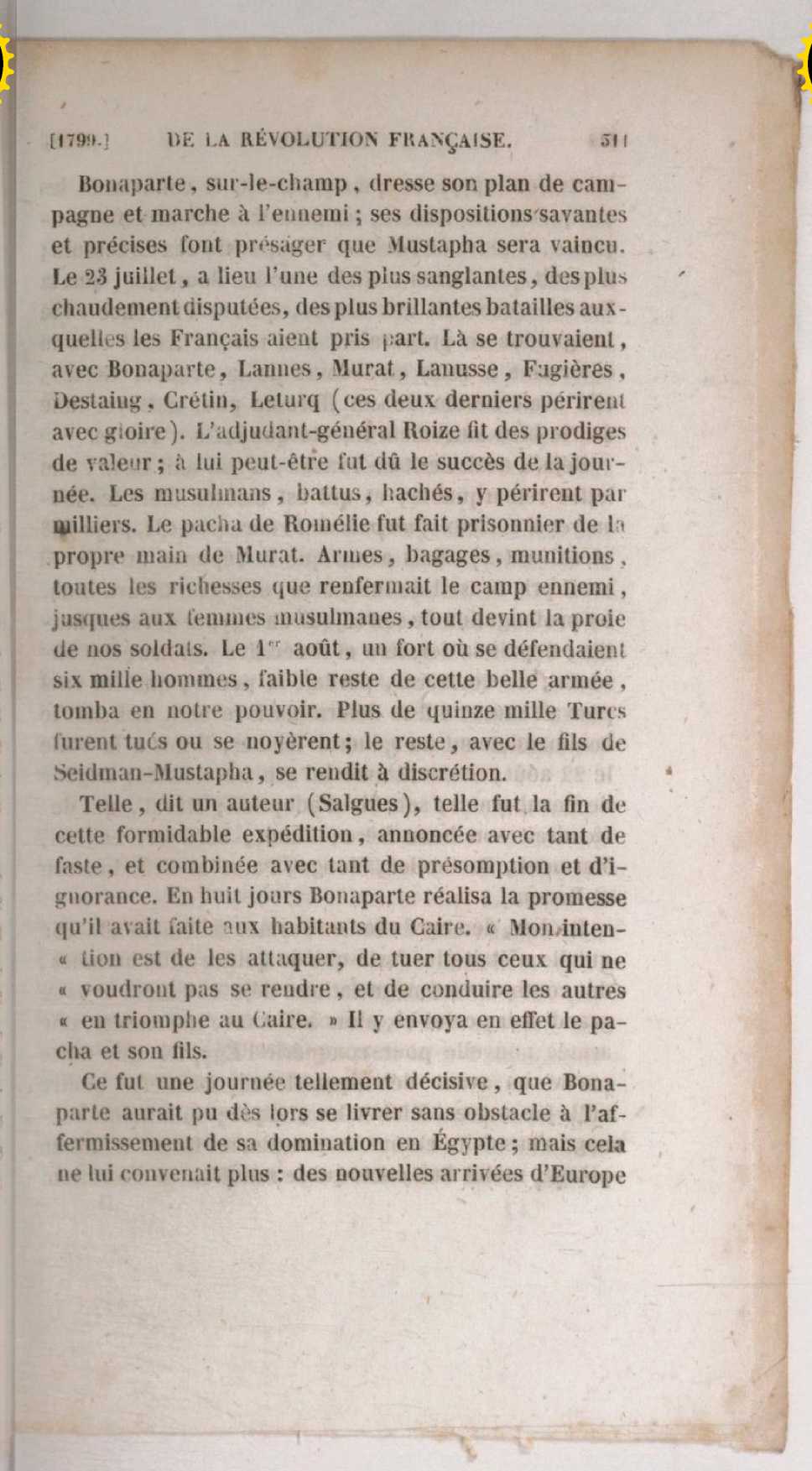
[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 511
Bonaparte, sur-le-champ, dresse son plan de campagne et marche à l’ennemi ; ses dispositions savantes et précises font présager que Mustapha sera vaincu. Le 23 juillet, a lieu l’une des plus sanglantes, desplus chaudement disputées, des plus brillantes batailles auxquelles les Français aient pris part. Là se trouvaient, avec Bonaparte, Lamies, Murat, Lanusse, Fugi ères , Destaiug. Crétin, Leturq (ces deux derniers périrent avec gloire). L’adjudant-général Roize fit des prodiges de valeur; à lui peut-être fut dû le succès de la journée. Les musulmans, battus, hachés, y périrent par milliers. Le pacha de Romélie fut fait prisonnier de la propre main de Murat. Armes, bagages, munitions, toutes les richesses que renfermait le camp ennemi, jusques aux femmes musulmanes, tout devint la proie de nos soldais. Le rr août, un fort où se défendaient six mille hommes, faible reste de cette belle armée . tomba en notre pouvoir. Plus de quinze mille Turcs lurent tués ou se noyèrent; le reste, avec le fils de Seidman-Mustapha, se rendit à discrétion.
Telle, dit un auteur (Salgues), telle fut la fin de cette formidable expédition, annoncée avec tant de faste, et combinée avec tant de présomption et d’ignorance. En huit jours Bonaparte réalisa la promesse qu’il avait faite aux habitants du Caire. « Mon inlen-« lion est de les attaquer, de tuer tous ceux qui ne « voudront pas se rendre, et de conduire les autres « en triomphe au Caire. » Il y envoya en effet le pacha et son lils.
Ce fut une journée tellement décisive, que Bonaparte aurait pu dès lors se livrer sans obstacle à raffermissement de sa domination en Égypte ; mais cela ne lui convenait plus : des nouvelles arrivées d’Europe
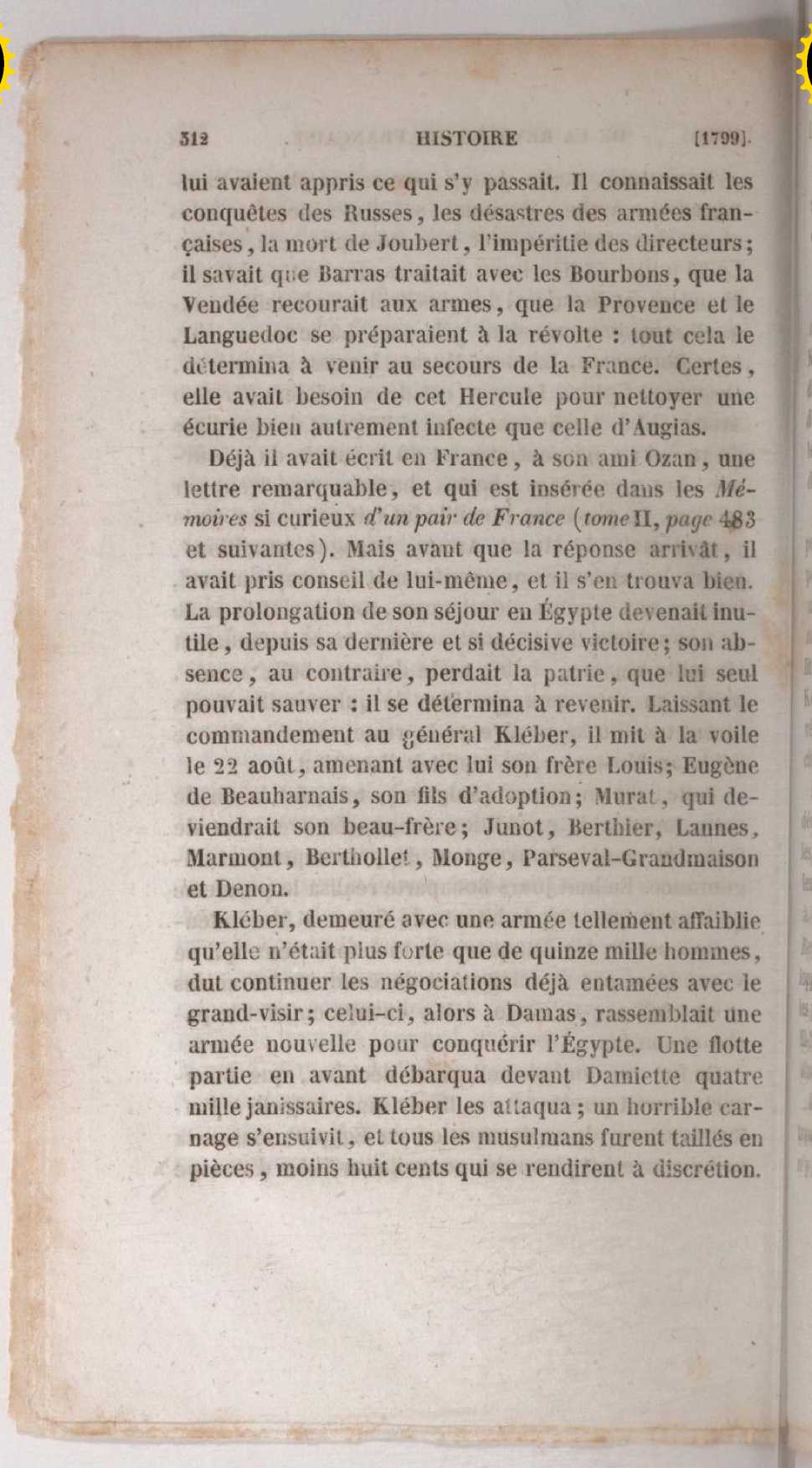
lui avaient appris ce qui s’y passait. Il connaissait les conquêtes des Russes, les désastres des armées françaises, la mort de Joubert, l'impéritie des directeurs; il savait que Barras traitait avec les Bourbons, que la Vendée recourait aux armes, que la Provence et le Languedoc se préparaient à la révolte : tout cela le détermina à venir au secours de la France. Certes, elle avait besoin de cet Hercule pour nettoyer une écurie bien autrement infecte que celle d’Augias.
Déjà il avait écrit en France, à son ami Ozan, une lettre remarquable, et qui est insérée, dans les Mémoires si curieux d'un pair de France (tomelL, page 483 et suivantes). Mais avant que la réponse arrivât, il avait pris conseil de lui-même, et il s’en trouva bien. La prolongation de son séjour en Égypte devenait inutile , depuis sa dernière et si décisive victoire; son absence, au contraire, perdait la patrie, que lui seul pouvait sauver : il se détermina à revenir. Laissant le commandement au général Kléber, il mit à la voile le 22 août, amenant avec lui son frère Louis; Eugène de Beauharnais, son fils d’adoption; Murat, qui deviendrait son beau-frère; Junot, Berthier, Lannes, Marmont, Berthollet, Monge, Parseval-Grand maison et Denou.
Kléber, demeuré avec une armée tellement affaiblie qu’elle n’était plus forte que de quinze mille homme», dut continuer les négociations déjà entamées avec le grand-visir; celui-ci, alors à Damas, rassemblait une armée nouvelle pour conquérir l’Égypte. Une flotte partie en avant débarqua devant Damiette quatre mille janissaires. Kléber les attaqua; un horrible carnage s’ensuivit, et tous les musulmans furent taillés en pièces, moins huit cents qui se rendirent à discrétion.
313
HISTOIRE
[1799].

Bd
GÎi
»
[I7G9.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 515
Ce succès était peu de chose, lorsqu’une armée de soixante mille hommes, grossie à chaque instant par des troupes asiatiques, qui la portèrent finalement à quatre-vingt mille hommes, ayant avec elle soixante-dix pièces de canon, allait arriver. Les négociations continuaient; et pour mieux endormir la confiance de Kléber, l’Anglais sir Sidney Smith s’en mêlait. Pendant ce temps, les Turcs avançaient, prenaient le fort d’El-Arich, et, sous la direction d’officiers envoyés par le roi de la Grande-Bretagne, marchaient vers le cœur de l’Égypte.
Kléber n’avait que huit mille cinq cents soldats disponibles pour s’opposer à cette masse formidable. La perfidie britannique le trompa jusqu’au dernier moment; alors il ne demanda plus de secours qu’à la victoire. Poin mieux exciter les Français, Kléber leur lit la lettre insolente qu'il vient de recevoir de l'amiral Keith; puis, prenant la parole : « Mes braves, ou ne répond que par des succès à une aussi indigne lâcheté. Préparons-nous à combattre. » .
il se rendit dans la plaine de Konbé, où devait se décider cette grande querelle. Le 21 mars 1800, dès les trois heures du matin, le village de Matariéh, défendu par une batterie de seize canons, est emporté à la baïonnette par les grenadiers que commandait Reynier. L'armée turque arrive en ce moment et enveloppe d’abord l'armée française; mais repoussée par les plus sublimes traits de courage, elle se replie sur El-Nunka, où Kléber la poursuit avec l'impétuosité d’un héros et la met en déroute.
Le jour suivant, il part pour Salahiéh, où il compte trouver tous les corps musulmans rassemblés ; mais il n’y rencontre qu'un camp abandonné, où les soldats

14
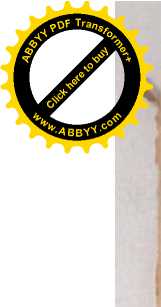
HISTOIRE
[1799]

font un butin prodigieux, et il apprend que le grand-visir, saisi d’effroi, a fui dans le désert, à peine escorte de cinq cents cavaliers. Cette victoire éclatante est inscrite dans nos fastes militaires sous le nom de bataille d’Héliopolis. •
Le Caire était en pleine révolte; mais, épouvantée au bruit de la dispersion des Ottomans, cette ville turbulente ouvre ses portes; Kléber y revient le 24 du mois de mars. Dès ce moment le général en chef se préparait à assurer notre domination en Égypte, lorsqu’un assassin turc, nommé Soleyman,le poignarda, le 14 juin 1800.
Le général Menou succéda à ce grand homme : il s’était couvert de ridicule aux yeux de l’armée par la folie qu’il avait faite d’embrasser l’islamisme sous le nom d’Abdallah. Il n’était pas capable de succéder ni à Bonaparte ni à Kléber. On blâma universellement son administration et ses opérations militaires. Il s’était fait des ennemis nombreux ; manquant de dignité, il remplaçait cette qualité, si essentielle dans un général en chef, par de la forfanterie, et ne savait pas se faire obéir; ses altercations avec les généraux, particulièrement avec Rej nier, prirent un caractère grave.
Sur ces entrefaites, et au milieu de ces symptômes de désorganisation, le 21 mai 1801, une armée anglaise de seize mille combattants, aux ordres du général Abercromby, descendit sur la plage d’Alexandrie. Menou y courut : les Français attaquèrent les Anglais aussi valeureusement que de coutume; mais l’habileté du commandant ne répondant pas à la bravoure des soldats, ils furent repoussés pour la première fois. Nous perdîmes à cette fatale bataille les vaillants généraux Lanusse et Ro’ze, Du côté de l'en

(1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
515
nemi, le commandant en chef, Abercromby, périt également; mais Hutchinson, qui le remplaça, sut profiter de l’incapacité de Menou. Une capitulation devint indispensable, et l’Égypte, conquise, retomba au pouvoir des Mamelucks et du sul'an.
il
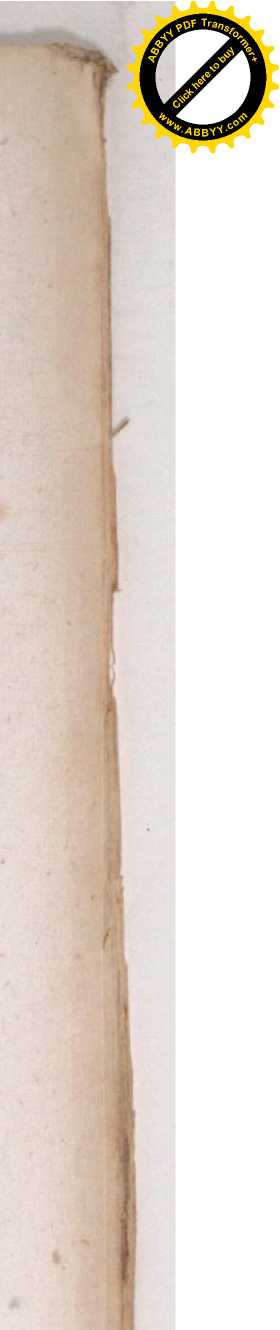


516
HISTOIRE
[1793-1799 I
La Vendée. —Sa position géographique. — Scs mœurs. — Début de la guerre.— Baudry d'Ausson. — D’Elbée. — Callielineau. — Bonehamp — Charette. — Stofflet. — Henri de La Rochejacqnelein.— Sa harangn sublime. — Lescnre. — Autres chefs. — Divers combats. — L'éveque d’Agra — Prise de Saumur. — Etablissement du conseil supérieur. — Mort de Bonchamp. — D’Elbée généralissime.— Mort de Biron. — Le général Tunck fait égorger plnjonrs milliers de Vendéens. — Crimes commis parles Mayemais.— Los Vendéens passent la Loire. — Affaire de Granville. — Déroute du Mans. — L'abbé Bernier.— Derniers instants de Charette. — Mort de Stofflet. — Derniers événements de la Vendée. — Quiberon , etc.
Avant de raconter les divers événements qui remplirent l’année 1799, et de conduire l’histoire de la révolution française au moment où Napoléon Bonaparte s’empara du pouvoir, je crois convenable de présenter dans son ensemble, et rapidement, les diverses circonstances qui accumulèrent tant de malheurs sur la Vendée et sur la Bretagne, où il coula tant de sang, et où la flamme dévora les cités et les campagnes; guerre sacrilège, guerre de géants, où tant d’obscurs paysans tirent des merveilles, et où se montra avec tant de vivacité le noble, le saint amour de la religion et du roi. Héroïque contrée, terre clas-
Mc
sique de la fidélité, chacun de tes tertres couvre un tombeau élevé à quelqu’une de ces nombreuses victimes qui se dévouèrent à la mort pour défendre leur religion et leur roi !
La Vendée forme une portion de l’ancien Poitou; , , elle est partagée en deux départements, les Deux-Sèvres et la Vendée ; ce dernier touche à l’Océan. Quand
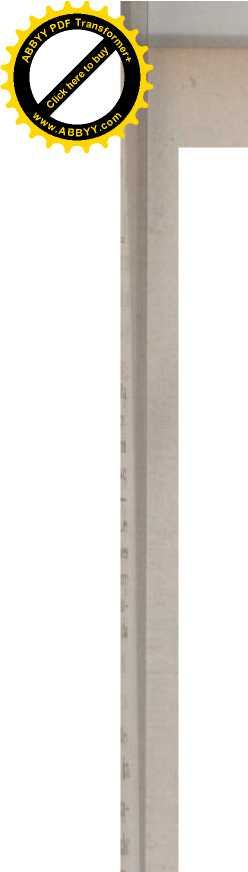
[1793-1799.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 517 la révolution commença, la Vendée comptait trois cent mille habitants, divisés en trois cent cinquante communes. Les villes manquaient de population : Fontenay-le-Cointe, la plus importante, n’avait que sept mille âmes. La Vendée est divisée en trois parties : le Marais, la Plaine, le Bocage; cette dernière, ayant en étendue les deux tiers du sol, doit son nom aux bois qui la couvrent : tout champ a une ceinture d’arbres de haute-futaie; des rivières nombreuses, des ruisseaux aux bords escarpés, l’absence de chemins, de ponts, de chaussées, de grandes routes, font de ce pays une immense fortification naturelle. Le Marais touche à l’Océan ; des flaques d’eau, des rigoles, des canaux, le couvrent de sentiers inextricables, obstrués de joncs, de saules, d’aunes, de frênes et de peupliers. La Plaine, qui est la partie méridionale, est presque séparée des deux autres par les mœurs et les usages de ses habitants. Dans la Vendée, la piété est entière, vive et sincère; on y associe le culte de la royauté à celui de la divinité. Là, les fortunes sont médiocres ; on n’y trouve que des nobles et des paysans, unis par une réciprocité d’affection, de services mutuels, de vertus patriarcales.
Les Deux-Sèvres sont aussi coupées par des bocages et des plaines, mais plus variés que dans la Vendée. Il y a des collines, des montagnes, des vallons, des eaux courantes, des étangs, des plaines, un air pur, un sol pierreux, des chemins en labyrinthe. Sa population, lourde, simple, crédule, attachée à la terre natale, aimant Dieu , chérissant son curé, son seigneur, craint et consulte les sorciers ; ses habitants n’ont que des plaisirs sans variété, de l’amour sans passion ; les arts y sont inconnus, le luxe y est ignoré; on n’y ren-
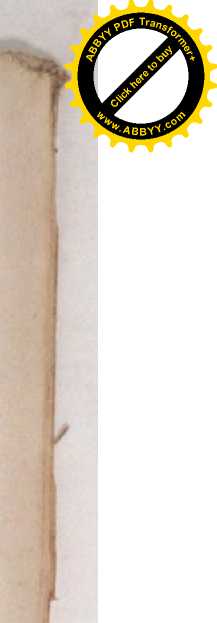

contre presque point de richesse, et cependant peu de misère, vu que les besoins y sont bornés.
ta Révolution attaqua le clergé, la noblesse ; les Jacobins, incrédules, dédaignèrent les sorciers. Les persécutions contre les prêtres, les senuents qu’on exigeait d’eux, parurent insupportables aux paroissiens ; les seigneurs proscrits, et dont ils ne connaissaient que les qualités, leur firent haïr la Révolution ; la vente des biens nationaux acheva d’exaspérer les esprits ; les sorciers humiliés poussèrent à la vengeance.
Avec de pareils éléments, une étincelle suffirait pour produire une explosion. Déjà la Bretagne, contrée voisine, était agitée par le marquis de la Rouai-rie. Cet homme extraordinaire, à l’âme forte, au cœur intrépide, aurait entraîné la province, si son activité ne l’eût dévoré lui-même. Il mourut le 13 mars 1793, consumé par ses efforts contre les républicains; et sept jours après, une portion de la Bretagne, de l’Anjou, du Poitou, s’insurgeait en faveur de la royauté.
Un arrêté barbare lancé contre les prêtres réfractaires des Deux-Sèvres est accueilli avec colère et mépris. Huit mille paysans des environs de Chàtillon se lèvent en masse : leur chef est Gabriel Faudry d’Ausson, ancien militaire, brave et simple; on lui jure obéissance. Il prend Châtillon, et attaque Bres-suire, le 2 4 août 1793. La victoire reste aux républicains, qui égorgent six cents Vendéens et nombre de femmes et d’enfants. Ce furent donc les Jacobins qui ajoutèrent les horreurs de l’extermination au fléau de la guerre civile.
Le calme n’est point rétabli ; à l’apparition de nouveaux griefs, des chefs habiles se montrent. Le

[E 93-1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
5Í9
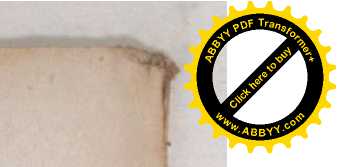
J
f
I
11 mars 1793, à la nouvelle d’une levée de trois cent mille hommes ordonnée par la Convention nationale, le tocsin sonne dans neuf cents paroisses du Poitou. A la tète des paysans soulevés paraissent d’Elbée, ardent. téméraire, irascible, au coup d’œil d’aigle; Catheli-neau, simple roulier, intrépide, doué de l’instinct du commandement, beau comme un ange, et que ses vertus ont fait surnommer Ze .saint d’Anjou, le marquis de Bonchamp. l’Épaminondas moderne, aussi généreux que brave; Charette, lieutenant de vaisseau, le Mar-cellus de la Vendée, infatigable, ambitieux, invincible, superbe, tyran même, qui rendit d’éminents services. et auquel les Bourbons auraient dû accorder plus de confiance; Stofllet, simple garde-chasse, bon militaire, retenu, discret, énergique, se faisant noble par ses exploits, mais sombre, jaloux, ennemi des supériorités, affectant l’indépendance, et aspirant au suprême commandement ; le chevaleresque Henri de La Roche-jacquelein, monsieur Henri, comme l’appelaient les paysans, et qui, sublime dans ses discours laconiques, disait : Si j'avance, suivez-moi ; si je recule, tuez-moi; si je meurs, vengez-moi.
Citerai-je encore de Lescure, si brillant, si religieux , et d’une bonne foi à toute épreuve : clément autant que plein de bravoure, il épargnait après la victoire celui qui avait tenté de lui donner la mort; Richard Duplessis, Danguy de Viec, La Cathelinière, Lucas-Championnet; Saint-André , plus hardi qu’heureux; le marquis de Romquery, de Couétus, Joly de la Chapelle-Hermié, La Sècherie, Savin, Rissau, Royan, les deux Bejary, de Hargues, les Sapinaud, les d’Autichamp, La Vérie, Villeneuve - Lirol, Sol, Mercier, le prince deTalmont, Beauvoilliers, les frères
^
1
520 niSTOÎIŒ (1795-1799]
Chouan, les Cadoudal; Vau ban, malgré ses odieux Mémoires; Puisaye, tant soupçonné de trahison; de la Ratoulière. Biron , Dandigné, de Mainacn, de Ma-rigny, et tant d’antres encore non moi.js célèbres, qui échappent à ma mémoire infidèle ; je voudrais pouvoir offrir à la vénération de la Fi ance tous ces chefs, ces officiers, ces soldats, si grands, si pieux, si braves , si royalistes.
En cinq jours, les Vendéens surprirent .(allais, Chollet, Vihiers, Saint-Florent, Challans, Machecoul, Chanlonay, Léger, Palluau, Saint Fulgent. La Roche-sur-Yon, Les Herbiers ; avec plus d’audace ils auraient envahi les villes de Lucon, des Sables, et Nantes même.
La guerre allumée, on court aux armes. Le 19 mars 1793, le général républicain Mareé, avec dix-sept cents hommes, attaque les Vendéens dans le vallon de Laye; trois heures après, ces derniers étaient vainqueurs ; et pourtant ils ne combattaient encore qu'avec des bâtons, des faux, des pioches, des haches, des pierres. Prier Dieu, se ruer contre l’ennemi , était leur tactique; ils s’emparaient des canons en courant sur eux entre chaque décharge.
La Convention envoya une armée formidable, commandée par le général Berruyer. Les Vendéens échouèrent à l’attaque des Sables-d’Olonne ; mais ailleurs ils prirent leur revanche : la victoire de Beaupreau, à la date du 28 avril 1793, leur livra toute la rive gauche de la Loire. La Rocbejacquelein battit Quelineau ; les Vendéens s’emparèrent de Bressuire, d’Argenlon-le-Château, et là, délivrèrent le marquis de Donnistanet Bernard de Marigny, qui depuis, ayant commandé l’artillerie vendéenne, périt misérablement, par suite de la jalousie de Charette et de Sloillet.

«1
'1
[1793-1799.1 DE LA RÉVOLLTION FRANÇAISE. 521
Thouars fut pris le 5 avril, quoique défendue par Quettineau, avec six mille hommes. Le général républicain , l’armée, les munitions, six mille fusils, douze canons, vingt caissons, tombèrent entre les mains des vainqueurs. Là, parut l’abbé Guillot de Fosseville, qui, d’accord avec les chefs, prit le titre d’éveque d’Agra, sans avoir été sacré, sans avoir reçu de mission apostolique , mais dans un but honorable. Il avait fait demander au pape de confirmer le titre qu’il se donnait; avant la réponse, les républicains avaient égorgé ce malheureux ecclésiastique.
La Convention se vengea de la défaite de Thouars en faisant mourir Quettineau ; ce qui n’empêcha ni la prise de La Châtaigneraie ni la défaite du bleu (1) Chalbot. A Fontenay, Lescure, par trop d’impétuosité, s’était laissé battre complètement le 16 mai. Le ‘24, il prit sa revanche ; ses soldats manquaient de munitions; Bcauvoilliei s, leur désignant les ennemis : Eu voilà, dit-il, et ils allèrent les prendre. Cette bataille procura d’immenses avantages aux Vendéens; ils devinrent une puissance.
Les royalistes avaient obtenu de grands avantages : ils étaient maîtres de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la partie méridionale de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, et leur influence s’étendait à vingt lieues en avant de ce rayon ; Nantes et Niort étaient menacées. Paris envoya contre eux douze mille hommes, commandés par San terre. La légion du Nord avait pour chefs Westermann, l’ex-duc de Lauzun, le général

I ) Li s Veudeeus donnèrent aux soldais de la République le so-briquel dr bleus, à cause du vêtement bleu qui avait remplacé l’habit blanc de l’armée française. L. L L.
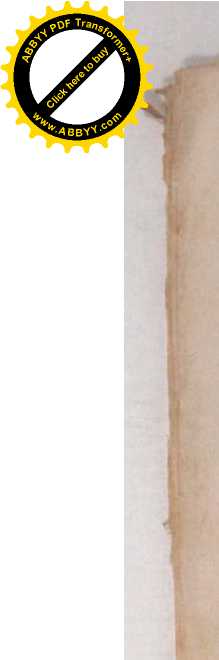
522 HISTOIRE {1595-1799.]
Biron, militaire sans mérite, comme courtisan sans vertu, qui paya plus tard de sa tète sa défection envers son roi. Il s’y trouvait aussi plusieurs conventionnels pour diriger les opérations, savoir : Bourbotte, Moreau, Bourdon de l’Oise, Chaudieu et Danton. Un comité central, composé de Richard, Chaudieu et Ruelle, résidait à Angers.
Quarante mille royalistes, sons les ordres de La Rochejacquelein, Beauvoilliers, Lescure, Stotllet et Cathelineau, se dirigent vers Saumur; le 7 juin 1793, ils battent le général jacobin Ligonnier, sur les hauteurs de Concarison; sa déroule livre Doué, et rend impossible la défense de Saumur. Cette place, pourtant, était défendue par les généraux Salomon , San-terre, Coutard, Menou et Berruyer. Ils furent culbutés par les Vendéens, qui y perdirent Domagné avec deux mille hommes ; Lescure y fut blessé.
Cathelineau fut élu généralissime; il débuta par un succès, la prise d’Angers. On marcha sur Nantes; Beysser et Canclaux y commandaient pour la République. Quarante mille Vendéens l’attaquèrent ; Cathelineau , d’Elbée, Bonchamp, Lirot de la Poterie, étaient à leur tête. Le 27 juin, le siège fut changé en bataille ; on combattit à la fois sur sept points, avec une bravoure égale, car c’étaient malheureusement des Français contre des Français. Cathelineau pénétra jusqu’à la place de Viarmes : là il trouva la mort; ce malheur fut le signal de la retraite. Les diverses colonnes vendéennes que d’Elbée voulut rallier restèrent sourdes à sa voix; elles se retirèrent au point du jour suivant, repassèrent la Loire, rentrèrent même dans leurs foyers, et Nantes fut sauvée.
Des combats partiels succédèrent à cette grande
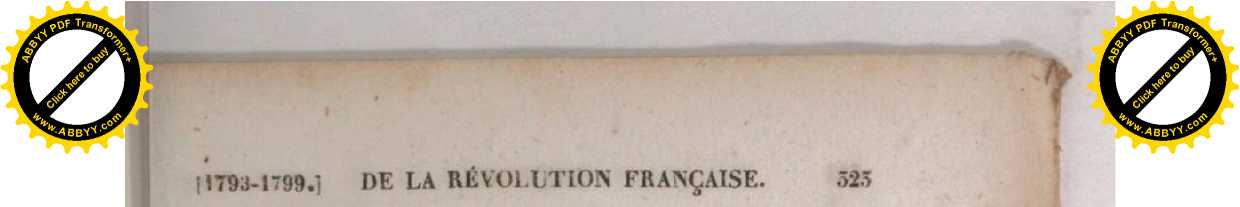
entreprise, avec une balance égale de succès et de revers pour les deux partis. Westermann, qui avant l’attaque de Nantes surprenait Lescure le 20 juin , fut à son tour surpris par ce même général, soutenu par Bonchamp et La Rochejacquelein.
Un peu avant cette époque, on établit à Ghâtillon le |
conseil-général de la Vendée, ainsi composé : l’évêque d’Agra, président; Michel Desessarts, vice-président;
Bernier, curé de Saint-Laud d’Angers, l’un des plus habiles et des moins probes de l’époque (1) ; Body, avocat à Angers ; Michelin, procureur à Champtoceaux ; Boutilliers des Homelles, de Mortagne ; le baron de La Rochefoucauld-Bayers, de Lamoignon, Pailhon. le sénéchal de La Flocelière; Lenoir de Pas-de-Loup, ex-officier de carabiniers; Thomas, de Saint-Philbert ' de Grandlieu ; Duplessis, avocat ; Genferon ; Coudraye, notaire ; Bressy, prêtre ; Bourrassean, de La Bunolière ;
Lirot de La Patoullière, de La Boberie; Gassière, procureur-générai du roi; Sagault, de Thouars, bénédictin , secrdaire-générat; Barré, de Saint-Florent, secrétaire-général dît bureau des dépêches.
D’Etbée devint généralissime; on eût préféré Bon-champ : sa modestie fut un malheur, la vanité de son rival un plus grand encore. L’élection se fit à Châ-tillon, le 15 juillet 1793; Gharette n’y prit aucune part : il affectait déjà l’indépendance qui le perdit plus tard, et qui perdit sa cause avec lui.
Quand la Convention eut ordonne la destruction de
1) Cet abbé. ayant plu à Aapoleon, obtint sa confiance et le\é rhé d'Orléans. Il avait été nommé cardinal in petto. La mort l’em pécha de recevoir le chapeau rouge.
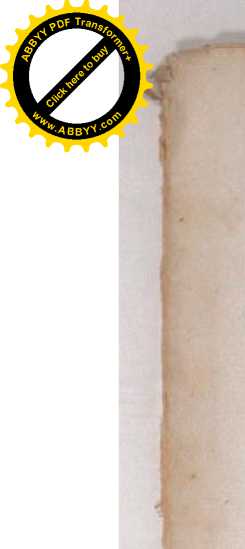

3Î4 HISTORIE [1795-1799 ]
¡a Vendée, celle-ci ne s’en effraya pas. Biron, attaqué le 15 juillet, força les royalistes à une retraite, qui fut aussi déterminée par les blessures de Boncliamp et de LaRochejacquelein. Le 18, ces derniers prirent à Vihiers une revanche éclatante; Biron paya cette déroute de sa tête. En allant au supplice , il dit : J'ai été infidèle à Dieu, au roi, à mon ordre ; je meurs plein de repentir.
Rossignol lui succéda; ce choix était marqué au coin de l’absurdité. Ce général stupide assista aux succès des bleus, soutenus par les décrets atroces de la Convention , que Barrère provoqua. Les républicains formèrent quatre-vingts compagnies d’incendiaires et de braconniers égorgeurs. La flamme dévora le Bocage ; les villes, villages, hameaux, châteaux, maisons, fermes, cabanes, rien ne fut épargné ; on enleva, on détruisit les grains, les fruits, les bestiaux; on tua les vieillards sans défense, les femmes, les enfants. Les garnisons de Mayence et de Valenciennes, qui n'avaient pu tenir contre des troupes réglées, s’en vengèrent par le massacre de leurs concitoyens.
Les Vendéens furent vaincus à Luçon par le général Tunck, qui lit immoler de sang-froid ceux qui n’avaient pas été tués pendant l’action. En date du 8 septembre 1793, la bataille fut gagnée parles royalistes; l’arrestation d’un courrier leur dévoila le plan de campagne des bleus. Attaqués par soixante-dix mille hommes secondés par la garde nationale, ils éprouvèrent d’abord un échec le 14 septembre, où le général d’Ambarrère triompha; mais le 18, à Loron , d Elbée tailla en pièces l’armée jacobine ; pareil succès fut obtenu contre le général Duhoux; quatre mille républicains mordirent la poussière. Un chevalier Duhoux. neveu du battu. était parmi les royalistes. « Cama-

(1793-1799.1 DE LA REVOLUTIS FRANÇAISE. 323
10
*
M
rades, leur dit-il en riant, prenez patience; mon oncle, qui vient avec les bleus, ne nous laissera pas manquer de munitions. »
Les Mayençais arrivaient, portant partout l’incendie , le pillage et la mort. Les Vendéens les battirent à Sofron, le 14 octobre 1793; Kléber y fut vaincu et blessé; Charette commandait; l’arrivée de Bon-champ décida la victoire. Les Vendéens obtinrent encore un autre succès à Mortagne, où Beysser fut défait. Les républicains, conduits par le général Léchelle, prirent leur revanche à Châüllou, à Mortagne et à Chollet. Le marquis de Bonchamp, blessé à mort dans cette affaire, sauva la vie à cinq mille bleus prisonniers, qu’on allait lui immoler en holocauste. Cette dernière action était digne de ce héros chrétien. Sa veuve prit part aux combats de la Vendée; elle en a écrit le récit.
Les Vendéens, réduits au désespoir, abandonnèrent le sol natal, et passèrent la Loire. Le 16 octobre, soixante mille hommes exécutèrent cette grande résolution. Au milieu de ces combats, Lescurc trouvé la mort ; celle de d’Elbée, suivant de près sa captivité, fit passer le suprême commandement à Henri de La Rochejacquelein ; Stofllet fut fait major-général ; le prince de Talmont eut le commandement de la cavalerie , et Bernard de Marigny celui de l’artillerie.
Les bleus, commandés successivement par le général Aulanie et le major-général Tabary, poursuivirent les Vendéens, et fqrent vaincus par Desessarts. de .largues et Duhoux. D’autres succès suivirent et préludèrent à la grande victoire de Laval, où, le 2¿ octobre 1794, les républicains, au nombre de trente mille, furent battus. Leur général (Léchelle) mourut

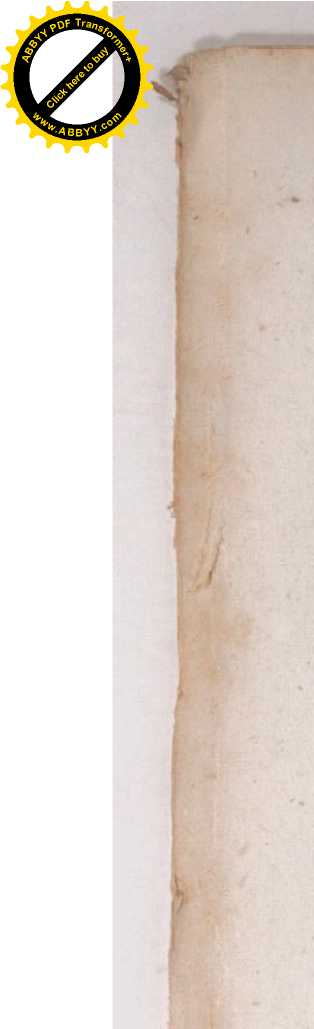
t

526 • Histoire [1793-1799.1
tle ses blessures. On entra dans la Bretagne, bien que le Maine ne se soulevât pas, et l’on obtint de nouveaux succès à Fougères et à Maycar.
Le 11 novembre, les Vendéens quittèrent Dol, s’emparèrent d’Avranches et attaquèrent Granville. La ville en flammes ne se rendit pas ; sa résistance admirable découragea l’armée royale : malgré ses chefs, elle voulut repasser la Loire. Les bleus, à Pontorson, tentèrent d’empêcher la retraite : ils furent repoussés. La grande armée conventionnelle, conduite par Wes-termann et par Marceau, rejoignit les royalistes à Antrain. Là, une victoire éclatante, que ces derniers remportèrent, les dédommagea de l’échec de Granville. Le résultat de la journée lut dû à La Rochejac-quelein.
Le 5 décembre, Angers, pris auparavant, résista cette fois aux Vendéens. Le 10, ils atteignirent Le Mans, .le ne me sens pas le couiage de décrire cette bataille funeste ( 13 décembre), où la première Vendée fut anéantie; où périrent tant de héros; où tant d’enfants et de femmes furent si lâchement égorgés, après la victoire, par les républicains.
Le mal fut irréparable. La fuite devint un devoir, car on ne pouvait plus conserver aucune espérance. La Rochejacquelein, seul, impassible lorsque tous avaient perdu la tête, rallia le 13 au soir un noyau de braves à Laval. On voulut de nouveau repasser la Loire; une terreur panique, et l’affaire fatale de Savenay, achevèrent de désorganiser et de disperser cette généreuse armée. Une foule de chefs illustres venaient successivement de périr sur le champ de bataille ou d’être mis à mort par ordre du Gouvernement. Je citerai dans le nombre Bonchamp, d’Elbée, l’évêque d’Agra ,
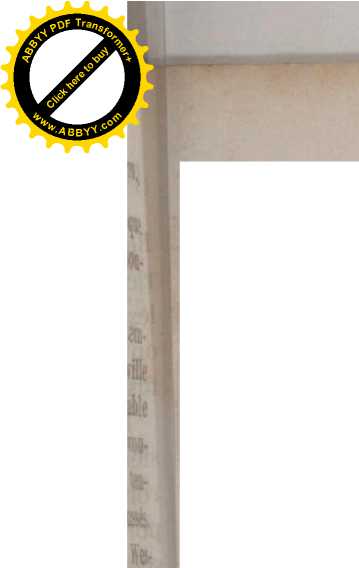

11793-1799.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 527
Bérault, Lemeignan, Verseuil, Labigolière, Carrière, Villeneuve-Deligny père, le chevalier DuLoux, les deux Beauvoilliers, Desessarts, Grenier, Donistan ; on traîna d’Elbée sur un fauteuil au lieu où on le fusilla , après la rentrée des bleus à Noirmoutier.
La Convention, de son côté, envoya à la mort plusieurs de ses généraux, entre autres Quettineau , Biron, Beysser, AVestermann. Douze colonnes mobiles, se portant à tous les excès, dévastèrent la Vendée sans la soumettre, car La Rochejacquelein, Charette, Stofflet, d’Autichamp, vivaient encore. Déjà, autour du premier, se ralliaient de nouvelles troupes ; mais son intrépidité aveugle lui coûta la vie. Le 4 mars 1794, à NaaiUé, Stoillet s’empara de vive force du commandement suprême; il légitima cette sorte d’usurpation par de beaux faits d’armes : il battit les généraux Moulin et Caffin. prit Chollet, d’où le chassa ensuite le général Chastellier.
Bernard de Marigny assiégea et prit Mortagne, à la tin de mars. Cette belle action détermina sa mort, qui. ordonnée par Stofflet et par Charette, ternit la gloire de ces deux habiles chefs. Ce meurtre, commis en employant les formes d’un conseil de guerre, fut nue des causes principales de la destruction de l’armée royale. Charette se conserva le Poitou; Stofflet se donna l’Anjou ; auprès de Ici parut un homme d’un rare mérite, l’abbé Bernier, curé de Saint-Laud d’Angers.
Ce personnage, déjà connu, parce qu’il faisait partie du conseil supérieur, était doué d’une grande finesse, d’une capacité peu commune, d’une élocution entraînante, et d’une extrême rectitude de jugement; il joignait à une âme ardente une tête froide, et un

528
HISTOIRE
(1793-1799J
courage qui s’alliait merveilleusement à une prudence accomplie. Il se lança dans une carrière hérissée de périls, l’exploita dans l'avantage commun, et s’en retira avec sagesse, dès qu’il crut que la partie était perdue. La Vendée , qui n’avait eu jusque-là que de grands capitaines, eut enfin son homme d’état.
Il ne put empêcher la désunion entre Stoflletet Cha-rette; celui-ci, profitant de son influence, fit prononcer la destitution de Stoillet par le conseil supérieur; mais l’exécution de cette mesure était impossible ; le condamné ne conserva pas moins son pouvoir, et continua à battre les jacobins jusqu’au jour où il tomba sous leurs coups.
Gharette, le dernier des héros de la Vendée, était né à Couffé, en Bretagne, le 21 août 1763, d’une famille noble ; il cuira dans la marine royale à seize ans ; en 1790, il émigra, bien que nouvellement marié; il était rentré de bonne heure, puisqu’au 10 août il combattait aux Tuileries. Venu dans la Vendée, il refusa deux fois de commander ; à la troisième , on lui laissa le choix de mourir ou de s’armer pour le roi. Nommé général en chef après la fin malheureuse de Saint-André, il débuta par un succès à Machecoul ; il prit une part active à la journée de Torfou, où les Mayençais éprouvèrent une défaite sanglante ; il aida aussi aux victoires de Montaigu et de Saint-Fulge ni.
Mais, trop ambitieux, trop impatient pour se soumettre à un supérieur, ou pour s’entendre avec des égaux, il affecta de bonne heure une indépendance qui détruisit l’unité de la Vendée; on lui dut la conquête de l’île de Noirmoutier; sa retraite devant le général llaxo, aux marais vendéens, fit éclater sa science et sa bravoure.
'h-
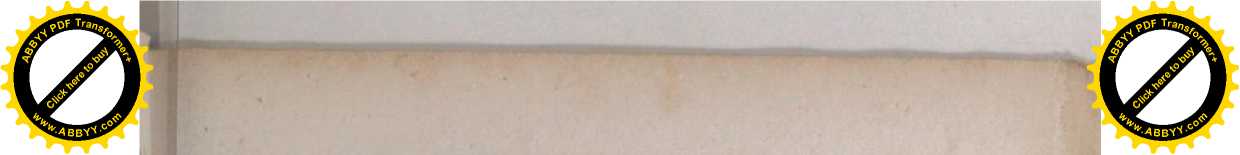
[1793-1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 529
Ayant perdu son artillerie, il fit la guerre en partisan avec audace et génie ; poursuivi, blessé, trahi, abandonné , il vainquit sa mauvaise fortune, rien n’altérant sa constance et son énergie. N’ayant pris aucune part à l’expédition d’outre-Loire, ses ressources n’étaient pas entamées. Lorsque La Rocbejacquelein se réfugia près de lui, Gharette l’accueillit comme royaliste poursuivi, mais il lui refusa toute participation aux affaires. Ce jeune héros le quitta son admirateur, mais non son ami.
Le 19 mars 1794, Gharette surprit les bleus; le général Haxo fut tué dans la fuite. Thureau, qui lui succéda , contraignit le Vendéen à repasser la Sèvre; sentant le besoin qu’il avait de faire oublier le meurtre de Bernard de Marigny, Gharette en vint aux prises avec les républicains en diverses circonstances, et souvent il les battit. En juin, il attaqua successivement les trois camps retranchés des ennemis. La victoire de Saint-Christophe préluda à cette entreprise brillante, que le succès couronna. Dès lors son influence prévalut dans la Vendée.
Le 9 thermidor arrêta le cours des assassinats juridiques, des noyades de Nantes et de tant d’autres massacres. En faisant cesser la permanence de l’échafaud , la Convention nationale conçut le projet de ramener au moins la paix dans la France, si elle ne pouvait avoir lieu complètement au dehors; elle chargea plusieurs de ses membres , Richard , Ruelle, etc., de s’entendre avec les insurgés. Bureau de la Bâtar-dière. homme de sens et de courage, poursuivi comme émigré, se présenta du côté de l’armée royale pour traiter avec les députés.
Les négociations s’ouvrirent à Nantes; Charette y
550 HISTOIRE [17 93-1790.]
prit part, StolTIet s’en éloigna; il voulut s’y opposer; vaincu et poursuivi, il se sauva. Lu traité fut conclu à La Saunais, le 15 janvier 1795. On affranchit le culte catholique des formes révolutionnaires; on paya deux miliions de francs à Charelte; on solda un corps de deux mille Vendéens relevant de ce chef, et chargé de maintenir la paix ; on accorda des secours aux régni-coles, des indemnités, la main-levée des séquestres à ceux dont les biens avaient été saisis, l’exemption momentanée des réquisitions, impôts et levées d’hommes. Ces concessions faisaient de la Vendée un état indépendant au milieu de la république.
Charelte parut à Nantes le 26 février, avec l’écharpe, le plumet blanc, et son état-major. Les cris de vive le /w allaient prévaloir; Bureau delà Bâtardière y substitua celui de vive la paix! Due des clauses secrètes de ce traité était la remise aux Vendéens du roi Louis XVII ; sa mort, résultat d’un crime, dégagea la Convention de la nécessité d’exécuter cet article.
Louis XVIII, en montant sur le trône, porta son attention sur la Vendée; elle n’était pas tranquille. Malgré la paix, les chouans, qui tiraient leur nom de Jean Chouan et des siens, commençaient à se montrer. Je passe sous silence une foule de combats isolés , de faits glorieux sans résultats.
L’Angleterre préparait, d’après les avis du marquis de Puisaye, une expédition formidable ; une multitude d’émigrés, ou nobles, ou dignes de l’être par leur belle conduite, s’enrégimentèrent sous les ordres des comtes d’Hervilly et de Sombreuil.
Déjà étaient débarqués Puisaye, Vauban , Tinténiac, Joseph de Broglie, Confiaos, Contactes, Bois-Ber-thelot, et l’évêque de Dôle. A leur arrivée, Charette,
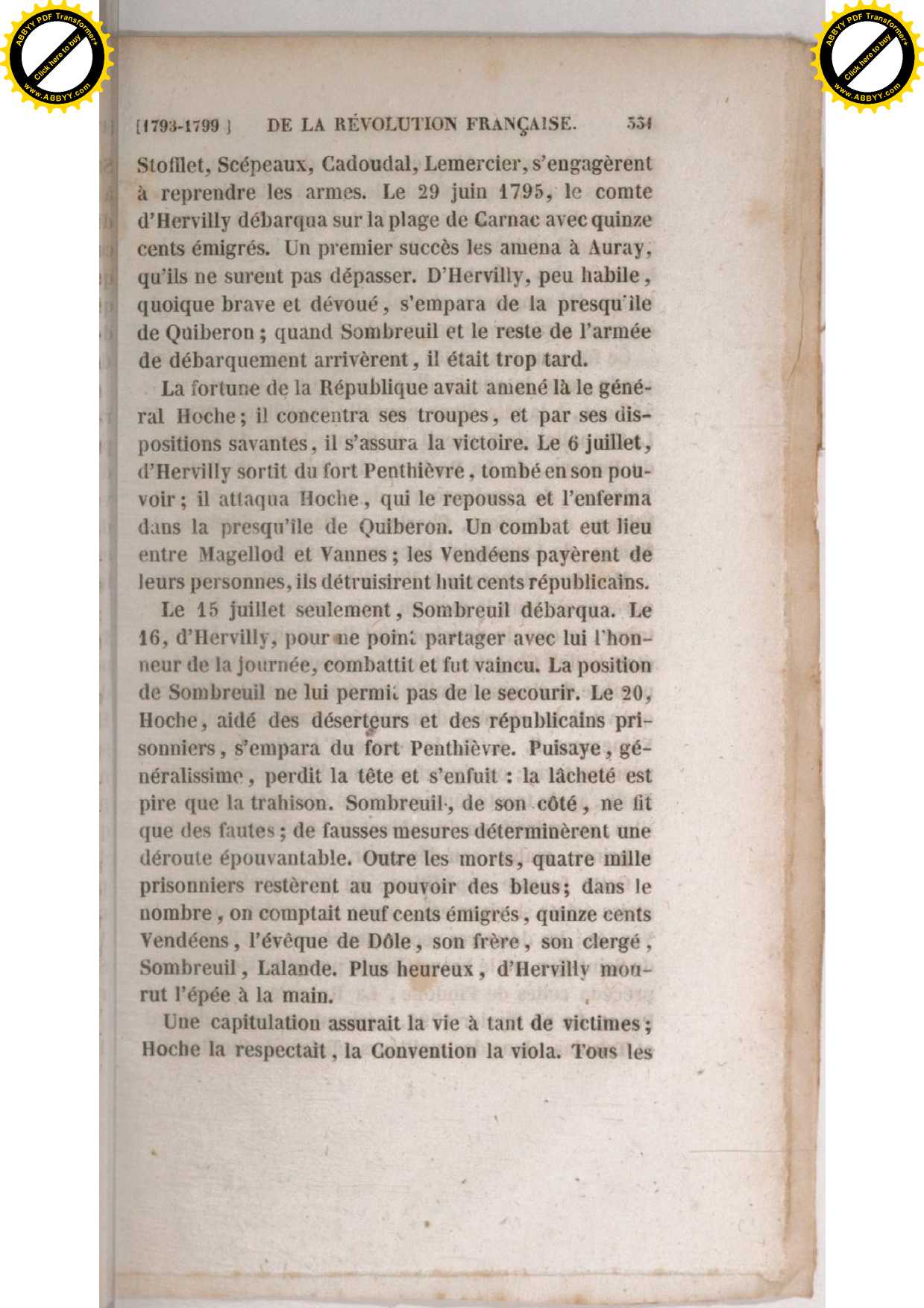
Stoíllet, Scépeaux, Cadoudal, Lemercier, s’engagèrent à reprendre les armes. Le 29 juin 1795, le comte d’Hervilly débarqua sur la plage de Carnac avec quinze cents émigrés. Lu premier succès les amena à Auray, qu’ils ne surent pas dépasser. D’Hervilly, peu habile, quoique brave et dévoué, s’empara de la presqu'île de Quiberon ; quand Sombreuil et le reste de l’armée de débarquement arrivèrent, il était trop tard.
La fortune de la République avait amené là le général Hoche ; il concentra ses troupes, et par ses dispositions savantes, il s’assura la victoire. Le 6 juillet, d’Hervilly sortit du fort Penthièvre. tombé en son pouvoir; il attaqua Hoche, qui le repoussa et l’enferma dans la presqu’île de Quiberon. Un combat eut lieu entre Magellod et Vannes ; les Vendéens payèrent de leurs personnes, ils détruisirent huit cents républicains.
Le 15 juillet seulement, Sombreuil débarqua. Le 16, d’Hervilly, pour-ne point partager avec lui l'honneur de la journée, combattit et fut vaincu. La position de Sombreuil ne lui permit pas de le secourir. Le 20, Hoche, aidé des déserteurs et des républicains prisonniers , s’empara du fort Penthièvre. Puisaye, généralissime , perdit la tête et s’enfuit : la lâcheté est pire que la trahison. Sombreuil-, de son côté, ne lit que des fautes ; de fausses mesures déterminèrent une déroute épouvantable. Outre les morts, quatre mille prisonniers restèrent au pouvoir des bleus; dans le nombre, on comptait neuf cents émigrés, quinze cents Vendéens, l’évêque de Dôle, son frère, son clergé , Sombreuil, Lalande. Plus heureux, d’Hervilly mourut l’épée à la main. .
Une capitulation assurait la vie à tant de victimes; Hoche la respectait, la Convention la viola. Tous les
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
[1793-1799 I
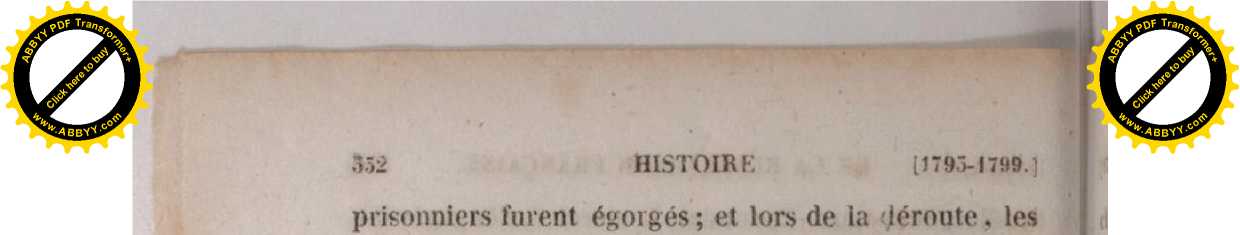
Anglais axaient eu l’infamie (le tirer à mitraille sur ces
mêmes Français qu’ils venaient d’amener à la mort. Sombreuil, l’évêque de Dol, Lalande, les prêtres , les femmes, les enfants, tout périt par le feu de la mitraille. O ! sanglantes et fatales journées, que ne perlon vous arracher de nos annales !
Ce fut sous ces tristes auspices, lorsque tout était perdu, que le comte d’Artois partit d’Angleterre le 25 août, à la tête d’une nouvelle expédition. MM. de LaChapelle, de Verneuil, de Sainte-Luce, de Vauban, de Puisaye, de La Rosière, de Chapeu, de Roll, de Valcourt, de Sanslancourt, de Püységur, de Serrant, Étienne de Durfort, Charles de Damas, l’évêque de Nantes, de Laurencio, l’accompagnaient.
Monsieur débarqua à File d’Yeu le 29 septembre, après avoir tenu la mer un mois environ; et le 3 octobre, le duc de Bourbon vint l’j rejoindre. L’armée était belle ; Charette et les Vendéens l’attendaient au nombre de cinquante mille hommes. Mais l’Angleterre, qui vit là les chances d’un succès, y mit des entraves. Vainement S. A. R. le comte d’Artois demanda à prendre terre; on s’y refusa sous différents prétextes. Enfin, après trente jours passés en démonstrations inutiles, un ordre venu du cabinet de Londres lit ramener le priuce, malgré son désespoir.
Cette funeste expédition, où la malveillance anglaise éclata si vivement, porta le dernier coup à la Vendée; les désastres recommencèrent par la déroute de Saint-Cyr, où le brave Guérin perdit la vie; sa mort précéda celles de Pindone, La Ruberie, Couétus et Payot. Le 23 février 1796, périrent encore Guichard et Trirolas, deux des meilleurs officiers de StoiHet. Ce
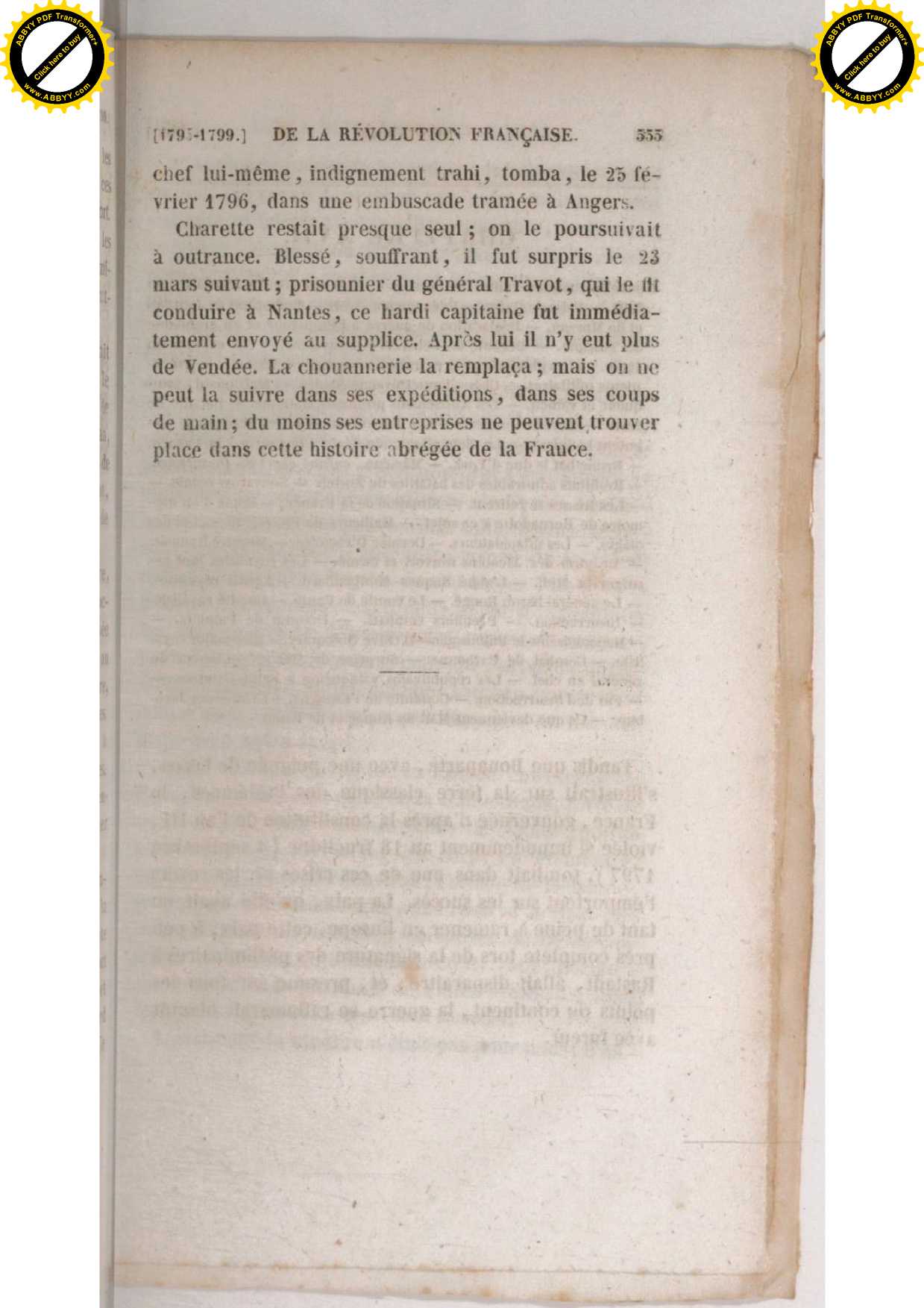
[17»;-!799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 555 chef lui-même, indignement trahi, tomba, le 25 lévrier 1796, dans une embuscade tramée à Angers.
Charelte restait presque seul ; on le poursuivait à outrance. Blessé, souffrant, il fut surpris le 23 mars suivant; prisonnier du général Travot, qui le lit conduire à Nantes, ce hardi capitaine fut immédiatement envoyé au supplice. Après lui il n’y eut plus de Vendée. La chouannerie la remplaça ; mais on ne peut la suivre dans ses expéditions, dans ses coups de main; du moins ses entreprises ne peuvent trouver place clans cette histoire abrégée de la France.
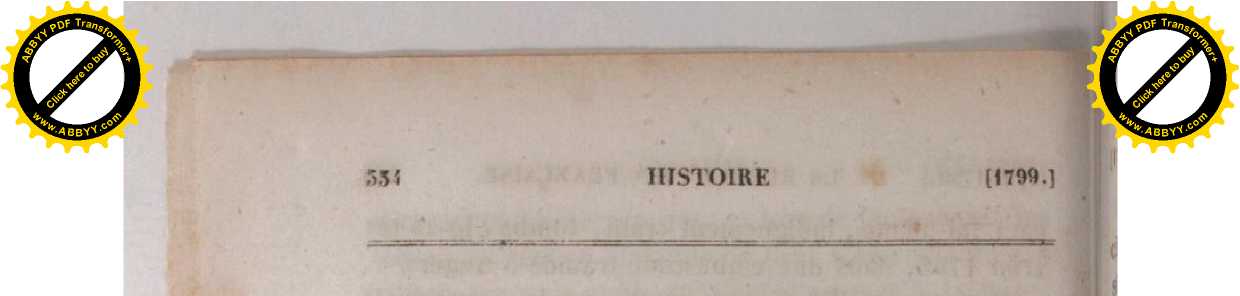
Nouvelle coalition contre la France. — Etal des armées françaises en 1799. — Prise de Gacte. — Événements divers.— Opérations de Jourdan et de Moreau. — Déclaration de guerre à l’Empereur et au grand-duc de Toscane. — Déroule de Schérer. — Souvarow. — Ses exploits en Italie. — Les plénipotentiaires français assassinés à Rastadt.— Événements militaires.--Chainpionnet évacue Naples. — Macdonald, vainqueur el vaincu. — Les Autrichiens prennent Manione. — Bataille de Novi. — Mort de JouberL — Les Austro-Russes et les Français se disputent la Suisse. — La diète allemande déclare la guerre à la France. — Brune bat le duc d'York. — Masséna, enfant chéri de la victoire. — Résultats admirables des batailles de Zurich. — Souvarow recule. — — Les Russes se retirent. — Situation de la France. — Copie d’un mémoire de Bernadotte à ce sujet. — Malheurs de l'intérieur. — Loi des otages. — Les dilapidateurs. — Dernier Directoire. — Ministre français. — Le club des Jacobins rouvert et fermé. — Les royalistes font insurger le Midi. — L’abbé Roques-Montgailiard. —Agents royalistes. — Le général baron Rongé. — Le comte de Paulo. — Comité royaliste. — Insurrection. — Premiers combats. — Déroute de Pamiers. — — Mademoiselle <le Puibusque.—D’Olive Quinquiry.— État-major royaliste. — Combat de Carbonne. — Surprise de Martus. — Erreur du général en chef. — Les républicains vainqueurs à Sainl-Gaudens. — — Fin de l’insurrection. — Conduite de l'Espagne. — Crimes des Jacobins — Ce que deviennent MM. de Rongé et de Paulo.
Tandis que Bonaparte, avec une poignée de héros, s’illustrait sur la terre classique des Ptolémées, la France, gouvernée d’après la constitution de l’an III, violée si impudemment au 18 fructidor (4 septembre 1797 ), tombait dans une de ces crises où les revers l’emportent sur les succès. La paix, qu’elle avait eu tant de peine à ramener en Europe, cette paix, à peu près complète lors de la signature des préliminaires à Rastadt, allait disparaître, et, presque sur tous les points du continent, la guerre se rallumerait bientôt avec fureur.

[1799.1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 55S
L’Angleterre, ennemie active, infatigable,
astu-
cieuse, parvenait à renouer une autre coalition; elle s’alliait, et faisait s’enlre-allier ensemble, la Russie, la Suède, le royaume de Naples, les Ottomans, 1 empereur d'Autriche; en un mot la moitié de l’Europe tarderait peu à nous attaquer simultanément.
L’armée autrichienne, commandée par le prince Charles, établie sur le Lech et en Bavière, est forte de cent mille fantassins et de vingt-trois régiments de cavalerie. Le général Kray, posté sur l’Adige, a sous ses ordres cent mille hommes de troupes de ligne et trente escadrons. Des corps nombreux stationnent et couvrent les points intermédiaires, le Tyrol, les Grisons; soixante-dix à quatre-vingt mille Russes accourent par la Moravie ; une autre armée de la même nation débarque à Naples pour balayer l’Italie et la délivrer des républicains. A cette masse il faut ajouter les contingents de l’Empire, les régiments suédois, l’armée anglaise, et même celle du Portugal; finalement , cinq cent mille hommes sont en mouvement contre nous, sans compter que l’Espagne est très-mal disposée à notre égard.
Outre l’armée d’Égypte, la France entretenait en Europe sept armées: celle de la Haute-Italie, forte de quarante-sept mille hommes; celle de Naples, qui en comptait vingt-cinq mille ; les corps en Piémont et en Ligurie, douze mille environ ; l’armée de Hollande, quinze mille; du même côté, une réserve de vingt-cinq mille; l’armée du Danube, composée de trente-cinq mille; enfin celle de Suisse, dite d'Helvétie, portée à quarante mille combattants de toutes armes. Le total était de près de deux cent mille hommes.
L'avantage du nombre n’était pas pour nous; d’ail-
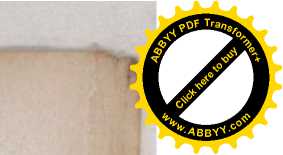

556
HRTOIKE
[1799.]

leurs les munitions, les armes, la solde, tout manquait ou à peu près.
Le 3 janvier, le général Reille, par l’effroi que les Français inspirent, se fait ouvrir la puissante forteresse de Gaëte, au royaume de Naples ; il y fait quatre mille prisonniers, et s’empare de soixante-dix canons, de vingt mortiers, de vingt mille fusils, de cent milliers de poudre, et d’approvisionnements immenses.
La veille, à Constantinople, un nouveau traité avait lié le sultan et Georges III. Le surlendemain, 5, une alliance cffensive et défensive avait uni les cabinets de Londres et de Saint-Pétersbourg. Le 23, pareil accord avait été conclu entre le grand-seigneur et le roi de Naples; mais le 25, cette dernière ville tombait au pouvoir des Français, conduits par Je vaillant Cham-pionnet. Mack, chef de l’armée napolitaine, dut venir chercher dans notre camp un asile contre la colère des vaincus. Le roi Ferdinand III, avec la reine, sa cour, ses trésors, ses objets précieux, sa flotte, fuyaient vers Palermo; et les Napolitains fondaient la république Parthénopéenne, qui, presque à sa naissance , mourut noyée dans sou propre sang.
Du côté de l’Allemagne, les hostilités commencèrent avec le mois de mars. Jourdan commandait l’armée du Danube, sur la rive droite du Rhin; son quartier-général était à Offenbourg; cependant, la guerre n’était pas légalement déclarée; mais tandis que, dans l’Adriatique, la très-faible garnison française de Corfou se rendait le 3 mars, après quatre mois d’un siège opiniâtre, aux Russes et aux Turcs réunis, le 1, le prince Charles passait le Lech et rompait la trêve.
Moreau, chef de notre armée d’Helvétie, débuta d’une manière brillante; il prit Coire, battit les Au-

»,
/■'í I
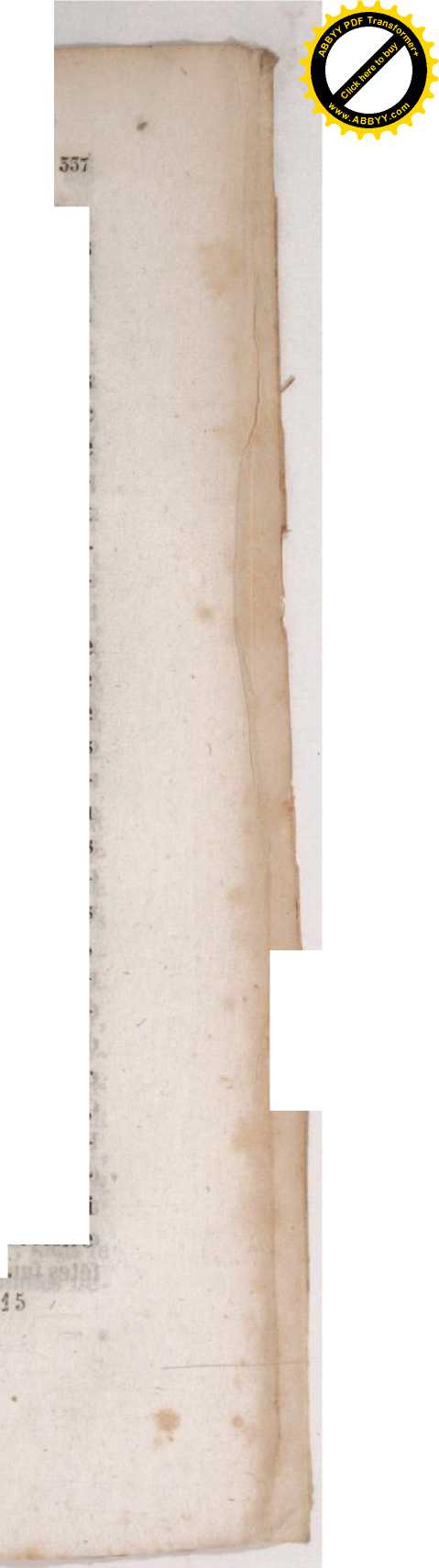
[1799.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
tricbiens, et, malgré leurs efforts, conquit le pays des Grisons. Jourdan, non moins brave, mais moins heureux, fut vaincu le 10 à Ostrac; il est vrai que l’infériorité (lu nombre rendait excusable sa défaite, dont les ennemis obtinrent de grands résultats.
Le 12, les conseils des Anciens et des Cinq-Cents déclarèrent la guerre à l’empereur et au grand-duc de Toscane, son frère. Du 21 au 22, Jourdan, que frappait la fatalité, perdit la bataille de Pfullen-dorf et de Stockach, malgré l’avantage, plus brillant qu’utile, obtenu à l’aile gauche par le général Gou-vion-Saint-Cyr. Le prince Charles en espéra des merveilles.
Jourdan fut destitué, et son armée réunie à celle de Moreau ; mais déjà celle-là avait repassé le Rhin. Ce désastre fut réparé jusqu’à un certain point par une suite de victoires partielles, que les généraux Dessol les et Lecourbe remportèrent sur les frontières de la Val-teline ; entre autres celle de Sainte-Marie, qui eut lieu le 25, et où Dessolles, avec quatre mille hommes, sans canons, attaqua à la baïonnette et mit dans une déroute complète sept mille Autrichiens retranchés dans une position formidable ; il tua douze cents soldats, en prit quatre mille avec vingt pièces d’artillerie. L'occupation de Glaureu fut le dernier fruit de cet admirable fait d’armes.
A Vérone, au contraire, l’inepte et dilapidateur Schérer se fit battre de telle sorte, du 25 au 30 mars, que sept mille hommes restèrent sur le champ de bataille. Le 3 avril, à Mugnano, sur l’Adige, son inhabileté le livra encore aux coups du général Kray, qui le battit complètement. Enfin, le 22 avril, le Directoire le destitua : il partit chargé d’or et de mépris.
IL
A cette époque, Souvarow, ce héros russe si bizarre, si heureux, si vaillant, si cruel, si désintéressé ; ce foudre de guerre, effroi des Turcs, horreur des Polonais, idole des troupes russes, débarquait à Trieste avec quarante mille Moscovites, qu’il courut unir aux soixante mille Autrichiens de K ray (30 avril). L’armée d’Italie se trouvait dans le plus grand péril; mais Moreau, qui, en qualité de volontaire, avait accompagné Schérer, prit le commandement provisoire d’une armée que celui-ci laissait désorganisée.
Moreau ne fut pas heureux à Cassano, le 27 avril, où Souvarow, avec ses cent mille soldats, écrasa nos trente mille braves, dont sept ou huit mille furent tués, mis hors de combat ou faits prisonniers. Ce fut alors que le général russe fit prévenir les Français que cent des nôtres seraient régulièrement fusillés chaque fois qu’on mettrait à mort un émigré pris les armes à la main, ainsi que l’ordonnait la loi républicaine. Le général Vandamme , en nombre de circonstances , ainsi quïl s’en est vanté dans une de ses lettres à la Convention nationale, insérée dans le Moniteur, n’avait pas manqué d’exécuter ces ordres barbares.
Au milieu de toutes ces opérations militaires, l’Europe apprit avec indignation qu’à la sortie de Rastadt, deux plénipotentiaires français, Roberjot et Bonnier d’Alco, avaient été assassinés par des hussards autrichiens de Szeckler ; le troisième, Jean de Brie, échappa. On accusa l’empereur d’Allemagne, la Russie, la Prusse, l’Angleterre, le Directoire et même LouisX VIII, » de ce crime. Le temps a fait connaître que son premier auteur est la reine Caroline de Naples, mal conseillée et trop bien servie. Ce meurtre eut lieu le 28 avril. Des fêtes funèbres lui donnèrent en France un grand éclat.
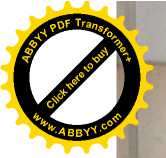

'1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. .^"9 Aux conseils, la place des deux victimes demeura vide et couverte d’un crêpe noir; on appelait ces deux noms avec ceux des autres législateurs, et le président répondait : Que leur sang retombe sur (a maison d’Autriche! Chaque armée de terre reçut une oriflamme aux trois couleurs, avec cette inscription : Vengeance aux mânes des citoyens Bonnier et Boberjot, assassinés à Bastadt. En temps de paix on devait la déposer dans la salle des conseils.
/
Le 12 mal, Moreau, vaillamment secondé par Victor et Grenier, repoussa à Bassignano les Austro-Russes ; mais cela ne suffisait pas pour rétablir les affaires. Deux mille cinq cents Français rendirent, le 24 mai, la citadelle de Milan, assiégée depuis vingt-six jours ; Bresse, Peschiera, Pizzighcttone, Ferrare, avaient été prises auparavant ou attendaient les vainqueurs. En dépit de leurs efforts prodi deux, les Français ne cessaient d’être poussés en arrière.
Du côté de Naples, Championnet est également cerné par les Anglais, les Russes, les Calabrois, soulevés à la voix du cardinal Ruffo, qui, la croix d’une main et l’épée de saint Paul de l’autre, a fanatisé les campagnes au nom de Dieu et du roi. Il se voit contraint d’abandonner Naples, que les vainqueurs remplissent de meurtres, d’évacuer Rome et de venir, avec les faibles débris de son armée, se rallier à Moreau. La calomnie avait devancé son retour : ne pouvant en faire un lâche, un imbécile, elle en avait fait un traître. L’ordre est donné à Macdonald de l’arrêter, de prendre le commandement de ses troupes, et c’est lui qui effectue la réunion avec Moreau.
Macdonald est vainqueur les 17 et 18 juin ; mais le 19, battu à son tour, il perd douze mille hommes de-
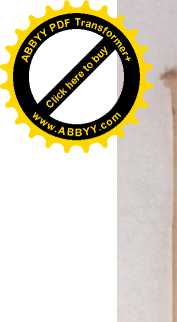
540 HISTOIRE [1799.]
vaut la Trébia. ïi franchit cette rivière et se retire sur Modène; Souvarow détruit son arrière-garde. Enfin, ce qui reste de cette armée et de celle de Schérer, opèrent leur jonction, le 29 suivant, auprès de Gênes. Joubert vient bientôt en prendre le commandement général.
La garnison de Mantoue, forte de quatre mille hommes , était assiégée par cent mille ; elle cède le 30 juillet , après quatorze jours de tranchée ouverte. Le général Latour-Foissac s’y couvre de gloire.
Pour couronner tant de désastres en Italie, vingt-cinq mille Russes, avec Souvarow, et quarante mille Autrichiens, attaquent, le 17 août, à Novi, Joubert, qui avait avec lui Pérignon, Gouvion-Saint-Cyr, Des-solles, Grouchy, Partouneaux , et qui recevait les avis de Moreau sur le point de partir pour aller prendre le commandement de l’armée du Rhin. Nous leur opposons quarante mille hommes découragés. Joubert est tué dès les premières décharges ; Moreau le remplace. combat en héros; mais, après une lutte de douze heures, la victoire passe à Souvarow, et nous laissons dix mille morts au moins sur le champ de bataille ; les ennemis en perdent autant. Nos débris courent se renfermer dans Gênes , où ils soutiendront un de ces sièges qui illustrent les annales d’un peuple.
Depuis que le vaillant Masséna avait réuni sous ses drapeaux l’armée de Jourdan et la sienne, l’archiduc Charles, victorieux de celui-là, s’était flatté de pouvoir vaincre le nouveau général, comme il avait battu le premier. Afin de parvenir à ce double résultat, il était accouru vers la Suisse, et, du 4 au 8 juin, il attaqua les Français avec une vivacité extrême : plusieurs combats où le sang coula à flots, maintinrent

M

h
N
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 3H l’archiduc dans sa supériorité momentanée. Il prit possession de Zurich; puis, tout à coup, il s’arrêta dans sa marche victorieuse, à laquelle succéda une inaction incompréhensible. Il en résulta que, malgré leur constant désavantage, les nôtres purent conserver en Suisse presque toutes leurs positions. Il est vrai que s’ils n’avaient plus Masséna, ils avaient encore Le-courbe, Soult, Ney, Molitor.
Le général en chef français occupait les lacs de 7,ug, de Lucerne, les postes sur l’Aar et sur le Rhin jusqu’il Bâle : le 14 août, il prend témérairement l’olfensive. Le succès ne répond pas à son audace ; il est repoussé par l’archiduc Charles, sans que celui-ci, à son tour, puisse empêcher Lecourbe, secondé de Compans, de s’emparer des passages du Saint-Gothard, des bords de la Reuss et des divers défilés qui communiquent des lignes des Grisons au Milanais et au Piémont D’autres troupes emportent le mont Cenis, forment des barricades, et par ce moyen maintiennent les communications avec l’armée des Alpes, nouvellement formée.
Tandis que Souvarow remportait à Novi une victoire si chèrement achetée, trente mille Russes, aux ordres de Korsakow, filaient vers Schaffouse, pour se réunir aux troupes du prince Charles, et pour exécuter le nouveau plan de campagne arrêté entre les cours impériales (je Saint-Pétersbourg et de Vienne. Trois armées devaient agir simultanément contre la France : à droite, sur le Rhin, l’armée de l’archiduc ; à gauche, en Italie, celle composée d’Autrichiens et de Russes, commandés par Mêlas et Kray ; au centre et en Suisse, une troisième, formée uniquement de Russes, opérait sous les ordres do Souvarow, tandis que vers la .Nord-Hollande, sur la presqu’île du Helder, une ar-


3« HISTOIRE U 7 99.)
mée de vingt mille Anglais débarquait, afin d’éviter a l’empereur un envoi de troupes vers ses anciens états, la Belgique et le Brabant.
L’empire croit l’instant favorable p our se joindre à son chef. Le 18 septembre , la diète de Ratisbonne, au nom de toute l’Allemagne, déclare la guerre à la France. Mais ces belles espérances tardent peu à s’évanouir. Le 15 septembre, six mille Anglais avaient débarqué au Helder, pour renforcer les vingt premiers mille. Le duc d’York, inepte généralissime, rêvait aussi des triomphes. Le 16, Brune, à la tête de vingt-cinq mille hommes, fond sur les vingt-six mille Anglais, renforcés de dix-huit mille Russes, ce qui fai ait un total de quarante-quatre mille hommes; il les surprend , les bat et les écrase complètement. L’incapacité du prince anglais, son ignorance de la stratégie, déterminèrent plus rapidement sans doute les désastres de la journée. Le 6 octobre, à Kastrican, une dernière bataille perdue acheva de ruiner la réputation de héros à laquelle prétendait S. A. R. le duc d’York; pour mieux fuir, il dut faire usage de sou meilleur cheval.
Ces affaires, bien que décisives sur ce point, étaient encore peu de chose auprès de ces batailles de géants qu’allaient se livrer pendant quatorze jours, dans les montagnes de la Suisse, les Austro-Russes et les Français. Cette sublime quinzaine commença le 25 septembre. Korsakow, pour le début, fut battu par Masséna, Oudinot et Soult, près de Zurich. Durant ces quatorze jours, le canon et l’incendie détruisirent tous les villages, les hameaux et maisons situés dans cet espace de terrain qui s’étend du Saint-Gothard à Waldshut, de la lisière de la forêt Noire et de la montagne d’Al-bis au lac de Constance : on eût pris ce pays pour

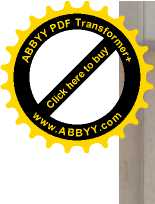
[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 345 une mer de feu. « La destructiva, a dit un auteur, fut telle, que la terre était cachée sous les débris, les cadavres et le sang. »
Masséna se multiplie ; son génie guerrier lui suggère un plan de campagne admirable. Quatre généraux autrichiens sont tués, cinq faits prisonniers; il coupe les deux armées coalisées, et les sépare si complètement, qu'elles ne peuvent se réunir qu’en arrière de Constance. Les ennemis perdent là seize mille hommes, cent canons, et presque la totalité de leurs munitions et de leurs bagages. Au reste, voici comment Mas-séna, cet enfant chéri de la victoire, rend compte de cette suite de belles actions :
< Une bataille de quinze jours , sur plus de soixante « lieues de développement, contre trois armées com-« binées, conduites par des généraux expérimentés, « la plupart environnés de grandes réputations, oc-« cupant des positions réputées inexpugnables, telles « ont été nos opérations. Trois armées battues et dis* persées, vingt mille prisonniers, plus de dix mille « morts ou blessés, cent pièces de canon, quinze dra-« peaux, tous les bagages de l’ennemi, neuf de leurs a généraux tués ou prisonniers, l’Italie et le bas Rhin « dégagés, l’Helvétie libre, le prestige de l’invinci-« bilité des Russes dissipé ; tel a été le résultat de ce « combat général. »
Souvarow, avec son nom, avait rempli l’Europe d’espoir et la France d’épouvante ; la bataille de Novi venait encore d’augmenter sa réputation ; ou s’attendait à le voir franchir nos frontières : tout à coup, on apprend que Masséna le contient, que Molitor, avec quinze cents hommes, a, pendant tout uu jour, soutenu l’attaque du Russe avec cinq mille des siens, et

_________-" ‘ ---
5ÍÍ HISTOIRE [1799.1
ne lui a pas permis d’aller rejoindre les Autrichiens à Claris.
Avant ce beau fait d’armes, Molitor avait déjà repoussé les généraux autrichiens Jellachichs et Liken, qui, avec des troupes dix fois plus nombreuses que les siennes, se portaient par le Linlh-Thal sur Claris, pour se réunir à Souvarow.
On continue à se battre tout le mois d’octobre ; Molitor, Masséna, harcèlent, tourmentent, contiennent toujours les Russes. L’orgueilleux Souvarow évacue Claris * se retire au pays des Grisons, honteux, désespéré de voir le prestige détruit; sa gloire est flétrie. il n’est plus invaincu, désormais il ne sera plus invincible.
Le 7 octobre, Gazan , vainqueur de Korsakow, s’empare de Constance ; les coalisés repassent le Rhin, et, après tant de combats livrés, ils se retrouvent aux lieux où ils étaient naguère, avant d’avoir battu Jourdan. Recourbe, moins favorisé de la fortune, commandant par intérim l’armée de Moreau, attaque les Autrichiens sur toute la ligne entre le Necker et Phi-tisbourg ; le 16 octobre, il est contraint à une retraite pénible, tandis que ce même jour, à Bosco, en Italie, Gouvion-Saint-Cyr, sans canons, sans cavalerie, bat les Autrichiens, qui avaient deux mille chevaux, un parc d’artillerie considérable, et dont le nombre était quadruple de celui des Français.
Le 18 suivant, à Alkmaar, une capitulation accordée par Brune au duc d’York, en couvrant ce dernier de honte , lui laisse la facilité de rembarquer les débris de son armée.
Tant de défaites mortifiaient les Russes : ils accusent les Autrichiens de ne pas les avoir secondés;

[1799 ] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE.
345
h
W .
bientôt la querelle s’envenime ; Souvarow refuse de reconnaître la suprématie du cabinet de Vienne, et d’obéir à l’archiduc Charles : il en réfère au czar. Paul Ier, indigné de voir son armée placée en sous-ordre , rompt avec la coalition : il ordonne à son feld-général de cesser la guerre contre la France, et de rentrer en Pologne sans délai; Souvarow ne ramena tpie trente mille hommes des quatre-vingt mille qui l’avaient accompagné; cinquante mille avaient péri sous le fer des Français, ou restaient leurs prisonniers.
Malgré les victoires de Masséna, celles de Brune et des autres généraux français, la situation de la république était précaire; un avenir sinistre menaçait la patrie, et le général Bernadotte, dans un mémoire, a présenté si clairement la triste situation de nos affaires aux approches du 18 brumaire, que je ne puis m’empêcher de le rapporter ici :
u K
« « <
«
«
a
«
K
a
« L’armée française avait été forcée d’abandonner le Mantouan, la Cisalpine et le Piémont; le matériel de son artillerie était perdu ; les remparts des places fortes de ses états, et leur armement, étaient tombés au pouvoir de l’ennemi ; l’armée, qui, deux ans auparavant, menaçait les murs de Vienne, maintenant retranchée sur les Apennins Liguriens, sans vivres, sans munitions, était consternée. L’armée de Naples devait l’aider à reprendre l’offensive. La bataille de la Trébia, perdue malgré les efforts de son chef et la valeur héroïque des soldats, la priva de cet espoir; la chaîne des Alpes était occupée par l’ennemi ; Briançon devenait une place de première ligne; une partie du département des Hautes-Alpes et du mont Blanc était insultée ; celui du Léman à la veille d’être attaqué. L’Helvétie .jusqu’à Zurich, était aux 15.

« mains des Autrichiens; ils s’étaient emparés de la « belle artillerie du camp retranché qui défendait « cette ville. Le bas Rhin était dégarni de troupes; « l’armée de Hollande n’était plus que de seize mille « hommes ; la Belgique sans défense; les places fortes i du nord dépourvues de tout approvisionnement; « nos côtes sans soldats; l’ouest recommençant sa < rébellion ; le midi tout à coup en feu, une armée « royale aussitôt levée dans la Haute-Garonne : telle « était la situation de la république...... L’arriéré de « la solde dû à plusieurs corps depuis plus de six « mois, le déoûment de toute espèce d’habillement, « d’équipement et d’armement ; les hôpitaux devenus < les asiles des soldats nus et affamés ; ces asiles transir formés en vastes tombeaux; le manque absolu de « subsistances; l’abandon de tous les services; la dé-« sertion des fournisseurs, l’épuisement du trésor pu-« blic grevé de dettes toujours croissantes, formaient « un abîme effrayant, toujours de plus en plus difficile a à combler, par la conséquence fatale de la première « impossibilité de s’acquitter. Qu’on juge si des re-« mèdes ordinaires suffisaient pour réparer des maux « tellement extraordinaires. Voilà l’état dans lequel le i Directoire avait réduit la France militaire. »
Les familles ruinées, divisées, exilées, séparées, appauvries ; les prêtres proscrits ou en fuite, prisonniers, et parfois même envoyés au supplice; le commerce anéanti, l’industrie disparue, l’agriculture fournissant à peine aux premiers besoins des riches ou des heureux; les marchands et négociants en détail et en gros forcés de faire banqueroute ou de suspendre leurs
opérations ; un agiotage effrayant remplaçant les entreprises sages, motivées, et susceptibles de succès;


[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 547 une corruption insolente, universelle, déshonorant les administrateurs et pesant péniblement sur les administrés ; des lois incertaines, folles, draconiennes, mises à exécution (celle des otages, surtout, était digne des temps néfastes du comité de Salut public. Elle avait été provoquée par Merlin de Douai, empressé d’associer son nom à tout acte de tyrannie jacobine); la Vendée se réveillant, ainsique la chouannerie ; la guerre civile agitant le reste du royaume ; des troubles, des émeutes partielles éclatant à Lille , à Lyon, à Amiens, à Bordeaux, dans les départements des Ardennes, de l’Aube, de l’Aude, du Gers, de la Haute-Garonne; tel était l’état auquel le Directoire avait réduit la France civile.
■Cette atroce loi des otages, rendue le 12 juillet, autorisait les administrateurs des départements à prendre, en qualité d’otages, les nobles et les parents d’émigrés. On déporterait hors de la république quatre de ceux-là, et leurs biens seraient confisqués, chaque fois qu’un fonctionnaire aurait été assassiné. Dans chaque département, les otages seraient solidairement responsables des amendes frappées sur l’un d’eux.
Les élections, qui renouvellent un tiers des conseils, y amènent nombre de Jacobins, peu d’honnétes gens, et force républicains modérés. On ne cesse de déporter à la Guyane des gentilshommes, des émigrés, des prêtres, des roturiers royalistes ; les directeurs, divisés, gouvernent au hasard; Barras négocie avec Louis XV1IÍ par l’entremise de Fauche-Borrel, de l’abbé David, de M. de Guérin Saint-Tropès ; il est presque d’accord du prix auquel il vendra la France. Sieyès, que l’on vient d’appeler au Directoire, conspire pour faire adopter une constitution qui lui don-

nera la suprématie pour la direction des affaires. L’argent manque dans le trésor, vidé par les vols des fonctionnaires, par les friponneries en tous genres des fournisseurs. Tout le mal que ces gens-là ont fait à la France est incalculable ; il en est dont on a oublié les rapines, et des places honorables leur ont été accordées , au lieu du pilori qui leur serait si bien dû. I. n million restait dans la caisse des législateurs, comme représentant le traitement des députés condamnés à la déportation, ou chassés. Les vainqueurs, sans honte, se partagent entre eux cette somme, véritable prix du sang; et chaque membre des deux conseils emporte environ quatorze cents francs. Le jacobinisme redevient en crédit.
Le Directoire, à la fin de l’année, est ainsi composé : Barras, Sieyès, Roger Ducos. Moulin etGohier. Moulin , général de brigade sans talents, sans renommée; (¡obier, avocat, parleur, niais, sans-culotte, larmoyant; aucun des deux n’a la moindre idée de la science du gouvernement; le portefeuille de Injustice est donné à Cambacérès, magistrat sage, habile, poli, désintéressé; Quinette reçoit celui de l’intérieur ; Robert Lindet et Tîllleyrand-Périgord sont nommés aux finances et aux relations extérieures; les ministères de la marine, de la police et de la guerre sont confiés à Pléville-Ie-Peley, à Fouché et à Bernadotte. Ce dernier avait été à Vienne en qualité d’ambassadeur; sa fermeté, sa pénétration, déplurent à ce cabinet ; il revint en France prendre le commandement d’une armée d’observation; il y resta peu; le Directoire comprenant la nécessité de confier la direction des opérations militaires à un homme d’un génie supérieur, le choisit. Bernadotte rendit à la France, à cette époque.
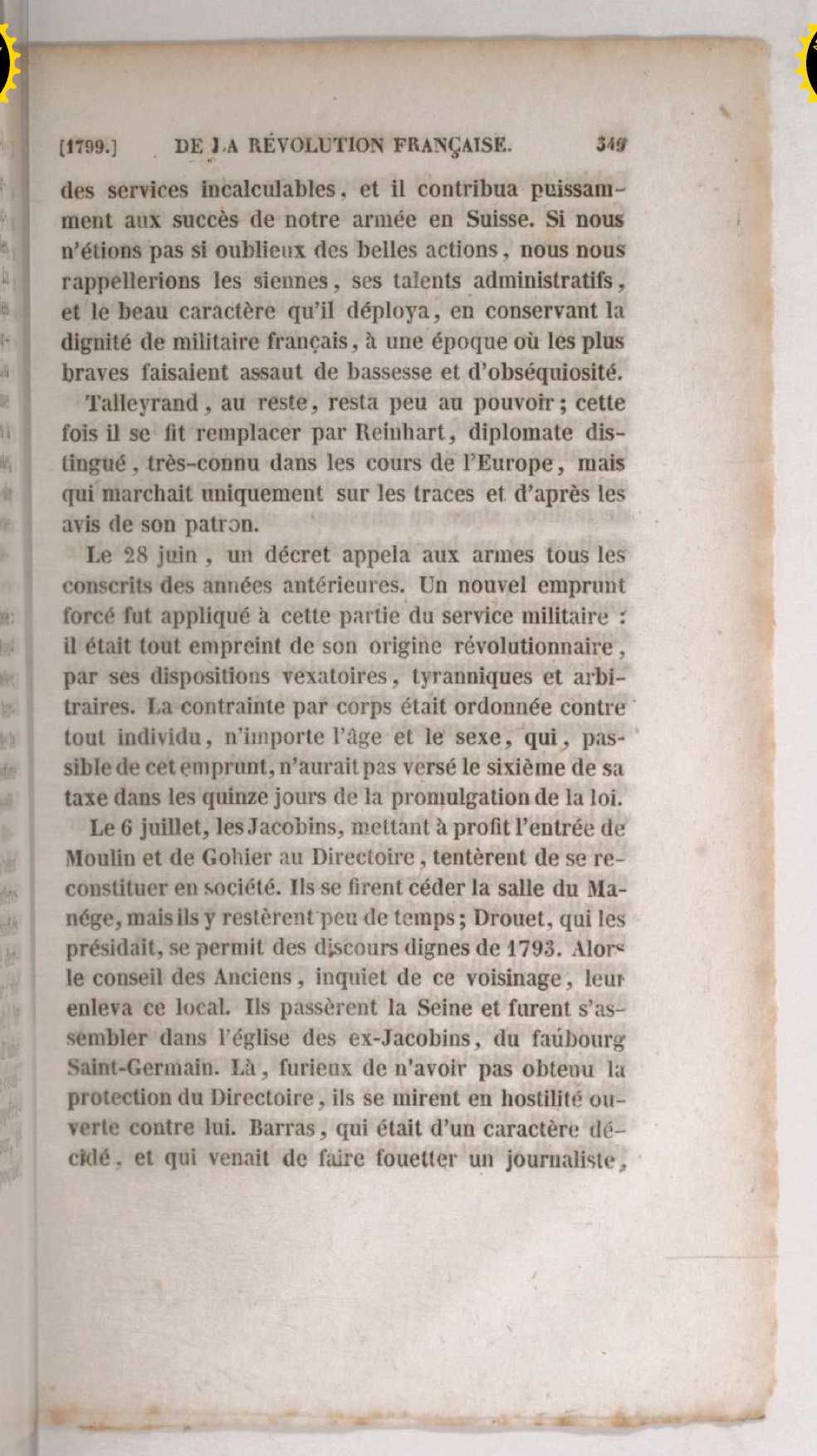
des services incalculables, et il contribua puissamment aux succès de notre armée en Suisse. Si nous n’étions pas si oublieux des belles actions, nous nous rappellerions les siennes, ses talents administratifs, et le beau caractère qu’il déploya, en conservant la dignité de militaire français, à une époque où les plus braves faisaient assaut de bassesse et d’obséquiosité.
Talleyrand, au reste, resta peu au pouvoir; cette fois il se fit remplacer par Reinhart, diplomate distingué . très-connu dans les cours de l’Europe, mais qui marchait uniquement sur les traces et d’après les avis de son patron.
Le 28 juin, un décret appela aux armes tous les conscrits des années antérieures. Un nouvel emprunt forcé fut appliqué à cette partie du service militaire : il était tout empreint de son origine révolutionnaire, par ses dispositions vexatoires, tyranniques et arbitraires. La contrainte par corps était ordonnée contre tout individu, n’importe l’âge et le sexe, qui, passible de cet emprunt, n’aurait pas versé le sixième de sa taxe dans les quinze jours de la promulgation de la loi.
Le 6 juillet, les Jacobins, mettant à profit l’entrée de Moulin et de Gohier au Directoire, tentèrent de se reconstituer en société. Ils se firent céder la salle du Manège, mais ils y restèrent peu de temps ; Drouet, qui les présidait, se permit des discours dignes de 1793. Alor* le conseil des Anciens, inquiet de ce voisinage, leur enleva ce local. Ils passèrent la Seine et furent s’assembler dans l'église des ex-Jacobins, du faubourg Saint-Germain. Là, furieux de n’avoir pas obtenu la protection du Directoire, ils se mirent en hostilité ouverte contre lui. Barras, qui était d’un caractère décidé. et qui venait de faire fouetter un journaliste.
^ I
[1799.] DE J.A RÉVOLUTION FRANÇAISE.
34»
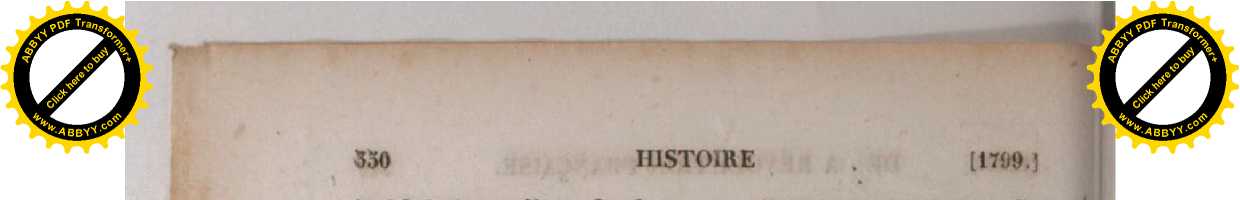
l’abbe Poncelin, fit fermer cette autre caverne de Cacus, malgré la protection de Garat, qui était alors
au conseil des Anciens, et qui depuis devint sénateur et comte. En revanche, une loi du 13 août autorisa les visites domiciliaires, et la sécurité des citoyens fut abandonnée au caprice et à la méchanceté des administrateurs.
Au midi, les agents royalistes essayaient de constituer une seconde Vendée. Parmi eux, figurait un certain abbé Roques de Montgaillard, vendu secrètement au Directoire ; c'était un petit bossu rempli de fiel et de malice, singe au physique, chat au moral; il y avait en lui un besoin irrésistible d’épancher la bile qui le dévorait. Le gouvernement, qui soupçonnait une conspiration à Toulouse, l’envoya dans celte ville. Commissionné également de Louis XVIII, cet homme était d’autant plus dangereux dans le pays, qu’il y était né, qu’il en parlait la langue, et qu’il était connu de presque tout le monde.
Les royalistes, poussés secrètement par les agents de Louis XVIII, par Dupont de Bordeaux, Dubourg de la Pouqueric, de Vaure, se déterminèrent à lever l’étendard de l’insurrection. Leur premier soin fut de chercher un militaire capable de se mettre à la tête des révoltés. Leur choix fut heureux, il tomba sur le général Bougé ; celui-ci avait vu l’ennemi de près, il savait comment il fallait s’y prendre pour le combattre avec avantage ; intrépide jusqu’à la témérité, prompt à prendre un parti, habile à l’exécuter, il abordait de front les obstacles qu’il ne pouvait tourner; le danger lui plaisait, autant que le repos aurait eu de charmes pour tant d’autres. Après avoir servi son pays avec gloire, il voulut travailler au bonheur de sa patrie en
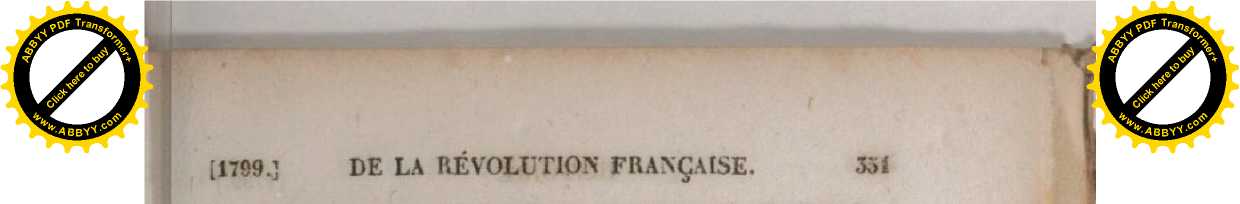
la replaçant sous le gouvernement royal. Il était en congé ou en retraite à Toulouse.
A côté de lui parut un jeune gentilhomme, à la taille gigantesque, à la ligure agréable, beau, lier, hardi, impétueux, galant auprès des dames, poli avec les hommes, mais de cette politesse cérémonieuse qui vise à la supériorité ; il avait ce courage qui regarde la mort avec indifférence, et cette témérité qui porte à la braver; c’était un vrai héros de roman. La nature, en accordant tant au comte de Paulo, lui avait refusé la sagesse, la prudence, la science surtout : léger, superliciel, sans capacité, sans prévoyance, il était soldat et non général; bon pour tenter un coup de main en enfant perdu, il ne connaissait rien à cette tactique habile qui supplée au nombre par la force des positions; il croyait qu'à la guerre tout le savoir consistait à marcher en avant et le sabre nu : avec ces qualités et ces défauts, il plaisait a une foule de gens aventureux, mieux disposés à se perdre avec lui qu’à se sauver avec un plus habile.
Les membres du conseil d’insurrection furent de Villeneuve-Beauville, le chevalier d’Auffriry, de Pa-razol, de James, de Gez, de Martin - Lacroix, de Roquemaurel, de Saint-Germain, de Boussac, de Du-faur-D’Encuns, de Calla, de Saint-Félix-la-Varenne', d’Esquirol, de Montoussin, d’Olive-Quinquiry, etc. Le comte de Caraman, ou le marquis de Bouille, devaient commander ; mais aucun des deux ne parut. Le comte de Guintrans dirigea les troupes royales du Tarn, et le baron Bougé celles de la Haute-Garonne.
Le 2 août, le comte de Vaure reçut du roi l'ordre de faire prendre les armes dans la nuit du 8 au 9. La veille, MM. de Rongé et de Paulo sortirent de la ville.

Le premier, avec douze cents hommes, attendit nuitamment le mouvement intérieur qui devait s’opérer dans Toulouse ; le projet avorta par la poltronnerie des chefs, qui, à l’heure du péril, se cachèrent. Depuis, ils prétendirent qu’avertis de la trahison de l’abbé Roques de Montgaillard, ils avaient craint d’être arrêtés en sortant de chez eux. Ce méchant homme, instruit de tous les secrets de la conjuration, la dénonça aux autorités de la ville; on l’arrêta pour la forme, puis il alla chercher à Paris le prix du sang de ses concitoyens et de sa perfidie. De Launay, aussi porteur d'un sauf-conduit du Directoire, s’évada. On n’a plus entendu parler de lui.
Malgré cette défection, Rougé ayant réuni les insurgés des cantons de Montgisard, Castanet, Mon-tastruc. Lania, et du reste de la banlieue, marcha avec environ trois mille hommes vers les coteaux de Pech. Il s’y retrancha, et, avec une si faible armée, mal approvisionnée, il attendit les républicains. Les généraux Aubugès et Comme marchèrent contre lui; ils furent repoussés, et rentrèrent honteusement dans la ville. Rougé aurait dû les suivre, mais ses ordres, mal compris, mal exécutés, ne produisirent aucun bon résultat; les républicains reprirent l’offensive, et Rougé fut battu.
A travers une suite de très-hautes collines, il fit sa retraite sur Auterive ( Ariége); là, et à Sainte-Gabelle, il fut rejoint par M. de Gilède-Preissac, suivi de beaucoup de gens du pays, et par le comte de Paulo ; celui-ci amenait un corps formé de paysans de Terre-Aqueuse , où était situé son château, que les républicains incendièrent peu de jours après. De nouveaux renforts grossirent l’armée royale ; à Saverdun.
i 1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 555 MM. d’Arlingueset Mancilles arrivèrent avec leur contingent. Madame d’Onous reçut et nourrit ces braves gens.
Dans le combat de Pamiers, cette partie de l’insurrection fut anéantie ; Rougé, abandonné des siens, courut à Muret, où l’on avait arboré le drapeau blanc. Là, des hommes arrivèrent du Gers, de la Haute-Garonne et de l’Ariége. Pendant ce temps, le chevalier d’Albys, d’Uzech, de Belloc, de Laurat, Lassalle, Bechon, Ourchein, tous chefs d’insurrection dans la (Gascogne, avaient été battus et les leurs indignement massacrés. A Montauban, les royalistes furent également malheureux.
A Lauta, la victoire des républicains fut accompagnée de crimes horribles : une demoiselle de Pui-busque dut sucer le sabre teint du sang de son père. M. d’Olive-Quinqniry, seul avec sa famille et deux domestiques,s’était retranché dans son château (commune de b Ioniens); là, il attendit une colonne ennemie , la contraignit à former le siège d’une bicoque qui ne renfermait que deux femmes, trois jeunes garçons, quelques lilles presque à la mamelle, et qui n’était défendue que par trois hommes. Le feu de ces royalistes fut si bien nourri, que les républicains ne doutèrent pas qu’un corps nombreux d’insurgés ne fût retranché derrière ces murailles de terre. A la nuit close, cette famille de héros s’évada heureusement, à la faveur des bois voisins.
Douze mille hommes campèrent à Muret. Là étaient, avec Rougé et Paulo, MM. de Martos, Dufaur d’En-cuns. et une foule d’autres personnes des premières familles de ces pays-là. *
La désunion se mit dans cette armée ; Paulo voulut
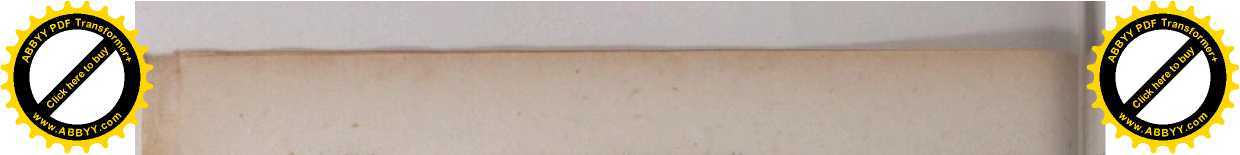
554 HISTOIRE 11799.]
commander au détriment de Bougé, et se sépara de lui. Le fol espoir de renforts envoyés par FEspagne lit prendre le chemin des Pyrénées. Les troupes du Gouvernement furent vaincues au pont de Carbonne , sur la Garonne ; à la Terrasse, où leur déroute fut complète, on leur lit neuf cents prisonniers. Rongé empêcha qu’on les mît à mort, ainsi que le demandaient les agents secrets du Directoire. Il les renvoya sur parole, se contentant de leur faire couper la queue, qui était la coiffure de ce temps-U, afin de les reconnaître s’ils reprenaient du service.
A Saint-Gaudens, l’armée royaliste lit une entrée triomphale. Là, on trouva des députés qui venaient annoncer l’insurrection des départements des Hautes et Basses-Pyrénées ; Paulo, qui de son côté avait aussi battu vigoureusement les républicains à Martres, y rejoignit le corps de Rougé. De faux bruits annoncèrent l’existence, au village de Fox, d’un corps de quinze cents émigrés , venus d’Espagne, avec armes et bagages, et soutenus par des troupes de Charles IV. Rougé, maladroitement, y courut; il n’y rencontra personne. Cette absence imprudente acheva de ruiner l’insurrection. Un seul émigré, ML de Revel, était à Fox; il suivit le général français royaliste, qui se hâta de retourner à Saint-Gaudens, où il trouva tout perdu. Les hommes sont naturellement portés à attribuer à la trahison la non-réussite d’une entreprise; nul ne lient compte de mille incidents qui viennent contrarier le plan le mieux combiné, et de tous ces hasards qui se rencontrent plus à la guerre que partout ailleurs.
A peine le baron Rougé avait-il quitté imprudemment son ai mée, qu elle fut travaillée par mille bruits
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 555 sinistres : le général en chef était parti, disait-on, pour ne plus revenir ; il emportait avec lui des sommes immenses enlevées dans le trésor commun : et cependant la caisse du payeur, restée avec les insurgés, contenait sept mille francs, qui plus tard leur furent distribués ; on ajoutait qu’il avait vendu ses camarades ; que trente raille hommes de troupes de ligne ( dans tout le Midi, du Var à l’Océan, il n’y avait pas ce nombre disponible) s’avancaient, renforcés de cinquante mille gardes nationaux ; le lendemain, les royalistes seraient cernés et tous passés au fil de l’épée.
La trahison s’en mêla; les espions semèrent la terreur et donnèrent l’exemple de la défection ; de toutes parts des compagnies entières se débandaient, et chacun prenait la fuite isolément. Le général Rougé, arrivant le lendemain de cette nuit fatale, vit qu’elle avait coûté à l’armée royale les deux tiers de ses combattants. Beaucoup d’hommes n’ont de l’énergie que dans la prospérité ; celle dont ils auraient besoin pour lutter contre le malheur leur manque presque toujours à l’heure du danger.
Le moment devenait critique; les républicains, commandés par le général Barthier-Saint-Hilaire, qui venait des Hautes-Pyrénées, par le général Comme, et par l’adjudant-général Vicose, amenant avec eux les Toulousains volontaires et fa troupe de ligue de la Haute-Garonne, s’avançaient rapidement. On eût pu les vaincre, sans la défection funeste qui avait eu lieu la nuit précédente ; maintenant il ne s’agissait plus que de tomber avec gloire.
L’aube naissait, lorsque le général Rougé apprit du comte de Paulo que les hauteurs enceignant Mon-tripence étaient occupées par les ennemis. Rougé
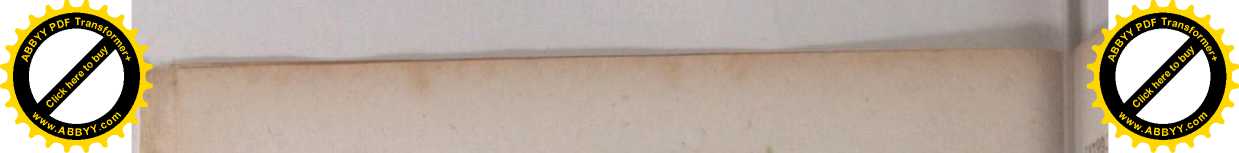
35G HISTOIRE [IÎ9!)J
courut s’assurer par lui-même de ce qui le menaçait* Un seul regard lui montra le péril, qui l’étonna sans le troubler ; mais ce fut avec une douleur amère qu’il s’aperçut qu’au mépris de ses ordres antérieurs, le comte de Paulo, trop étranger à la science stratégique, avait fait abandonner par les royalistes les positions inexpugnables des coteaux voisins. Les républicains, profitant de cette faute, s’en étaient emparés et les avaient garnies d’une nombreuse artillerie, avec laquelle ils foudroyaient la plaine.
L’impéritie est souvent plus funeste que la trahison* La générale retentissait sur toute la ligne royale, malgré le feu terrible des républicains. La petite armée royale se porta intrépidement, et avec rapidité, en avant, au cri sacré de vive le roi! Le comte Jules de Paulo commandait le centre; la droite obéissait à MM. de Galbas et de Tourreil, et la gauche à M. Pai-gnon. bougé s’était chargé du commandement de la réserve*
Les républicains, non moins braves, plus nombreux, mieux armés, et bien disciplinés, honteux d’être prévenus, chargèrent en poussant d’horribles cris, mêlés de blasphèmes; tout leur effort se porta sur l’aile gauche des royalistes. La supériorité des masses fit plier le courage des soldats du roi. M. Paignon, malgré des efforts incroyables de courage et d’habileté militaire, perdit du terrain, et sa déroute rendit inutiles les succès de la droite et du centre, où, après un instant d’incertitude, la victoire s’était rangée du côté du drapeau blanc.
I .e général Rongé, à l’aspect de ce revers , accourt avec sa réserve, joint l’ennemi corps à corps, le surprend , le jette dans l’incertitude.... mais de nouveaux


[1799.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 357 bataillons descendent des rochers voisins ; l'artillerie, si habilement placée. vomit une grêle de mitraille et de boulets. La gauche des royalistes est vaincue; elle recule sans se rompre, en disputant le terrain pied à pied ; peut-être pouvait-on regagner le terrain perdu , mais les deux autres corps se sont aperçus de cette retraite, une terreur panique les saisit, des perfides s’écrient qu’on est enveloppé, le cri désorganisateur sauve gui peut! se fait entendre.... et le dernier espoir des royalistes disparait; l’aile droite et le centre, au lieu de secourir la gauche et la réserve, engagées si malencontreusement, se dispersent, plient à leur tour sur tous les points, se rompent, et l’armée royale est dissoute. Le comte de Paulo perdit la tête : il ne sut qu’être soldat, (pie marcher en avant; et hors d’état de pouvoir trouver une de ces inspirations soudaines qui illuminent les grands capitaines, et qui souvent font éclore la victoire du sein même d’un revers, il partagea la déroute des siens, parce qu’il n’avait pas su leur apprendre à saisir le succès.
Les accidents du terrain, tout hérissé de rochers, de petits vallons, aidèrent à la défaite. Rongé tenta en vain de la rendre moins désastreuse; ses efforts infructueux ne firent que retarder le triomphe des ennemis, a Jamais, m’a-t-il écrit, on ne vit confusion pareille; ce fut un sauve qui peut général. Cinq cents royalistes restèrent morts sur le champ de bataille; un nombre pareil de blessés eussent pu être rappelés à la vie, mais le vainqueur, d’autant plus féroce qu’il combattait des concitoyens, les égorgea jusqu’au dernier. » (Lettre autographe. )
Cependant le général Rongé, consterné, mais sans perdre son énergie, se relira, emmenant avec lui le,
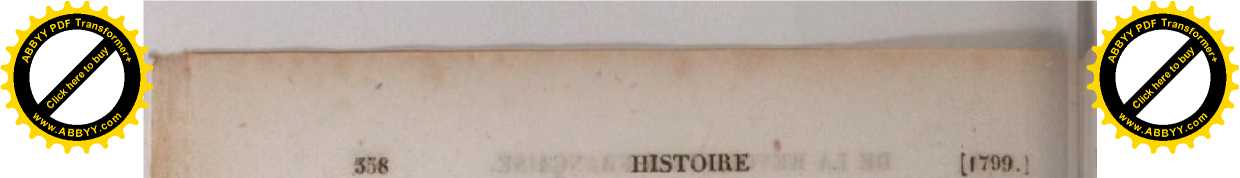
comte de Paulo et environ deux cents des siens : à marche forcée il gagna la frontière d’Espagne, bien qu’il sût l’accueil indigne qu’on lui réservait. L’odieux Godoy avait fait rendre par Charles IV un rescrit royal qui enjoignait aux autorités espagnoles de livrer à la République française tous les insurgés qui franchiraient les Pyrénées. Cet ordre abominable, et que le Ciel a sans doute puni par tous les maux qui depuis celte époque pèsent sur la branche des Bourbons établie en Espagne, fut exécuté par quelques alcades, mais le plus grand nombre le repoussa avec indignation.
Les deux cents royalistes étant parvenus au premier village espagnol, le général Bougé leur distribua les sept mille francs du trésor de l’armée, en ayant égard . m’a-t-il écrit, à la position sociale et aux besoins de chacun. Cette faible somme s’étant trouvée insuffisante , il tira de sa bourse particulière soixante louis, qu’il distribua aux derniers de ses compagnons d’infortune, et lui, avec vingt louis pour toute ressource, gagna l’Aragon. Après cela chacun tirade son côté (1).
(t) Le général Bougé, bien accueilli dans les cours d'Espagne et de Portugal, passa en Angleterre, où il fut présenté A Louis XVIII et à Monsieur. Ces princes l'autorisèrent A rentrer en France après 1800; il ne fut pas employé. Rentré dans son grade en 1814, il contraignit l'année suivante, au mois de juillet, le lieutenant-général • Decaen A quitter Toulouse. Le baron Bougé alla commander à Marseille; il est mort il y a peu de temps. Il était officier de la Lé-gion-d'Honueur et chevalier de Saint-Louis.
Le comte Jules de Paulo alla aussi en Espagne et en Angleterre, où il vit le roi de France, et son auguste famille. Rentré en France en 1802 , il mourut d'une affection de poitrine en 1805.
M. de Tourreil, d'ancienne et noble famille, descendait du célèbre Tourreil, traducteur de Démosthène, membre de l’Académie frau-faise, et de Tourreil, procureur-général au parlement de Toulouse.
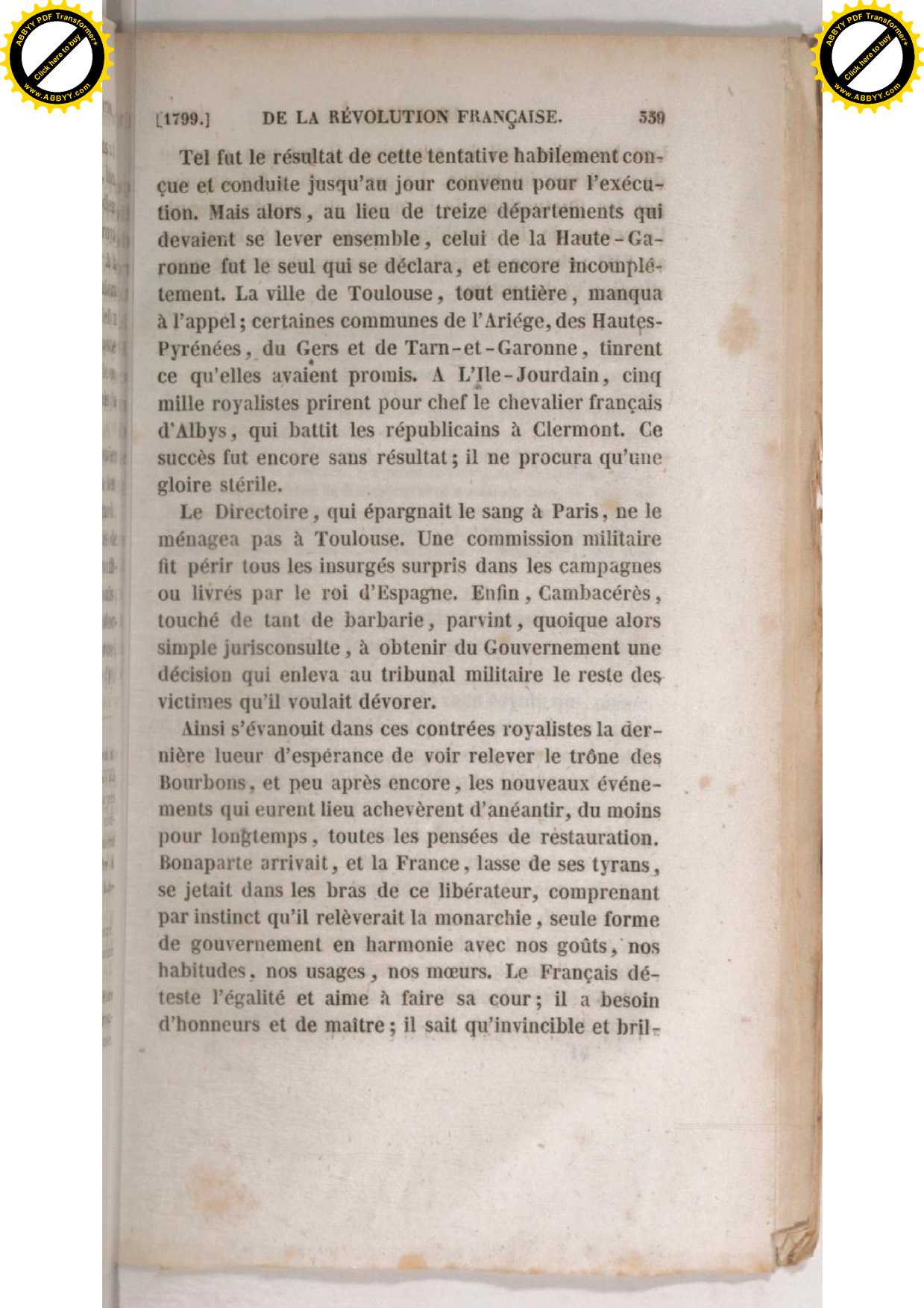
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 559
Tel fut le résultat de cette tentative habilement conçue et conduite jusqu’au jour convenu pour l’exécution. Mais alors, au lieu de treize départements qui devaient se lever ensemble, celui de la Haute-Garonne fut le seul qui se déclara, et encore incomplètement. La ville de Toulouse, tout entière, manqua à l’appel; certaines communes de l’Ariége,dcs Hautes-Pyrénées, du Gers et de Tarn-et-Garonne, tinrent ce qu'elles avaient promis. A L’Ile-Jourdain, cinq mille royalistes prirent pour chef le chevalier français d’Albys, qui battit les républicains à Clermont. Ce succès fut encore sans résultat ; il ne procura qu’une gloire stérile.
Le Directoire, qui épargnait le sang à Paris, ne le ménagea pas à Toulouse. Une commission militaire lit périr tous les insurgés surpris dans les campagnes ou livrés par le roi d’Espagne. Enfin, Cambacérès, touché de tant de barbarie, parvint, quoique alors simple jurisconsulte, à obtenir du Gouvernement une décision qui enleva au tribunal militaire le reste des victimes qu’il voulait dévorer.
Ainsi s’évanouit dans ces contrées royalistes la dernière lueur d’espérance de voir relever le trône des Bourbons. et peu après encore, les nouveaux événements (jui eurent lieu achevèrent d’anéantir, du moins pour longtemps, toutes les pensées de restauration. Bonaparte arrivait, et la France, lasse de ses tyrans, se jetait dans les bras de ce libérateur, comprenant par instinct qu’il relèverait la monarchie, seule forme de gouvernement en harmonie avec nos goûts, nos habitudes, nos usages, nos mœurs. Le Français déteste l’égalité et aime il faire sa cour; il a besoin d’honneurs et de maître; il sait qu’invincible et bril-
4*M
^■J
^l
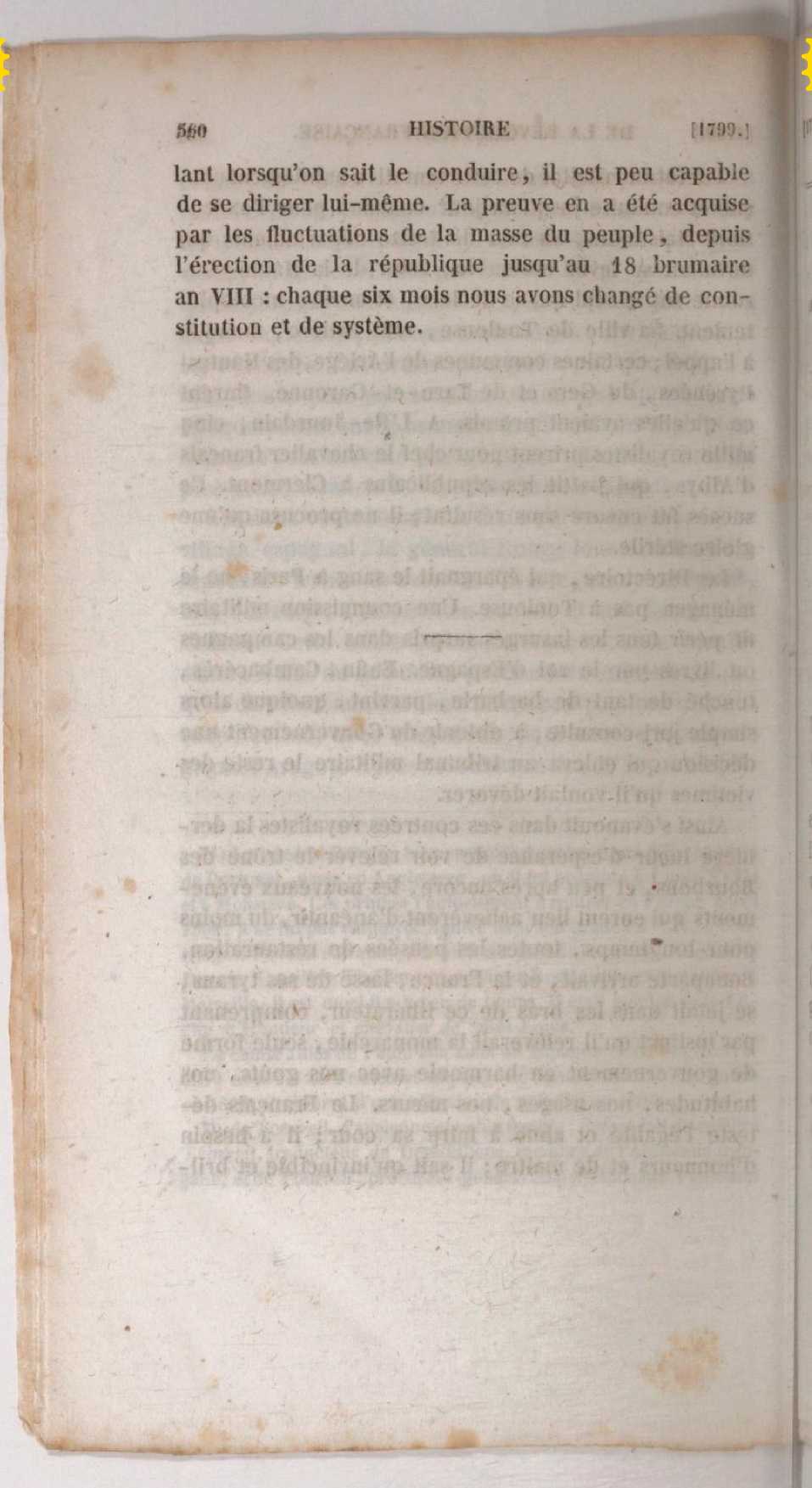
' > *’ in fi > »? oí
HISTOIRE
[1799.’
lant lorsqu’on sait le conduire, il est peu capable de se diriger lui-même. La preuve en a été acquise par les fluctuations de la niasse du peuple, depuis l’érection de la république jusqu’au 18 brumaire an VIII : chaque six mois nous avons changé de constitution et de système.

[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
561

Antiquité et grandeur de la maison royale de France. — Retour de la France à des idées sages. — La République est délestée. — Les parti» veulent un chef. — La force des choses décide en faveur de Bonaparte. — Situation des affaires à l’approche de son retour. — Projets de Barras et de Sieyès. — Bernadotte refuse de s’entendre avec ce dernier. — Moreau ne sait accepter ni refuser. — Détails de la traversée de Bonaparte. — 11 est reçu avec transport à Fréjus et à Lyon. — Projet de l'assassiner pendant la route. — Effet que produit sou arrivée à Paris. — Situation respective des directeurs et du héros. — Sa première réception au Directoire. — Barras et Sieyès intriguent. — Bonaparte repousse le premier. — Fouché et Talleyrand se rallient à lui. — Conversation curieuse de Bonaparte avec un de ses amis. — Visite solennelle au Luxembourg. — Tous les hommes célèbres font la cour à Bonaparte. — Bernadotte. — Moreau. — Jourdan. — Intrigues multipliées. — Réal. — Rœderer. — Thibaudcau. — Bonaparte rompt avec Barras, et traite avec Sieyès.
Les cabinets européens avaient, dans le principe, laissé la révolution française suivre son cours destructeur.
Tous jalousaient cette grande race royale qui, même en ne remontant qu’à Robert le Fort, avait donné, dans l’espace de huit cents ans, trente-cinq rois de France, quatre empereurs de Constantinople (la branche des Courtenay ), quatorze rois ou reines de Navarre ( branche d’Évreux), onze rois et deux reines de Naples (branche d’Anjou), cinq rois et une reine de Hongrie’, un roi et une reine de Pologne ( tous sortis des deux branches d’Anjou), vingt-deux rois de Portugal ( branche de Bourgogne), un roi de Pologne (branche deuxième de Valois), ciuq rois d’Espagne (branche deuxième d’Anjou ), deux rois de Naples et de Sicile, un roi d’Angleterre (Louis VIII), deux rois d’Étrurie n. 16

562
HISTOIRE
( branche de Parme), un roi d’Écosse (François II) de plus, quatorze ducs de Bourgogne, issus d’Henri Ier cinq ducs et duchesses venus des deux fils du roi Jean ; treize ducs de Bretagne (branche d’Évreux) : ce qui, en y joignant les trente-cinq rois de la première race, ou branche aînée, les treize de la seconde, les sept empereurs d’Allemagne, les trois rois d’Aquitaine, les six rois de Bourgogne, les neuf comtes de Provence, les cinq de Flandre, le comte de Toulouse ( Alphonse); en y joignant encore les souverains de France. d’Espagne, de Portugal, de Naples, d’Étru-rie, qui ont régné depuis Louis XVI, donne l’énorme chiffre de deux cent trente-sept tètes couronnées ; et si maintenant on y joignait les empereurs du Brésil, les rois de Navarre, d’Aragon, etc., les ducs d’Aquitaine , et en un mot tous les souverains mérovingiens, les ducs d’Anjou, de Bourbon , les comtes d’Évreux, de Vendôme, de Champagne, etc., tous descendus de la troisième race, on porterait ce chiffre, déjà si élevé, bien au delà de trois cents (1).
Une telle grandeur, une majesté si supérieure, et auprès de laquelle toutes les autres disparaissaient, avaient inspiré une telle envie, que l’on ferma les yeux sur le danger des principes révolutionnaires, pour ne
[1799.]

!
(I) Ne comptant pas les branches de Portugal et plusieurs autres, je trouve environ quinze hiles de France , impératrices de Constantinople, d’Allemagne, etc., et quatre-vingts reines en Europe. Je ne cile point les duchesses de Bavière, de Lorraine, de Bourgogne, de Hollande, qui, certes, pouvaient marcher de pair avec des reines. Quelle maison! où trouver sa pareille sur le globe! Et puis on ose lui comparer d'ubscurs souverains sans territoire, sans puissance , et sans véritable antiquité.

[1709.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 5 ¡5 voir que l’abaissement de cette auguste race, si colossale dans son illustration.
Mais la marche terrible des événements avait fait surgir, du sein des ruines et des flots de sang, un autre ordre de choses. Ce n’était pas la puissance du roi de France qui venait d’être affaiblie, mais la royauté elle-même qui avait péri. Les peuples n’en voulaient plus aux abus, mais aux principes; le clergé, la noblesse, la magistrature, l’administration, tout périssait à la fois, tout au moins était menacé en même temps.
L’Europe, donc, avait compris la faute qu’elle avait commise, lorsqu’elle avait si mal organisé sa première coalition. La seconde, formée avec plus d’intelligence, n’avait pu vaincre les Français, dont l’énergie et le courage, grandissant avec les périls, les avaient fait triompher des efforts de tous les potentats réunis.
Alors, les souverains étonnés, épouvantés, s’entre-regardèrent : ils comprirent que la France constituée en république les renverserait tôt ou tard ; et de concert, quoiqu’en secret, ils préparèrent les esprits au retour de la monarchie, espérant un meilleur avenir plutôt d’un roi intéressé comme eux à repousser les maximes subversives de l’ordre public, que du concours d’une république essentiellement turbulente et

désorganisatrice.
Mais, tandis qu’ils agissaient dans ce sens, la France, entraînée par des idées fausses de philosophie, de liberté sans règle, d’égalité extravagante, s’était lancée hors de son cercle, et avait répudié tous ses antécédents. Elle se trouvait sans religion, elle foncièrement pieuse ; sans trône, elle fière de son trône de quatorze cents ans ; sans constitution, tant on lui en avait
■TH HISTOIRE [1799.]
improvisé de toutes les espèces, au détriment de celle si antique, si imprescriptible, à laquelle elle avait <lù son bonheur et sa prospérité pendant tant de siècles; sans lois, car on avait commencé par abolir celles qui la régissaient, et qui étaient le fruit de la sagesse et de l’expérience, et on n’avait encore décrété que des arrêts de sang; sans magistrature, elle qui dans ses parlements possédait d’une manière si complète ce que les tribuns, à Rome, ne procuraient au peuple qu’en ébranlant l’État; sans mœurs enfin, car l’anarchie ne peut conduire qu’à la débauche ; sans agriculture, les propriétaires étant ou morís, ou fugitifs , ou en prison ; sans commerce, à raison du maximum et de la terreur; sans industrie, car tous les bras étaient appelés aux armes. Enfin , lasse de cette indépendance, dégénérée en tyrannie sanglante, de cette égalité qui la livrait à l’arbitraire des proconsuls et au glaive des assassins ; décimée par l’échafaud, pillée par les armées révolutionnaires, voyant ses plus belles villes détruites ou incendiées, elle envisageait avec horreur la situation déplorable dans laquelle la Révolution l’avait précipitée.
Tombée dans cet épouvantable état, la France en était venue à détester ses illusions, ses folies, ses erreurs; elle ne voulait plus de ces démagogues insensés ou féroces, elle dont les usages étaient si doux, si sociaux; il lui fallait renoncer aux fêtes, aux bals, aux jeux, aux représentations scéniques ; plus de cercles, de réunion, de société; la prison suivait la dénonciation , et le supplice vous attendait à la sortie du cachot. Un tel état devenait tous les jours plus insupportable : la nation voulait en finir avec la république. En 1795,ses mandataires, comprenant un désir qu’ils

[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 365 partageaient, tuèrent la révolution et ramenèrent la monarchie, par la constitution de l’an III (1795).
La république, née pour le malheur commun le 21 septembre 1792, cessa d’exister, à la satisfaction générale, le 21 septembre 1795, après une durée de trois ans, qui parurent trois siècles. La constitution nouvelle, si elle ne fut pas monarchique, prépara du moins le retour de la monarchie. Elle fut une véritable transition, un gouvernement provisoire : l'unité royale, que l’on n’osa pas encore proclamer, fut simulée par la nomination de cinq directeurs, véritables fractions de souverains, qui à eux cinq réunis représentaient le roi; les deux conseils remplacèrent les vieux états généraux et les parlements, et ce fut par ce moyen que l’on arriva au mieux que chacun désirait.
En effet, dès ce moment, on vit clairement que les partis travaillaient à établir, non une autre forme de république, mais une royauté complète ; les uns cherchaient à ramener le prince légitime, et ils avaient raison, car là où le chef n’est pas légitime, la guerre civile est flagrante : elle peut naître d’un moment à l’autre. Avec la seule légitimité, le principe révolutionnaire : L'insurrection est le plus saint des devoirs, est un crime. En dehors d’elle, il devient un droit sacré, inviolable, imprescriptible.
D'autres proposaient timidement le duc d’Orléans; mais les Parisiens n’avaient pas encore oublié les crimes de son père ; quelques - uns parlaient du duc de Brunswick; on alla même jusqu’à présenter je ne sais quel misérable, tout couvert de boue et de sang. Un grand nombre appelait tour à tour les généraux Ber-nadotte, Moreau, Boraparte; on allait jusqu’à regretter l’emprisonnement de Lafayette. Tous, crai-
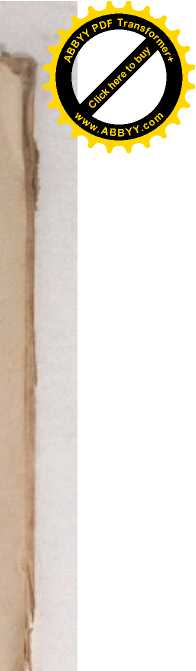
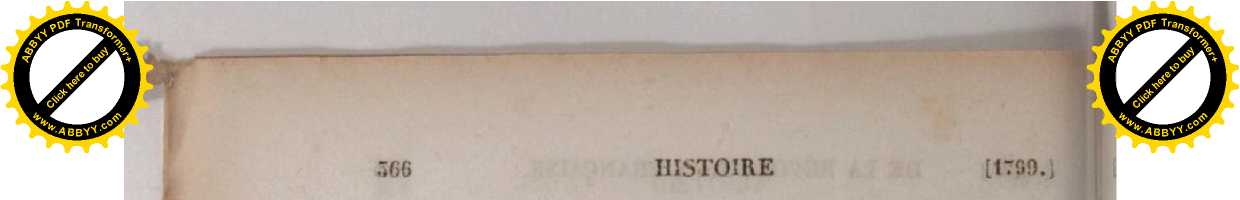
gnani le pouvoir royal, se seraient accommodés d’une
monarchie déguisée sous un titre plus modeste; mais dans ce conflit, et comme dit Lucien, de Caron pas un mot, c’est-à-dire de la république ; les seuls qui la voulussent alors ne se composaient que des débris des bandes de Marat, de Danton, de Robespierre; à cette époque, un honnête homme se serait cru déshonoré si on l’eût appelé républicain ; tous avaient vu les résultats de l’établissement de la République, et ils frémissaient à la seule idée que son retour fût possible.
Mais ce qui, vers la fin du dix-huitième siècle, ramena d’une manière plus complète les esprits vers la monarchie, ce fut l’immoralité, la basse cupidité, ia lâcheté du Directoire. Les hommes qui le composaient, montés au rang des rois, n’avaient pu renoncer à leur jacobinisme. Sans-culottes affublés d’un man- , teau royal, ils savaient mieux punir, piller, désorganiser, que s’élever à la hauteur de leur place. On ne fait pas un roi en disant au premier venu, tu es roi; il faut que celui qui arrive au pouvoir offre, sinon l'illustration de la famille, du moins une vie honorable, glorieuse, admirée, sans tache; que le génie, le courage , l’abstinence des passions viles, commandent pour lui le respect qui naît de l’estime et de la vénération. Jamais Marat, Robespierre, Couthon, Lebon, Carrière, Babœuf, Fieschi, n’auraient pu être rois ni gouverner; mais on Ht roi Charles Martel, Pépin, Raoul, Eudes, Hugues-Capet; et de nos jours Berna-dotte, le prince Eugène Napoléon, le furent ou l’auraient été, parce qu’il y avait en eux ce qu’il faut pour éblouir, entraîner l’opinion, et maintenir le pouvoir acquis.
Or, rien dans Letourneur, Rewbell, Laréveillère,

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
567
Merlin de Douai, Gohier, Sieyès, Roger-Ducos, Treil-hard, etc., ne faisait naître en leur faveur une pensée de royauté; le seul Barras fit illusion un moment, car il passait pour bon militaire, et il avait mis l’épée à la main au 9 thermidor et au 13 vendémiaire ; mais tant de vices et de turpitudes le déshonoraient, que cette idée ne fut qu’éphémère, et qu’elle disparut sans retour à l’arrivée de Bonaparte.
Ainsi, vers la lin de 1799, la France, dégoûtée à tout jamais dé ta république, avait trouvé assez de douceur dans le gouvernement transitoire du Directoire, pour mieux sentir le besoin de la royauté, tandis que , d’une autre part, la conduite des directeurs l’avait convaincue de rinsuflisance d’un simulacre de monarchie. Les fauteuils des cinq directeurs ne suifi-saient pas; il était prouvé qu’il fallait les échanger contre un trône unique. Mais qui appellerait-on à régner sur la France? qui en serait digne? Chacun se faisait cette question, lorsque Bonaparte débarqua. La France entière prouva par son allégresse et ses acclamations que c’était lui qu’elle attendait.
Ce fut donc la force des choses qui fit arriver Bonaparte au pouvoir suprême, haine de la tyrannie jacobine, amour de la monarchie, nécessité de reconstituer l’état dans les lois, les mœurs, les institutions, l’agriculture, le commerce, l’industrie, les finances, les arts, les belles-lettres et les scieuces. La conviction que des hommes sortis des rangs de la nation sont incapables de régner, l’expérience qu’on en avait faite pendant quatre années, tout prouvait que pour acquérir de la stabilité, il faut à un roi des vertus, des talents, une réputation brillante, et l’amour des majorités. Or, eu 1799, la chute des Bourbons était trop


568 HISTOIRE (1799 ] récente pour qu’on ne craignit pas le retour et les vengeances de ces Bourbons si méconnus. Nul en Europe ne pouvait donc les remplacer, que celui qui réunissait la noblesse de la gloire à celle du génie.
J’ai cru, avant de raconter la nouvelle révolution qui s’opéra le 18 brumaire de l’an VIII, qu’il convenait de présenter dans un cadre resserré l’ensemble de la trame ourdie pour amener, quatre ans auparavant, les Français à donner la première place à un hemme obscur; j’ai prouvé : 1° que la France, essentiellement monarchiste, n’avait accepté la république que par surprise et par terreur; 2° qu’après un esclavage de trois ans elle avait été si dégoûtée de son essai funeste, qu’elle avait secoué le joug des anarchistes et reconstruit les fondements de la monarchie; 3“ que les cinq directeurs, n’étant que des hommes sortis des rangs de la nation, avaient ployé sous le faix de la cou-tonne, et que leur incapacité avait bien appris aux Français qu’un pareil gouvernement ne pouvait assurer le repos et la prospérité de notre patrie ; que pour obtenir ce résultat, il fallait un souverain unique, et digne de cette haute position ; 4“ que le conflit des prétendants n’avait fait que retarder la détermination ; 5° que, d’une part, les circonstances s’opposant au retour des Bourbons, et que, de l’autre , la France étant lasse d’attendre, tout faisait préjuger que pour sortir de cette situation précaire, elle prendrait le premier héros qui s’offrirait à son choix ; 6° que Bonaparte s’étant présenté avec sa réputation immense . les Français, à la seule nouvelle de son débarquement, s’étaient réunis dans la pensée unanime que lui seul était capable de tenir d’une main ferme les rênes de l’État.

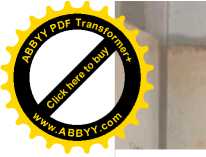
[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
589
ll^|
■^
•H-
<®
Par toutes ces causes, il advint que Napoléon Bonaparte, débarquant à Fréjus le 9 octobre comme simple particulier, fut, trente jours après (le 9 novembre 1799, soit 18 brumaire an VIII), appelé à gouverner la France, sans contestation, sans guerre civile, que sa présence, au contraire, éteignit sans retour.
A la fin de cette année, qui vit finir le règne du Directoire, la France, menacée par la seconde coalition , avait été à la veille de subir l’envahissement de son territoire par Souvarow ; mais les efforts héroïques de Masséna et d une foule de grands généraux avaient repoussé hors de la Suisse les armées alliées. La mésintelligence ayant dissous la coalition, et l’empereur de Russie, Paul F‘, retirant ses troupes, le péril avait diminué d’imminence, sans cependant être dissipé, puisque l’empereur d’Allemagne augmentait son matériel, se disposait à pénétrer au cœur de la République, et prétendait lui dicter la loi.
Ainsi que je l’ai déjà dit, la discorde étendait sa cruelle influence sur toutes les parties de la France, en proie à la misère, à la famine, à la dévastation, à l’agiotage. Le 18 fructidor avait porté l’irritation à son comble. Le Midi, agité par l’insurrection de Toulouse, comptait de nombreuses victimes, dont la mort avait été le résultat de l’infâme trahison de l’abbé Roques de Montgaillard, qui jouait dans la France le rôle que l’un de ses frères remplissait au dehors. Partout on haïssait, on détestait le Directoire, et les yeux se tournaient vers l’Égypte, comme si c’était de ce seul lieu que l’on dût attendre un sauveur.
Au moment où la presque totalité des citoyens souhaitait la chute du Directoire, la majorité des directeurs cherchait à sc maintenir au pouvoir ; deux d’entre
16.
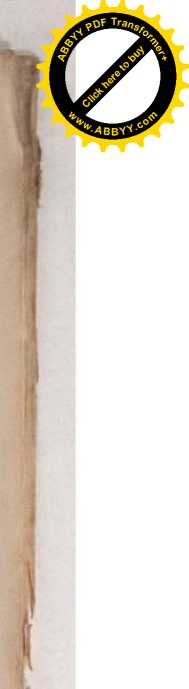

570
HISTOIRE
eux auraient accepté le concours des hommes forts ( les jacobins ). Barras traitait de nouveau avec Louis XVIil, par l’intermédiaire du chevalier Guérin •le Saint-Tropès et de Fauche-Borel. Sieyès, tout plein de sa propre importance, se flattait de faire accepter son dernier projet de constitution. D’après ce projet, deux consuls, l’un de la paix et l’autre de la (pierre, seraient investis du pouvoir exécutif; un grand-èleaeur, doté de six millions de rente et du château de Versailles, aurait pour toute fonction celle de proclamer les consuls et de les désigner â l’absorption du sénat. Ce dernier corps, composé de sommités largement rétribuées, ferait les lois, que le grand-électeur promulguerait ; et lorsque le grand-électeur ou les consuls acquerraient une prépondérance dangereuse pour la durée ou pour la liberté de la République, le sénat, de son plein pouvoir, paralyserait son influence inquiétante en appelant dans son sein le fonctionnaire dont l’ambition menacerait la constitution de l’État : par ce moyen, le grand-électeur, les consuls et autres personnages dont l’ambition inspirerait des craintes, perdraient leur omnipotence, et, confondus parmi les sénateurs, deviendraient les égaux de leurs pairs.
Cette complication ridicule, qui mettait en évidence l’égoïsme de l’auteur, devait tomber à la première lutte. Sieyès ne le présumait pas; il travaillait à la mettre à exécution, et pour cela il ne lui fallait qu’un sabre. Il désignait ainsi le militaire en réputation auquel il destinait la place de consul de la guerre ; il le cherchait. Joubert lui avait plu un instant; il tarda peu à le redouter ; d’ailleurs la mort de ce général rompit ses vues sur lui.

[Í7V9.]
[1799.J DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 571
Sieyès alors s’adressa au général Bernadette, le plus célèbre après Bonaparte. Ce guerrier, que les intrigues de Barras venaient de chasser du ministère de la guerre,'répliqua vivement que, soldat de la République, il la servirait toujours et ne la trahirait jamais. — Eh bien, repartit l’abbé directeur, vous la servirez sous les ordres d’un de vos collègues. — Je plaindrai celui qui sacrifiera sa gloire à son ambition, répondit Bernadotte.
L’entretien en resta là. Sieyès, sans se rebuter, courut à Moreau. Celui-ci, depuis longtemps, rêvait la puissance souveraine, bien que son désir l’épouvantât; cet homme, d’une fermeté admirable sur le champ de bataille, ne conservait plus aucune énergie quand il rentrait dans la vie civile ; envieux de la couronne, mais incapable de la saisir, son destin le condamnait à n’occuper que la seconde place, d’où, comme un autre Tantale, il passerait ses jours à souhaiter la première. Avocat avant d’être général, il était arrivé dans les camps avec cette finesse maladroite, cette taquinerie, ces petits moyens, cette jactance de sa première profession; I dominé par sa femme, et surtout par sa belle-mère , ce conspirateur honteux n’apportait dans ses projets ambitieux rien de celte grandeur et de cette audace qui les parent et les justifient en quelque sorte. Plutôt Sinon que Catilina, on le vit trahir Pichegru aussitôt que celui-ci eut été abandonné de la victoire : par cette lâcheté maladroite il indigna les vrais patriotes , et se rendit ridicule aux yeux des intrigants. On le verra bientôt servir Bonaparte, et, tout en versant des larmes de rage, s’avifir en acceptant les fonctions honteuses de geôlier du Directoire. Dès
♦U. 24*


372
HISTOIRE
[1799.!
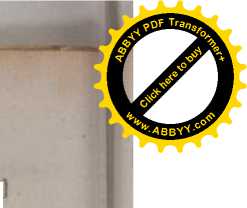
ce jour, il perdit toute l’iníluence dont il jouissait; stigmatisé par l’adresse de Bonaparte, il ne fut plus pouf lui qu’un enfant de mauvaise humeur ; il conspira secrètement contre lui ; mais ses projets furent découverts, et il ne parvint à sauver sa vie qu’en perdant sa gloire. En 1812, trahissant ouvertement son pays, on le vit reparaître sans renommée devant ses compagnons, qui tous avaient grandi de réputation. Il ne rapportait que la jalousie que lui inspirait la grandeur de Bonaparte; et, pour satisfaire cette basse passion, il venait tenter la perte de sa patrie. La Providence, qui se préparait à le punir, ne lui accorda pas l’indigne joie de voir tomber sous les efforts de l’Europe armée contre nous l’homme qu’il avait jalousé sans cesse, au lieu de tenter de l’égaler par des efforts généreux.
Moreau avait trop d’astuce pour répondre franchement à la proposition de Sieyès ; sa réponse fut pleine de réticences, d’hésitation; il dissimula, refusa, sans ôter complètement l’espoir qu’il finirait par accepter ; il ajourna la question, comme si, pour s’emparer d’un trône, on a le choix de l’heure, on peut maîtriser les événements : il n’avait dit ni oui ni non. Sieyès, dès lors, fut persuadé qu’il accepterait; il fit ses dispositions en conséquence, lorsque tout à coup retentit dans Paris la nouvelle que Bonaparte était débarqué à Fréjus.
Ce héros, conduit par la fortune, était parti d’Égypte, amenant avec lui deux frégates, le Muiron et la Carrère, et les chebecs l'Avance et la Fortune. Il traversa la Méditerranée sans rencontrer les Anglais ; lui-même avait tracé au contre-amiral la route à suivre, en ajoutant :

(1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 575

« Je veux que vous longiez la côle d’Afrique, le plus près possible des rivages de la Méditerranée ; vous suivrez cette route jusques au sud de la Sardaigne. J'ai là une poignée de braves, j'ai un peu d’artillerie ; si les Anglais se présentent, je m’échouerai sur le sable, je gagnerai par terre, avec mes troupes. Oran et Tunis, et là je trouverai les moyens de me rembarquer. »
Pendant vingt-un jours, des vents contraires le retinrent à cent lieues de l’Égypte ; enfin, le temps changea, les voiles furent tournées vers la France, la mer rapidement sillonnée, et on tarda peu à signaler les montagnes de la Sardaigne ; alors un grain survint, qui contraignit la flottille à mouiller sur les côtes de Corse , au port d’Ajaccio. La Providence voulait que Bonaparte revît la maison modeste de ses pères, et qu’il ne quittât cette humble demeure que pour aller dormir dans le palais de nos rois, devenu le sien.
Le 7, le temps fut favorable; on se remit en mer : vers le soir, quatorze vaisseaux anglais apparurent à l’horizon. Gantheaume, qui commandait la flottille, s’effraya ; il proposa de rentrer dans le port. — Non, dit Bonaparte, allons en avant; mon étoile ne pâlira pas. Comme beaucoup de grands hommes, il était superstitieux ; il croyait son destin lié à la marche mystérieuse d’un des astres du ciel : c’était l’étoile de l’angle gauche du grand char (Mémoires inédits d’Ozun}.
Gantheaume obéit. Dieu, qui avait ses desseins, déroba la vue de notre escadrille à la flotte anglaise, qui ne l’aperçut pas. Le 9 octobre, elle entra comme en triomphe, à huit heures du matin, dans la rade de Saint-Rapheau, non loin de Fréjus.
Les habitants, qui venaient de voir filer dans leurs eaux la flotte d’Angleterre, crurent que les quatre

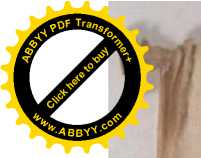
574
MISTOME
[1793.]

navires français en faisaient partie. Les batteries de la côte firent feu et lancèrent plusieurs boulets, qui heureusement n’atteignirent pas leur but ; niais tout à coup , et sans qu’on ait pu savoir comment la chose s’était faite, voilà que le bruit se répand que Bonaparte, si vivement désiré, sans être attendu, est sur cette escadre; aussitôt les démonstrations hostiles cessent, mille et mille acclamations frappent les airs, les citoyens des lieux voisins accourent en foule avec leurs oiliciers municipaux en tète; on bat la générale, on descend au rivage; bon nombre d’eux montent sur des embarcations légères, sur des barques de pêcheurs, et rament vers les navires: on les hèle.... Oui, Bonaparte est là, il arrive, et avec lui la gloire de la France. La nouvelle, transmise de bouche en bouche, parvient au rivage, se répand avec la rapidité de l’éclair, et en moins d’une demi-journée, la moitié de la Provence sait que le libérateur est arrivé.
On le conjure de descendre à terre; il hésite, car il connaît la rigueur des lois sanitaires. Les préposés refusent d’accéder au désir de la multitude, qui répond : Nous aimons mieux la peste que les Autrichiens, que les Anglais. Les premiers menaçaient alors le Var, et les autres ne cessaient d’insulter nos côtes. Enfin, le peuple se rappelle sa souveraineté, tant de fois proclamée : il voit par les patentes apportées d’Alexandrie que les vaisseaux n’ont pas la contagion avec eux ; aussitôt il ordonne le débarquement. Jamais arrêt ne fut mieux accueilli, ni plus vite exécuté. Le général Peyremont, instruit de ce qui se passait, accourut, et par sa présence acheva de lever toutes les difficultés.
Enfin Bonaparte touche le sol de la patrie, qui

[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
515
tremble sous ses pas : les applaudissements, les vivat des Provençaux, lui présagent la réception que la France lui prépare. Il répond aux autorités qui le complimentent ; il parle de prospérité intérieure aux paysans, d’industrie aux négociants, de victoire aux soldats, charme tous les cœurs, et part ensuite pour Paris, où l’attendait le premier trône du monde.
Arrivé le 9 à Fréjus, le soir même il monte en voiture ; il laisse à gauche Toulon et Marseille, et prend sa route par Brignolles, Saint-Maximin, Aix, Avignon, Valence, Vienne, Lyon , etc.; partout la renommée l’a devancé, on l’attend sous des arcs de triomphe improvisés. Les administrateurs le reçoivent comme un souverain : dès que la nuit arrive, une multitude de feux de joie, allumés sur toute la route, lui prouvent l’enthousiasme général; partout, aussi loin que la vue peut s’étendre, à la gauche du Rhône (en remontant), il voit les montagnes du Vivarais s’illuminer des mêmes feux, dont l’éclat semble présager la fin du règne de l’anarchie.
A Lyon, l’enthousiasme est porté jusqu’au délire. Là, des avis bien sûrs lui font connaître que des embûches lui seront tendues. Pour déjouer les complots de l’ambition jalouse, il change son itinéraire, et tandis que sa famille vient à sa rencontre par la route de la Bourgogne, il prend le chemin du Bourbonnais, et sans accident fâcheux, il entre à Paris le 24 vendémiaire an VIII (16 octobre).
Paris n’était plus le même. Aussitôt que le télégraphe eut transmis la nouvelle que Bonaparte venait de débarquer à Fréjus, la grande cité changea de face, prit une attitude de contentement et de bonheur qui frappa tous les esprits. De l’abattement extrême on passa à

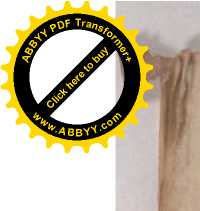
37 B
HISTOIRE
une confiance sans bornes. La veille, on ne voyait que défaites, le lendemain on ne compta que des succès; la rente, tombée à neuf pour cent, remonta rapidement à vingt.
Dès que le général fut dans son hôtel de la rue de la Victoire, nul ne crut en France à la durée du Gouvernement; chacun demeura convaincu qu’un changement était inévitable, autant que nécessaire; on variait uniquement sur la forme à donner aux amélio-riations que tous appelaient de leurs vœux.
C’est toujours un grand avantage pour un parti que de profiter des idées du moment, et de savoir agir alors que les masses, tourmentées d’un malaise, aspirent à un autre ordre de dioses, qu’elles ne savent pas désigner nettement; mais combien la position est plus belle encore, lorsque l’opinion se prononce pour les novateurs; lorsque, lasse des fautes passées, elle se jette dans les bras de celui qu’elle admire, qu’elle aime, et dont elle espère un sort meilleur.
Telle était la France à la fin de 1799. Fatiguée par le despotisme du Directoire, elle était prête il sanctionner de son approbation tout ce que tenterait Bonaparte; ce héros, malgré tout ce que ses détracteurs ont pu dire, n’était connu à son retour d’Égypte que sous un jour favorable; sa conduite en Italie lui avait conquis il la fois l’estime et l’admiration de l’Europe. Respectueux envers le Saint-Siège, protecteur de la religion catholique, favorable aux émigrés, pur de toute concussion , sa conduite contrastait honorablement avec la perfidie, la cupidité du Directoire, qui venait de traîner captif le saint pape Pie VI, et de lui procurer à Valence la double couronne de martyr et de confesseur de la foi. Les mœurs de Bonaparte
[1799.]

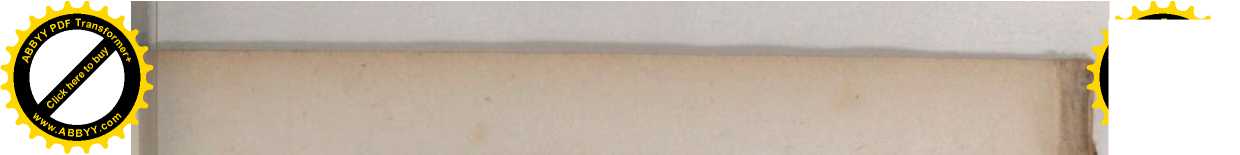
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 577 étaient irréprochables, ses principes sévères; il manifestait trop sa haine pour les fripons pour qu’on pût croire qu’il s’entendrait jamais avec les dilapidaient de la fortune publique. Il avait à peine vingt-neuf ans, et sa réputation militaire égalait déjà celle des plus fameux capitaines des temps anciens et modernes. En attendant qu’il la surpassât, la fortune paraissait prendre plaisir à le combler de ses faveurs, et lui, loin d’en être accablé, se montrait supérieur à sa fortune.
Tel était l’homme qui se présentait aux Français dans des circonstances si favorables, alors que les conseils de la flatterie et l’enivrement du pouvoir ne l’avaient encore entraîné à aucune faute. Ses adversaires, au contraire, se montraient avides d’une autorité qu’ils ne méritaient sous aucun rapport, et sans être investis de la confiance de la nation. Guidés par des idées toutes révolutionnaires, dépourvus de toute supériorité, soit dans la carrière desarmes, soit dans l'administration, ils ne gouvernaient que par la déception , par de petites et basses intrigues : hors d’état de contenir les partis, ils commettaient l’énorme faute de quitter la position de chefs de la France, pour ne se montrer que les chefs d’une faction. Or, tout chef de parti n’a qu’un pouvoir partiel, et dès lors il n’a plus d'influence que sur une fraction de la société, au lieu de gouverner la nation tout entière. L’Europe en armes pressait de toutes parts ces faibles directeurs, qui, moins occupés de la repousser que soucieux de prolonger leur existence précaire, n’avaient que la folle témérité de vouloir perdre un homme à qui la confiance publique attribuait le pouvoir de réparer tout le mal que nous avaient fait dix années de révolution : c’était dès lors lui frayer le chemin du trône.

578 . HISTOIRE (1799.]
Autour du Directoire, et mûs par l’instinct d’une conservation mutuelle, se ralliaient les hommes de sang, les fauteurs des crimes de la Révolution ; les fournisseurs, les agioteurs, les banqueroutiers frauduleux, les entrepreneurs fripons, les délateurs, tous ceux enfin qui avaient besoin, pour exister, de la perpétuité de notre misère ; êtres impurs que les révolutions enfantent, qui les soutiennent, et qui environnaient le Directoire, avec lequel ils tombaient tous.
De l’autre côté, la France contemplait, groupée autour du héros de l’Italie et de l’Égypte, l’élite de ses citoyens les plus érudits, les plus habiles, les plus sages, les plus braves. Là se pressait une foule de généraux chargés de lauriers, des savants illustres, des artistes célèbres, des littérateurs recommandables. L’espoir d’une ère de réconciliation, de concorde, surgissait derrière eux; en les voyant, on ne pouvait douter que le règne de leur chef ne fût celui de la paix intérieure, de la puissance au-dehors. Sa vie passée était le gage de son avenir; il ne prenait rang dans aucun parti, dès lors il les dominerait : il n’en adopterait aucun pour s’en servir à écraser les autres, mais sa volonté ferme les réunirait tous en un seul faisceau, pour procurer à la patrie des jours de calme et de repos, après l’agitation terrible des violentes tempêtes passées.
Une lutte établie sur un terrain pareil, et entre de tels adversaires, ne pouvait être de longue durée : aussi, dès que les antagonistes se trouvèrent en présence , ils songèrent à la terminer rapidement. Pour arriver à ce but, tout moyen sembla bon aux uns, toute résistance parut légitime aux autres. Si j’en crois un témoin oculaire, le parti républicain, comprenant

I

[1799.) DE LA DÉVOLUTION FRANÇAISE. 579 l’imminence du danger, aurait, dès cette époque, eu recours aux moyens violents et criminels dont il fit usage plus tard ; trois tentatives d’assassinat et deux d’empoisonnement eurent lieu dans le mois qui sépara l’époque de l’arrivée de Bonaparte à Paris de celle du 18 brumaire. On en trouvera les détails dans les Mémoires du tribun et préfet Antoine Ozun, que je publierai plus tard.
Le 16 octobre, deux heures après son arrivée, Bonaparte se rendit au Directoire. L’enthousiasme qui l’avait accueilli dès son débarquement à Saint-Ra-pheau l’accompagna au milieu de Paris. La garde du Directoire, instruite de son approche par les cris, les applaudissements, les transports de la multitude, courut aux armes d’elle-même, nul chef ne se trouvant là dans ce moment ; elle se mit en bataille, les tambours battirent aux champs; on porta en triomphe l’homme du destin, et l’enthousiasme fut tel, qu’au Luxembourg on put croire à la venue d’un sixième directeur, ou plutôt à la présence du souverain unique de la France.
Gohier présidait le Directoire ; il allait se mettre à table avec ses collègues, Sieyès et Moulin; il accueillit Bonaparte, il le flatta, le convia à dîner, et envoya chercher Barras et Ducos. On ne les trouva point : l’un était ailé faire une orgie à Vincennes, et le second dînait hors de chez lui.
Dès ce jour, les intrigues commencèrent. Sieyès et Barras, sans se concerter, agirent à l’insu de leurs ‘ collègues. Le premier se rapprocha de Bonaparte, lui prouvant qu’il entraînerait avec lui une partie des Conseils. Le général devina sa jactance, sa suffisance maladroite; il comprit qu’en s’unissant à lui il arriverait
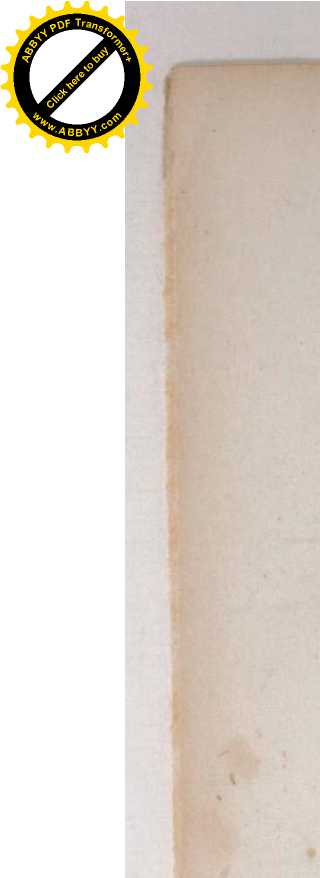
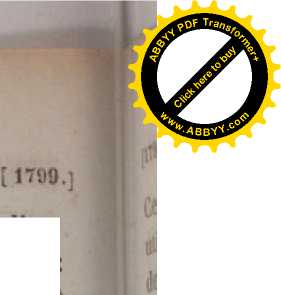
5X0
HISTOIRE
plus tôt à son but, et un traité tarda peu à les lier.
D’un autre côté, Barras traitrit avec Louis XVIII : il s’imagina que ce prince et les Anglais envoyaient Bonaparte pour diriger le mouvement contre-révolutionnaire; il en fut piqué, il s’irrita de ne jouer que le deuxième rôle. En conséquence, au lieu de terminer ses arrangements secrets, il les rompit, et chercha à s’entendre directement avec le général; mais celui-ci détestait Barras, ce Barras, assez léger pour avoir laissé propager des bruits qui blessaient les affections de Bonaparte, en le rendant ridicule. Une telle offense ne se pardonne pas, et au premier mot qui lui fut dit pour préparer un arrangement entre lui et le directeur, il s’écria :
« Qu’on ne me parle pas de cet homme; on se flétrirait rien que de marcher de concert avec lui. »
Bonaparte, en arrivant, n’eut aucun besoin de faire des avances à qui que ce fût; on vint à lui, et tous lui dirent qu’il était le seul espoir de la France, que la France ne voulait que lui. Ces paroles lui confirmaient la force des sentiments manifestés sur son passage. Il tarda peu à se croire appelé à sauver la République, à devenir son conseil, son régulateur, son soutien ; car l’assentiment général l’investissait des droits de chacun et de la procuration de tous.
Il ne conspira point, il agit; il se disposa, non à s’emparer du pouvoir, mais à s’en faire investir; il marcha droit à ce but, à découvert, sans mystère , sans finesse : le vœu universel faisait sa force et son autorité.
Ce fut à cette époque que Fouché, que Talleyrand-Périgord, se dévouèrent à lui : par l’un, il sut tous les secrets de la police intérieure ; par l’autre, il fut mis au courant de la marche des affaires à l’étranger.
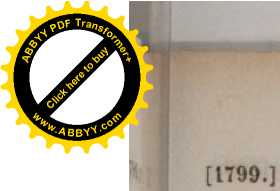
DE LA HÉ VOLET ION FRANÇAISE.
581
Ces deux adroits auxiliaires lui furent d’une grande utilité ; il s’en servit et se montra reconnaissant. Ces deux hommes d’État, suivant les mêmes maximes, ont toujours trahi les faibles , et se sont toujours montrés fidèles aux puissants. L’histoire les peindra se ralliant sans cesse au parti qui devait être victorieux, tout en prodiguant des soins et des marques d’affection à ceux dont ils prévoyaient la chute prochaine.
Bonaparte, rencontrant l’un de ses amis (Ozun) qui lui disait : « Tout est perdu. — Oh ! non, reprit-il, la France a des ressources immenses, il ne faut que savoir les employer. — Le metteur en œuvre lui manquait; il arrive, je suis tranquille. — Si je me fusse écouté, j’aurais pris mon parti plus tôt; mais j’avais des devoirs à remplir, ils m’ont arrêté; ma tâche là-bas a été complétée par ma victoire d’Aboukir ; elle a décidé du sort de l’Égypte. J’ai pu alors me tourner vers la France : me voici.... Quelle position, mon ami ? que devient la république? L’Italie, que j’avais conquise, est perdue; on nous a menés tambour battant du fond de la Calabre au pied des Alpes; les Barbares sont arrivés dans le cœur de l’Europe; je n’aurais même plus retrouvé le sol français intact, sans le courage et la science de Bernadotte, de Brune et de Masséna. J’ai appris à la fois la captivité et la mort du pape, acte de sottise stupide, atroce, cruel, que rien n’excuse, car rien ne le nécessitait; et l’insurrection de Toulouse, et les nouveaux troubles de la Vendée, et Le réveil de la chouannerie ? Quoi ! dans chaque ville la guerre intestine, les passions en présence, les haines fomentées; à Paris, une population mourant de faim, des masses mécontentes, un corps législatif avili, le Directoire livré aux agioteurs; Barras corn-


582 HISTOIRE [1-tMM
plotant avec les Bourbons; Gohier, Moulin, avec les sans-culottes ; Sieyès cherchant à s’emparer du pouvoir : qu’est-ce que cela signifie? N’y a-t-il donc aucun homme capable, aucun esprit qui veuille la concorde au-dedans, la victoire au-dehors, et partout la majesté du peuple français? »
En m’écartant ici de la rapidité du récit de tant d’événements, j’ai voulu montrer la supériorité du génie de Bonaparte, qui, en vingt-quatre heures, avait si bien compris la position des choses, et d'où le mal provenait.
Les convenances exigeaient que Bonaparte fît au Directoire une visite solennelle ; elle eut lieu le lendemain ou le surlendemain de son arrivée. Son cortège fut celui, non d’un général en chef qui va rendre compte de sa conduite, mais d’un souverain qui vient prendre possession de son trône. Bonaparte était environné d’un nombre considérable de généraux et d’officiers de tous grades; une population immense le devançait, le suivait ou l’attendait à son passage, faisant retentir l’air de ses acclamations. Le ministre de la Guerre, Dubois de Crancé, et celui des Relations extérieures, Talleyrand, le présentèrent au Directoire : il parla modestement de ce qu’y avait fait eu Égypte, prétendant n’être revenu que pour secourir la patrie, que tant de malheurs accablaient; mais qu’en débarquant il avait appris les succès des généraux commandant en chef, et qu’il s’estimait heureux que sa bonne volonté n’eût pas besoin d’être mise à l’épreuve. En terminant il posa la main sur la garde de son épée , et déclara qu’elle ne serait jamais tirée (pic pour la défense de la République.
Gohier répondit : il vanta la conquête de l’Égypte,
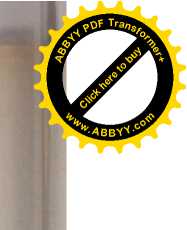
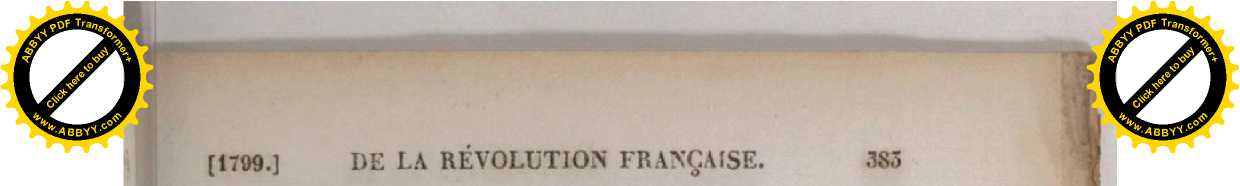
il justifia le Directoire des derniers revers, et prophétisant sans le savoir, il annonça que désormais la E France allait marcher de triomphes en triomphes.
L’accolade fraternelle, étiquette récente, ne fut pas oubliée dans cette solennité. Bonaparte, après l'avoir donnée et reçue, partit, et le Directoire resta seul, humilié de voir la foule de gens illustres qui se pressait sur les pas de Bonaparte. En effet, on comptait dans le cortège qui l’accompagnait ce jour-là, Jourdan, Moreau, Augereau , Macdonald, Beurnon-ville, Lefèvre, Marbot, Leclerc, Brueix, Dubois de Crancé, Cambacérès, Talleyrand, Regnauld de Saint-Jean-d’Angély, Auguis, Bailleul, Bérenger, Bodin, Boulay (de la Meurthe), Cabanis, Cacault, Chénier, Ozun , Chollet, Dumoulin, Desmeuniers, Duplantier, Duviquet, Depère, d’Ambarrère, Fabre (de l’Aude), Garnier, Gaudin, Gossuin, Delarue, Lamarque, Lho-inond, Nogaret, Sallicetti, Texier-Olivier, Villetard. Baron , Baudin , Cornet, Cornudet, Alfonse, Farguc, Garat, Garnier, Goupil de Préfein, Lebrun, Daunou, Péré, Pérès, Porcher, Vimar, Volney, et beaucoup d’autres, tous généraux, hommes d’État, ou membres des deux Conseils.
On a dit que Bonaparte mena une vie retirée à son retour d’Égypte ; cela n’est pas exact. Sa maison, du matin au soir, et jusque fort avant dans la nuit, ne cessa pas d’être pleine de gens qui tous offraient leurs services, et le poussaient à un coup d’État. Bonaparte sortait peu, c’est vrai, mais il ne faisait par-là qu’augmenter l’envie de le voir. Cette foule lui déplaisait en apparence ; souvent, pour l’éviter, il se retirait dans un entre-sol, où il s’enfermait à triple tour, tantôt avec Cambacérès, Talleyrand, Fouché ; tantôt avec Ozun ,

381 HISTOIRE (1709.]
Regnauld et autres intimes. Là, on méditait le plan d’attaque, on disposait les moyens de séduction à employer envers les membres du Conseil des Anciens et de celui des Cinq-Cents. Bonaparte ne cessait de répéter :
« Je ne veux pas faire une conspiration, je ne veux qu’exécuter la volonté du peuple. Il n’est point question de faire triompher un parti, mais de réintégrer la France dans sa splendeur, et de la rendre paisible et florissante. »
Bernadotte, seul, inquiétait le héros : il le savait opposé à un changement de constitution; car lorsqu’il lui avait dit n’être revenu que pour réparer les maux de la. République, Bernadotte avait répondu : ('/est fort bien, mais aller au delà serait mal. On le circonvint; il ne s’engagea pas, mais il laissa faire ce que certainement il aurait pu empêcher. Barras, qui, repoussé par Bonaparte, aurait pu lui opposer Bernadotte, n’osa pas aller à celui-ci, se rappelant ses torts à son égard, et de quelle façon perfide il lui avait naguère enlevé le portefeuille de la Guerre. Il eu résulta que, laissant de côté le seul homme capable de résister au vainqueur de l’Italie et de l’Égypte, il crut devoir s’adresser à Moreau.
Moreau, dont l’aptitude ne lui permettait d’occuper que la seconde place, ne cessait d’envier la première. Bonaparte, qui le connaissait bien, disait de lui : « Il prend tant de peine à me résister dans le silence de son cabinet, que lorsqu’il se trouve en face de moi, il ne lui reste plus de force pour me combattre. » Moreau écouta Barras, qui était appuyé par Gohieret par Moulin; il leur promit tout, mais il différa tellement d’agir, qu’il fut gagné de vitesse.
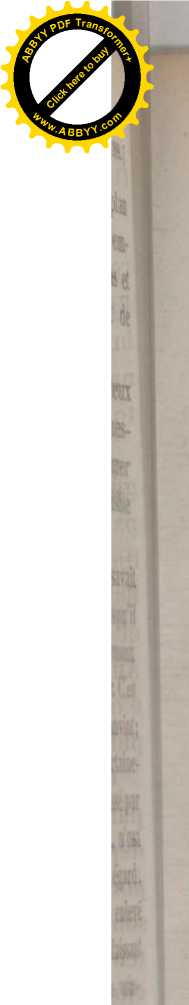
(1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 585
Les trois directeurs, ne comptant plus sur lui, eurent recours à Augereau, qui s’avisait de jalouser Bonaparte, mais qui était si bien convaincu de son infériorité, qu’on ne put rien tirer de l*ui de raisonnable; il fallut donc l’abandonner aussi, et se retourner du côté de .Jourdan.
Celui-ci, homme de cœur, mais malheureux à la guerre, était devenu timide, à force de revers. Bon patriote, rempli d’honneur, de vertu, digne de l’estime publique, il méprisait la débauche effrénée de Barras, regardait Moulin comme un homme incapable, et se moquait de la loquacité prétentieuse de Gohier. Aussi, tout en voyant le péril de la République, il n’osa pas se charger de la défendre avec de tels appuis.
Cependant Sieyès, déterminé à se lier avec Bonaparte, et faisant cause commune avec Roger-Ducos, dépêcha vers le premier le médecin Cabanis, qui porta la parole. Sieyès paraissait alors l’homme raisonnable du Directoire; Bonaparte consentit à s’entendre avec lui : dès ce moment tout marcha bien et vite. Le Directeur avait de l’influenee dans les Conseils; il détermina la majorité à le suivre. D’ailleurs, tout conspirait en faveur de Bonaparte; jamais dans aucune circonstance la volonté publique ne s’est prononcée comme elle le lit en 1799.
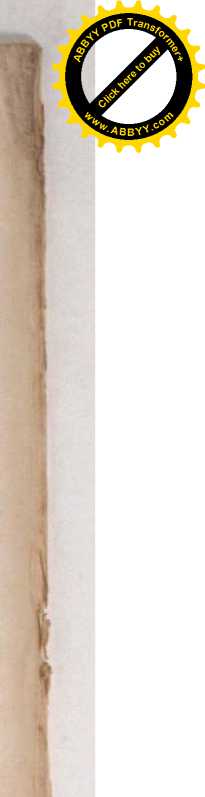
Tandis que Sieyès préparait ainsi les voies, d’autres hommes, non moins habiles, poussaient Bonaparte à s’emparer du pouvoir. Parmi eux on comptait Réal, l’un des conventionnels dont on se plaignait le plus, et qui peut-être avait fait le moins de mal : il pétillait de malice et d’esprit; il joignait à cela de grands talents, beaucoup d’adresse; c’était un excellent chef
n. 17
386 HISTOIRE [179».)
de police, indispensable à qui voudrait bien gouverner. Rœderer, sorte de beau parleur, journaliste ministériel, moins habile que Réal, mais aussi compromis aux yeux des royalistes; Rœderer, qui déjà se targuait d'avoir, au 10 août, sauvé la vie au roi et à la reine, tandis qu’op l’accusait avec raison d’avoir fait tomber dans le piège ces augustes personnages; l’amiral Brueix, bon marin, rusé diplomate, capable de servir avec autant de zèle que d'aptitude celui qui l’emploierait ; Thibaudeau, beaucoup plus Romain dans ses Mémoires que dans sa vie, homme de sens et de savoir ; Treilhard, légiste à vues larges et de haute capacité ; en un mot, toutes les supériorités de l’époque abandonnaient le Directoire, tombé dans le plus profond mépris, pour s’attacher au jeune héros.
Un instant, Barras essaya d’avoir une entrevue avec Bonaparte, à qui il donna à dîner, le 30 octobre. Le repas fut magnifique, mais triste; la gaieté n’était qu’apparente ; la joie feinte cachait l’inquiétude et la crainte ; on eut bientôt quitté la table. Barras, prenant alors son convive à part, l’entretint de la situation des affaires. Il fit seul tous les frais de la conversation ; il affecta de s’humilier, espérant être rehaussé par Bonaparte, qui, le devinant, gardait un silence significatif.
Barras, poursuivant, prétendit être malade, usé. fatigué et condamné à renoncer aux affaires. Le silence du général continua. Le directeur, poussé à bout, ajouta que la désorganisation de la République était patente, que pour la sauver il fallait concentrer le pouvoir, et nommer un président, mais que c’était là la difficulté : le général Hédouville lui semblait digne de l’être. « Quant à vous, général, votre intention est

(1799-1 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 587
sans doute de vous rendre à l’armée? Allez y cueillir des palmes nouvelles, et replacer la France au rang qui lui appartient; pour moi, je vais dans la retraite chercher le repos dont j’ai besoin. »
Indigné de ce détour, et devinant sans peine le but de Barras, qui voulait l’écarter pour gouverner sous le nom d’Hédouville, mannequin à mettre de côté dès qu’on le voudrait, Bonaparte ne répliqua pas un mot : il lança à Barras un des regards dont il foudroyait les hommes qu’il méprisait, le salua et sortit du salon , mais sans quitter le Luxembourg; il passa chez Sieyès, et prit jour avec lui pour l’exécution du coup d’état convenu: on décida qu’il aurait lieu le 18 ou le 20 brumaire (9 ou 11 novembre).


Gohier propose au Directoire l'arrestation de Bonaparte. — Sieyès rompt la délibération. — Diner à Saint-Sulpice. — Plan de la nouvelle révolution. — Bonaparte élude le projet de constitution que Sieyès propose. — Journée du 18 brumaire. — Lefèvre chez Bonaparte. — Le Conseil des Anciens ordonne la translation du Corps législatif à Saint-Cloud.— Décret relatif à cette mesure. — Opposition vaincue. — Bonaparte, investi du pouvoir militaire , harangue les troupes dans les Tuileries. — Colloque important de Bonaparte et de Bernadotte. — Discours de Bonaparte au Conseil des Anciens. — Détails sur ce qui se passe au Directoire. — Sieyès et Roger-Ducos se démettent de leurs fonctions, et se rallient au général en chef.—Talleyrand et Brueix décident Barras à abdiquer. — Sa lettre à ce sujet. — Démarches inutiles de Gohier ei de Moulin. — Réponse dure de ce dernier à Moreau. — Barras quitte Paris.—Apostrophe foudroyante de Bonaparte au Directoire expirant.— Mot habile du général en chef. — Dumolard. — Journée du <9 brumaire. — La scène transportée à Saint-Cloud. — Propos prophétique de Barras à Brueix. — Détails historiques. —Position inquiétante d'Augc-reau et de Jourdan. — Les républicains tournent les Cinq-Cents contre Bonaparte. — Les Anciens sont indécis. — Discours éloquent de Bonaparte à ces derniers. — Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents. — Tumulte. — Sa vie est menacée. — Scs soldats l’arrachent aux poignards des démocrates. — Lucien, président des Cinq-Cents, quitte le Conseil. — Son allocution aux troupes. — Murat et Leclerc dissolvent le Conseil des Cinq-Cents par la force des baïonnettes. — On réorganise les deux Conseils, qui changent la constitution. — Sieyès . Roger-Ducos et Bonaparte, consuls provisoires. — Ajournement des deux Conseils. — Le Directoire aboli. — Liste des députés mis hors la loi. — Fin de la République. — État des arts, des sciences, de la littérature et de l'armée, de 1795 à 1799. — Astronomes. — Mathématiciens. — Naturalistes. — Industriels. — Historiens. — Orientalistes. — Orateurs. — Poêles. — Prosateurs. — Peintres. — Sculpteurs. — Architectes. — Musiciens. — Chanteurs. — Danseurs. — Acteurs du Théâtre-Français. — Militaires. — Démagogues fameux. — Personnages célèbres par leur* vérins, leur mérite et leurs malheurs. — Créations, inventions, établissements utiles dns à l’ère républicaine. — Les royalistes. — Les républicains. — Ce qu'il faut attendre de ces derniers.
On touchait au dénouement de ce grand drame; Barras ayant calomnié Bonaparte au sujet des pré-
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 589
tendus trésors rapportés d’Égypte, celui-ci vint le dé- • I mentir devant le Directoire assemblé, refusa le commandement militaire queGohier lui offrait, et se retira sîws prendre congé : alors Goliier proposa son arrestation ; Moulin l’appuya ; Sieyès la combattit avec Roger-Ducos; Barras, qui n’avait plus d’énergie, se rangea à leur avis, et on ne tenta pas cette mesure incertaine.
Ce fut au milieu de ces agitations que les deux Conseils dédièrent à Bonaparte une fête donnée dans l’église Sair.t-Sulpice, qu’on métamorphosa en temple de la gloire. Cette fête fut encore plus morne que le diner de Barras ; le héros n’y fit qu’une courte apparition ; il affecta de ne manger que des œufs frais et du fruit; puis, se levant sañs attendre que les présidents en donnassent le signal, il fit le tour des tables, parla à quelques intimes, et partit.
Le moment d’agir était arrivé ; on discuta la forme du mouvement contre-révolutionnaire. Le Conseil des Anciens, en vertu de l’article 103 de la constitution de l’an III, avait le droit, sans opposition possible, de changer le lieu des séances du Directoire et du Corps législatif, et de désigner le lieu où le Gouvernement établirait sa nouvelle résidence. L’article 105 interdisait au Conseil des Cinq-Cents toute délibération , avant d’avoir obéi à cette mesure constitutionnelle.
On décida que l’on profiterait de cette clause pour amener les Conseils à Saint-Cloud, où il serait plus facile de déjouer la mauvaise volonté des opposants ; que pour mettre Bonaparte à même d’exécuter la commission qu’il avait reçue de protéger celte translation ; il serait autorisé à appeler à lui tous les ofli-
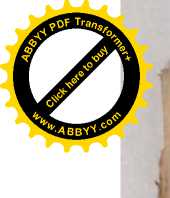
590 HISTOIRE ' [1799. |
ciers qui se trouvaient à Paris; que l’on ferait demander aux directeurs leur démission. Deux de ses membres, Sieyès et Ducos, étaient d’accord de la donner sur l’heure, et, supposant celle des autres obtenue, on créerait à leur place un pouvoir exécutif composé de trois consuls, qui seraient Bonaparte et les deux directeurs qui étaient convenus de se démettre.
Sieyès approuva ce plan, mais il voulait s’entendre à l’avance sur la constitution à proposer, ajoutant qu’il en avait une toute prête. « Tant mieux ! répondit Bonaparte; cela nous épargnera les recherches, et dès que celle-là existe, pourquoi la discuter aujourd’hui? nous l’adopterons après la victoire. »
Sieyès ne vit pas le piège, et le jeune lion trompa le vieux renard.

L’exécution du plan arrêté fut fixée au 18 brumaire; Cabanis se chargea d’influencer les Anciens, et on travailla en secret à préparer les lettres de convocation. Fouché, tout-puissant à la police, la rendit aveugle, sourde et muette; le Directoire n’eut que quelques vagues soupçons de son péril. Cambacérès, Boulay de la Meurthe, Ozun, Fabre de l’Aude, Réal, Régnault, firent preuve d’activité; dans la nuit du 17 on distribua les convocations aux députés qui étaient dans le secret; les autres ne reçurent les leurs que le 18 au matin.
Lefèvre commandait Paris. A minuit il reçut de Bonaparte l’invitation de venir chez lui, le lendemain, à six heures du matin ; il promit de s’y rendre. Avant le jour tout fut en mouvement dans Paris; les militaires de tous grades appelés à domicile, les chefs de la garde nationale et celle-ci avec eux accoururent

[1799.] DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 501 au commandement d’un simple général. dont les ordres avaient force de loi. Les appartements, le jardin, la cour, la longue allée de la maison de Bonaparte, la rue de la Victoire, celles adjacentes, se remplirent d’une foule ivre de joie.
Lefèvre arrive, s’étonne, hésite, et enfin cède à l’ascendant du grand homme : sur sa demande, il fait ranger en bataille les troupes de la garnison sur les boulevards et la place Louis XV. C’est là le début des événements du 18 brumaire (9 novembre).
Cependant le Conseil des Anciens s’assemble ; Cornet, président de la commission des inspecteurs de la salle, prend la parole, et dénonce un complot. « Des gens sans aveu, dit-il, remplissent Paris; déjà les faubourgs s’insurgent, les moyens de défense manquent momentanément; c’est le cas de profiter de l'article 103 de la constitution, de transférer la représentation nationale à Saint-Cloud, et d’investir un général du soin de protéger cette translation. » Un projet de décret est lu :
« Art. rr. Le Corps législatif est transféré dans la « commune de Saint-Cloud ; les deux Conseils siége-« ront dans les deux ailes du palais. — Art. II. Ils y « seront rendus demain, 19 brumaire, à midi; toute « continuation de fonctions, de délibération , est in-« terdite avant ce temps. — Art. III. Le général Bo-« naparte est chargé de l’exécution du présent décret. « Toutes les troupes existantes dans la dix-septième « division militaire passeront sous ses ordres, n’obéi* ront qu’à lui ; tout citoyen lui prêtera main-forte. « — Art. IV. Le général Bonaparte prêtera serment au « Conseil, et se concertera avec les commissaires-in-• specteurs du Corps législatif. — Art. V. Le présent

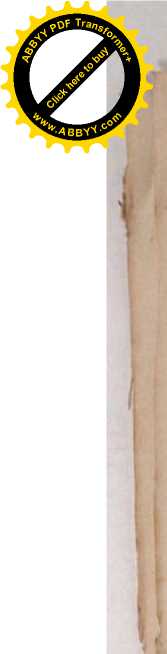
MA
A
592
HISTOIRE
[1799 ]
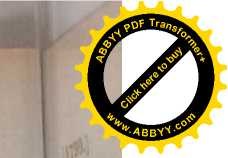
a décret sera destiñe transmis au Conseil des Cinq-Cents « et au Directoire exécutif; il sera imprimé, affiché, « promulgué et envoyé dans toutes les communes de « la République par des courriers extraordinaires. »
Des députés opposés à cette mesure demandent avant tout une enquête. La majorité, parmi laquelle Lebrun, depuis second consul, se distingue, se déclare assez éclairée, et vole par enthousiasme. Le décret est rendu; il est transmis au Directoire, dont il est l’arrêt de dissolution; aux Cinq-Cents, qui, présidés par Lucien, ne peuvent délibérer, arrêtés par le président, armé du texte de la loi constitutive, et à Bonaparte, qui l’attendait pour l'exécuter. Aussitôt qu'il l’a reçu, il le communique à son brillant état-major, monte à cheval, court aux Tuileries; dix mille soldats sont dans le jardin, il les passe en revue, leur fait connaître le décret, et leur dit :
« Oui, je l’ai accepté, pour seconder les mesures « que le Corps législatif va prendre, et qui sont toutes « en faveur du peuple.
« La République est mal gouvernée ; vous avez este péré depuis deux ans que mon retour mettrait un « terme à tant de maux; vous l’avez célébré avec une « union qui m’impose les obligations que je remplis; « vous remplirez les vôtres, et vous seconderez votre « général avec l’énergie, la confiance, la fermeté, « que j’ai toujours trouvées en vous.
« La liberté, la victoire et la paix replaceront la « République française au rang qu’elle occupait en « Europe, et que l’ineptie ou la trahison ont pu seules « lui faire perdre. »
Ces paroles sont suivies d’acclamations unanimes, et la dictature militaire va reposer désormais sur une


[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
595
base dont la seule main de Dieu brisera les fondements. La communication du héros était d’autant plus nécessaire, qu’il n’était pas sans inquiétude; le matin même il avait vu Bernadotte, et lui avait parlé franchement. « Je ne veux pas prendre part à un acte de rébellion, avait répondu celui-ci. — Au moins me donnez-vous votre parole d’honneur de ne rien entreprendre? — Je vous la donne comme simple citoyen; mais si le Directoire me dit de le défendre, j’agirai. »
Ce pronos n’était pas rassurant. Bonaparte, après sa harangue aux troupes , paraît à la barre des Anciens , suivi de tous les généraux qui se trouvaient à Paris ; Moreau était du nombre, Bernadotte seul manquait.
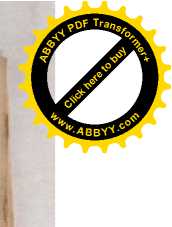
«
«
«
«
«
K «
«
a
« Citoyens représentants, leur dit-il, la République allait périr, votre décret vient de la sauver. Malheur à ceux qui voudront s’opposer à son exé- . cution ! Aidé de tous mes compagnons d’armes rassemblés autour de moi, je saurai prévenir leurs efforts. On cherche en vain des exemples dans le passé pour inquiéter vos esprits; rien dans l’histoire ne ressemble au dix-huitième siècle, et rien dans ce siècle ne ressemble à sa fin.
« Ytw voulons (a république, nous la voulons fondée sur la vraie liberté, sur le système représentatif; nous l’aurons, je le jure en mon nom et au nom de mes compagnons d’armes. »
Un député veut parler ; on lui oppose la constitu-
tion : il est obligé de se taire. Enfin les partisans du Directoire, répudiés par tous les hommes qui jouissaient de quelque réputation, se virent réduits à prendre l’inepte Santerre pour l'opposer à Bonaparte : c’était se jeter entre les bras des jacobins.
17.
t


594 HISTOIRE [1799 ]
Tandis que ceci se passe aux Tuileries, Barras, Gohier et Moulin, placés à des fenêtres du Luxembourg , regardent en riant Sieyès, qui prend une leçon d’équitation. Tout à coup un oflicier paraît, lui remet un écrit; il le lit, appelle Roger-Ducos et rentre avec lui. Tous deux se démettent de leurs fonctions, et se rendent auprès de Bonaparte. Barras se met au bain ; il y est depuis peu de temps, lorsque Gohier arrive, l’instruit des événements, lui signale la défection de Sieyès, de Ducos et du ministre de la Guerre.
A cette nouvelle terrible, Barras s’habille, envoie Bottot, son secrétaire, aux Tuileries, et promet à Gohier, qui parle de résistance, de l’aider de tout son pouvoir.
Sur ces entrefaites, Talleyrand-Périgord et Brueix viennent à lui, pour le déterminer à donner sa démission. Il leur demande ce que fait Bernadette. « Il s’efface. — Et Moreau ? — Il vient d’accepter le commandement du Luxembourg. Vous êtes son prisonnier.... » Barrasse met à rire. « Le lâche! s'écrie-t-il; il jalouse, il hait Bonaparte, et le sert. » Puis, prenant son parti, il adresse son abdication au président des Anciens, en lui écrivant la lettre suivante :
« Engagé dans les affaires publiques uniquement : par ma passion pour la liberté, je n’ai consenti à « partager la première magistrature de l’État que « pour l’aider dans ses périls par mou dévouement. « pour la préserver des atteintes de ses ennemis, pour « protéger les patriotes compromis dans sa cause, et « pour assurer aux défenseurs de la patrie des soins « particuliers, qui ne pouvaient leur être plus con-
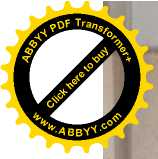
[1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
595

«
«
«
«
« « «
U
«
«
«
a
stamment donnés que par un citoyen anciennement témoin de leurs vertus héroïques et toujours touché de leurs besoins.
« L’admiration qui accompagne le retour du guerrier illustre à qui j’ai eu le bonheur d’ouvrir le chemin de la gloire, les marques éclatantes de confiance que lui donne le Corps législatif, et le décret du Conseil des Anciens, m’ont convaincu que, quel que soit le poste où l’appelle désormais l’intérêt public, les périls de la liberté seront surmontés, et les intérêts des armées garanties.
« Je rentre avec joie dans les rangs des simples citoyens, heureux après tant d’orages de remettre entiers, et plus respectables que jamais, les destins de la France dont j’ai partagé le dépôt.
« Salut et fraternité !
« Signé Barras. »
Il avait à peine signé cette pièce importante, que Cohier et Moulin heurtent à sa porte; ils lui demandent son concours; il les terrifie en leur apprenant qu’il vient d’abdiquer. Ils courent aussitôt à la recherche de Roger-Ducos, et même de Sieyès. Libres encore, car leur geôlier, Moreau , n’a pas encore paru , ils se rendent aux Tuileries, rencontrent Bonaparte , et cherchent à lui parler ; mais il leur tourne le dos : ils s’en reviennent alors au Luxembourg, où ils trouvent Moreau chargé de les garder à vue, et qui s’avise de demander à Moulin où il doit se tenir.
« Dans l’antichambre, réplique durement le directeur ; c’est la place des valets et des sbires. »
Barras croyait rester à Paris; mais un officier de hussards se présente. « Le général Bonaparte, dit-il,
b

306 HISTOIRE [1799] instruit du désir de l’ex-directeur d’aller habiter sa terre de Grosbois, m’a donné l’ordre de l’accompagner avec mon escadron, et de protéger sa route. — Va donc pour Grosbois! s’écrie Barras, on dort mieux à la campagne qu’à la ville. »
Les républicains, surpris, s’étonnent d’abord, puis réfléchissent, se réunissent, s’interrogent. A-t-on le projet de ne changer que les gouvernants ou celui de détruire la constitution ? Bonaparte veut-il être Monk ou Cromwell (1) ? Dans les deux cas, on s’opposera à son entreprise. Les membres des deux Conseils qui partagent cette opinion exagérée se promettent de défendre le lendemain la cause de la République et de la constitution. On cherche Santerre; mais ce lâche, effrayé des menaces de Bonaparte, qui a dit à Moulin qu’il ferait fusiller le général Mousseux (2), se cache et disparaît, tandis que, pour achever d’intimider les opposants, Bonaparte interpelle Bottot, envoyé de Barras :
« Qu’avez-vous fait de cette France que j’avais lais-« sée si brillante? j’avais laissé la paix, j’ai retrouvé * la guerre ; j’avais laissé la victoire, j’ai retrouvé « des revers ; j’avais laissé les millions de l’Italie, j’ai
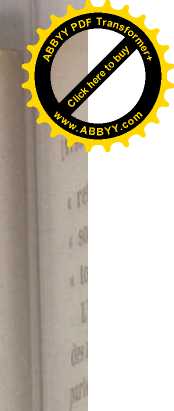
(1) Cromwell usurpa la couronne d’Angleterre sur Charles Ier, qu’il fit périr le 9 janvier de 1649. Il mourut maître de la Grande-Bretagne, le 13 septembre 1658. Le général Monk rétablit en 1660, aux mois de mai et de juin, Charles II, Ois du roi martyr, sur le trône d'Angleterre. L. L. L.
(2) Santerre, avant 1789, vendait de la bière : de là lui vint le sobriquet de général Mousseux. On lançait sur lui une foule de quolibets relatifs à ses deux professions d'industriel et de militaire.
L. L. L.
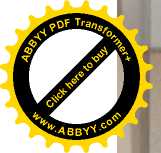
[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 597 « retrouvé des lois spoliatrices (1) et la misère ; que « sont devenus cent mille Français que je connaissais « tous, mes compagnons de gloire ? ils sont morts ! »
L’envoyé de Barras se retire atterré. Sieyès propose des mesures de rigueur. « Non, non, réplique Bonaparte, gardons-nous d’obtenir par la violence ce qui doit être le résultat d’un mouvement libre et réfléchi. S’il faut en venir à un coup de main, j’ai des soldats qui sauront imposer silence aux parleurs les plus obstinés. »
Par ces paroles il désignait Dumolard, un de ces orateurs sans génie, avocat dont la faconde éblouit les ignorants et fatigue les hommes éclairés. Muet sous le règne de Bonaparte, son bavardage audacieux ne recommença que sous le règne des Bourbons. Il est mort sans laisser ni renommée ni souvenir littéraire.
Le reste de la journée du 18 brumaire et toute la nuit suivante s’écoulent dans le calme ; de fortes patrouilles sillonnent Paris, et les malintentionnés craignent de réveiller le canon du 13 vendémiaire. Bonaparte eut raison de dire que, par sa conduite dans ce jour, il avait mis son cachet sur les Parisiens. L’effervescence des faubourgs n’est qu’un feu de paille. Bonaparte pourvoit à tout, chacun s’empresse d’exécuter ses ordres ; il est le centre unique autour duquel viennent se grouper les ministres, les conseils, la magistrature, l’administration, les généraux, le peuple.

(I) Entre autres celle de l'emprunt forcé, delà banqueroute nationale , et l’horrible loi des otages, qui rendait les nobles et les parents d'émigrés responsables en leur liberté, leur fortune, leur vie, de tout événement désastreux dont un jacobin aurait à se plaindre dans chaque commune. L. L. L.
59» HISTOIRE 11799]
l’armée. Sieyès seul ne s’en aperçoit pas encore ; il n’a pas la perspicacité de Barras, qui tantôt a dit à Brueix. en lui remettant son abdication :
« Jusqu'ici les militaires avaient eu des chefs; dorénavant ils auront un maître. »
Barras a raison , et Bonaparte ne lui pardonnera pas sa prévision.
Dès le malin du 19 brumaire une foule nombreuse se porte à Saint-Cloud, pour voir, intriguer, ou donner assistance. Les Conseils, convoqués pour midi, ne. s’ouvrent qu’à deux heures. Les Anciens se rassemblent dans la chapelle, les Cinq-Cents dans l’orangerie; cette lenteur donne le temps aux députés malveillants de pérorer au milieu des groupes, de chercher à séduire les soldats. Ozun et Cambacérès en informent le général en chef, qui, se tournant vers Marmont. son aide-de-camp, lui dit :
« Allez donner l’ordre de faire feu ou de passer au fil de l’épée quiconque tentera de parler à la troupe. en opposition avec la volonté des Conseils. »
La fermeté devient de plus en plus nécessaire. Sieyès, qui voit qu’on le met de côté, boude et a peur. Au-Igereau et Jourdan se tiennent à l’écart ; l’opinion de Bernadette est connue; le bruit se répand que ces (rois généraux, obéissant à Moulin et à Gohier, marchent sur Saint-Cloud ; puis ou annonce que les faubourgs s’insurgent, tantôt en faveur de Bonaparte . tantôt pour soutenir la République.
En attendant, la mauvaise volonté de nombre de députés devient manifeste ; l’attente tue l’enthousiasme , le refroidissement amène la résistance ; il faut avancer, sous peine d’être bientôt contraint à reculer. La séance s’ouvre; Augereau, Jourdan, apparaissent.
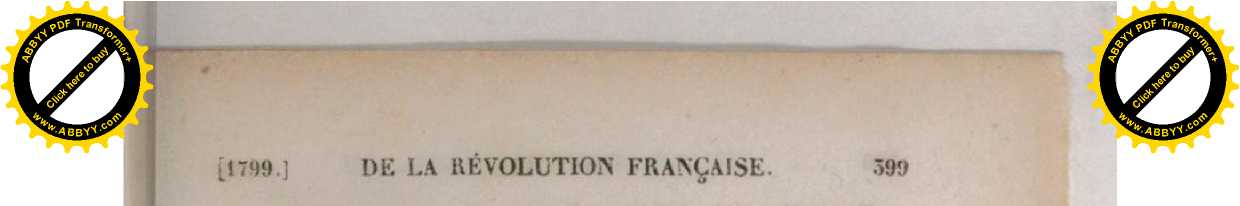
non toutefois parmi les généraux, mais dans les salles, car ils sont députés. Bonaparte les aime mieux à Saint-Cloud qu’à Paris.... Mais où est Bernadotte? il est le seul dont le nouveau dictateur s’occupe ; ceci fait son éloge. Il doit être un homme de mérite, celui dont la seule inaction suflit pour inquiéter Bonaparte.
Déjà on pérore aux Cinq-Cents. Gaudin, qui était du parti de Sieyès et de Bonaparte, demande que le Conseil nomme une commission qui fasse, séance tenante, un rapport sur la situation périlleuse de la République, sur les mesures à prendre pour" la sauver.
On se flatte que cette proposition passera d’emblée ; ki commission, formée à l’avance, sera désignée par le président. Lucien, frère de Bonaparte, qui remplissait alors cette fonction, propose l’ajournement des séances des deux Conseils et la création de trois consuls provisoires ; le piège, peu adroitement conçu, est éventé. Les républicains s’irritent, s’emportent; de tous côtés la salle retentit des cris de vice la constitution! pus de dictature! rien que la république ! à bas le despotisme! à bas le tyran! « Oui, dit Delbrel, la constitu-« tion ou la mort!... Les baïonnettes ne nous épou-« vantent point; nous sommes libres ici autant que « nous le serions à Paris. Pas de dictature! pas de « nouvelle constitution ! »
Le tumulte devient effroyable; on reproche à Lucien sa trahison , sa connivence avec sou frère. Il veut répondre, mais ses explications ne sont pas écoutées: le péril augmente; le député Grandmaison propose que sur-le-champ on prête individuellement un serment nouveau à la constitution de l’an III. La situation était grave : Ozun comprend le danger, sort du Con-

400 HISTOIRE [1799.]
seil, et court instruire Bonaparte de ce qui s’y passe. Le général appelle Fouché, et l’interroge sur les mesures à prendre.
« Agissez, ou tout est perdu, réplique l’homme d’état ; empêchez l’effet de ce serment qui vous tue, présentez-vous, parlez, votre influence les ramènera sans doute. »
Bonaparte suit cet avis; il pénètre dans la salle des Anciens ; sa présence irrite d’abord ; mais il va parler. 11 eût été habite de lui imposer silence : la curiosité, le désir de le mortifier, l’emportent ; on se tait, et lui, vivement émû, mais d’une voix forte, leur adresse ces paroles :
« Représentants!
« Vous n’êtes point dans des circonstances ordi-« naircs, mais sur un volcan; permettez-moi quel-« ques explications. Vous avez cru la République en « danger, vous avez transféré le Corps législatif à « Saint-Cloud, vous m’avez appelé pour assurer l’exé-« cution de vos décrets, je suis sorti de ma demeure « pour vous obéir, et déjà on nous abreuve de ca-« lomnies, moi et mes compagnons d’armes; on parle « d’un nouveau Cromwell, d’un autre César. Ci-« loyens, si j’eusse voulu d’un tel rôle, il m’eût été « facile de le prendre au retour d’Italie, au moment « du plus beau triomphe, et lorsque le peuple et « l’armée m’invitaient à m’en emparer ; je ne l’ai pas « voulu alors, je ne le veux pas aujourd’hui. Ce sont « les dangers seuls de la patrie qui ont éveillé mon « zèle et le vôtre; la patrie, si vivem»ent menacée au « dehors par la coalition des rois, que les impru-« dences du Directoire ont provoquée, est déchirée
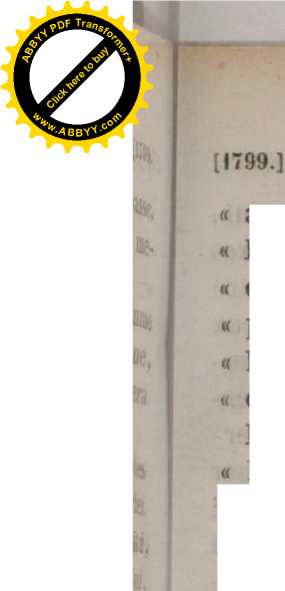
«
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
ÎOf
au dedans par la guerre civile et par la discorde. . La Vendée n’est pas écrasée, les royalistes du Midi quittent à peine les armes, ils les reprendront au premier signal. Prévenons tant de maux, sauvons les deux choses pour lesquelle nous avons fait tant de sacrifices : la liberté et l’égalité.....
Ici le député Linglet lui crie d’un ton d’impatience : Parlez donc aussi de la constitution. »
Cette interruption soudaine déconcerte un instant Bonaparte, mais il se remet bien vite :
a
«
« « « «
« «
« « « « «■ « K U K
U
U
« La constitution ! reprend-il avec un mouvement chaleureux et une ironie amère et sublime ; vous l’avez violée au 18 fructidor! vous l’avez violée au 22 floréal! vous l’avez violée au 30 prairial! cette constitution ! ! ! Elle est invoquée par chaque faction , et violée par tous les partis. Ils sont tous venus me confier leurs projets, et me proposer de les seconder. Barras et Moulin, qui sont vos hommes, offraient de me vendre la République, de partager le pouvoir avec eux. Prévenons tant de maux ; sauvons la liberté et l’égalité.
« l ai repoussé les offres de toutes les factions, parce que je ne veux être que d’un parti : celui du peuple français. En acceptant le commandement, je ne me suis reposé que sur votre sagesse ; je n’ai pas compté sur le Couseil des Cinq-Cents, qui est divisé ; sur le Conseil des Cinq-Cents, où il se trouve des hommes qui voudraient nous rendre la Convention , les comités révolutionnaires et les échafauds ; sur le Conseil des Cinq-Cents, où les chefs de ce parti prennent séance en ce moment; sur le Conseil des Cinq-Cents, d’où viennent de partir des émissaires chargés d’organiser un mouvement dans Pa-

« ris. Que ces projets criminels ne vous effraient point, « représentants du peuple. Environné de mes frères « d’armes, je saurai vous seconder ; j’en atteste votre « courage, et vous, mes h raves camarades, aux yeux « desquels on voudrait me faire passer pour un ente nemi de la liberté; vous, grenadiers, dont j’aper-« cois les bonnets; vous, braves soldats, dont j’aper-« çois les baïonnettes, que j’ai si souvent fait tourner « à la honte de l’ennemi, à l’humiliation des rois ; « que j’ai employés à fonder des républiques : et si « quelque orateur, ajoute Bonaparte d’une voix me-« naçante, si quelque orateur payé par l’étranger parte lait de me mettre hors la loi, qu’il prenne garde de « porter un arrêt contre lui-même; j’en appellerais à « mes compagnons d’armes, aux braves défenseurs « de la République, avec qui j’ai partagé tant de pé-« rils pour affermir la liberté et l’égalité : je m’en « remettrais à mes braves amis, à vous tous et à nui « fortune (1).
« J’achève en invitant le Conseil à se former en « comité et à prendre les mesures nécessaires que « l’urgence des circonstances exige impérieusement. »
Ce noble discours, ces paroles énergiques, qui étaient un avis pour les Cinq-Cents, raniment les Anciens; on l’applaudit, les malveillants se taisent, et l’on invite le général aux honneurs de la séance ; mais lui, qui sent son œuvre imparfaite, se rend à l’orangerie , où siégeaient les Cinq-Cents.
Sieyès venait de présenter aux législateurs la démis-
(I) Ce discours produisit un effet incroyable. Bourrieune nie qu’il .lit été tenu; il le remplace par un récit tellement faux, que si Bonaparte s’était conduit comme il le raconte , il se serait perdu.
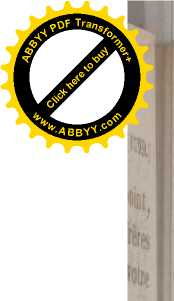
ta I

kr I
1799/ DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
sion de Barras, qui paralysait le Directoire. Le général paraît, suivi de quelques grenadiers, qu’il laisse à l’entrée de la salle. A son aspect, une clameur presque universelle s’élève. Les républicains veulent triompher, et, selon leur coutume, ils demandent la victoire à la violence. De toutes parts on s’écrie :
« Quoi, des armes!.... des soldats dans cette enceinte!.... La constitution est violée!.... A bas le tyran !... Mort au dictateur !... Hors la loi Bonaparte!... Lu grand nombre de députés s’élancent au-devant de lui en l’interpellant, en lui demandant si c’est pour se conduire ainsi qu’il a remporté tant de victoires !... Sa gloire est souillée!.... Ses lauriers sont flétris! lui crie-t-on de toutes parts....
Ou se lève, on le menace; un instant il est confondu au milieu de la foule qui l’entoure. C’est vainement qu’il cherche à se faire écouter, sa voix est couverte par les cris, par les hurlements frénétiques des députés. On le pousse, on le presse; Arena, dit-on, lève un poignard sur lui, dont le grenadier Thomé détourne le coup (1).... Il va périr peut-être, mais ses soldats sont là ; ils voient le péril, ils accourent, ils enlèvent leur général, l’entraînent hors de la salle. 11 remonte à cheval et revient au milieu de son état-major. en disant qu’on a voulu l’assassiner.
Lucien cherche à calmer scs collègues; mais on le maltraite lui-même, on l’accable de reproches, d’outrages, on veut le forcer à mettre son frère hors la loi ; alors il s’écrie :
« Misérables, vous me demandez un fratricide, je
1) On a nié ce fait ; des témoins oculaires ralflrment. Ozuu, dans ses Mémoires manuscrits, dit en avoir été le témoin. L. L. L.

40 i
HISTOIRE
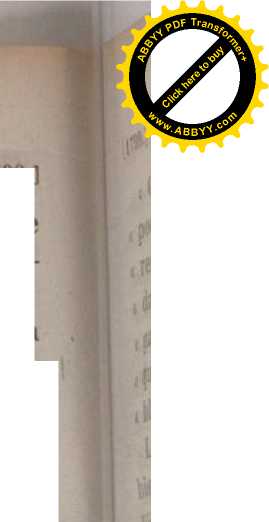
[1790.]
renonce à vous présider, et je descendrai à la barre pour y défendre celui que vous accusez si injustement. »
Ces paroles fermes sont couvertes par le bruit ; la
rage furibonde des républicains s’accroît, les jours de Lucien sont en péril. Bonaparte entend cette scène effroyable, il tremble pour son frère, et envoie des grenadiers le chercher : ceux-ci le sauvent. Lucien, hors de danger, s’élance sur un cheval qu’on lui présente, après avoir repris son costume, dont il s’était dépouillé. Il se porte dans les rangs, s’adresse à la troupe, et d’une voix véhémente :
« « «
«
K
«
«
«
«
«
«
U
« « a « «
a Citoyens et soldats !
« Le président du Conseil des Cinq-Cents vous déclare que l’immense majorité de ce Conseil est en ce moment sous la terreur de quelques représentants indignes de ce nom, qui assiègent la tribune, menacent leurs collègues de la mort, et provoquent des mesures qui compromettent le salut de la patrie. « Je vous déclare que ces audacieux terroristes, sans doute soldés par l’Angleterre, se sont mis en rébellion contre le Conseil des Anciens, et ont osé parler de mettre hors la loi le général chargé de l’exécution de son décret, comme si nous étions encore au temps affreux de leur règne, où ce mot, hors la loi, suffisait pour faire tomber les tètes les plus chères à la patrie.
« Ce petit nombre de factieux s’est mis lui-même hors la loi, par son attentat contre la liberté du Conseil des Anciens. Au nom du peuple, qui depuis tant d’années est le misérable jouet de ces suppôts de la terreur, je confie aux guerriers le soin de délivrer la majorité des représentants.

1799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 105

« Général, et vous, soldats, vous ne reconnaîtrez « pour députés de la France que ceux qui vont se « rendre autour de moi ; quant à ceux qui resteront « dans l’orangerie, que la force les expulse : ces bri-« gands ne sont plus les représentants du peuple, « qu’ils outragent en le trompant. Vive la Répu-« blique! »
Les soldats répondent au vivat de Lucien par un cri bien plus en harmonie avec leurs sentiments, celui de rive Bonapate! Lucien termine en s’écriant : Je jure de percer le sein de mon propre frère s'il porte atteinte ¿i la liberv des Français ! Il fut un temps où on crut qu’il lienuait ce serment.
Ce mcuvement oratoire exalte les soldats, ils sont prêts à tout entreprendre. Bonaparte le voit, fait un signe ; Murat et Leclerc le comprennent : ils se mettent à a tête d’un bataillon de grenadiers, qu’ils conduise! à l’entrée de la salle au bruit du tambour; Mûri- s’avance et dit :
«Citoyens représentants, on ne répond plus de la sùrté du Conseil ; je vous invite à vous retirer. »
iul n’obéit. Alors Leclerc s’écrie à son tour :
« Représentants, séparez-vous; le général l’or-jnne. »
On se tait, on reste immobile; les républicains hé-ilent; cependant ils se disposent à parler. Murat alors se tourne vers la troupe, et d’une voix tonnante :
« Par ordre du général en chef Bonaparte, qu’on fasse évacuer la salle. Grenadiers, en avant ! »
Les soldats marchent la baïonnette au bout du fusil, cl au pas de charge. Nos Brutus modernes ne veulent plus mourir; cédant à l’effroi, tous fuient. les uns par

les couloirs, les autres par les fenêtres. En deux minutes l’orangerie est évacuée.
Les Anciens étaient restés en séance ; on vient leur apprendre l’événement, et bientôt Lucien se présente à leur barre pour justifier sa conduite à l’égard des Cinq-Cents, qui étaient dissous. On laisse partir les malintentionnés, qui regagnent Paris. Il n’était resté qu'une cinquantaine de députés, partisans du coup d’état, ils rentrent dans leur salle, et à neuf heures du soir le Corps législatif déclare que Bonaparte et l’armée ont bien mérité de la patrie.
On charge une commission de proposer, séance tenante, des mesures de salut public. A orne heures son rapporteur, Boulay de la Meurlhe, prqjose un nouvel ordre de choses intermédiaire et provisoire, jusqu’à ce qu’on ait réformé les vices de la coistitu-tion. Villetard, ensuite, fait adopter un projette constitution, dont le premier article porte : Il nyipi^ de Directoire exécutif; par le second, on crée une^m-mission consulaire exécutive, composée de Sieyès, Ro-ger-Ducos et Bonaparte ; d’autres articles ordonnent l’ajournement des deux Conseils au 1er ventôse an yn ( 20 février 1800), la formation de deux commisses législatives intermédiaires, et la mise hors la loi d’e-viron soixante membres des deux Conseils (1). Ce de cret, objet de la révolution qu’on venait d’opérer
(t) Ce furent : André, du Bas-Rhin; Aréna; Bailly, de la Haute-baronne; Bergasse; LazirouleJ, dit Venragé, de VAriége; Bertrand, Au Calvados; Beyts, Bigonnet, Blin, Boissié, Bordas, Bouvier, Boulay-Paty, Briecbet, Briot; Briche, de VOurthe; Carrièrc-Lagar-rière, Chalmes, Citadeila; Colotnbel, de la Meurthe; Constant, des Bouches-du-Rhône; Dimartinelly, Dauberinénit, Delbrel, Demoor, Desaix , Destrem, Doche—Delille ; Duplaotier, de la Gironde; Fri-
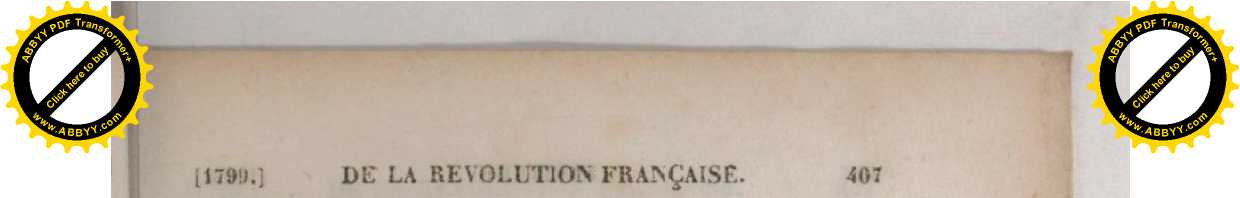
est porté de suite aux Anciens, qui l’adoptent vers le milieu de la nuit. Ces résolutions passèrent à l’unanimité dans les deux Conseils, avec d’autant plus de calme, qu’on apprit que Moulin, déguisé en femme , avait fui du Luxembourg dès la nuit venue, et que Moreau , pour trancher la difficulté, avait pris sur lui de mettre Gohier à la porte.
Les trois consuls furent appelés à l’instant même ; chacun d’eux prêta serment en ces termes : Je jure fidélité à la République une et indivisible, à la liberté, à l'égalité et au système représentatif. On les installa, dès cette nuit, à la satisfaction de l’immense majorité des Français; le système démocratique, qui avait régné du 21 septembre 1792 au 10 novembre 1799, tut renversé, et la monarchie de fait fut rétablie plus forte qu’en 1789.
Le règne de la terreur, les agitations qui suivirent le 9 thermidor, les orages d’une révolution pareille à la nôtre, et les turpitudes du Directoire, ne semblaient pas devoir permettre aux sciences, aux lettres et aux arts, de se développer. Cependant il y a peu d’époques où ils aient brillé d’autant d’éclat. Lalande et Arquier, Messier, Méchain, Cassini, et d’autres astronomes, continuèrent à observer les astres ; Laplace fut leur émule; Monge, Lagrange, Lacroix, et mie foule d’au-
sou, Garanti; Gastio, du Var; Gorean; Goupilleau, de Montaigu; Grandmaison, Donaasant-Dorimont, Gnedon, Honoré-Dallère , H dus tel; Jouberf, de l'Hérault; Joueune; Jourdain, à'illc-et Vilaine; Jourdan, de la Haute- Vienne ; Laurent, du Bas-Rhin ; Leclerc, Schepper, Legot, Lesage-Sennault, Letourneur, Legris, Marquézy, Mentor, Montpellier ; Moreau, de T Yonne; Philippe, Portés, Poulain-Grandpré, Prudbun, Quirest, Sunllié, Slbéve-nutte, Taloi, Truck.
très avec eux, poussèrent loin la science des mathématiques; le domaine de l’histoire naturelle fut enrichi par Lacépède, Cuvier, Daubenton, Dolomieu, Hauy, Lesage, Geoffroy Saint-Hilaire, Thouin,Lefèvre-Gineau, Levaillant ; l’industrie dut des miracles à Lavoisier, à Fourcroy, à Guyton-Morveau, à Chaptal, à Berthollct, à Parmentier, à Cadet-Gassicourt, etc.; Anquetil, Danse, de Sainte-Croix, Delille de Sales, le marquis de Ferrières, Rabaud-Saint-Étienne, etc.. se firent un nom honorable dans l’histoire ; Villoison, Gail, Coraï, Langlès, Sylvestre de Sacy, Dacicr, etc., furent des hellénistes habiles ou des professeurs savants dans les langues orientales ; l’éloquence eut dans Mirabeau, Cazalès, Maury, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal, Vergniaud, Barnave, Guadet, Gensonné , et Danton même, de dignes interprètes; Lanjuinais, Boissy-d’Anglas, firent entendre à la tribune leurs voix généreuses; André Chénier, immolé par les jacobins, Marie-Joseph, son frère, qui était un grand poète, Lebrun, qui nous rendit Pindare, Jacques Delille , Lemercier, Lormian, appartiennent en partie à la même époque ; Parny, aussi, fut un poète célèbre dans le genre érotique, mais on lui reprochera, au nom de la religion et de la morale, son poème de la Guerre des Dieux; Chaussard, Desorgue, Sélis, ne furent pas des poètes sans mérite. Cette ère vit débuter brillamment Picard, Alexandre Duval, Fabre-d’É-glantine, Laya, Legouvé, Berchoux, Michaud, An-drieux; Colin d’Harleville y poursuivit ses succès avec La Harpe, avec Ginguené, avec Richer-Serisy, le Paul Courier de ce temps, mais royaliste.
David saisit le sceptre de la peinture, que lui disputèrent avec plus ou moins de succès Gérard, Guérin ,

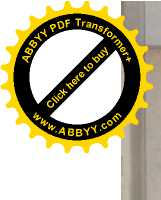
11799.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 409
Girodet, Prudhon, Meynier; alors brillèrent encore . Carie Vernet, Gautherot, Gros, Lafitte, Régnault, Vincent, etc.; Roland, Julien, Moilte, Cartellier, Chi-nard, etc., ne laissèrent pas périr la sculpture; et Poyel, Bellangé, Fontaine, Percier, Ledoux, entretinrent le goût d’une architecture élégante.
La musique se signala également par des progrès : Alors brillèrent Méhul, Berton, Lesueur, Boïeldieu,Da-leyrac, Gossec, Della-Maria, Champein, Nicolo Isoard, Cherubini, Rigel, Rouget de ITsle, qui, par la seule Marseillaise, dont il composa Pair aussi bien que les paroles, se plaça au premier rang des compositeurs du jour. Vestris, Duport, Coulon, mesdames Clotilde , Gardeł et son mari, rendirent la danse célèbre. Les actrices Maillard, Branchu, Saint-Aubin, Renaud, Rolando, Dugazon; les acteurs Laïs, Lainez, Chenard, Elleviou, Martin, Gavaudan, Solié, et bien d’autres, firent entendre sur la scène de l’Opéra et de l’Opéra-Comique leurs chants, modulés par les inspirations du génie.
Larive, Molé, Fleury, Saint-Phal, Dugazon, Saint-Prix, Dazincourt, Caumont, Michaud, les deux Baptiste, Grandménil; mesdames Contât, Mézeray, Saint-Val, Raucourt, Devienne, Vanhove, augmentèrent la gloire du Théâtre-Français. Ce fut avec la Révolution que l’inimitable Taima, que mademoiselle Mars, le diamant de la scène, commencèrent leur carrière si remplie de succès mérités..
On eût dit que ces agitations politiques, ces insurrections de tous les jours, cette lutte continuelle avec la mort, ces cachots toujours ouverts pour recevoir des prisonniers, ces échafauds en permanence, ces grandes victoires, ces guerres civiles et étrangères
il , 18

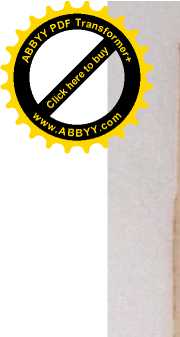
410 HISTOIRE [1799.J donnaient au génie un nouvel essor, et le portaient à enfanter des prodiges.
Nos marins, moins heureux, ne sont presque connus que par leurs désastres; mais quelle époque d’une aussi courte durée peut présenter dans l’histoire de tous les peuples cette foule immense de grands généraux qui dûrent leurs incroyables succès à l’établissement de la République, qui naquirent ou moururent avec elle, et qui commencèrent sous elle cette réputation qu’ils ont portée si haut pendant les quatorze premières années du XIX1 siècle?
Je citerai d’abord, dans la première catégorie, le prince de Condé, Dumouriez, Kellermann, Luckner. Custine, Biron, Montesquieu, Beauharnais (Alexandre), Westermann, Miranda, etc.; la seconde nous offre Dugommier, Pichegru, Hoche, Marceau, Championne!, Laharpe, Stengel, Cervoni, Kléber, Desaix, Caffarelli, Dugua, Dupuy, Vaubois, Carnot, Jourdan, Moreau, Lecourbe, Dammartin, Travot, Leclerc, Joubert, Beaurepaire, Despérières, Bouchard, etc.; on trouve dans la troisième Napoléon Bonaparte, Murat, Eugène Beauharnais, Masséna, Augereau, Lannes, Verdier, Tilly, Sainte-Suzanne, Serrurier, Lefèvre, Bernadotte , Berthier, Reynier, Davoust, Macdonald, Pé-rignon, Mortier, Richepanse, Lanusse, Kellermann fils, Alexandre Caffarelli, Junot, Bessières, Soult, Gouvion-Saint-Cyr, Sainte-Croix, d’Hautpoul, Poniatowski, Ney, Oudinot, Victor, Moncey, Su-chet, etc., etc.
Certes, j’en oublie un bon nombre dans les trois classes; mais ceux que je viens de nommer suffisent pour présenter un faisceau compacte et immense des gloires militaires de notre révolution.



[1799.] DE LA RÉVOLUTION’ FRANÇAISE. 41!
Ce n’est pas que cette période si fertile en grands génies n’ait été souillée par une tourbe de scélérats , qui furent le fléau de leurs concitoyens. Parmi ces hommes atroces, figurent en première ligne Robespierre, Marat, Couthon, Saint-Just, Lebas, Lebon, Carrier, Barrère, Collot-d’Herbois, Billaud-Varennes, Léonard Bourdon, les Lecointe, Amar, Ingrand, Chabot, Fournier, d’Orléans, Danton, Fréron , Jourdan, surnommé coupe-iête, Javogues, Legendre, et malheureusement tant d’autres encore. Mais en opposition à ces monstres, quels nobles caractères honorent la France! Louis XVI, les princes de Condé, Marie-Antoinette, madame Élisabeth, Malesherbes, Romain de Sèze, Tronchet, Chauveau - Lagarde, Angrand d’Alleray, Lanjuinais, Boissy-d’Anglas, Cazalès, Sylvain Bailly, qui se trompa en croyant bien faire, Charlotte Corday, La Rochejacquelein, Bonchamp et sa digne femme, Lescure, Cathelineau, d’Elbée, Stof-flet, Charette ; les citoyens qui tentèrent d’arracher Lyon à la tyrannie, le général Rougé, le comte de Paulo, l’archevêque d’Arles, les abbés de Firmont, l’Enfant; cette liste d’évêques si vénérables, de prêtres martyrs de la foi, tant de magistrats respectables qui reçurent la mort, comme les sénateurs de Rome l’attendirent des Gaulois; Bouillé, malheureux et fidèle, le duc de Broglie, d’Espréménil, Lavoisier, madame Royale, son auguste sœur, la princesse de Lamballc, la princesse de Chimay, madame la duchesse douairière d’Orléans.
Le Ciel accorda sans doute à la France tous ces personnages recommandables qui brillèrent à la fin du XVIir siècle, pour la consoler, pour la dédommager des maux qu’elle avait soulïerts.

HISTOIRE
[1799.]
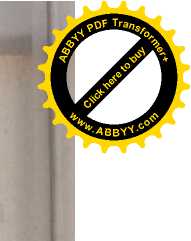
Si celle époque fut marquée par tant de destructions , si les institutions ducs à tant d’années de sagesse furent anéanties, si la rage de l’anarchie, s’attaquant à des lombes sacrées, osa violer l’asile des morts, et arracher de Saint-Denis les ossements de nos monarques, en profanant les tombes royales, du moins de ces ruines sortirent des établissements utiles dont nous recueillons aujourd’hui les fruits.
L’égalité des poids et mesures, le système décimal, les télégraphes, la propriété des inventions utiles assurée à leurs auteurs, la culture des tabacs autorisée en France , l’école normale, les écoles primaires ; l’Institut, pour remplacer les quatre académies; le bureau des longitudes, le conservatoire de musique, l’école polytechnique, la France dotée des plus beaux ouvrages de peinture et de sculpture dont s’enorgueillissait l’Italie, la stereotypie, l’école des beaux-arts, la fantasmagorie, les panoramas, les tables des logarithmes , l’établissement des lycées ou collèges, et une (juantité de découvertes utiles au développement des sciences et des arts, datent tous de ce temps-là.
Ces avanlages furent balancés par les semences de haine que la révolution avait jetées parmi nous. Dès lors les Français, qui n’avaient fait qu’un seul peuple pendant quatorze cents ans, se séparèrent en deux classes bien distinctes cl irréconciliables, parce qu’elles différaient de principes, d’opinions, de préjugés : les royalistes et les républicains. Les premiers se divisaient en diverses nuances : il y avait parmi eux les monarchistes, les constitutionnels, les aristocrates, les royalistes, les ultras, les bonapartistes; tous, au fond, voulant que le pouvoir fût placé dans les mains d’un roi libre : de l’autre côlé existèrent tour à tour
I

[1799 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.' 415 les démocrates, les jacobins, les sans-culottes, les terroristes, les anarchistes, les révolutionnaires, tous ennemis de la paix, de la concorde ; affamés d’or, ivres de sang, ennemis de la nation , hommes incorrigibles qui seraient encore prêts à pactiser avec qui voudrait nous replonger dans les horreurs que j’ai signalées dans le cours de ces deux premiers volumes.
FIN DC TOME SECOND.
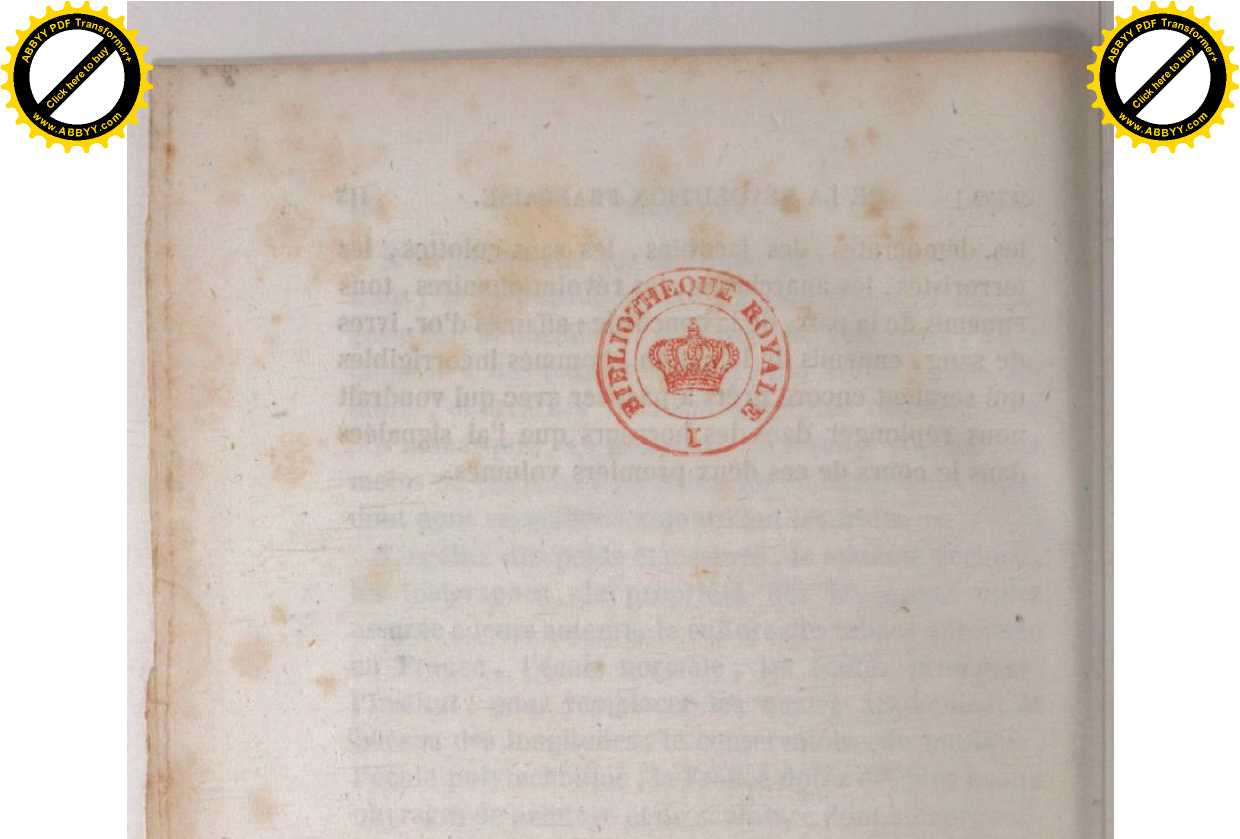

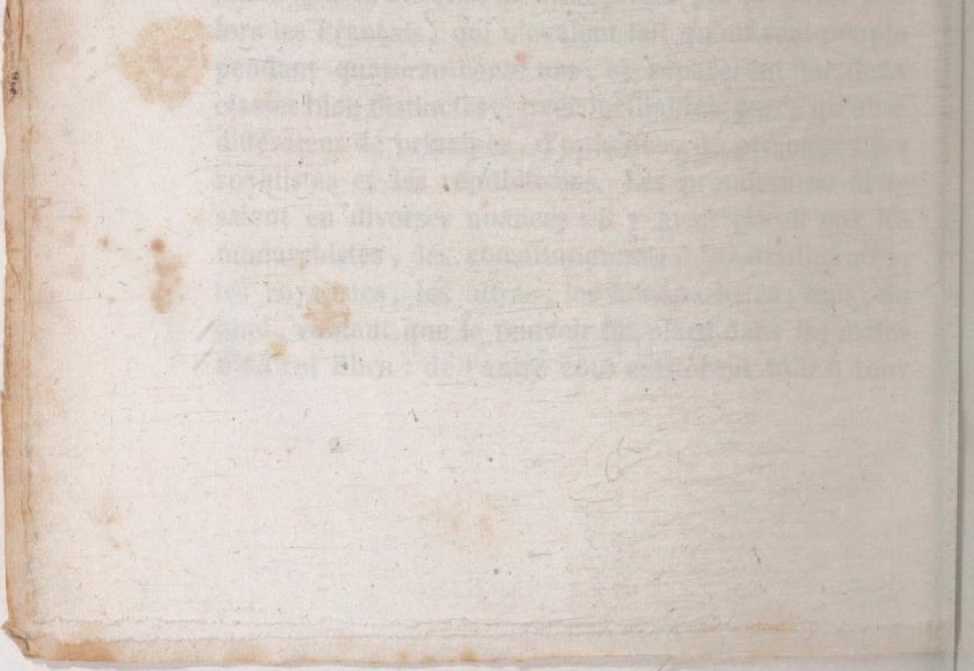

Page*.
Chapitre I". 1793 ; Convention nationale i
Séance du 29 mai et journée du 31 mai. .23
Jugement et supplice de la reine...... 52•
Translation A'Egalité à Paris, et sa mort. 64
II. III. IV.
VU. État de la France après le 9 thermidor. . . 143
XI. Quelques grands capitaines. — Napoléon. 202
XII. Départ de Bonaparte pour l’armée d’Italie. 221
XIV. Situation de la France et de l’Europe en
XVII. Nouvelle coalition contre la France. . . . 334
XVIII. Antiquité et grandeur de la maison royale de France. — Retour de Napoléon. . . 361
FIN UE LA TABLE.