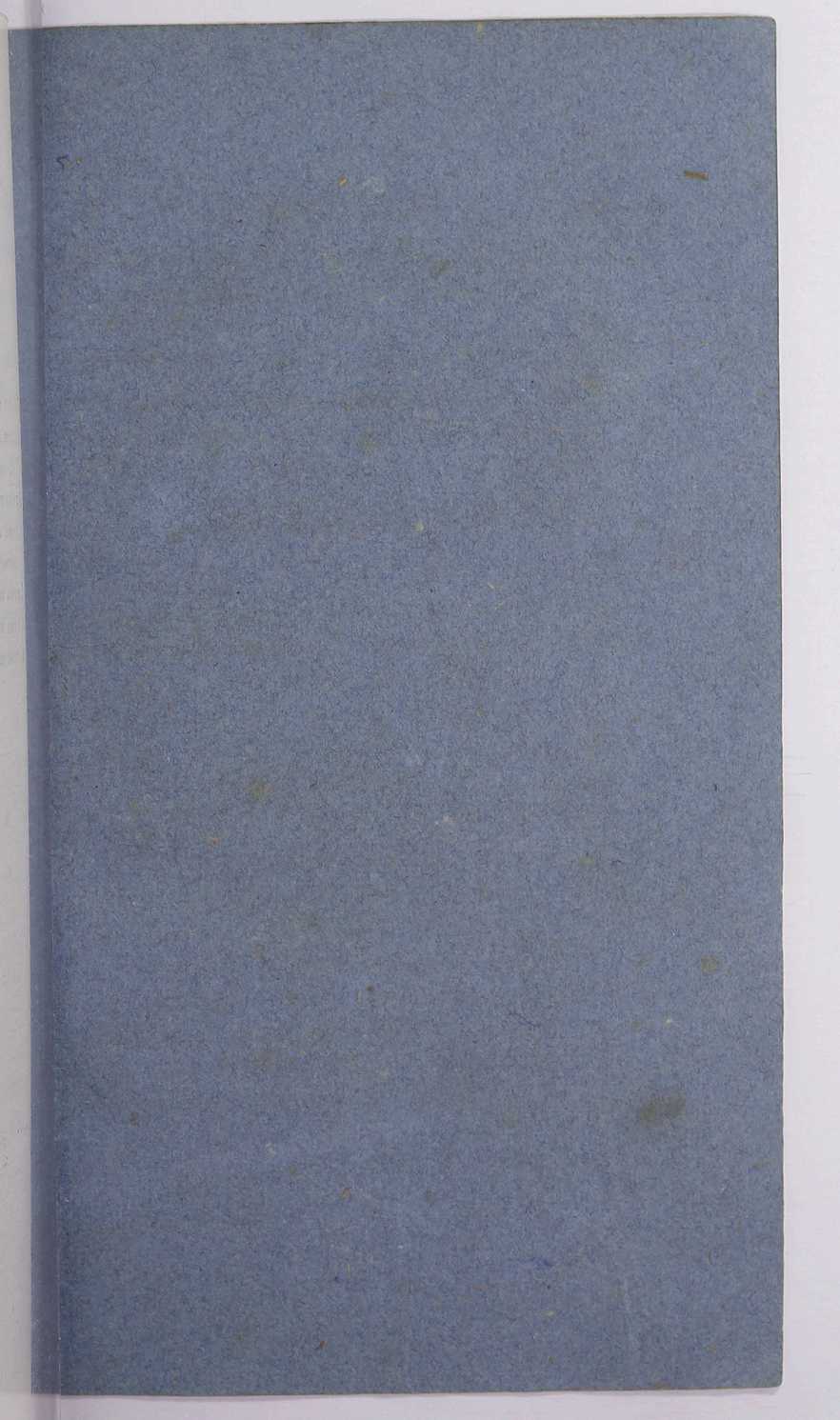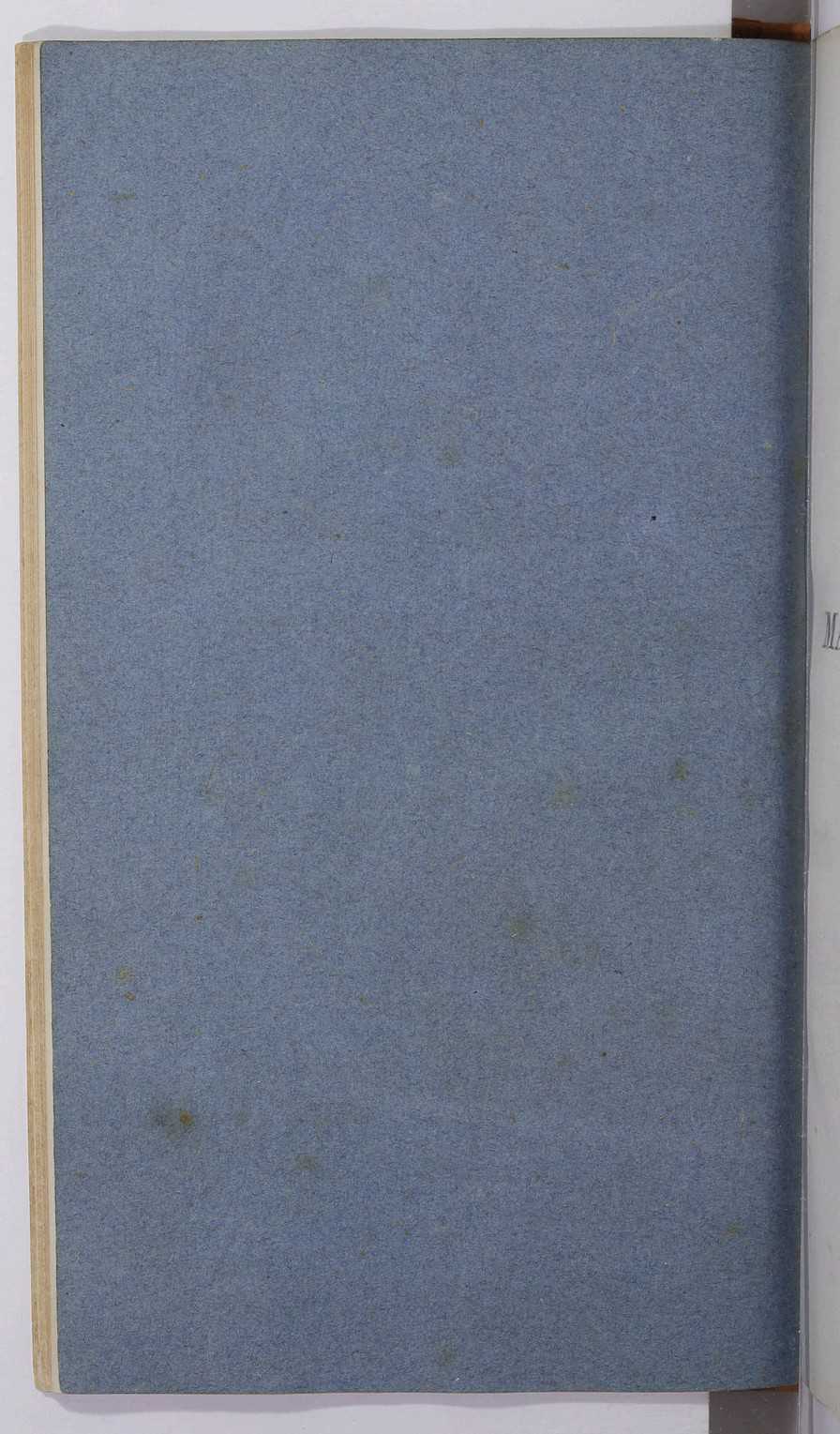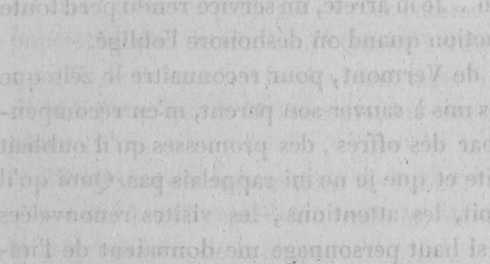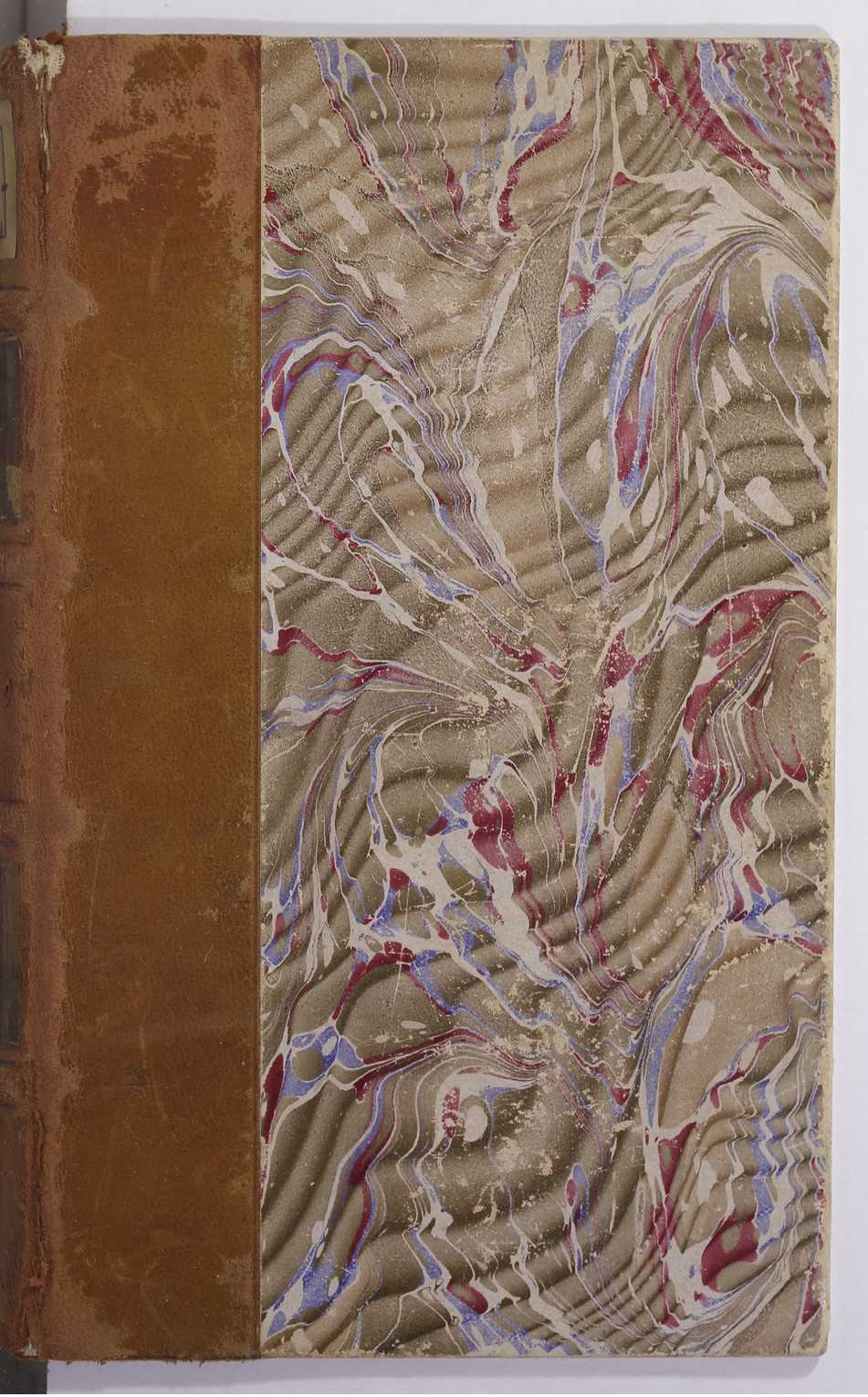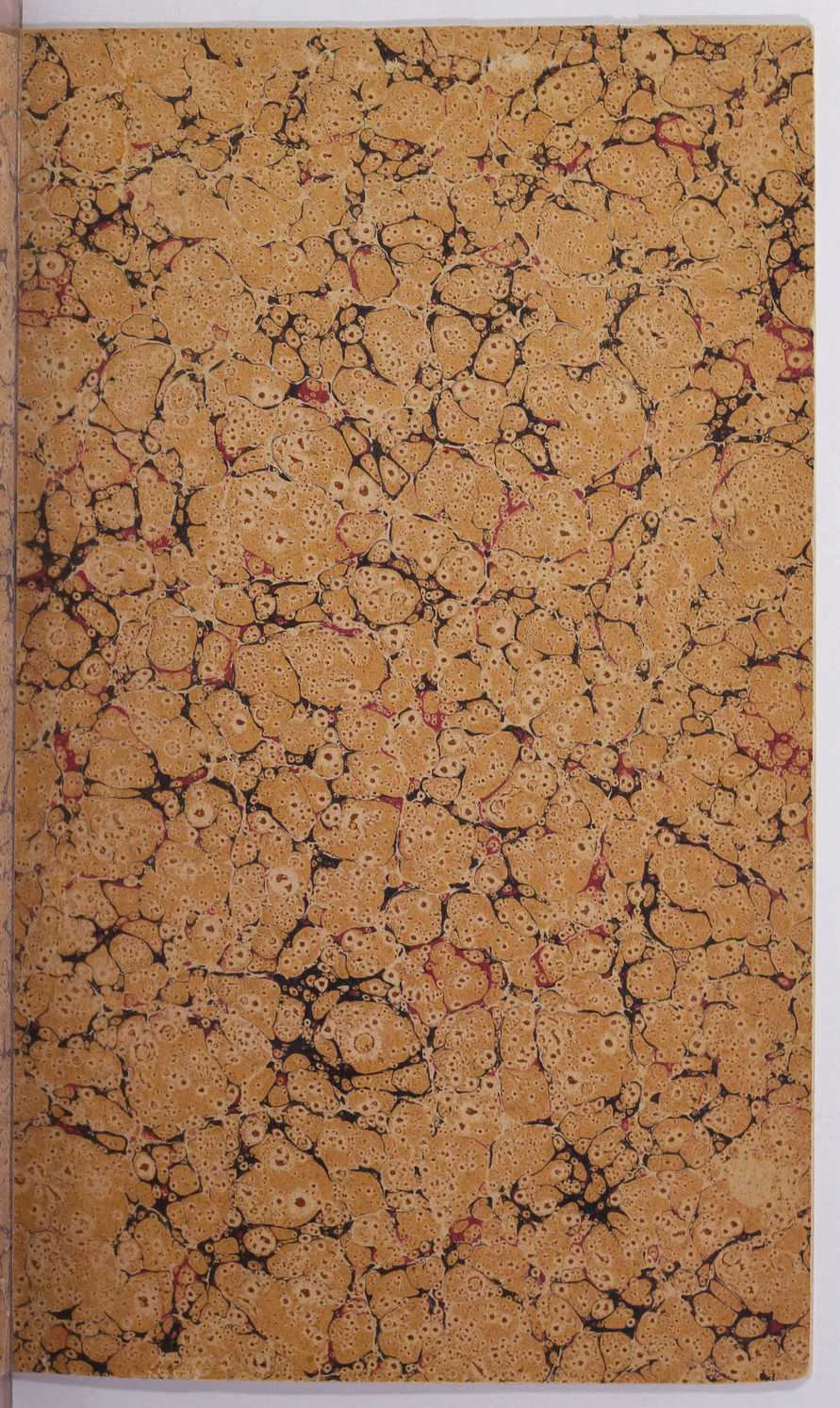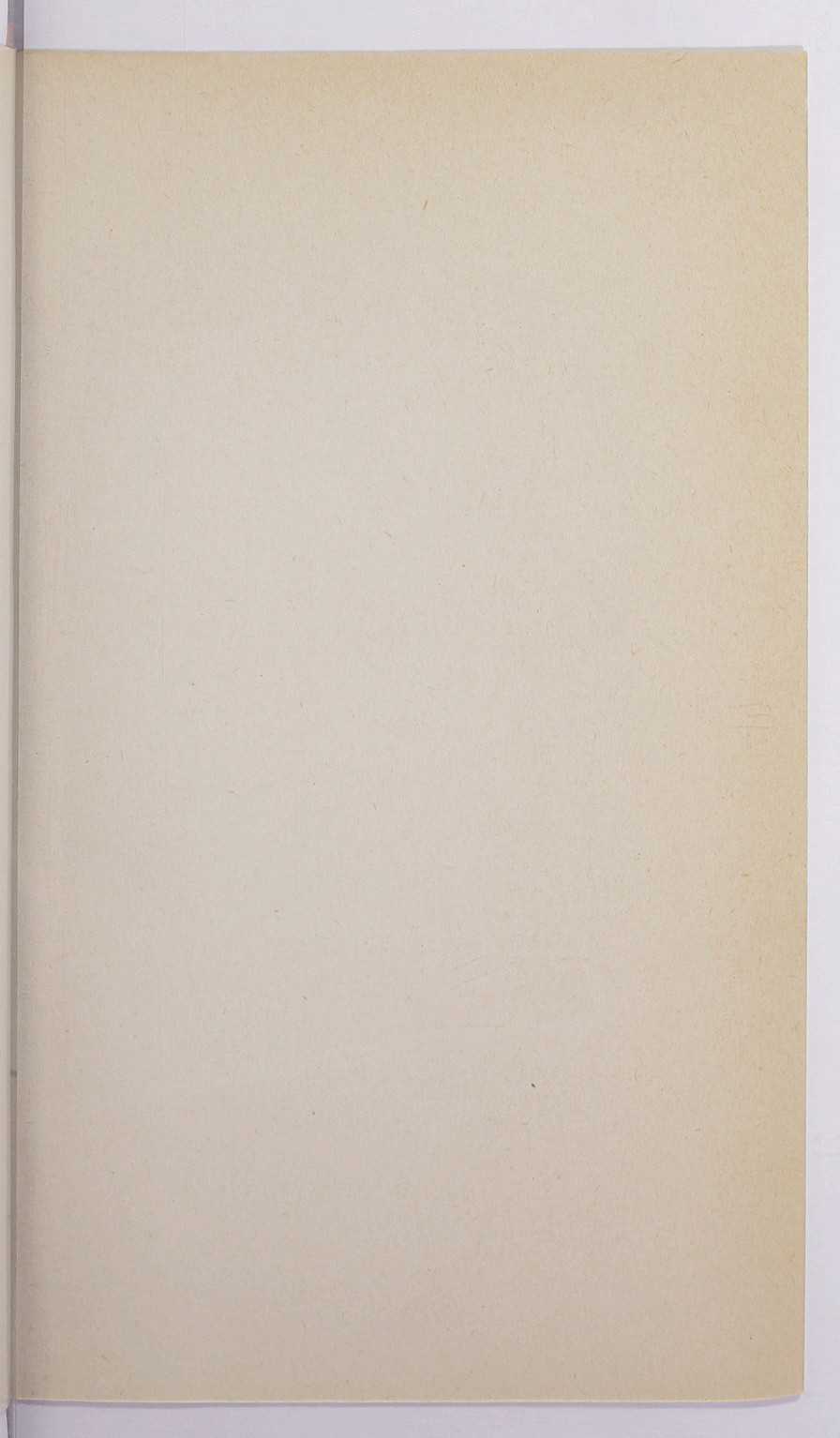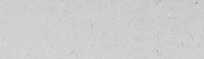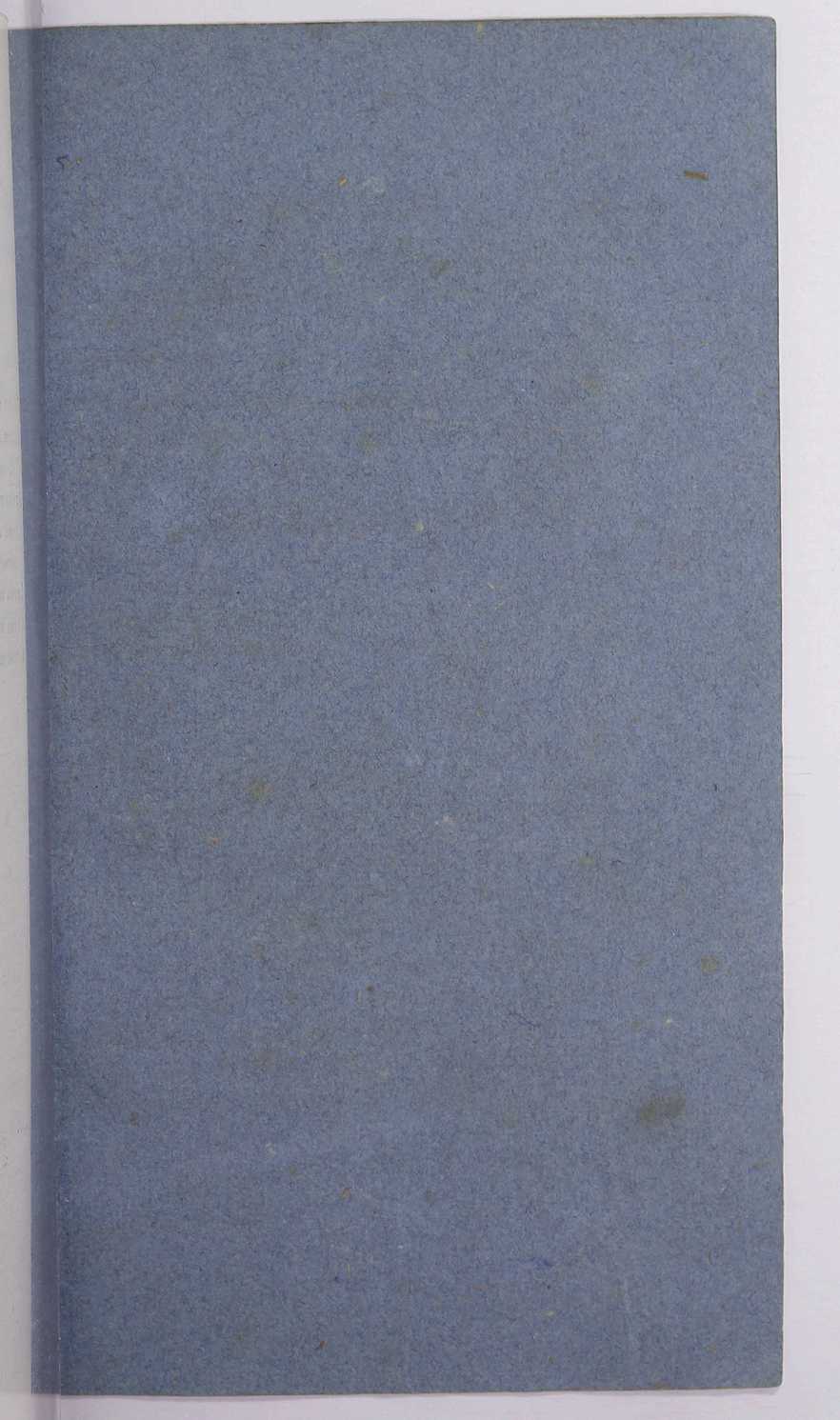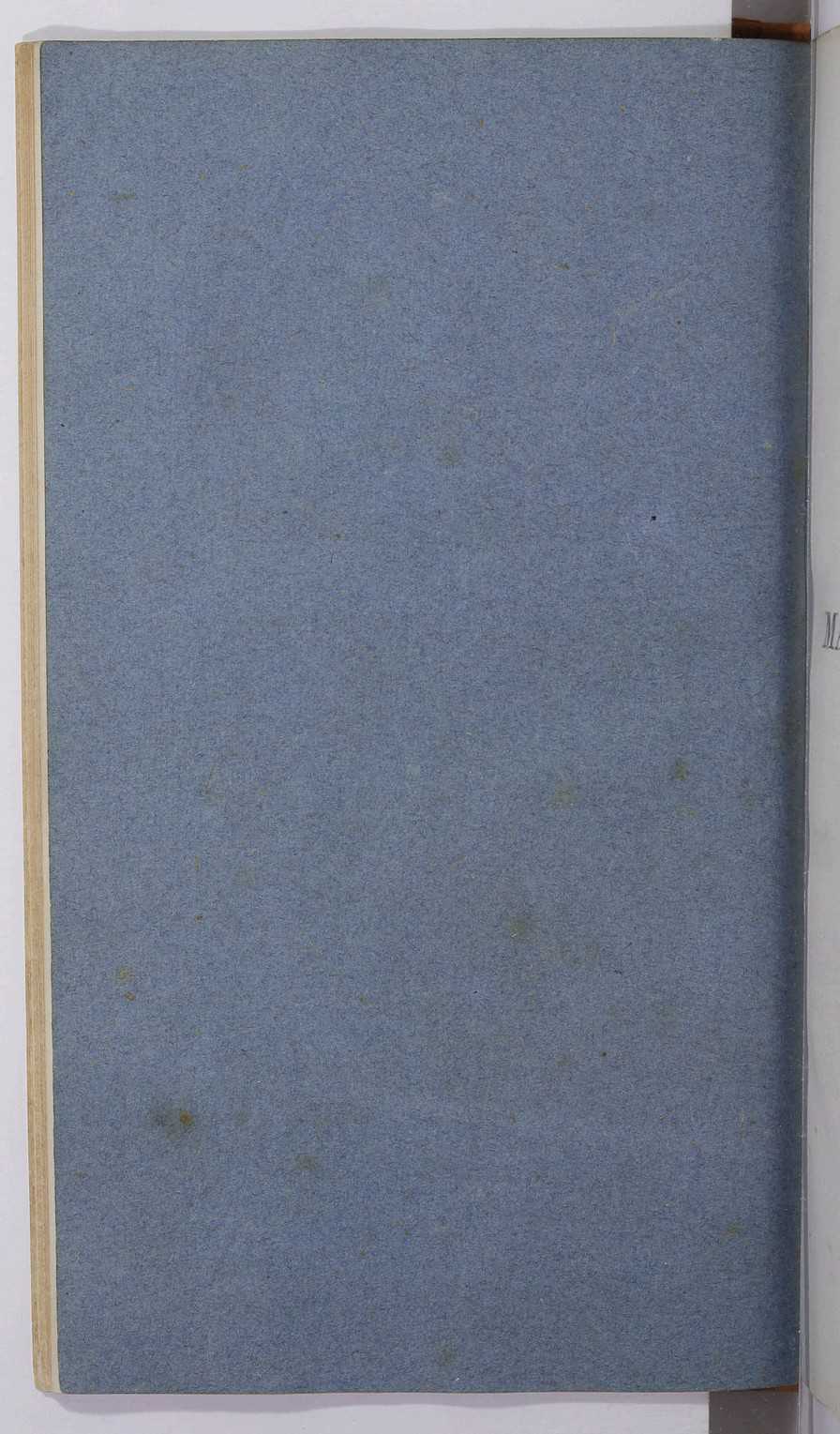Souvenirs sur Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France, et sur la cour de Versailles.
Tome 3 / par [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Lamothe-Langon, Étienne-Léon de (1786-1864). Auteur du texte. Souvenirs sur Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France, et sur la cour de Versailles. Tome 3 / par madame la Csse d'Adhémar,... [par É.-L. de Lamothe-Langon]. 1836.
-
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
-
- La3réutilisation"non1commerciale3deEces 5contenus5ouJdans5le3cadre3d’une3publication " académiqueEouJscientifique3 est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
-
- La réutilisation~commerciale de ces5contenus5 est 1payante et 1fait 1l'objet1d'une licence. Est1entendue par réutilisation1 commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
-
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
-
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
-
- des 5 reproductions 5 de documents5protégés 5 par un " droit 1d'auteurrappartenant 1à un tiers. Ces5documents5ne peuvent t être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
-
- des5reproductions5deEdocuments!conservés5dans5les5bibliothèques5ou . autres5institutions5partenaires. Ceux-ci sontt signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
-
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
-
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
-
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
-
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.
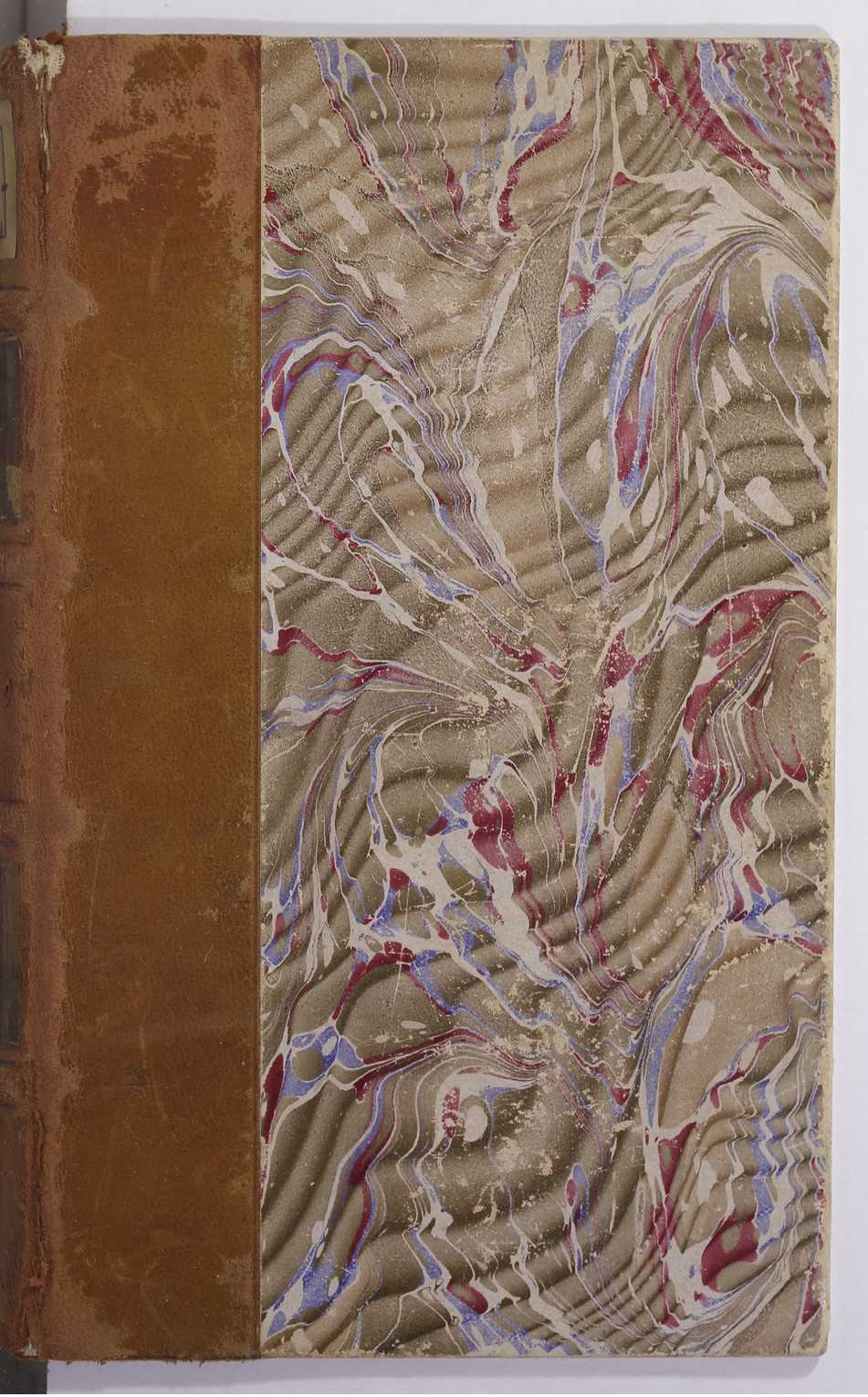
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

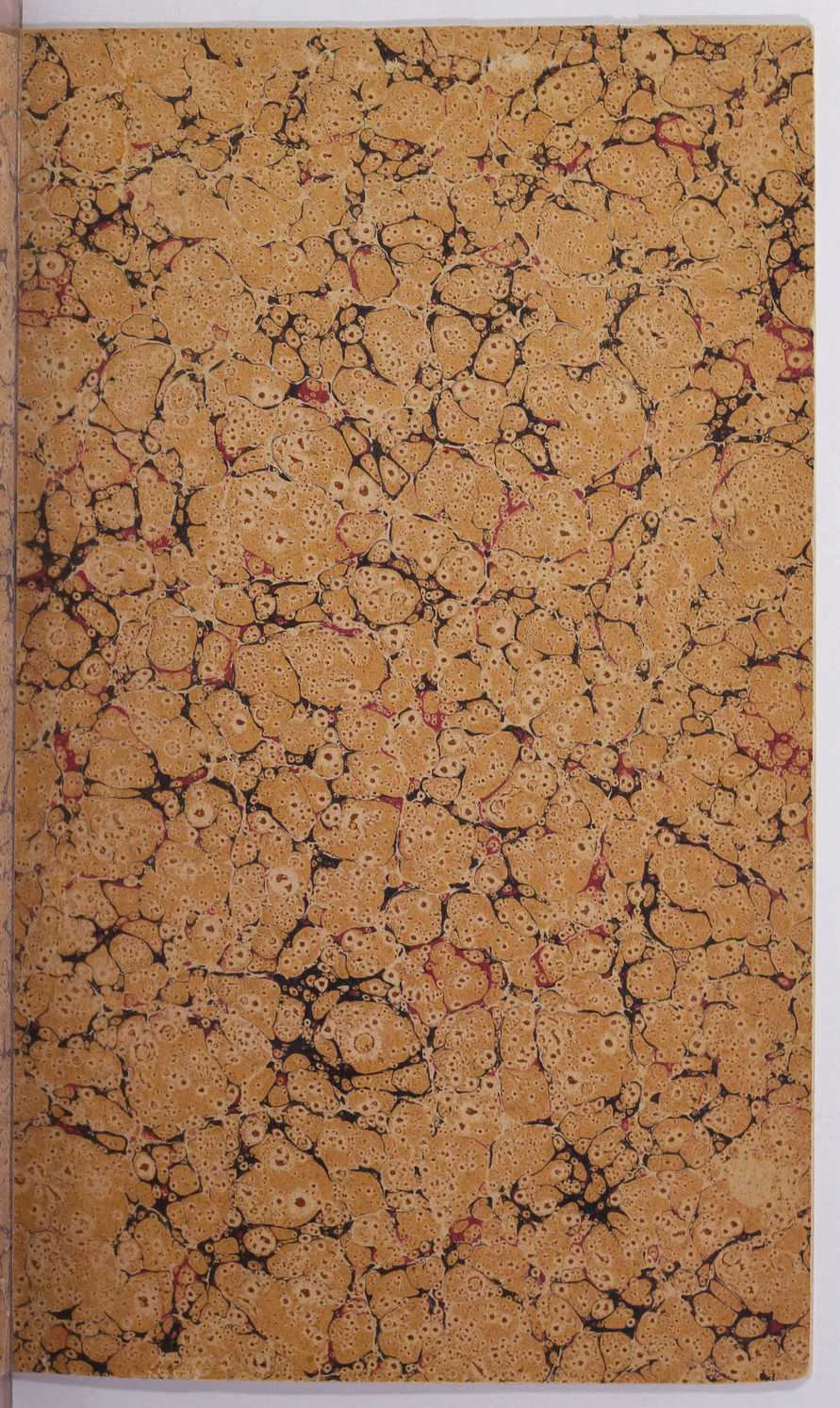
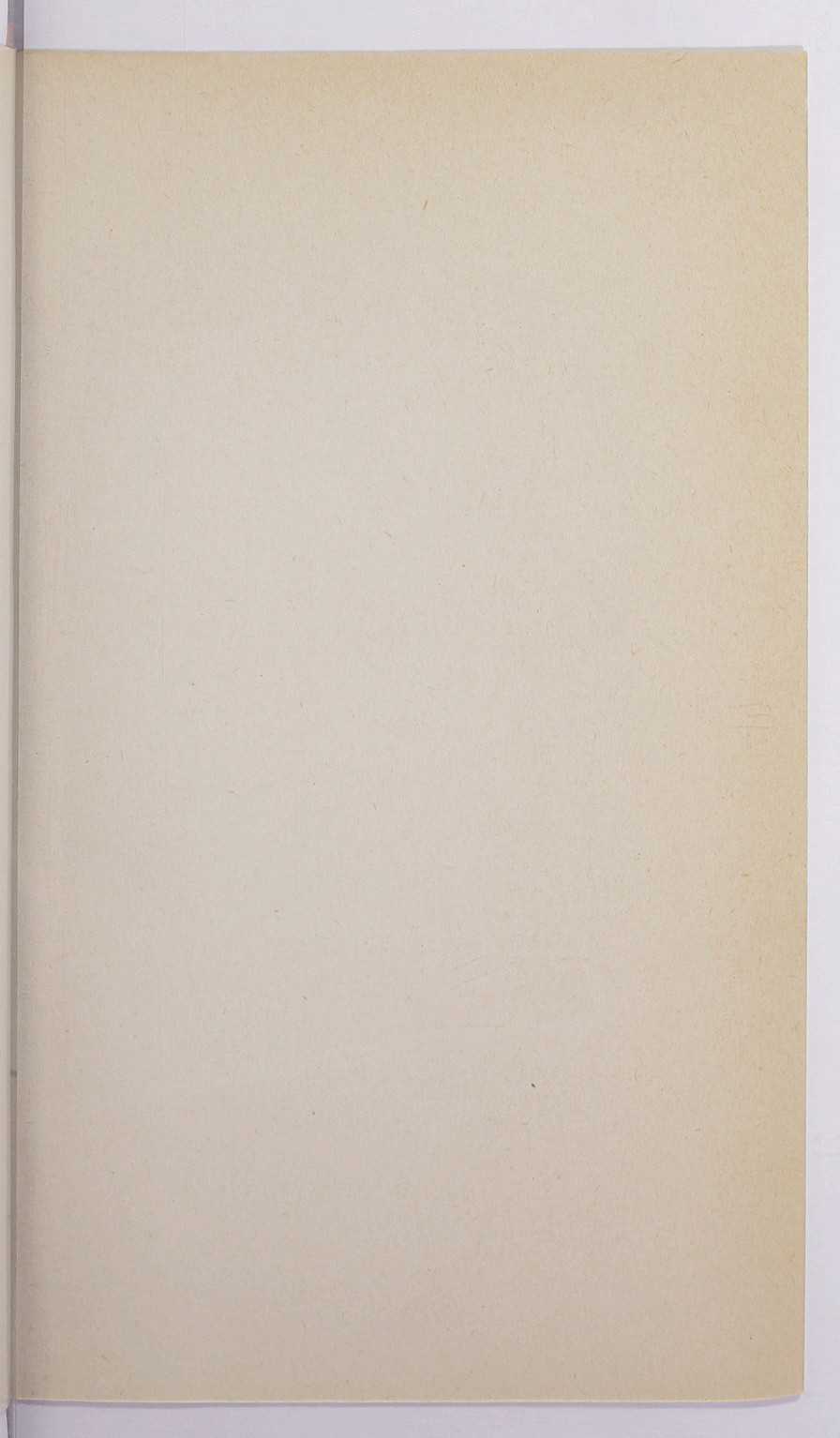

SOUVENIRS ■ £231
MARIE-ANTOINETTE.
imprimerie de bourgogne et martinet
BCl BD COLOMBIE» , 50.
SOUVENIRS
MARIE-ANTOINETTE,
la Cour de Versailles,
LA C«« D’ADHEMAR,
TOME TROISIEME,

L. MAME, ÉDITEUR,
MB GCÉNÉGAUII, 331
1836,
VFMPEREVB JOSEPH Ił.
A mesure que j’avance, je m’effraie de la tâche immense que je me suis imposée ; les faits se pressent tellement sous ma plume, que je dois nécessairement les diviser , les choisir , rejeter ceux qui n’offrent qu’un intérêt secondaire, pour n’admettre que les plus curieux, sinon je me laisserais entraîner au-delà des bornes que je me suis prescrites, et je suis un peu comme le naïf La Fontaine :
Les longs ouvrages nie font peur.
AU.
D’ailleurs n’est-ce pas à Marie-Antoinette que tous mes souvenirs se rattachent, à cette auguste reine dont la mort, hélas ! pèse trop affreusement sur mon cœur. Et en outre, je le répète, je regarde comme un devoir de la disculper des atroces calomnies dont elle a été l’objet, de la montrer sousson vrai jour,gaie,simple,charitable, pieuse, bonne fille, épouse irréprochable, mère parfaite, méritant enfin l’estime des hommes et la pitié des saints. Assurément, parmi les habitaos des demeures célestes, aucun ne souffrit davantage et n’était plus digne que la femme du vertueux Lotus XVI, de la palme du martyre.
Mais oublions le passé, car je sens mon indignation surgir à l’idée de l’horrible supplice que îles hommes osèrent infliger à une femme inoffensive, à une reine comme elle. Soyons magnanime, pardonnons à ses bourreaux 1..... Revenons à des scènes plus douces, à ces scènes d’intérieur où Marie-Antoinette se détache comme une figure brillante et gracieuse qui éclaire, qui se reflète sur tout ce qui l’approche*
Malheureusement les archiducs d’Autriche ne pouvaient être comparés à cette princesse , sous le rapport de ces agrémens extérieurs qui la rem
daient si ravissante. J’ai déjà fait le portrait du prince Maximilien, et maintenant je vais parler de l’empereur Joseph qui vint aussi à Paris. Bien que moins disgracié que son frère, sçs traits n’auraient pu soutenir une sévère critique ; la coupe de son visage manquait de noblesse, et sa taille n’offrait rien que d’ordinaire.
Quiconque aurait vu l’empereur sans le con* naître ne l’eût nullement deviné; il se mettait d’ailleurs sans goût, ses habits étaient mal coupés, de couleurs désavantageuses, son épée posée sans grâce, et de plus, il y avait toujours quelque chose de travers dans sa coiffure. Je fus altérée à son aspect, car j’espérais qu’il détruirait la fâcheuse impression qu’avait laissée le souvenir de l’archiduc Maximilien.
J’étais d’affection, je dois le dire, très avant dans le comité autrichien, cet être de raison dont on fit un corps palpable, meme à une époque antérieure à la révolution. A entendre les mé-chans et les sots , un grand nombre de Français de haut rang auraient été d’accprd pour ruiner la nation dans le seul avantage de la cour de Vienne. Le comité autrichien disposait des reve nus de l’État au profit de l’empereur; il subor-
donnait la politique du cabinet de Versailles à celle du cabinet de Joseph lï ; il lui livrait nos secrets, nos soldats, nos flottes, nos arsenaux; enfin jamais il ne fut accusation plus étendue, crimes plus vastes, complices de meilleure intelligence. Mais où les trouver, où donc se trouvait le comité autrichien ? Quels étaient ses membres? Voilà ce qu’il était impossible de dire.
N’importe, on n’a pas moins persisté à prétendre qu’il existait, et chaque jour encore les gazettes de la Montagne le jettent comme un épouvantail aux esprits crédules de la nation.
Si vous voulez savoir ce qu’était ce comité autrichien , je vais vous le dire, moi: un groupe de serviteurs dévoués à la reine, qui l’aimaient assez pour respecter sa famille, qui louaient Marie-Thérèse et Joseph II, sans se mêler de la paix ou de la guerre. Néanmoins, bien qu’il ny eût aucune politique dans tout cela, on ne peut disconvenir qu’involontairement nous n’ayons fait beaucoup de mal à notre reine infortunée, j’en fais mon meâ culpâ.
Malgré mes préventions en faveur de tous les membres de la famille impériale et le portrait flatteur sous lequel Ma rie- Antoinette nous avait
représenté Joseph II, je répète queje fus cruellement mystifiée lorsque je le vis* Madame de Talleyrand, qui était anti-autrichienne, ainsique la maligne marquise du Défiant, vendue corps et âme à l’Angleterre, à cause de son ami Horace Walpole, se moquèrent sans pitié de ma naïveté. Force me fut de reconnaître que l’empereur ne pouvait soutenir la comparaison avec M. le comte d’Artois, ce modèle achevé d’élégance , et même avec M. le duc de Chartres.
Cependant j’eus ma revanche. Joseph IT, doué de beaucoup d’esprit et de jugement, sut plaire à chacun, en ne disant que ce qu’il fallait dire et montrant en tout une conduite pleine de tact et de mesure.
Il y a de par le monde une dame de Coaslin , qui a de la finesse à revendre, mais de bon sens point, sorte de folle raisonnable, hardie, audacieuse, rompant en visière à tout l’univers, et échappant, par la vivacité de ses reparties, aux coups de boutoir que lui attirent ses impertinences. Ne s’avisa-t-elle pas, la malapprise! quoique certes elle n’ait guère vu que bonne compagnie, d’attaquer chez madame de Lamballe M le comte de Fœlkeinstein (on sait que
c’était le nom de guerre de l’empereur ), à propos du soulèvement de l’Amérique septentrionale contre l’Angleterre ! Cette nation ingrate voulait rompre les liens du sang, elle prenait les armes contre la mère-patrie, et à Paris on trouvait cela sublime. A Paris soit, parmi la roture, la finance et labasserobe;mais à Versailles, aumilieudenous autres nobles féodaux et en face la majesté royale, conçoit-on que l’on pût être insurgent ? Cependant cette aberration existait déjà dans certains esprits.
On se passionnait dans ce Versailles pour ces rebelles d’outre-mer, et voilà madame deCoaslin qui, chez madame la princesse de Lamballe, en présence de la reine, s’avisa de dire à l’empereur, de sa voix aiguë et traînante :
—Eh bien, monsieur le comte, que vous semble des insurgens ? n’est-ce pas qu’ils sont admirables ?
— Madame, répondit sèchement l’empereur , ma position me fait un devoir d’être royaliste.
M. de Maurepas se prit à sourire, la reine se mordit les lèvres, nous gardâmes toutes le silence, et madame de Coasiin marmotta à l’oreille du chevalier de Crussol, aussi présent:
— En effet, que pouvait dire de mieux ce
pauvre prince ? à sa place c’était fort embarrassant.
Cette réponse convenable de l’empereur n’est pas la seule de ce genre que je lui aie entendu faire ou qu’on m’ait rapportée; il avait aussi des mots fort heureux. Je me rappelle à ce sujet d’avoir vu l’excellent comte de Buffon pleurer et rire tout à la fois de plaisir. Joseph II n’avait pas manqué de visiter le Jardin-des-Plàhtes ; en abordant le grand naturaliste qui en était l’intendant, il lui dit :
— Monsieur, me voici sur les terres de votre empire.
Puis, comme si un souvenir soudain se fut présenté à sa mémoire :
— A. propos , monsieur le comte, ajouta-t-il, je ne dois pas oublier de réclamer un exemplaire de vos œuvres que mon frère Maximilien a laissé chez vous par distraction.
L’empereur ne pouvait réparer plus délicatement la gaucherie du pauvre archiduc (i). Là reine en but une vive satisfaction. Je crois avoir signalé que Joseph II ne fut injuste qu’en vêts sa sœur.
(r) Voyez Ionie 1”,
“ N’est-ce pas, avait-il dit à Campan en passant, que votre jeune et jolie reine est bien étourdie ?
Campan ne répondit rien ; mais l’empereur, ugeant à l’expression de sa physionomie qu’il était blessé au vif, reprit :
— Les souverains qui possèdent l’affection de leurs sujets la méritent sans doute par des qualités réelles.
L’empereur attaquait aussi quelquefois la reine à l’occasion de ses parures. 11 lui dit un jour, à propos d’une robe ravissante de fraîcheur et de dessin qu’elle portait :
— Cette étoffe doit coûter cher.
— Non, mon frère, puisqu’elle fait vivre des familles. Si je ne choisissais que des robes simples, deux cents maisons de commerce fermeraient demain leurs ateliers.
Souvent quand Joseph II sortait de chez la reine il la laissait triste et pleurant. Il prêtait trop l’oreille aux mensonges que la malignité faisait circuler sur Marie-Antoinette. Il eut un moment où il s’engoua de tout ce qui venait du Palais-Royal; et je sais qu’il se plaignit une fois de ce qu’il appela les familiarités du duc de Coi-
SUB MARIE-A N TOI NETTE. g gny et des arrogances de M. de Vaudreui!, et cela assurément sans la moindre raison.
Le duc était le seigneur le plus respectueux de la cour. M. deVaudrcuil, en créole ou en enfant gâ-té, avait un laisser-aller qui n’imposait à personne. Mais des ennemis tirent parti de tout ; et madame de B...., que l’empereur voyait chez le comte de Mercy, ayant eu mission du duc de Chartres de calomnier la reine, ne trouva rien de mieux que de parler méchamment du duc et du marquis.
Cette fois Marie-Antoinette se fâcha sérieusement, et elle força l’empereur de lui nommer madame de B...., qu’on envoya aussitôt chercher. J’arrivais pour faire mon service; et, comme je passais ordinairement par les petits cabinets, je rencontrai la comtesse de B.... qui prenait la même voie. Pâle, embarrassée, elle me salua la première, elle si raide, si gourmée. — Oh, oh! me dis-je, que signifie ceci? Je pris en humilité ma bonne fortune. Mais ma surprise augmenta; car madame de B.... me fit un éloge pompeux de la reine, me vanta son attachement, son amour pour cette princesse. En l’écoutant j’en étais stupéfaite.
Cependant j’allais prendre congé de la com-
lesse, croyant qu’elle attendait une audience sollicitée, lorsque nous entendîmes du bruit dans la pièce voisine. On éleva la voix : c’était Marie-Antoinetté et Joseph IL
Madame de B.... trembla, ses dents se choquaient ; j’en eus pitié : je lui offris un flacon d’alcali volatil que je portais avec moi. Présent de la reine, il était en cristal de roche, précieusement taillé, avec les armes de S. M. : chaîne du plus beau jaseron de Venise, étui galuchat vert garni en or, rien n’y manquait.
Madame Campan entra en ce moment. Je m’avançai , croyant que c’était moi qu’on demandait; mais la première femme de chambre, me repoussant par une civile révérence, se tourna vers ma compagne et lui dit :
— Madame , la reine est là.
La comtesse de B...., attérée et toujours mon flacon à la main, ce qui certes était contre les règles de l’étiquette, passa dans l’autre pièce, dont madame Campan referma soigneusement la porte. Nous n’entendîmes pas moins une scène des plus violentes : nous en avions le frisson.
L’empereur, du ton d’un écolier pris eh flagrant délit, répéta, sur la demande impérative
de la reine, tout ce que madame de B.... lui avait raconté. Elle resta muette, n’ayant rien à dire pour sa justification. S. M. alors d’une voix solennelle :
•— Madame, dit-elle, je m’abstiendrai de qualifier votre conduite; néanmoins je vous la pardonne, à une condition toutefois, c’est que vous me ferez connaître la personne qui vous a chargée de débiter ces calomnies.
Il y eut un moment de silence. Je me flattais qu’une hante intrigue allait être découverte. Il paraît que la comtesse hésita ; mais lorsqu’on pouvait espérer qu’elle se laisserait toucher par l’indulgence de la princesse, elle répondit effrontément :
— Ce que la reine me demande est impossible. J’ai inventé tout ce que j’ai dit à M. le comte. Au reste, je suis à la disposition de S. M. Cependant si elle me punit, toute l’Europe saura qu’un empereur manque à sa parole, car il m’avait promis le secret, et que c’est lui qui est mon délateur.
— Eh bien ! mon frère, reprit Marie-Antoinette en se tournant vers lui, une autre fois vous croirez à l’intérêt qu’on vous porte et à la véracité de ceux que vous daignez écouter quand
ils ne-craignent pas de calomnier votre sœur. Ces paroles de la reine furent une représailie bien terrible ; mais aussi avec quelle indignité ou Pavait outragée!
S, M. en achevant ajouta :
— Sortez, madame, je vous abandonne à vos remords.
La comtesse dc B.... ne se le fit pas dire deux fois, elle rentra où elle aurait voulu ne pas nous trouver madame Campan et moi : son visage était en feu. Elle me rendit mon flacon sans mot dire, me lança un regard de haine et de menace, puis disparut.
La reine sonna aussitôt. La première femme de chambre courut à l’appel et revint me dire que j’étais demandée. Je me rendis à l’ordre de S. M., presque aussi effrayée que si j’avais été complice. L’empereur, quand j’entrai, sortait par l’autre porte. La reine en me voyant dit :
— Je suis charmée que vous vous soyez trouvée là : votre discrétion m’est connue, et j’aurais été moins sûre de celle d’une autre... Je me suis doutée qui nous entendait à la vue du flacon à nies armes que tenait madame de B.... Elle s’est donc trouvée mal avant de comparaître?
Je répétai ce qui s’ôtait passé.
— Que ceci lui serve de leçon, poursuivit la reine. Ah! madame... et c’est une famille que le roi a comblée de biens. Voilà comme on nous récompense ; j’en ai le cœur brisé!
Le même soir, au jeu de la reine, M. le duc de Penthièvre me prit à parti et mediten baissant la voix :
— Il y a une personne bien malheureuse, madame, qui espère en votre générosité pour ne pas révéler ce que le hasard vous a fait découvrir.
Je compris l’allusion du prince.
— J’ai à Versailles, répliquai-je, des yeux pour ne rien voir et des oreilles pour ne rien entendre.
Il sourit tristement et vint le lendemain chez moi. Je le reçus avec autant de respect qued’em-barras, lui-même ne savait trop comment aborder la question ; il finit par comprendre que le mieux, lorsqu’on a une mauvaise cause à défendre, c’est de convenir qu’elle ne vaut rien.
— Vous avez, me dit-il, assisté hier soir à une scène?
— Affreuse en effet, monseigneur , répliquai-je.
— Soit ; mais enfin je suis venu avec la mission de vous demander un silence absolu.
— Je l’ai promis à la reine.
— MJe duc d’Orléans en est désespéré, et mon gendre...
J’eus pitié de cet excellent prince.
— Je supplie votre altesse royale, repris-je, de changer de conversation, celle-ci nous est trop pénible.
— Ah! madame d’Adhémar, ils me tueront.
Depuis ce moment mes lèvres sont restées closes, et jamais je ne signalerai plus clairement que je ne l’ai fait, la personne dont il s’agit dans cette fatale aventure; tout m’en fait un devoir, et aujourd’hui plus qu’en aucun temps (i).
Tandis que ce fait si désagréable me plaçait dans une fausse et fâcheuse position, la petite cour de Madame de France était fort égayée par la demande en mariage qu’une chanoine de Lu-
zarche, ville voisine de Chantilly, venait de faire à la princesse Adélaïde. Voici les détails de cet acte de folie tels que S. A. R. daigna me les raconter.
« Hier, M. le baron de Montmorency, chevalier de l’ordre, et mon chevalier d’honneur, me demanda si j’aurais pour agréable de recevoir un chanoine, prêtre de bonne mine, quoique assez âgé,bien vêtu, et qui tient à ne révéler qu’à moi seul un secret d’où dépendait le bonheur de ma vie.
» Ceci me fut dit en présence de madame la comtesse de Narbonne, dame d’atours delà princesse, laquelle, d’un air mécontent, s’informa de mon chevalier d’honneur depuis quand il se chargeait des présentations. Les voilà à se prendre de querelle, et moi de rire en pensant que cette jalousie était excitée par un vieux prêtre. Je pris la parole à mon tour, et ordonnai à madame de Narbonne d’aller elle-même chercher le curé de Luzarche, Borrico ( François-Nicplas), et de me l’amener.
»B entre, me salue; les deux assistans se retirent dans l’embrasure d’une fenêtre, et trouvant sans doute le lieu commode à une dispute,
recommencent la leur de manière à ne pouvoir entendre un mot à ce qu’on disait de notrecôté. Quant à moi, me voyant en présence du saint homme :
— Eh bien, monsieur le chanoine, lui dis-je, me communiquerez-vous ce qui doit assurer le bonheur de ma vie?
— Je supplie votre altesse royale, répliqua-1- il, d’excuser mon audace, mais je suis envoyé par le Saint-Esprit avec la mission de vous dire que pour le bon exemple vous devriez vous marier... Oui, madame, il vous faut prendre un mari; peut-être seriez-vous embarrassée sur le choix si je n’étais là. Que votre altesse royale connaisse enfin le secret de mon coeur, je l’aime depuis vingt ans, et par respect j’ai caché ma tendresse. Aujourd’hui que cet hymen est une affaire du ciel, je crois devoir parler.....Que Madame se lie donc à moi par des noeuds indissolubles; j’ai la parole du pape qui viendra lui-même célébrer la cérémonie; et comme il serait possible que le roi hésitât à donner son consentement, vu ma position actuelle, j’ai prévu cette difficulté en dressant moi-même le contrat de mariage,où votre altesse royale verra que je minti tyle 1res haut et très puis-
SUR MARi£-ANTOINETT£. 1^ sant seigneur Alexandre César Néophyte (le Lusignan; attendu que je descends incontestablement des rois de Jérusalem et de Chypre.
» A mesure que cet insensé avançait dans ses discours, j’étais dominée à la fois par l’envie de rire et la frayeur; la première l’emporta, et me tournant vers mes deux grands-officiers dont la querelle ne se ralentissait point :
— Madame de Narbonne, dis-je, voici M. l’abbé qui vient me demander en mariage, et qui apporte le contrat prêt à signer.
> Madame d’atours faillit tomber à la renverse ; le baron de Montmorency, tout confus de son patronage, court au chanoine, le prend par le bras, l’emmène en toute hâte, tandis que le pauvre homme se lamentait contre la barbarie de mes tyrans, de mes argus, ennemis de notre commune félicité. »
Et madame Adélaïde de se remettre’ en accès de gaieté, et d’ajouter :
« Madame d’Adhémar, si je suis célibataire, ne croyez pas que ce soit faute de demandes en mariage. Voici la seconde fois queje trouve l’occasion de m’établir honorablement. M. Jollain, ex-marchand de dentelles, qui avait obtenu une
Ut.
petite charge dans la maison du roi, se trouvant un soir avec mon père dans les petits apparte-mens, l’arrêta très humblement entre les deux portes, et là lui demanda ma main. Il se flattait que S. M., en faveur de l’alliance, me doterait de la comté de Toulouse, si mieux il n’aimait se dessaisir de la Provence, en se réservant Forcal-quier et les îles d’JIyères, auxquelles lui, M. Jol-lain, ne tenait pas beaucoup. Le roi répondit en riant qu’il allait me consulter, et qu’il lui communiquerait ma décision. En effet, il me fit appeler, et devant mes sœurs me rapporta la proposition du digne M. Jollain. On se contenta de renvoyer l’extravagant à Paris dans sa famille. Quant à M. Néophyte de Lusignan, on va, par mesure de prudence, le diriger sur Charenton. »
Le comte de Falkeinstein était alors à son premier voyage en France, je reviens à lui. J’ai su que la reine lui reprocha avec amertume sa facilité à admettre les faux rapports qu’on lui faisait sur elle. M. Campan m’a dit qu’un jour où il présentait à Marie-Antoinette des papiers peu importans à signer, l’état émargé des officiers de sa maison, l’empereur lui demanda pourquoi elle signait sans lire.
— Si Ton surprenait votre confiance ? ajouta-t-il.
— La courdes comptes est là pour régulariser les erreurs, répondit la princesse; d’ailleurs, M. Campan est un honnête homme, outre qu’il n’aurait rien à gagner à me tromper; lorsque les choses en valent la peine, j’examine avec soin, non par méfiance, mais pour savoir ce que je fais.
Joseph II aimait sa sœur, quoiqu’on puisse en douter d’après ce que je rapporte. En lui cherchant querelle, c’était moins dans l’intention de la tourmenter que parce que la prospérité de la France lui inspirait une profonde jalousie.
— Quel royaume, disait-il, si l’on en comprenait bien toutes les ressources ! Le roi de France pourrait l’être du monde entier, dans le cas où la fantaisie lui en prendrait. En Autriche, ajoutait-il, lorsque je veux mettre une idée à exécution, il faut que je l’inculque dans chaque tête de mon conseil; au lieu qu’en France, si je la jetais, elle serait ramassée et commentée par le dernier des employés de l’État.
Je me suis laissé conter par M. de Mercy une anecdote fort extraordinaire, relative au roi, à la reine et à l’empereur. Je vais la répéter, en la
donnant telle que je l’ai reçue, sans vouloir en prendre la responsabilité, mais persuadée de la véracité du noble ambassadeur.
Le roi Louis XVI, causant avec son beau-frère , lui demanda s’il avait vu Saint-Denis. La réponse fut négative.
— Je ne connais pas non plus cette royale abbaye, ajouta Louis XVI.
— Quoi! mon frère, vous n’avez jamais eu le désir d’aller visiter le lieu que vous habiterez un jour, auprès de vos aïeux !
— Ce serait réellement réjouissant, repartit le roi avec gaieté : est-ce un plaisir que vous vous procurez souvent ?
— Je croyais qu’Antoinette vous aurait entretenu des habitudes de ma famille. Oui, sire, les princes de la maison d’Autriche descendent fréquemment dans les caveaux de l’église de Saint-Étienne. Ma respectable mère y va deux fois par mois, et pour moi c’est un besoin de suivre son exemple.
— Vrai, mon frère, vous me donnez l’envie d’aller, en votre compagnie, manger une matelote à Saint-Denis... Oui, mais comment s’y prendre? que chanteront là-dessus les registres
du grand-maître des cérémonies de France? Ici tout est soumis à des règles invariables : quand les rois s’ennuient à Versailles, ils ont la consolation de savoir pourquoi. Or, si je fais part de mon désir de courir cette aventure, il s’élèvera des prétentions entre le grand-aumônier et ces messieurs de Saint-Denis, entre le grand-écuyer, le grand-maître de la garde-robe, etc. ; puis viendront les gentilshommes de la chambre, les capitaines des gardes. On écrira des mémoires, on se plaindra, on protestera; et pendant tous ces débats vous partirez.
— Parbleu ! mon frère , s’écria l’empereur, votre majesté peut se vanter de jouir d’une heureuse indépendance !
— Voilà, dit la reine, les chaînes que j’ai trouvées en arrivant à Versailles; et l’on me reproche de vouloir les secouer! J’aurais pourtant grande envie d’aller à Saint-Denis avec vos majestés.
— Savez-vous ce qu’il faut faire ? dit l’empereur; partons tous les trois incognito à minuit; qu’une lettre de cachet, adressée à l’avance au prieur, lui enjoigne de tenir les portes ouvertes
à cette heure, et que tout, illuminé , soit livré à la curiosité d’une farfulle étrangère.
Le roi et la reine applaudirent à la pensée de Joseph IL Ce fut chez le couple royal à qui se réjouirait le plus de jouer un tel tour, Louis XVI au capitaine des gardes de quartier et au premier gentilhomme de service ; la reine à ses dames d’honneur, d’atours, à sa surintendante et à son chevalier d’honneur.
Ce délassement présenté sous cet aspect mystérieux interrompit quelque peu la monotonie ordinaire. Il ne faut pas grand’chose pour amuser les grands : il suffit de les faire sortir du cercle tracé de leurs plaisirs officiels. J’aurais pu me douter de ce qu’on tramait en dehors de nous par une question que me fit la reine : elle me demanda si j’avais vu Saint-Denis et ses cryptes; je répondis affirmativement. S. M. me pria en outre de lui donner divers renseignemens à ce sujet, et elle fut très étonnée d’apprendre que M. de Turenne reposait dans les caveaux, à côté de Louis XIV.
— Un sujet! dit-elle, c’est singulier!
— 11 n’est pas le seul, madame : le connétable
Duguesclin et de Sancerre y ont été placés aussi. — Autrefois c’est possible, mais de nos jours ! Lorsque la reine eut épuisé ma science elle cessa de m’interroger. Un moment elle eut le désir d’emmener madame de Guémené, mais elle y renonça; et je ne sais pourquoi la fantaisie lui prit lors du départ de joindre à l'auguste trio la princesse deLambalIe. A cette époque c’étaient encore les favorites.
A la nuit fixée pour le voyage, le roi, qui se releva avec l’aide de son premier valet de chambre, l’excellent Thierry, car on avait simulé la scène du grand et du petit coucher, passa en bonne fortune chez la reine, où l’empereur arriva à son tour. Madame de Lamballe se fit attendre. Ce fut, ai-je su par madame de Misery, des excuses sans fin.
La reine/heureuse de cette équipée, riait aux larmes. A une heure du matin on était en route, à la surprise inexprimable du service de l’écurie, qui avait reconnu les pèlerins : des relais étaient disposés à l’avance. Pour ne pas traverser Paris, on prit par Saint-Cloud , bois de Boulogne et le chemin de la Révolte.
A Saint-Denis tout était en mouvement. ï/am-
pleur de la lettre de cachet, l’ordre d’illuminer l’église et les souterrains, firent deviner une partie de la vérité : on se douta de la venue de l’empereur; mais qui pouvait croire que le roi et la reine l’accompagneraient ^ Aussi personne ne s’en occupa. Le prieur, charmé de trouver l’occasion de voir Joseph II, voulut jouer de son côté un rôle dans cette mystification réciproque.
Un page, déguisé en jockey, courant bride abattue, alla annoncer l’arrivée de ses maîtres.
— Leurs noms ?
— Je ne me les rappelle pas bien; mais si vous êtes si curieux de les connaître, vous pouvez les leur demander.
Le grand-prieur et deux acolytes parurent à la porte pour recevoir les étrangers. On les fit entrer dans une salle où des rafraîchissemens avaient été préparés. Le roi mangea avec appétit, l’empereur prit une tasse de café.
Le grand-prieur, ayant reconnu LL. MM., conduisit l’illustre société dans l’église. Il dit que son étendue était de trois cent trente-sept pieds de longueur, cent vingt de largeur à la croix, et quatre-vingt-dix de hauteur. Édifiée à diverses reprises depuis la première race, et pour la der-
SUR MARUï-ANTôîNETTE. aí rftère construite dans le treizième siècle, le roi saint Louis régnant. Les vitraux, admirablement peints, n’y laissaient pénétrer pendant le jour qu’une clarté* mystérieuse. A cette heure nocturne, illuminée imparfaitement par des lampes et des girandoles, on se sentait porté à la mélancolie et à la méditation.
L’empereur donnait le brasà lareine, LouisXVI à la princesse de Lamballe, et tous quatre, joyeux naguère, furent tout-à-coup saisis d’une vague tristesse qui obscurcit leur physionomie ; les moines marchaient en avant, et d’une voix uniforme faisaient l’historique des monumens sans nombre de ce lieu magnifique.
Saint-Denis possédait alors toutes ses richesses royales, des sacrilèges n’avaient point encore violé ce sanctuaire de la mort ; les pieds heurtaient incessamment des noms illustres, et qui, articulés, réveillaient soudain d’imposans souvenirs. Le tombeau de Hugues Capet attira les yeux de son dernier descendant. Hélas, contre l’usage, ils se trouvaient en présence ces deux princes à la fortune si opposée ! L’un avait fondé une nouvelle dynastie, l’autre devait en être le terme; l’un fit trembler ses ennemis, l’autre ne sut que leur
livrer sa tète, contraste terrible que nul ne pouvait deviner en ce moment, et qui peut-être arracha une larme divine à l’être incréé dont le regard seul plongeait dans l’avenir.
Les moines montraient aussi la représentation de nos grands monarques, et celle de Philippe-Auguste proclamé par deux fois roi des Français , à son sacre et à Bouvines , lorsque, posant la couronne sur l’autel, il l’offrit au plus digne. L’armée, en la replaçant sur sa tête, consolida sans retour les droits de sa postérité; puis celles de Charles V, dit le Sage, de Charles VII qui reconquit son royaume vendu, par sa mère, aux Anglais ; de François Ier, le second chef de la branche des Valois, dont le monument tout en marbre blanc resplendissait de magnificence, et de son fils Henri IL si intrépide, etc.
De tous côtés on voyait des sépultures soutenant les insignes de la souveraineté, à chaque pas les regards contemplaient le néant de la mort dans ces épitaphes pompeuses, qui seules relevaient l’illustration de ces cendres froides et insensibles.
L’empereur, habitué à parcourir les catacombes où gisaient ses ancêtres, regardait d’un œil
stoïque le mausolée des Mérovingiens, des Car-lovingiens et des deseen dans de Hugues-Capet ; mais Louis X VI, neuf d'impressions ; mais Marie-Antoinette, qui, depuis son arrivée en France, avait oublié la solennité de ce spectacle ; mais madame de Lamba lie, à lame si jeune, ne pouvaient, comme Joseph II, demeurer impassibles en présence de ce lieu solennel ; ils se rapprochaient involontairement les uns des autres, et se promenaient inquiets au milieu de ce champ mortuaire, où les rangs étaient si pressés, et dans lequel deux au moins des trois viendraient un jour prendre place.
Plongé dans ces graves réflexions, qui sait ce que la voix mystérieuse du ciel fit entendre en cet instant à ce roi,à cette reine, à cette princesse qui, moins de dix ans après, devaient mourir d’un si horrible supplice!
Ils écoutaient à peine les explications données par le prieur, à tel point leur préoccupation était complète. Le religieux, qui s’en aperçut, et d’ailleurs en courtisan véritable, crut qu’il convenait d’abréger la grande leçon, et précédant tou jours ses hôtes, il se dirigeait vers le trésor de l’église,
lorsqu’à la vue d’un caveau béant et illuminé, près duquel on passait sans s’y arrêter, Tempe-reur tirant le prieur par la manche lui dit :
— Père, où conduit cette voûte ?
— Aux souterrains où reposent les princes augustes de la maison de Bourbon.
— Il y a donc là Henri IV et Louis XIV ? s’écria l’empereur; avec votre permission nous y entrerons. Sire, poursuivit Joseph II en s’adressant à Louis XVI, ceci en avance d’hoirie.
Cette plaisanterie ht mal au roi, la reine aussi sentit son cœur se serrer; mais tous deux craignant les railleries de l’empereur, le suivirent.... Quelque chose au bas de l’escalier leur barra le chemin ; c’était une forme longue et étroite recouverte d’un vaste tapis de velours noir, brodé d’une croix blanche, ayant aux angles les armes de France et de Navarre; des larmes et des fleurs-de-Iis, des doubles L et des couronnes royales, complétaient la décoration de ce poêle funèbre; il fallut que les religieux le dérangeassent pour laisser le passage libre.
— Qui est-ce? demanda Louis XVI, sans prévoir l’importance de sa question.
Le prieur de l’abbaye auquel elle s’adressait tressaillit j et d’une voix basse en inclinant profondément la tète répondit:
— Le cercueil du prédécesseur de S. M. aujourd’hui glorieusement régnant.
— Quoi ! s’écria la reine en pâlissant, est-ce une place convenable pour notre aïeul ?
Les trois religieux recouvrant leur front du capuce monéstique, s’étaient humblement agenouillés... La famille royale ne jouissait plus d’un incognito dont elle-même venait de se dépouiller, il y eut un moment de silence, puis le roi dît :
— Messieurs , relevez-vous !
Le prieur obéissant, répondit à la reine :
— Madame, un usage solennel, et consacré dans la grande étiquette des cérémonies funèbres des rois de France, veut que le dernier monarque décédé demeure au pied de ce degré en attendant son successeur, et c’est seulement à l’arrivée de celui-ci qu’il va prendre la place qu’on lui réserve. Voyez ce candélabre, ajouta le prieur, il supporte autant de lampes que le roi a régné d’années; on les entretient nuit et jour, car elles ne doivent jamais s’éteindre. Si
elles cessaient de brûler, ce serait un grand malheur.
Les auditeurs écoutaient cette explication avec une attention mélée de terreur; l’empereur lui-même éprouvait un trouble dont il ne se rendait pas compte. Sa soeur, son beau-frère et madame de Lamballe s’agenouillèrent et récitèrent pieusement le De profundis, que répéta le reste de l’assemblée.
En ce moment, il s’éleva sous ces voûtes un vent impétueux qui souleva par trois fois le drap funèbre, et si violemment à la dernière, qu’il heurta le lampadaire mystérieux et en éteignit la plupart des lumières; dix-sept seules restèrent allumées, et on était en 1779..... Un cri d’effroi partit de toutes les bouches , et la reine se jeta dans les bras du roi.
— Partons ! dit vivement l’empereur.
Madame de Lamballe s’était évanouie. Le roi, alors, s’adressant auprieuraavec une noble fermeté :
—' Mon père, dit-il, je ne serai pas venu ici pour en sortir sans avoir prié sur la tombe de mes ancêtres. Un cas de pur hasard ne peut être
un présage pour nous autres chrétiens qui n’admettons pas ces superstitions; veuillez donc m’ouvrir la porte du caveau où m’attendent Henri IV avec Louis XIV.
— Sire, vous n’y entrerez pas sans moi, reprit la reine avec chaleur; mon devoir et mon droit sont de ne jamais me séparer de votre majesté.
Le prieur, passant devant ses souverains, arriva au travail exécuté naguère pour remédier au trop pressé des rangs. Le lieu qui servait de sépulture à la royale branche de Bourbon consistait, à cette époque, en deux caveaux. Louis XII fit faire le premier pour Anne de Bretagne , sa seconde femme ; depuis lors on y enterra non plus les Valois, mais les Bourbons. Bientôt trop garni, à cause du peu d’étendue de son enceinte, on ne put, en 1685, y placer le corps de la reine de France, Marie-Thérèse d’Autriche. Cela fit entreprendre un travail hardi et difficile; on perça, par-dessous le chevet de l’église, un caveau qui eut neuf toises de long sur dix et demie de large. Il communiqua avec l’ancien par un corridor de trois pieds de largeur sur sept de hauteur. Cet ouvrage terminé, on ne laissa dans le premier caveau que le cor-
OU
cueil de Louis XIV; tous les autres de cette branche royale, au nombre de trente-sept, furent inhumés dans le nouveau, où ils étaient rangés sur des barres de fer à trois pieds de terre.
Ce fut vers ce lieu vénérable que se dirigèrent le roi et la reine de France, précédés par le prieur de l’abbaye; mais ils y entrèrent seuls... ils y restèrent pendant une demi-heure, et quand ils en sortirent, leurs traits exprimaient l’épouvante. Qu’avaient-ils vu? que s’était-il passé? Nul n’osa les interroger sur ce point, pas plus l’empereur que madame de Lamballe. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils se refusèrent à voir le trésor et se montrèrent empressés de sortir de ce sanctuaire terrible. Le retour à Versailles fut rapide, et la conversation languit pendant le trajet.
Combien de fois, depuis la captivité de leurs majestés, et depuis leur fin sanglante, me suis-je rappelé cette funeste anecdote ! L’empereur la répéta mot à mot à son ambassadeur, qui voulut bien me mettre dans la confidence. Au reste, ce n’est pas la dernière histoire de ce genre que je raconterai; et puisque M. de La Harpe a conservé écrit le récit succinct de la prédiction
suit MARIE-AXTOTNETTE. 53 célèbre de Cazotles, au souper du prince de Beau-vau, je le compléterai à l’aide de mes souvenirs; car si je me trouvai comme lui ce soir-là assise à la meme table, et comme lui j’entendis les menaces de ce Cazottes, véritable illuminé, et qui réellement possédait une prévision que la nature à certaines époques accorde à quelques uns de nous.
C’était un chapitre sur lequel il fallait écouter le comte de Saint-Germain. Celui-ci, bien que physicien habile, n’aurait pas expliqué comme le firent l’empereur et son ministre, par la ra-réfication de l’air, le lait du vent qui soulevait le manteau sépulcral contre le lampadaire, il y avait des cas où il admettait mieux que le hasard, et il avait raison.
J’ai rapporté ce que je me rappelle de plus saillant relativement au voyage de l’empereur Joseph II en France. Si quelques autres particularités de la seconde visite me reviennent à la mémoire, je les consignerai dans mes cahiers. En attendant, voici le résumé d’une longue causerie avec sa majesté impériale, au sujet ch s trois impératrices de Russie, Catherine B", Anne et Elisabeth.
La première mourut par le poison ; c’est du moins ce qu’on croit généralement en Russie; il est vrai qu’elle avait une conduite si extraordinaire qu’elle hâta beaucoup sa fin. Elle aimait lés commotions violentes, les promenades rapides sur les rochers pendant le jour, et la nuit sur la glace. Elle sablait à grands verres les énormes bouteilles de Tockay et de Constance. Mensikoff ne fut pas son seul amant, elle voulait la vie courte et bonne, aussi a-t-elle été servie à souhait.
L’impératrice Anne, qui avait tant fait pour le duc de Courlande, finit, non sans motif, par se défier de Biren. Ce prince, sorti de la fange et parvenu au rang des souverains, grâce à la faiblesse de la czarine, s’avisa un beau matin d’ouvrir avec fracas la porte du cabinet d’Anne, et de lui dire :
— Madame, vous n’écoutez que vos ennemis ; ils veulent ma perte; eh bien, pour me sauver de leurs haines et de votre manque d’énergie, je me retire en Courlande, où je règne, et là je braverai mes rivaux.
Cette menace effraya tellement la czarine, qu’elle mit la main sur son cœur prêt à se briser,
SUR MARIE-ANTOINETTE. 35 et fit ouvrir une fenêtre, quoiqu’il gelât à trente degrés, car elle suffoquait. Ce Biren, qui avait reçu l’éducation d’un gentilhomme, et fait ses études à Kœnigsberg, n’en était pas moins un rustre, il ne savait même pas écrire correctement sa langue maternelle.
La princesse Anne fut d’abord élevée par une dame livonienne nommée Aderkast, née Mar-fuld ; mais Biren la fit transférer à la hâte de Riga en Allemagne. Etant soupçonnée d’avoir favorisé une intrigue amoureuse entre la princesse et le ministre de la cour de Dresde, le comte de Linar, elle fut remplacée par une dame de Neck, Courlandaise. La princesse n’avait souvent, et selon le costume ancien qu’observent encore quelquefois les dames russes, pour toute coiffure qu’un mouchoir de soie dont elle entourait sa tête le plus coquettement possible. Elle passa de cette pauvreté à l’empire de Russie.
La garde-robe de l’impératrice Elisabeth était d’une rare magnificence. A sa mort il s’y trouvait huit mille sept cents habits complets , des négligés, de simples robes et manteaux sans nombre, et une multitude incroyable d’étoffes
30 servons
de ruis genres en pièces, sans eotnpter ce çtdeli# distribuait a profusión non seulêmcht aux Ferri* mes de son service, mais à celles de la ville et de la cour.
Cette princesse avait une frayeur extraordinaire de la mort. Pendant les dernières années de sa vie, elle payait une saignée sept mille cinq cents roubles , que partageaient ses deux médecins ordinaires et son chirurgien. Lorsqu’elle fut à l’extrémité, elle promit à chacun de ces docteurs vingt-cinq mille roubles s’ils voulaient lui sauver la vie. Cependant son intempérance ne lui permettait de suivre aucun régime dans sa manière de vivre. Elle mangeait souvent au sou-per les mets du diner. Lorsqu’on désirait obtenir ou conserver ses faveurs, il fallait lui envoyer des plats recherchés et propres à flatter sou palais. Elle gracia de la peine capitale un homme qui lui fit passer la recette d’un ragoût qu’elle trouva excellent ; elle le combla en outre de bienfaits, et aujourd’hui ses descendans sont comptés parmi les plus riches de la Russie.
L’empereur ne tarissait point quand on le mettait sur le chapitre des têtes couronnées^ et avait sur toutes celles du siècle une collection
SUR MARIE-ANTOINETTE. ^ d’anecdotes piquantes et peu charitables. Il n’épargnait pas non plus Je roi de Prusse, bien qu’il professât pour lui une grande admiration. Néanmoins, en petit comité, il nous racontait les bizarreries de ce monarque. J’ai vu la reine se boucher les oreilles avec les doigts et dire à son frère :
— Votre majesté impériale Auguste César est aujourd’hui de bien mauvaise compagnie.
Ces récits amusaient Louis XVI, mais en enfant naïf qui se contente de rire d’une plaisanterie. Jamais le roi n’a dit un mot qui pût faire du tort à quelqu’un; excepté ie jour où il surprit M. de G,., volant à Versailles des porcelaines de Sèvres, Alors il ne put contenir sou indignation.
La reine vit partir sou frère avec une profonde douleur. Ce fut à la môme époque que Monsieur voyagea ainsi que le comte d’Artois. Ces princes, avant leur départ, avaient vivement agi pour faire renvoyer M. le comte de Saint-Germain, ministre de la guerre, dont les mesures leur déplaisaient. Ils le firent venir chez M. de A3 au repas, et AL le comte d’Artois le traita avec peu de ménagement. Quelque temps après je vis M. de Saint-Germain qui médit :
— Tout cela vient de M. de Montbarrey, il causera ma perte.
-
11 est certain que M. de Montbarrey, peut-être déjà prince du Saint-Empire, s’était rendu l’ami des deux Maurepas, qui l’implantèrent en survivance au ministère de la guerre, où ni ses ta-lens ni sa réputation n’auraient dû l’appeler; le pronostic du comte de Saint-Germain se réalisa: en décembre 1777, il dut partir de Versailles, et céder la place à M. de Montbarrey.
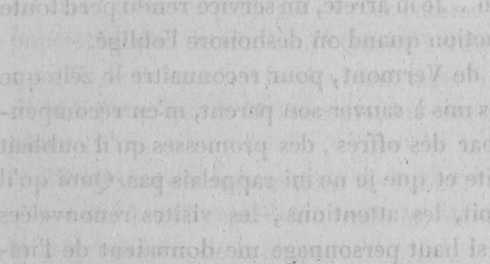
âsvas ^aaaSâ^aàaas»
MINISTRES, VOLTAIRE, ET FAITS HIVERS.
Je jouissais d’une faveur vivement enviée; l’abbé de Vermont daignait parfois me faire l’honneur de venir chez moi, non à Paris, je l’avoue, mais à Versailles, dans l’appartement exigu que je devais aux bontés de la reine. Ce puissant abbé, au crédit sans bornes, et dont il ne tirait pas vanité, s’était mis en tête qu’il me devait de la reconnaissance. Le fait datait de loin, il s’agissait d’un parent, de M. le comte de Valbelle, et d’une
4o SO U VJ N JR S
action... Je m'arrête, un service rendu perd toute son action quand on déshonore l’obligé.
M. de Vermont, pour reconnaître le zèle que j’avais mis à sauver son parent, m’en récompensait par des offres , des promesses qu’il oubliait ensuite et que je ne lui rappelais pas. Quoi qu’il en soit, les attentions, les visites renouvelées d’un si haut personnage me donnaient de l’importance, je n’en étais pas fâchée; car enfin, j’en retenais toujours quelque chose pour mes amis et mes protégés. L’abbé, peu communicatif, l’était davantage avec moi dont il connaissait la discrétion. Il me disait ce qu’il taisait aux autres; j’en faisais mon profit, mais sans éclat. Un beau matin l’abbé de Vermont arriva, je ne l’avais pas vu depuis quelque temps.
— Que devenez-vous? lui dis-je.
— Le sais-je? les soirées passent vite, et puis j’ai beaucoup de besogne.
— Encore si vous réussissiez ! (Je faisais allusion à l’archevêque de Toulouse, il me comprit.)
— Patientons! savez-vous, madame, que dans le pays où nous vivons vingt ans ne sont pas trop pour conduire à bout une intrigue, et il y en a dix seulement que je suis à l’œuvre. Le roi
est cruel clans ses préjugés : voyez comme il repousse le duc de ChoiseuU Quant à l’archevêque (M. de Brienne), il faudra bien, dans l’intérêt de la France, que S. M. l’accepte, lui seul peut la sauver.
C’était une des infatuations de l’abbé.
— Eh bien! repris-je, voilà M. de Mont-barrey ministre de la guerre!
— Oui, un pauvre choix, tout en dehors de nous autres (il voulait dire de la reine et de lui). C’est madame de Maurepasqui a prétendu avoir son ministre; les demoiselles de Paris fêteront assurément cette nomination.
— Et céux qui trafiquent de l’argent? ajoutai-je.
— Qu’ils se hâtent, la reine est mécontente.
Cela dit, nous parlâmes des finances, elles étaient au premier occupant. M. de Chigny n'avait fait que passer, M. Necker s’y installait ; renard revêtu de la peau de lion, ennemi caché de la monarchie, du roi, du clergé, de la noblesse et même de la France, forfantier de vertu, de philosophie, d’humanité, avare, fastueux, rongé d’orgueil et d’ennui; sa femme, le centre
de l’univers, et prétendant que tout roulait sur ce pivot.
M. Necker, étranger et protestant, accueilli, honoré en France, comblé des faveurs du roi et de sa confiance, admis enfin au conseil, employa son crédit à comploter contre son bienfaiteur, à intriguer au profit deje ne sais qui, mais dans le seul but de se rendre l’homme nécessaire. C’était un besoin d’adoration sans exemple ; il avait gagné tous les membres de sa famille. Madame Necker était dans son genre une autre divinité, la mère des pauvres, la protectrice des gens de lettres, un hôpital pour les premiers, des dîners, des soupers fins pour les seconds. De l’or répandu avec discernement et à propos, furent les moyens qui consolidèrent l’apothéose terrestre de la dame Necker née Curchaud, Cal-caud, ou Carchaud, on n’a jamais bien su son nom.
Je voudrais conserver toute mon impartialité au moment où j’ai à tracer le portrait de la fille Necker, autrement madame de Staël Holstein. Mais le souvenir de tout le mal que cette femme a fait à S. M. Marie-Antoinette peut conduire ma sévé-
SUR MARIE-ANTOINETTE, 4 5 rite jusqu’à l’injustice. Je parlerai donc le moins possible de madame de Staël, et pourtant que de choses j’aurais à en dire! Elle aussi devait se ranger parmi ceux que la reine combla ; elle l’avait mariée, en témoignant elle-même à l’ambassadeur de Suède la satisfaction que lui causerait cette alliance.
C’est un pauvre homme, que le baron de Staël; républicain sans pouvoir en donner le motif, il conspirait à la cour de Versailles contre le roi de France qui était le meilleur ami de son maître. La reine m’a dit qu’il avait osé insinuer à Gustave III que les Français verraient avec plaisir le duc d’Orléans à la place des Bourbons de labran-chc aînée. Au reste, la conduite de ce personnage pendant la révolution a donné la mesure de ses pensées ; il est un de ceux qui ont le plus traîné dans une boue sanglante la majesté royale, en la personne de ses représentans les ambassadeurs.
On me trouvera sans pitié, contre mon usage; mais lorsqu’on a vu ce que j’ai vu, aimé ce que j’ai aimé, peut-on froidement parler des hommes qui sont la cause flagrante de nos malheurs ?
L’abbé deVermont chérissant médiocrement
le grand financier de Genève, attendu que c’était un rival pour son archevêque. Il s’offre à moi une belle occasion de m’élancer dans la politi-que, mais cela m’effraie. Voici venir la révolte d’Amérique, les insurgés, MM. Dean ne,. Franck-lin , le sublime, l’incomparable Francklinje sage à la mode, qui découvrit l’électricité, qui de la même main arrache ia foudre aux dieux et le sceptre aux tyrans; phrase pompeuse traduite de la célèbre inscription latine eripuil cœlo fulmen scep-trum r/ue tyrannis, mérite qui, en bon sens royal, aurait dû suffire pour chasser de France ce monsieur au poignet si énergique.
J’ai vu Franck lin sous son masque de simplicité, il joua parmi nous la comédie avec succès. Nous fûmes scs dupes, et le malin en riait dans sa barbe. Oh! qu’il y avait d’esprit, de profondeur, de gaieté sur cette face à type particulier ! Chacun de ses traits avait une expression différente qui concourait à l’ensemble de la physionomie. Ou reconnaissait du calcul dans l’arrangement de cette ample chevelure non poudrée; et ces souliers, ces hauts de chausses sans boucles, ces guêtres, ce vaste chapeau et cette grosse canne, enfin toutes ces choses constituaient intégra-
leitient le grand humilie, il íes fallait là. Framklm vêtu, par exemple, comme M. le duc de Nivernais, aurait compromis peut-être le succès de sa mission. Maiscomment douter de la franchise, de la vertu politique d’un personnage si grotesquement travesti? C’était un nouveau Diogène, un Socrate; que sais-je, en un mot, ce que les Français d’alors n’auraient pas fait de ce retors Américain ?
Il me mit sur sa liste ( j’approchais de la reine, j’étais intimeavec madame de Polignac ). 11 venait souvent, ne savait rien, et brûlait d’apprendre. C’était un insoucieux diplomate qu’on trouvait admirable. Il ne comptait, disait-il, que dans la bonté de sa cause, et on s’y laissa prendre.
Madame Jules, je ne sais pourquoi, me faisait une visite de matin, lorsqu’on m’annonça le négociateur américain : elle se levait pour partir, la curiosité la retint. M. Francklin connaissait la duchesse, aussi il s’inclina profondément, puis il amena la conversation sur la famille royale. Ce furent des éloges sans fin du roi et de la reine; les insurgés idolâtraient Marie-Antoinette, lui-même professait pour elle l’admiration la plus exaltée.
Tout cela fut débité avec tant de chaleur et de sincérité apparente que la bonne duchesse en fut séduite. Francklin ajouta ensuite négligemment que l’Amérique serait reconnaissante de ce qu’on ferait pour elle, et qu’à la paix on déposerait aux pieds de S. M, les contrats de concession d’une étendue immense de pays, que la reine distribuerait à sa volonté. La duchesse toujours désintéressée ne fit nulle attention à l’appât qu’on lui proposait, et moi ayant de l’humeur, je dis que la reine donnait mais ne recevait pas, qu’un tel présent serait une offense, une injure à la majesté du trône.
Francklin sourit. Les gens de commerce résument tout avec de l’argent; je persistai, et lui se tut. 11 lui suffisait d’avoir fait briller aux yeux de madame de Polignac la possibilité d’augmenter prodigieusement sa fortune sans mettre pour cela les Français à contribution.
Tout ce que je dis déplaira , je le présume, aux enthousiastes de Francklin et de la philosophie, j’en suis fâchée, mais la vérité est une, on ne peut la farder; et je peins seulement ce que j’ai vu.
Au nombre des badauds je citerai l’excellent
SUR MARIE-ANTOINETTE. 47 prince de Beauvau. ^Quelle belle âme arrachée par les philosophes aux saines idées! Disciple séide de Voltaire, de Necker et de tous ceux qui ont déterminé la chute du trône, M. de Beauvau pleurait à l’ouverture des états-généraux. Hélas! que son réveil a été prompt et terrible! qu’il a versé de larmes en expiation de ses erreurs ! Nous étions entourés de dupes de cette force, comment donc aurait-on pu empêcher la révolution de nous écraser?
J’ai vu M. de Beauvau, l’un des seigneurs de France, capitaine des gardes, chevalier des ordres, grand d’Espagne, prince du saint empire , cousin du roi par alliance directe, maréchal de France, gouverneur du Languedoc , etc., prendre le chapeau, la canne de Francklin en le quittant, lui faire poser sur le plus beau fauteuil, et y veiller pendant la soirée avec une sollicitude sans pareille. Lorsque tant de gens déclamaient contre les privilèges, il applaudissait après le beau jour où l’égalité serait proclamée.
Au reste, je dois au prince de Beauvau comme aux hommes de son bord la justice de dire que pas un d’eux ne comprenait cette éga-. :fh ? : i<> îj r s fî il : | ' ‘h ; , - ? łi - * > >
lité qu’ils vaülaíent tant, pas un, en admettant i'abolition des privilèges, ne présumait qu’il lui en coûterait ses titres, son rang, ses honneurs , sa fortune. C’était un être de raison qu’on voulait donner au peuple pour l’amuser, mais de là à se figurer que le jour où l’égalité régnerait, où il faudrait dîner avec son laquais, la distance était incommensurable! Montrer en 1780 l’égalité de 1793, c’eut été exhumer la tête de Méduse, chacun se serait écrié : Nous ne voulons pas de ce monstre. — Que demandez-vous donc? —• Quelque chose qui plaise au peuple, mais sans le rapprocher de nous.
Je le répète, l’expérience manquait aux époques dont je parle, et toutes les fautes provenaient d’ignorance. Certes, parmi ceux que la liberté de 90 aurait épouvantés, je mets en tête Voltaire, lui féodal par excellence, qui eût abandonné la moitié de son génie à qui l’aurait fait homme de cour, lui qui ne pouvait vivre qu’avec les grands seigneurs et en flatteries réciproques avec les souverains.
Exilé de Paris depuis son voyage en Prusse, il y avait plus de vingt ans, ses écrits occupaient tous les esprits, mais sa personne était oubliée,
et on ne s’attendait guère à le revoir en février 1778, lorsque tout-à-coup le bruit se répand que M. de Voltaire était à Paris.
— Où est-il descendu? demandait-on.
— Chez M. de Villette, quai des Théatins, au coin de la rue de Beaune.
— Oh! je le verrai certainement.
— Nous le connaissons.
— Beaucoup, c’est-à-dire, je ne l’ai jamais vu, mais ma grand’mère a failli avoir un procès avec un ami intime de son père qui fut nommé arbitre. Vous voyez que cela établit entre nous des rapports de bienveillance; Voltaire est d’ailleurs un si grand homme !
J’ai entendu ce propos. Tel était alors l’engouement inspiré par Voltaire, qu’on se créait des prétextes pour se rapprocher de lui ; quant à moi, je ne l’avais qu’entrevu avant sa promenade sentimentale à Berlin, chez la marquise du Défiant, sa bergère ^ qualification dont elle fut flattée d’abord, et dont elle se plaignit ensuite comme si c’eût été un ridicule.
Curieuse en vraie fille d’Eve, je me réjouis de voir M. de Voltaire, aller chez lui me répugnait. Je priai donc madame du Défiant de me faire
souper avec lui. Elle s’engagea de bonne grâce, mais ce qu’elle et moi ne pouvaient prévoir fut que madame Denis manœuvra si bien que son oncle ne vit la marquise qu’une seule fois, et encore en passant.
Cette Denis était une femme prétentieuse, maniérée , laide, hommasse à faire peur, et bel esprit par-dessus tout ; rimant, prosaillant, et critiquant son oncle, dont elle se disait la meilleure élève. Tant de ridicules n’avaient pas échappé à la marquise du Deffant, qui s’en moqua impitoyablement. Quelques ames de bien le rapportèrent à madame Denis, et elle s’en vengea plus tard en empêchant Voltaire d’aller chez la marquise. Je fus enveloppée dans cette vengeance : il fallut me retourner d’un autre côté, et m’accrocher à M. de Villevieille, surnommé parmi nous Voltaire second. Savez-vous pourquoi, le pauvret, sans importance aucune par lui-même, était parvenu à s’en faire une? En se constituant le chien courant de Voltaire à Versailles,à Paris, dans les cercles et aux foyers de l’Opéra et de la Comédie-Française. Voyait-on le marquis de Villevieille, il tirait de sa poche une lettre de Voltaire qu’il vous fallait
SUR MARTE-ANTOINETTE. 51 entendre lire, ou bien il récitait une pièce de vers inédite à laquelle on n’échappait pas davantage. On commençait déjà à fuir l’éternel marquis, lorsque son dieu tomba des nues aux rives de la Seine. Alors M. de Villevieille , de trompette qu’il était naguère, se fit aide-décamp ; chambellan , valet de chambre, vrai om-nis homo enfin du grand homme.
Je l’envoyai prier de passer chez moi, et il me fit répondre très sérieusement qu’il viendrait à deux heures du matin , seul moment qu’il aurait libre, parce qu’il quittait sonami (Voltaire) à une heure jusqu’à cinq. Je me hâtai de lui mander que je dormirais probablement, ainsi que mes gens; mais que s’il voulait me présenter à son ami le lendemain, je lui serais fort obligée.
Voici sa réponse. Je la conserve comme un monument du délire de l’époque.
«Madame la comtesse,
» Sans doute le plus beau moment de ma vie «sera celui ou j’amènerai au grand homme une » femme si bien faite pour l’admirer. Les fonc-» lions que mon attachement me donnent auprès » de M. de Voltaire me remplissent l ame de joie.
-
• Je viens de lui parler de vous : il se reproche * ne pas vous prévenir ;, mais il ne sort point, et » il vous prie de l’excuser s’il vous reçoit en robe » de chambre, en attirail de malade. Ce n’est pas
-
• l’enveloppe que vous voulez voir, mais bien
-
• jouir de cet esprit divin dont la gloire sera sans • terme.
» M. de Voltaire attend à deux heures madame » Necker et sa fille, à deux heures et demie ma-» dame de Montesson et la comtesse de Genlis,
-
• à trois heures et demie les Beauvau et la mare» > chale de Mirepoix. Quatre heures sont libres : » arrivez alors. Ménagez, en grâce, une poitrine «faible, une santé débile : nous sommes tous • comptables envers la postérité d’une seconde » que nous ravissons inutilement à Voltaire.
-
• Ce n’est pas pour vous, madame la comtesse, • que je fais cette réflexion; je l’applique aux im-• portons, aux indiscrets, qui l’assomment,l’as* » sassinent.
-
■ Je suis, en attendant l’honneur de vous voir, • madame la comtesse, et avec un profond res-» pect votre très humble, etc»
-
• P. £, Il est d’usage d’embrasser l’illustre ma-
»lade, mais il faut autant que possible éviter de • manifester une trop vive émotion. Ce témoi-•gnage flatteur d’enthousiasme le trouble lors* » qu’il est trop souvent répété. »
Je peindrais mal la gaieté que m’inspira ce post-scriptum. M’insinuer de me trouver mal ne forme d’hommage était une idée si bouffonne!... Mais où ne peut conduire le fanatisme poussé à l’excès?
Je reçus cette lettre en présence d’un magistrat de province, M. de Lamothe, conseiller au parlement de Toulouse, homme d’esprit, et parent de mon mari, avec lequel il avait été élevé. 11 manifesta une telle envie de m’accompagner en l’absence de M. d’Adhémar, que j’y consentis. Il me dit que d’ailleurs il n’était pas inconnu à Voltaire, et en effet il me le prouva le lendemain.
Trois heures sonnaient lorsque mon carrosse s’arrêta dans la rue de Beaune, en face de la porte de l’hôtel Villette.Yentrer était impossible, vu l’exiguïté de la cour. Nous mîmes pied à terre, et mon chevalier écarta la foule des laquais et des curieux attirés par la vue de voitures aux armes d’Orléans. J’en conclus que madame de
54 SOUVENIRS
Montesson était encore avec sa nièce chez M. de Voltaire. Elles en sortaient, nous nous croisâmes sur l’escalier.
M. de Villevieille, qui apparut, fit abréger les complimens. Il s’empara de ma main, chargea sa mémoire du nom de M. de Lamothe qu’il avait connu en Languedoc, et, me faisant presque courir à travers les pièces du second étage, il me mit subitement en présence de M. de Voltaire... Oh! le drôle de fagotage qu’était le sien si l’on eût vu autre chose que son génie! Qu’on s’imagine un long squelette recouvert d’une peau tannée, noirâtre et huileuse. La figure faisait illusion : c’était une tête de mort vivante; les yeux seuls, brillans et hardis, y attestaient l’existence. Le rire de l’enfer errait sur des lèvres minces et pâles; et le tout était encadré dans une perruque volumineuse, surmontée d’un bonnet de coton à mèche, attaché par un ruban ponceau. Le corps avait pour vêtement une veste de brocart d’or et pourpre, et une robe de chambre à lampas rouge et bleu, garnie d’une fourrure admirable de renard bleu, présent impérial de la Sémiramis du nord.
Je m’attendais à voir un moribond; je trouvai
un homme encore plein de verdeur, tout esprit, tout flamme. Je lui présentai M. de Lamothe; il fit un bond sur son fauteuil au titre déclaré de conseiller au parlement de Toulouse , puis s’écria :
— Eh quoi ! chez moi un assassin de Calas !
— Oh! monsieur, répondit le conseiller, votre mémoire vous sert mal : vous-méme avez écrit que je comptais parmi les défenseurs de cette fa" mille infortunée.
— Vous avez raison, monsieur, repartit Voltaire en tendant la main à l’offensé en signe de satisfaction; j’ai tort, grand tort : vous êtes des nôtres, vous êtes tolérant.
— J’ai été juste dans cette circonstance, je le crois du moins.
— Quoi ! un doute!
— Ma conduite en cette fatale affaire me donne le droit d’en parler librement; je me tairai cependant et pour cause. Mais, monsieur, vous qui avez tant de fois fourni des preuves du fanatisme catholique, pourquoi refu seriez-vous de croire qu’il peut y en avoir parmi les sectateurs de Calvin ?
— Dans le cas présent, c’est impossible.
Mon compagnon ne répondit pas. Je pris alors la parole et prononçai le nom de madame du Deffant. La Denis, qui était présente , fit une laide grimace. Je me rappelai la phrase d’une lettre du roi de Prusse à Voltaire, dont le malin monarque avait laissé prendre copie à ses intimes, qui la répandaient à leur tour. L’une était venue jusqu’à moi.
« Je n’entre point dans la recherche du passé. »Vous avez eu sans doute les plus grands torts « envers moi. Votre conduite n’eût été tolérée » par aucun philosophe. Je vous ai tout pardon-» né, et meme je veux tout oublier ; mais si vous » n’aviez pas eu affaire à un fou amoureux de «votre génie, vous ne vous en seriez pas tiré » aussi bien. Tenez-le-vous donc pour dit, et que » je n’entende plus parler de cette nièce qui m’en-» nuie et qui n’a pas le mérite de son oncle pour » faire passer sur ses défauts. On parle de la ser-» vante de Molière, mais personne ne parlera de da nièce de Voltaire. » (1)
(Note de l’éditeur.)
J’étais donc sons l’empire de ce souvenir lorsque M. de Voltaire, joignant les mains et selon sa vieille habitude jouant la comédie, se reprocha son défaut de mémoire. Pouvait-il vivre sans aller porter son hommage aux pieds de la divine marquise! Certainement c’était un devoir que le lendemain il remplirait !
Ce texte alimentait encore la conversation lorsqu’on annonça les Beauvau. Je me levai pour sortir. M. de Voltaire, prenant alors la main de mon chevalier :
— Monsieur, lui dit-il, il faut que votre parlement ne pende plus que les rebelles aux rois : il suppliciera plus de bigots que d’incrédules.
Monsieur de Lamothe repartit froidement:
— Monsieur, nous envoyons rarement aux galères ceux qui sont persuadés de l’existence de Dieu.
Cela dit nous prîmes congé, et laissâmes les Beauvau en possession de la place. Je m’en allai tout droit à Saint-Joseph rapporter à la marquise du Deffant ce que Voltaire m’avait dit pour elle. Elle me répondit d’un ton aigre et pincé, voulant ne point paraître fâchée, et au fond furieuse de la négligence de son ancien berger.
Je ne revis Voltaire que le soir de son couronnement et de son triomphe à la Comédie-Française. Voici l’extrait d’une lettre que j’écrivis à ce sujet à M. d’Adhémar, alors en voyage :
« Vous serez bien aise, je présume, mon cher » ami, de raconter, dans les maisons où vous pas-»sez vos soirées, le récit d’une journée de Vol-» taire. Ce grand homme, ainsi qu’on le nomme, » peut mourir maintenant. Il a, par anticipation, « assisté, lui vivant, à ce que les puissans empe-5 reurs romains n’obtenaient qu’après leur décès, » à son apothéose; on la lui a décernée en plein » théâtre, à la Comédie-Française, en présence »de la cour, de la ville , de tout l’univers enfin, » représenté par l’élite de la nation et des autres » peuples.
» On savait que Voltaire rétabli irait assister à «une représentation d’Irène. C’était à qui aurait « des places. Madame de Mortemart, toujours «parfaite pour moi, me promit que si la solen-» nité avait lieu son jour de loge elle m’y condui-»rait. La fortune m’a servie, et je puis dire avoir » eu ma part de la scène la plus curieuse et la » plus étrange possible.
» Outre madame de Mortemart et moi, il y » avait dans notre loge le comte de Vaudreuil, et «madame Diane de Polignac, qui n’était pas en «beauté, aussi ne l’ai-je jamais vue moins ave-» nante. Le bonheur d’autrui lui est si insuppor-« table que. Dieu me pardonne, elle a été jalouse » du triomphe de Voltaire. Comme elle ressemble «peu à sa belle-sœur!
» Je ne saurais désigner qui manquait à cette » soirée : tous les noms connus s’y étaient donné rendez-vous. On y voyait l’Académie moins les » évêques, et encore n’oserais-je l’affirmer.
» La loge de madame de Mortemart est, vous de savez, à côté de celle de M. le comte d’Ar-» tois, et par conséquent en face de celle des • gentiihommes de la chambre, où Voltaire de-» vait être admis. On y vit d’abord entrer la pe-» tite marquise de Villette, belle et bonne, sur-» nommée ainsi par le patriarche de Ferney ; » madame Denis l’accompagnait horriblement «attifée, en or, brocart, diamans, plumes, fleurs, »et si grosse, si disgracieuse ! le parterre en a ri.
» Cependant la porte de la loge s’est rouverte... «Chut!... silence... le voici... Vive Voltaire!...
fio
J» Oh Voltaire!... Couronnez-le... La couronne..'. > Vive Voltaire !
» Cet ordre impérieux, donné en tels termes, a >reçu son exécution : une couronne est venue, «tout en lauriers et en oripeaux. Je dois vous » dire que Voltaire avait d’abord modestement ■ pris place derrière mesdames de Villette et De-finis; mais la volonté du parterre, empiétant » sur l’antique politesse de nos pères, a exigé que > Voltaire s’assît entre ces dames. Il portait un » somptueux habit de velours rouge brodé d’or, »les boutons en cailloux du Rhin; la veste gla-»cée d’or; et par là-dessus un vaste witchoura ■ de drap bleu, doublé de fourrures et agrafé par » des olivettes d’or ; plus, une immense perru-» que noire et un chapeau à ganse d’or : le tout » éblouissant, mais si en contradiction avec la » mode moderne que c’était ridicule.
» La couronne que Brizard portait aux comé-> diens a été présentée à Voltaire, qui, la refu-«sant, Fa donnée a Belle et Bonne. Celle-ci la lui »a rendue : nouveau débat. Enfin, le prince de i Beauvau, la saisissant, l’a posée sur la perru-• que du patriarche, qui s’est déterminé à la
» Le théâtre de Voltaire faisait seul les hon-■ neurs de la soirée. On avait commencé par sirène, on termina par Nanine. Mais à la fin ■ de la première pièce personne dans la salle * n’était tranquille* L’hommage ne semblait pas ■ complet : on voulait autre chose; il convenait de ■ mieux traiter le héros de la soirée. Je vous dirai ■ tout à l’heure ce qui est éclos de la belle imagi-■ nation de messieurs de la Comédie-Française.
» En attendant, le marquis de Montesquiou ■ est venu dans notre loge, et nous a conté ■ qu’avant l’entrée de Voltaire M. le duc de » Chartres avait arrêté ce dernier au passage pour ■ lui dire un mot, et que, soit embarras ou ad-■ miration, il ne put balbutier qu’une phrase in-■ intelligible.
»M. de Montesquiou j poursuivant son rôle ♦ de narrateur, nous apprit encore que Voltaire, ■ qu’on venait de voir sortir de la loge, s’était * rendu dans le petit salon de celle des premiers • gentilshommes ; où il eut l’honneur de rencon-■ trer M. le comte d’Artois et de lui faire sa cour.
«Nous nous sommes récriées, Comprenez-»vous que le second fils de France aille au-de-»vant de Voltaire, du fils d’un notaire? Mon » Dieu, que le monde prend une marche bizarre ! »Le talent a sans doute des droits à notre es-» time ; mais enfin sondez la distance qui sépare a ces deux hommes ! La comtesse Diane en écu-» mait : elle aurait volontiers arraché les yeux b à Voltaire. En ce moment sa douce et belle « sœur, qui était avec la duchesse de Cossé, nous » a souri. Le céleste visage! la charmante femme ! » Je vous avertis qu’elle gagne chaque jour du «terrain dans le cœur de la reine. Déjà, on le » remarque, madame de Lamballe boude, mándame de Guémené se tourmente. Aurions-«nous une favorite? Le comte de Vaudreuil en » est aux anges, et cela le rend presque tendre » pour la comtesse Diane.
» A propos de celle-ci que vous chérissez tant, si » vous étiez bien discret, je vous dirais.....mais » non, il est bon de garder quelque chose pour b le retour; aujourd’hui il ne sera question que » de Voltaire.
» Après que la toile fut baissée, le parterre, las »de crier vive Voltaire, s’endormait dans son
» enthousiasme, lorsque soudain on entendit un «grand bruit de tambours, trompettes, cymba-»les... Oh! oh !... qu’est-ce?... et chacun de se » retourner vers le théâtre fort intrigué de ce » qu’on allait voir. En ce moment, la comtesse » de Genlis a avancé la tête si vivement hors de » sa loge, que son chapeau est tombé sur le nez b du maréchal de Contados qu’il a coiffé. Jugez « des éclats de rire, des élans de gaieté que cet in-BCident a provoqués !...
«Cependant les fanfares continuaient,la toile » a été relevée, et on a vu, au milieu du théâtre, * le buste de Voltaire posé sur un cippe de mar-» bre blanc, et soutenu par deux, grenadiers des • gardes françaises. Tous les comédiens en habits »de caractère et tenant à la main des guirlandes «etdes palmes entouraient ce buste, groupés du » mieux possible. Les vivats ont éclaté de toutes « les parties de la salle ; madame Vestris, en » grande-prêtresse ou plutôt en sibylle, s’est avan-» cée jusqu’à la rampe; elle tenait à la main un b papier sur lequel le marquis de Saint-Marc avait a écrit un impromptu.... impromptu soit. Au «reste, il était assez mauvais pour qu’on le crut
» improvisé : on en a répandu des copies, en voici ■ une, amusez-vous-en î
Aux yeux de Paris enchanté *
Reçois en ce jour un hommage Que confirmera d’âge en âge La sévère postérité.
Non, tu n'as pas besoin d’atteindre au noir rivage Pour jouir des honneurs de l’immortalité.
Voltaire, reçois la couronne
Que l’on vient de te présenter ;
Il est beau de la mériter
Quand c'est la France qui la donne*
» Une seule lecture de ces vers n’a pas suffi au
-
• robuste appétit de nos fanatiques; on a crié bis, > et le bis est arrivé. Puis acteurs et actrices ont » été ceindre de leurs couronnes et guirlandes le » buste du demi-dieu. Mademoiselle Fan nier, qui » ne peut faire comme tout le monde, s’est avisée » de donner deux gros baisers à la froide effigie,
-
• bravo ! bravo ! s’est-on écrié ; et l’exemple ayant b été offert, les baisers ont accompagné les fleurs » et les lauriers.
b Tant qu’à moi, je ne perdais pas de vue le grand • Voltaire; il nageait dans une joie indicible. • Madame Denis avait l’air de prendre tout cela
» pour elle, madame de Viîlette pleurait, sou mari » trépignait, M. le prince de Beauvau, le duc de » Duras applaudissaient avec une force de clerc » de procureur; enfin tout le monde paraissait heureux. De temps en temps Voltaire disait : On s veut me faire mourir. Oh! Français ^ ce sont les » arts que vous honorez en ma personne ! Il a été » parfait.
»L’apothéose terminée, on a joué Nanine; le • buste, toujours couronné et soutenu, était là, «ses gardiens mourant de peur qu’il ne leur • échappât; leur frayeur naïve amusait le public, » et je vous assure que dans leur préoccupation » ils ont pris peu de part à l’allégresse générale.
«Enfin il a fallu partir... ce n’a pas été une pe-»tite affaire pour Voltaire que de regagner sa «voiture, c’était à qui le toucherait. Cepen-• dant il est parvenu sans malencontre au car-» rosse, pièce tres originale par elle-même. H est b b leu-de-ciel chargé d’étoiles d’or; on dirait »l’empyrée. On a d’abord proposé de dételer les » chevaux, mais le nombre de fanatiques n’étant » pas en proportion du travail, il a fallu y renon-«cer. La fête a fini plus tranquillement qu’elle «n’avait commencé... •
JH. $
Voltaire tarda peu à terminer sa brillante carrière; il expira sous les lauriers dont on le couvrait. Ses derniers instans furent affreux, dit-on; effrayé de l’autre vie il demandait un prêtre, et les philosophes qui l’entouraient se refusèrent à son désir pour conserver l’honneur de la secte. 11 mourut en dévorant ses bras et ses excré-mens.
Je sais qu’on fit d’autres versions sur ce moment terrible, mais je crois vraie celle queje rapporte, car je la tiens d’un valet de pied de M. de Villette, qui entra à mon service trois mois après le décès de Voltaire. Il était mort frappé du désespoir et des horreurs dont il avait été témoin.
Le clergé voulut empêcher les funérailles de Voltaire, on les lui enleva. Il trouva un sépulcre à l’abbaye de Scellières en Champagne, dont son neveu Mignot était abbé. C’est de là qu’en 1791 oti le transporta à Paris pour l’ensevelir au Panthéon.
Cette'même année, et le 2 juillet, si je ne me trompe, Jean-Jacques Rousseau alla pareillement de vie à trépas; il termina ses jours à Ermenonville , chez M. Girardin. Mais il fit beau-
SUR MARIE-ANTOÎNETTF. 67 coup moins de tapage que Voltaire; le bruit, courut qu’il s’était suicidé; je le crois, sans pouvoir l’affirmer. Ce qui est certain, c’est qu’il y a à son front que j’ai vu moulé en plâtre sur le cadavre, un trou par lequel passerait une très grosse balle. Voilà la fin des philosophes!
-Ce fut aussi cette année, au moment où Voltaire fit son apparition à Paris, qu’eut lieu la fameuse et triste affaire de M, le comte d’Artois avec M. le duc de Bourbon. Je raconterais plus longuement ce que je sais à ce sujet de première main, si d’autres n’en avaient pris le soin. Je viens de lire dans les Mémoires du baron de Bu-zen val, que le vicomte de Ségür, son ami, a publié sur celait beaucoup de détails vrais et d’autres inexacts. Je ne sais pourquoi il y traite mal la reine, par quelle malice sans cause il la signale comme ayant joué un rôle peu convenable dans cette affaire. C’est faux, car S. M. se conduisit très noblement, en sœur et en parente.
Madame la duchesse de Bourbon avait à sa suite, lors de son mariage, madame de Can il lac; ayant une jolie figure, de l'adresse et l'esprit d’intrigue; cette dame tourna ses batteries vers M. le duc de Bourbon, et parvint à lui faire faire
68 soüvESíftS
la première infidélité conjugale» La duchesse instruite, congédia la coquette, et madame de Canillac tendant plus haut ses filets, y prit M. le comte d'Artois.
A un bal masqué de l’Opéra, où se trouvait ce trio, madame de Canillac engagea le prince à la venger de la duchesse... S. A. R. cédant à con-tre-cœur, alla plaisanter sa cousine, qui, se fâchant, souleva la mentonnière du domino de monseigneur, afin de connaître l’audacieux qui osait la braver. Ce ton en provoqua un autre; S. A. R. courroucée, brisa le masque sur la figure de la duchesse, puis l’on se sépara.
Madame de Bourbon sachant à qui elle s’était attaquée, se promit de garder le silence; mais madame de Canillac gonflée de joie révéla tout. Aussitôt on prend feu à Versailles, et Paris se rangeant contre le comte d’Artois, cette étourderie lui fit un tort inconcevable. On parla de réparation, on laissa entrevoir un duel, car M. le duc de Bourbon, soutenu par l’opinion publique, haussa le ton. Le roi voulut intervenir, une entrevue eut lieu, qui mécontenta tout le monde. La reine désolée redoutait une rencontre, pourtant elle devint inévitable ; les princes se trouvèrent au
SOR MARIE-ANTOINETTE. 69 bois de Boulogne, échangèrent quelques passes, puis on les sépara au nom du roi, et tout fut terminé.
Le derrière de la toile présenta des incidens curieux j je les tairai hors un seul, c’est que M. le duc de Chartres, selon sa coutume, y joua un piètre rôle. Quel prince, il est bien mort comme il a vécu !
Le duel de M. le prince de Coudé avec M. d’A-goult pour une dame fit aussi rumeur dans le public; il ne me plaît pas d’en parler. Je n’aime point à mettre en jeu les princes de la famille royale, surtout en songeant à leur position présente.
La reine, qui traitait si bien madame de Gué-mené, fit en faveur de cette princesse un effort lorsqu’elle ne s’opposa pas à ce que le prince Louis de Rohan succédât dans la grande-aumônerie au cardinal de la Roche-Aymond, dont il avait la survivance. Il est certain, néanmoins, que madame de Marsan entreprit à elle seule la moitié de la besogne. Je tiens à ce sujet une révélation écrite par une personne attachée aux Rohan.
L’expectative de la grande-aumônerie avait
été promise par Louis XV à la comtesse dé Marsan, sœur du prince de Soubise, pour le prince Louis de Rohan, son cousin. Le monarque la lui assura par un écrit signé de sa main, et à l’avénement de Louis XVI, madame de Marsan obtint la ratification de cet acte royal; mais la reine, qui n’aimait pas le prince Louis, circonvint facilement le roi. Ou décida que la grande-aumônerie n’appartiendrait pas au premier, et qu’on dédommagerait la maison de Rohan de cette perte. Ce secret fut confié à M. de Maurepas, qui, ami de madame de Marsan, lui fit communiquer par un tiers la décision de Louis XVI.
Madame de Marsan n’en parla qu’à son frère et au prince Louis. L’abbé Georgel en informa la princesse de Guémené, qui, dans les bonnes grâces de la reine, pourrait faire changer d’opinion cette princesse, en lui peignant les vives inquiétudes de la maison de Rohan. Le moment pressait, le grand-aumônier était à l’extrémité; la princesse de Soubise. arriva chez sa fille, la princesse de Guémené, pour l’avertir qu’il était temps d’agir. Mais cette dernière ne put voir la reine qui se préparait pour aller à un bal mas-
SUR MARI E-A N TOI N ETTE. 7 î qué à Paris ; alors elle lui écrivit la lettre la plus touchante, et Marie-Antoinette y répondit tout de suite ces mots écrits de sa main :
« Soyez sans inquiétude,-ma chère princesse, 11 votre maison sera satisfaite, on ne lui enlèvera » pas la grande-aumônerie. »
Le prince de Soubise et sa fille étaient ravis dece succès; j’allai alors chez M. de Maurepas avec le billet, le soir à onze heures. Le ministre ne l’eut pas plus tôt parcouru qu’il me dit:—Non, on n’enlèvera pas la grande-aumônerie à la maison de Rohan , car le roi va la donner au prince Ferdinand de Rohan, frère du coadjuteur. Voilà le mol de l’énigme qui m’a été confié. Hâtez-vous, madame, de désabuser le prince de Gué-mené, et de prévenir la comtesse de Marsan.
La gouvernante des enfans de France fut confondue; le prince de Soubise se hâta d’aller à Paris pour montrer à sa sœur le billet de la reine, et lui en expliqua le sens. Le cardinal de la Roche-Aymond mourut, dans ia nuit; la comtesse de Marsan se trouva chez le roi à son réveil; et voici la conversation qui eut lieu entre eux.
Le roi. Je sais, ma cousine, que je vous ai
promis pour le prince Louis, la grande-aumônerie, mais c’est aujourd’hui chose impossible. Demandez-moi toute autre faveur pour lui et je vous l’accorderai.
Madame de Marsan. V. M. me cause une surprise qui ne peut s’allier avec la parole sacrée d’un roi. Non, sire, vous n’y manquerez pas, et mon neveu sera grand-aumônier.
Le roi. Personne ne peut me forcer à nommer un homme qui ne me convient pas.
Madame de Marsan. Mais, sire, une simple répugnance n’est pas un motif suffisant pour manquer à une parole solennellement donnée.
Le rai. Je rie manque point à ma parole je vous ai promis la place, et si je l’accorde au prince Ferdinand, la maison de Rohan n’a donc pas à se plaindre.
Madame de Marsan. Beaucoup, sire, oui, beaucoup, si le coadjuteur n’est pas grand-aumônier. C’est pour lui seul et non pas pour son frère que j’ai demandé et obtenu cette charge; votre promesse est formelle, je l’ai rendue publique, j’en suis garante vis-à-vis la maison de Rohan. V. M. voudrait-elle pour une répugnance déshonorer le coadjuteur et l'exposer
SUR MARIE-ANTOINETTE. ^0 au blâme d’avoir encouru votre disgrâce sans délit connu?
Le roi. Eh bien! je lui donnerai une faveur marquante pour détruire cette prévention; le cardinalat, par exemple ?
Madame de Marsan. Non, sire; nulle faveur ne peut compenser celle qui est revêtue du sceau de votre parole royale à laquelle seule s’attache le prix de mes services et des soins que j’ai prodigués à votre enfance.
Le roi. La reine aussi a ma parole.
Madame de Marsan» Je respecte, sire, les volontés de la reine, mais V. M. ne peut avoir deux paroles; la reine ne voudrait pas que par complaisance pour elle le roi fît ce que ne ferait pas le dernier gentilhomme de son royaume. Je prends donc la respectueuse liberté d’assurer V. M. qu’ayant publié la parole qu’elle m’a donnée, je me trouverai dans l’impérieuse nécessité de publier également que le roi n’y a manqué que pour complaire à la reine.
Le roi. Voulez-vous donc, ma cousine, me forcer à placer dans ma maison un homme qui me déplaît, et qui déplaît souverainement à la reine?
Madame de Marsan. Non, sire, je n’invoque aujourd’hui que votre loyauté, votre justice; nommez le coadjuteur grand-aumônier; si dans deux ans il n’a pas le bonheur de dissiper par sa bonne conduite et ses services les préventions de V. M., il donnera sa démission et ne paraîtra plus à votre cour : mon cousin remettra lui-méme au roi cette promesse par écrit au moment de sa nomination.
Le roi, pressé avec tant d’instances, se rendit enfin.
— Eh bien, dit-il, puisque vous l’exigez ainsi, je le nomme à regret, mais aux conditions que vous proposez vous-même.
Louis XVI n’eut pas plus tôt prononcé cette phrase qu’il parut plus à son aise. La comtesse de Marsan manifesta avec effusion , mais sans se départir de sa dignité ordinaire, le sentiment de sa reconnaissance. Elle se hâta ensuite d’annoncer à sa famille l’heureuse issue de son entretien avec le roi; néanmoins elle ne confia le secret des conditions qu’au coadjuteur. Le prince Louis de Rohan fut nommé, et le jour même il remit au roi la promesse convenue.
Cette anecdote est vraie ; mais ce que l’abbé
Georgel aurait dû ajouter, c’est que la reine, dès quelle eut appris la condition de nomination, dit au roi :
— Sire, c’est le jour des choses saintes, il y aurait en ceci une profanation que vous ne devez ni souffrir ni partager. J’aurais souhaité un autre grand-aumônier; mais puisque vous n’avez pu accorder cette charge qu’au prince Louis, laissez-l’en jouir en liberté.
Le roi rendit alors à madame de Marsan l’écrit de son neveu. Certes, la maison de Rohan qui a si mal agi envers la reine, aurait dû être touchée de cette générosité : on n’a tenu compte de rien à Marie-Antoinette. Je voudrais savoir ce que disent maintenant ceux qui, pour se venger, ont renversé la monarchie : je présume que, tombés en même temps, ils pleurent sur elle des larmes de sang.
Un homme qui vient d’obtenir une place fort importante, la doit à un événement assez singulier où il a fait preuve de cette hardiesse, de cette persistance qui sont presque toujours couronnées de succès. Sans fortune, et par conséquent sans considération, il sollicitait depuis longtemps un protecteur en sous-ordre qui lui avait
fait de belles offres, pour qu’il le présentât ail duc de Duras, duquel dépendait la place en question.
Le solliciteur rencontre le duc dans une promenade publique et l’accoste d’un grand coup sur l’épaule, puis d’un bonjour, mon ami..... Le duc se retourne. Mon homme, d’un air surpris, se confond en humbles excuses et semble at-téré. Enfin , feignant de revenir à lui, il supplie M. de Duras, qui voulait continuer sa marche, d’écouter sa justification. 11 prétendit l’avoir pris pour M. Duras, qui lui avait promis de le présenter le jour meme à M. le duc de Duras.
— Mais, reprit ce seigneur, le duc de Duras, c’est moi.
Nouvelles protestations de regret.
— Eh bien, pour quelle cause vouliez-vous m’être présenté?
— Ah ! monsieur le duc, je ne dois m’occuper en ce moment que d’obtenir la grâce de mon étourderie, et je n’ai plus rien à demander à M. Duras que devons supplier de la pardonner.
Leduc, touché de cette humilité, insiste et veut savoir en quoi il peut être utile; enfin , après quelques façons, mon homme, ravi du
succès de son stratagème, présente sa requête, et profite des dispositions favorables du duc pour l’intéresser en sa faveur. M. de Duras accueille sa demande, lui promet de s’en occuper, et l'invite à dîner pour le lendemain. L’intrigant ne manque pas de s’y rendre; la première personne qu’il rencontre chez le duc est son tiède protecteur, M. Duras. 11 lui raconte tout; celui-ci ne peut plus reculer; forcé d’aller à la rencontre du duc, qui arrive un instant après, il lui demande ses bontés pour le solliciteur.
— Vous venez trop tard, lui répond M. de Duras; votre protégé ne doit qu’à lui-même ce qu’il désire obtenir; il peut passer à mon secrétariat, on expédiera le brevet.
Après le dîner, mon intrigant, en effet, retira ses patentes, et je ne doute pas qu’avec un esprit aussi audacieux il n’ait été fort loin.
L’intrigue est à la cour le meilleur moyen de réussite, et à cette époque où la guerre venait d’être déclarée à l’Angleterre, le nombre était grand de ceux qui postulaient des emplois de terre et de mer. Parmi ces derniers on n’aurait pas du trouver M. le duc de Chartres; mais ce prince, avide de grossir son pécule, tendait à
78 SOUVENIRS
obtenir la survivance de la belle et lucrative charge de grand-amiral de France, possédée alors par son beau-père, S. A. S. le duc de Penthièvre.
Au château, on ne se souciait pas de la lui accorder pour mille raisons : la principale, celle de l’économie qui résulterait de la suppression de cette charge; la seconde, non moins décisive, était que M. le comte d’Artois la souhaitait aussi pour son nouveau-né, monseigneur le duc d’An-gouléme.
Cependant on n’osait pas rompre en visière au duc de Chartres, on le berçait meme d’une espérance vaine: et lui, pour l’emporter de haute lutte, s’avisa d’aller courir les chances d’une campagne sur mer. Il montait le Saint-Esprit, magnifique vaisseau commandé par le courageux Lamothe-Piquet, l’un des meilleurs marins de l’époque, lui pour qui on fit le mauvais quatrain suivant, mais pièce officielle, servant à constater la haute opinion que l’on avait de ce brave guerrier dans la marine :
C'était peu de nommer un vaisseau L'Invincible,'
U faut qu’il le soit en effet. Et la chose devient possible Quand Louis le confie à Lamothe-Piquet*
Donc M. le duc de Chartres, placé sur/e Sainte Esprit, suivait la Hotte commandée par le comte d’OrviUiers. Les Anglais sont rencontrés à Oues-tant, un combat naval s’engage, et la victoire nous reste. M. le duc de Chartres, après le premier coup de canon tiré, s’était fait mettre à terre; il monta en voiture, et fouette cocher!... Il arrive à Versailles et à Paris, où on le reçoit avec enthousiasme : « Il a de par Dieu gagné la bataille, c’est un héros!...» Cela est regardé comme certain pendant un ou deux jours; mais d’autres rapports surviennent, on reçoit des lettres, la vérité est connue, et l’on apprend de toutes parts qu’à l’exemple de Sosie, tandis qu’on se canonnait sur le pont, monseigneur au fond de la cale s’enivrait,
Afin de prendre du courage Pour nos gens qui se battaient.
Un mot dur, cruellement dur de M. de Lamothe-Piquet, qu’il ne démentit pas, acheva de montrer le revers de la médaille. La poltronnerie reconnue de l’altesse, les brocards, les chansons, les épigrammes tombèrent drus comme grêle ; je les réserve pour le Livre suivant.
aa^aa ^sawàaH»
Tai peu parlé d’un homme dont nous parlions tous les jours, du comte Maurepas, premier ministre, qui seul dirigea les affaires de l’État depuis le moment où Louis XVI l’appela auprès de lui, jusqu’à sa mort. J’aurai cependant beaucoup à en dire, ainsi que de sa femme, couple uni de cœur, et qui gouverna la France en bonne harmonie. Il en résulta que les favoris de la comtesse furent en réalité nos souverains. C’est madame de Maurepas qui donna pour sue
nt.
8a SOUVENIRS
cesseur au comte de Saint-Germain, ministre de la guerre j le prince de Montbarrey, vaniteux personnage, vrai comte de Tufière, et qui fit beaucoup de mal.
La reine ne pouvait souffrir M. de Maurepas. Il faut ajouter que tant qu’il vécut il ne laissa prendre aucune influence à Marie-Antoinette ; il n'hésita même pas à la calomnier auprès du roi et de la nation, afin de mieux la tenir à l’écart. Il fut un de ceux qui propagèrent la fable ridicule du comité autrichien, qui répandirent le bruit des envois prétendus de plusieurs millions à la cour de Vienne. La reine connaissait la malveillance des Maurepas pour elle, mais jamais elle ne leur a témoigné.
■—Je craindrais de déplaire au roi, disait-elle à madame de Polignac, si je l’éclairais sur les intrigues de ce ministre ; l’âge de M. de Maurepas mérite des égards.
— Mais, madame, il ne vous ménage point, lui l
— Il a tort.
— Il vous accuse de préférer l’Autriche à la France.
Et la reine, de pleurer et de ne plus répondre»
La pauvre princesse n’attendit pas la révolution pour répandre des larmes. Elle n’approuvait pas non plus la guerre d’Amérique, et à ce sujet je l’entendis dire avec beaucoup de sens à M. de Beauvau, alors très encroûté philosophe:
— Monsieur, je ne crois pas que le roi et la noblesse aient raison, quand ils préfèrent à une cause monarchique celle d’un état républicain. Si la république est bonne, pourquoi ne pas l’établir chez soi ? On envoie aux insurgens des hommes qui rapporteront ici leurs principes; ils voudront les mettre en^œuvre à Paris, et ce sera le bouleversement complet du royaume.
La suite a prouvé combien les raisonnemens de la reine étaient sages. M. de Mau repas ne voyait pas aussi loin ; il faisait des plaisanteries sur les insurgens et les Anglais. On avait arrangé la cheminée de son cabinet d’après un procédé nouveau auquel M. Franklin donna son nom. Le ministre s’étant aperçu de ce changement, dit à son architecte :
— Je vois que vous voulez empêcher lord Stormont (l’ambassadeur d’Angleterre) de venir se chauffer à mon feu.
M, de Maurepas mourut presque subitement sans avoir été malade; sa tête, depuis plusieurs semaines, se détraquait ; il se prenait pour le cardinal de Richelieu, et voulait être traité en conséquence. Connaissant son esprit porté au persiflage et à la mystification, .on s’imagina qu’il plaisantait : la persistance qu’il mit dans cette folie la rendit sérieuse; mais comme il raisonnait pertinemment sur tout le reste, on convint de ne pas s’y arrêter.
Dans les premiers jours de novembre 1781, je rencontrai M. de Maurepas qui sortait de chez la reine, où j’allais. Sa majesté riait aux larmes; je me réjouis de cette gaieté.
— Savez-vous ce qui la provoque? répondit* elle; M. de Maurepas est venu pour avoir une explication avec moi sur les nouveaux honneurs à lui rendre depuis que le pape l’a créé cardinal de Richelieu. Je vous assure qu’il est amusant de l’entendre.
Le roi survint, et la reine poursuivit le badinage. Louis XVI, d’un ton très sérieux, dit qu’il fallait avoir des égards pour un aussi bon ministre; qu’il voulait plaisanter.
— Dans ce cas, repartit Marie-Antoinette, le roi trouve-t-il convenable que M. de Maurepas me mystifie ?
Louis XVI ne répondit pas ; il s’en alla. La reine, alors, me pria de ne pas répéter ce que j’avais entendu, et je lui ai tenu parole tant qu’elle a vécu. Un instant après arriva madame de Maurepas, très inquiète, faisant un million d’excuses à S. M., qui la traita avec une bienveillance extrême; il fut convenu que l’on tairait les bizarreries du premier ministre.
Le 2i du même mois, à minuit, M. le duc de Nivernais entra chez moi.
— Que me donnerez-vous pour la grande nouvelle que j’apporte ? dit-il.
— Sans doute une mystification ?
•—Non, madame, une vérité importante: M. de Maurepas est mort il y a une heure.
Je poussai un cri.
— Sait-on qui le remplacera?
— Les uns nomment l’archevêque de Toulouse, les autres M. d’Ormesson, ou bien M. de Malesherbes.
— Mais l’ours est-il bien mort, avant que sa peau soit vendue ?
— J’étais chez le roi, à son coucher, lorsque le duc d’Estissac ( grand-maître de la garde-robe) est entré la larme à l’œil ; il a conté au monarque le grand événement; et sa douleur était telle, à cause de sa liaison avec le défunt, qu’il a cru devoir en demander pardon.
— Monsieur, a répliqué Louis XVI, j’excuse votre douleur, elle est légitime; mais si vous pleurez un bon ami, je perds un homme d’État supérieur, et de nous deux je suis le plus à plaindre.
Cette oraison funèbre , prononcé ex-cathedra, comme disent les savans , donna le ton. Il ne fut pas permis de se réjouir du départ d’un si pauvre ministre; le lendemain on fit son éloge. Le roi dit encore : Je n'entendrai plus, tous les Jours, mon ami à son lever. M. de Maurepas logeait au-dessus du monarque. Du reste, la faveur a survécu à la mort. Un usage immémorial fait emporter du château de Versailles tout cadavre dès l’instant du décès. On y garda celui de M. de Maurepas pendantsix heures, puis on le transporta vers cinq heures du matin au château de l’Ermitage, maison de plaisance située dans le parc de Versailles , que Louis XV fit construire pour ma-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 8? dame de Pompadour, et duquel son successeur avait fait don à vie à M. et madame de Mau-repas.
Le corps du défunt, revêtu de sa robe de chambre, fut d’abord couché dans un lit bien chaud, ou le mit dans une chaise à porteur, puis l’embaumement complété. Le cercueil fut présenté à Notre-Dame, et ensuite dans l’église de Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris, où reposaient tous les Pontchartrains.
Le roi s’était engagé à prendre sa part d’une fête que Monsieur donnait à Brunoy le 22; il envoya dire qu’on ne l’attendît pas, et il n’alla point à la chasse.
La reine gagnait trop à la mort de M. de Maurepas pour qu’on ne s’en félicitât pas d’une manière indirecte dans l’intimité. Elle nous dit avec cette mesure parfaite qui la distinguait :
— Savez-vous ce qu’il en arrivera ? mes ennemis , désormais, m’accuseront de toutes les fautes du gouvernement, tandis que jusqu’ici ils ne pouvaient suspecter que mes intentions.
Je crus devoir rappeler à S. M. les services et
les talens de M. d’Adhémar. Elle me répondit:
— Je ne les oublie pas, mais en ce moment je laisse au roi à décider de tous. Vous n’êtes pas la seule à me recommander un protégé, je ne savais pas la France si riche en grands hommes d’État.
Cette repartie ironique me blessa, et la reine le vit à ma physionomie, car, se levant, elle vint à moi et me tendit la main ; puis, avec sa grâce habituelle:
— Madame d’Adhémar, me dit-elle, ne m’en veuillez point, je n’ai pas fait allusion à votre mari. Mais si vous saviez à quelles persécutions je suis en butte, et quels personnages on me propose..... Pas plus tard qu’hier soir, chez la duchesse , madame de Polignac , on s'arrangea de manière à ce que je me trouvasse seule avec M. deVaudreuil, qui, saisissant l’occasion, me donna à entendre qu'il pourrait être un premier ministre tout comme un autre. Lui, premier ministre!... J’ai répondu franchement et même avec quelque rudesse. Eh bien, pendant le reste de la soirée, j’ai vu la consternation sur tous les visages, j’ai entendu chuchotter que je manquais
à l’amitié, que j'oubliais de grands services..... des extravagances enfin. Je suis entourée d’insensés.
La reine me cacha les scènes violentes que lui faisait l’abbé de Vermont en faveur de M. de Brienne, ainsi que tous les Choiseul qui la tourmentaient également pour qu’elle étayât de son influence le chef de la maison.
Un fait assez curieux, et que M. de Choiseul rédigea et fit circuler lui-même, fut celui de sa causerie explicative avec la princesse de Gué-méné. C’était au moment où le duc de Lauzun proclamait sa ruine totale au préjudice de sa femme, mademoiselle de Bonifiées, dont j’ai déjà parlé. La princesse de Guéméné avait euM.de Lauzun pour amant, et, en cette qualité, elle se croyait en droit de le défendre, même contre la duchesse de Lauzun. Celle-ci était parente de M. le duc de Choiseul, qui, peu satisfait de la conduite des Rohan pendant sa disgrâce , saisit cette occasion de les en punir. C’est dans ce but qu’il écrivit et fit répandre la relation suivante :
« M.le duc de Choiseul étant àVersailies au mois
de janvier 1778 , pour la cérémonie de l’ordre.
demanda un rendez-vous à madame la princesse
de Guéméné qui chercha à l'éluder sous divers prétextes. M. de Choiseul coupa court aux difficultés en lui disant qu’il viendrait le lendemain, et l’attendrait jusqu’à ce qu elle fût visible.
» Ne pouvant plus éviter cette visite, madame de Guéméné se trouva chez elle quand M. de Choiseul arriva. La princesse, affectant toutes les grâces d’une femme à la mode, demanda au duc, en minaudant, pourquoi il tenait tant à la voir.
»—Je vais vous l’apprendre, madame,répondit-il. Vous connaissez les liens qui m’attachent à madame de Lauzun , liens que ses malheurs Fessèrent encore davantage; aussi ai-je appris avec peine que vous prétendiez avoir en main de quoi la déshonorer. Serait-il vrai que la duchesse ait trompé ses amis et le public? Cette question, que je voulais vous adresser, est le but de ma visite.
» —Je n’ai pas eu tort, répondit-elle avec embarras, de dire à M. de Guéméné combien on lui en voudrait de son affaire avec M. de Lauzun.#
Pour l’intelligence de cette phrase, il faut savoir que le duc de Lauzun avait vendu au prince de Guéméné toute sa fortune à fonds perdu.
SUR MARIE-AN TOI NETTE. pi se réservant quatre-vingt mille livres de rente, un million comptant, un hôtel, et j’ignore quoi encore. Au reste, la banqueroute postérieure du prince annula ce marché.
« M. de Choiseul, devinant que la princesse cherchait un faux-fuyant, la ramena ainsi à la question principale :
» — Il ne s’agit point, madame, de cette triste affaire; elle a occasionné des murmures, il est vrai, mais je ne m’en mêle point, étant sans mandat pour la traiter. Je reviendrai donc, si vous le permettez, à vos propres paroles : que vous avez en main de quoi déshonorer madame de Lauzun.
» Cette persistance troublant le princesse, lui fit commettre une faute; et d’une voix émue :
»—Je reconnais,dit-elle, la malice indiscrète de M. Duchâtelet.
«Le duc, cachant sa joie, repartit :
»— Dire qu’il s’est rendu coupable d’indiscrétion, c’est avouer en même temps, madame, que vous lui avez tenu le propos dont je me plains, car il n’est pas homme à rien inventer. Or, ceci convenu, je vous prierai de me four-
nir les preuves du déshonneur de madame de Lauzun.
» La princesse, comprenant son tort, crut re prendre l’avantage en se retranchant dans sa dignité.
o — En vérité, M. le duc, reprit-elle d’un ton hautain, je ne m’attendais pas à me voir interroger judiciairement par vous sur ces faits et articles. C’est pis qu’à la Tournelle.
»—Madame, répondit M. de Choiseul avec autant de fermeté que de froideur, lorsqu’on avance sur une femme honnête un fait de cette nature, on doit en avoir la preuve, et cette preuve je persiste à la réclamer.
» — Je vois, dit la princesse avec un rire forcé, que vous me ferez assigner en plein Châtelet, pour peu que je m’obstine à garder le silence.
» — Il n’en sera pas besoin, madame; je prierai le roi d’assembler les deux familles, et de vous contraindre de montrer ces preuves dont vous êtes nantie.
» —Ceci est singulier, monsieur. Quoi, une telle esclandre, le roi mis enjeu; la cour aux aguets! C’est donc du scandale que vous voulez?
s — Non , madame ; mais que ce qui est vrai soit connu, que vous accusiez directement ma cousine... Au reste, il serait possible que nous ne fussions pas d’accord sur ce qui peut déshonorer une femme; et, en traitant cette question entre nous, probablement que nous nous entendrons mieux.
» — J’ignore où vous voulez en venir.
»— Vous allez le savoir, madame. Voilà mon opinion : une femme est déshonorée non parce quelle a un amant, mais bien si elle en a plusieurs à la fois, ou s’ils se succèdent avec une telle rapidité qu’on ne peut en compter le nombre ; si elle les prend au hasard, selon la taille, l’encolure, dans les antichambres comme dans les salons, et que ces derniers, un peu plus de mise que les autres, la méprisent assez pour ne pas même rester ses amis. Voilà, selon moi, et selon vous, madame, n’est-il pas vrai, ce qui doit déshonorer une femme. Or, je doute que vous prêtiez plus d’un amant à madame de Lauzun, que même vous lui en donniez un seul. 5/ pourtant vous avez la preuve en main...
» Pendant cette allocution faite avec une malice et un sang-froid écrasant, madame de Guéméné
s’agitait, balbutiait ; et lui, prenait acte des mots entrecoupés qui lui échappaient.
»— J’étais certain, reprit-il, que vos preuves ne pouvaient avoir rapport à ce genre de déshonneur, qui, du reste, n’est pas le seul dont une femme puisse se flétrir : il y a encore celui qui naît de la passion effrénée du jeu, d’un luxe ruineux pour la famille ; et on ne reprochera pas la première à madame de Lauzun, attendu qu’elle ne joue qu’au wisk à six francs la fiche, et puis elle paie ses dettes de jeu, ce que ne font pas toutes les dames de ma connaissance, cependant il se peut qu’elle nous trompe encore là-dessus, et st vous en avez ia preuve.,.
« — Non, monsieur, interrompit la princesse, furieuse intérieurement, je ne l’ai point, je n’ai pu le dire. Vous êtes un homme cruel... supposer que j’aurais...
» — Cela n’était donc pas? tant mieux. Cependant permettez-moi d’ajouter que ce qui déshonore réellement une femme c’est de mentir, je ne dis pas pour conter une chose qui amuse et fait rire, mais pour nuire aux autres, pour outrager le malheur, et imputer ses propres torts à celles qui n’en ont pas; et convenez, madame,
SUR MARIE-ANTOINETTE. q5 que sur ce point encore la duchesse de Lauzun est irréprochable.
» La princesse haletante, rouge de colère, et voulant répondre quelque chose, s’écria :
»— Eh bien, monsieur, puisqu’il faut vous le dire, madame de Lauzun affecte de condamner son mari.
» — Ce serait simplement un tort; et je ne crois pas d’ailleurs que M. de Lauzun ait le droit de s’en plaindre.
»—Mais, monsieur, elle est allée demeurer chez madame la maréchale de Luxembourg, que le duc de Lauzun ne peut souffrir.
»— Qui paierait sou logement si son aïeule ne lui en donnait pas un?
—» Elle ne porte pas les diamans que son mari lui a donnés.
»— Sur ce fait, madame, je puis vous éclairer d’une manière satisfaisante. M. de Lauzun a effectivement donné des diamans à sa femme, mais il a oublié de payer le joaillier, qui a écrit à la duchesse qu’il lui arracherait du cou des bi-joux quon lui a extorqués.
» — Je l’ignorais.
* — J’ajouterai que madame de Lauzun n’a
96
pas même ces diamans chez elle, les ayant mis en mains tierces. Je lui aurais conseillé de les vendre parce qu’il s lui appartiennent. M. de Guéméné devait satisfaire le joaillier ainsi que les autres créanciers, et comme il ne lui a pas payé sa dot, elle a besoin de ses diamans pour vivre.
»— M. de Guéméné la paiera exactement
» — Je l’espère, madame. Je ne suis pas venu ici pour discuter cette affaire, ni même pour justifier madame de Lauzun, qui est au-dessus de la calomnie ; je voulais seulement vous faire sentir que l’honnêteté, la décence, l’intérêt, s’il faut le dire, auraient dû vous rendre plus circonspecte, vous engager à ne point avancer des choses contre une famille qui a le droit et les moyens de les repousser.
»—Ehl monsieur, d’abord des reproches, maintenant des leçons. Vous avouerez que je ne devaispas me croi re encore sur les bancs del’école.
»— Aussi, madame, terminerai-je cette visite qui paraît vous importuner5 le but d’ailleurs en est rempli, dès que j’ai acquis la persuasion que vous navez point de preuve en main capable de déshonorer la duchesse de Lauzun... Adieu donc, madame *
> — Bonjour, monsieur. »
Et le duc alla raconter à qui voulut l’entendre ce que, pour la grande édification de tous, il écrivit en forme de récit comme je l’ai répété. La cour en fut divisée. La reine aimait alors la princesse; sa position devint embarrassante, chacun la voulant pour soi; on crut que le prince demanderait raison à M. le duc de Choiseul de son impertinence, il n’en fit rien, tout occupé qu’il était à se ruiner.
11 y travaillait largement et avec une promptitude extrême, empruntant à fonds perdu, en viager, de toute main, sans calcul ni retour sur soi-même. Aussi la masse des dettes et celle des rentes s’accrut dans une proportion effrayante; et voilà qu’un beau soir, en septembre 1785, si je ne me trompe, on vient d’abord nous dire à l’oreille : — Le prince de Guémené est mal dans ses affaires, puis le lendemain on ajoute : — H est ruiné. Le troisième jour on prononça le mot de banqueroute. Un Rohan !... Ce fut un coup de foudre.
La faillite s’éleva à plus de trente-cinq millions. Elle enveloppa tout le menu peuple de Paris qui portait là ses épargnes ; aussi il fallut
ni.
faire garder l’hôtel de Soubise contre la populace. Tous les Rohan feignirent d’être consternés , tandis que le prince Ferdinand, archevêque de Cambrai, s’en allait disant:— Convenez quil n’y avait en France que les hommes de notre mai’-son qui pussent faire une telle banqueroute.
— Aussi , monsieur, repartit Rivaro!, est-elle sérénissime.
Faisant allusion au titre de prince que se donnaient ces messieurs.
M. le prince de Soubise cessa de se montrer à l’Opéra. 11 y pensionnait une trentaine de danseuses qui eurent la générosité de lui offrir la remise de ses dons. Le roi fut indigné de cet événement; le prince de Guéméné reçut l’ordre de ne plus paraître à Versailles. La princesse y vint, vit la reine en privante, et demanda la conservation de sa charge de gouvernante des enfans de France. Cette grâce lui fut refusée, et elle partit furieuse.
Bientôt après arriva madame de Marsan, qui réclama comme sa propriété ladite charge. On lui répondit que la maison de Rohan n’avait point à prétendre en ce moment non seulement à un droit, mais même à une faveur.
Je savais déjà l’intention de la reine» car j’étais avec elle lorsque M. le duc de Nivernais lui donna le premier éveil sur la catastrophe des Gué-mené. Elle me fit signe de l’approcher.
Sans en savoir davantage, j’allai trouver la duchesse à laquelle je portai ce doux compliment. Elle ne comprit pas plus que moi ce qu'il signifiait, et comme elle était indisposée, elle écrivit presque sous ma dictée le billet dont voici à peu près les termes :
» Madame,
«Les bontés dont V. M. m’honore me font » espérer qu’elle me permettra de lui demander, » comme en étant la preuve, la première charge «qui deviendra libre avant peu de temps, pourvu » toutefois que je ne nuise en rien au titulaire et «à sa famille, etc... »
La duchesse de Polignac riait en écrivant
— Je gage, disait-elle, que c’est une mystification.
í 00 SOÜVEÑiRS
En ce moment le comte de Vandreuil entra tout hors de lui.
— Savez-vous, dit-il, la nouvelle absurde que l’on ose répandre?
— Non, dîmes-nous.
— On parle d’une banqueroute de 55 millions que fait le prince de Guéméné.
Madame de Polignac me regarda avec expression, puis elle se mit en devoir de cacher la lettre.
— Si vous écrivez à la reine, reprit M. de Vau-dreuil, mandez-lui cette fable.
La duchesse sourit, nous échangeâmes un autre coup d’œil, et elle, reprenant la plume, ajouta en post-scriptum :
« M. de Vaudreuil qui entre chez moi m’a dit • que le prince de Guéméné faisait une banque-» route immense5 la reine en savait-elle quelque • chose? »
Un domestique affidé prend Tépitre et l’emporte ; je me lève un instant après et me présente de nouveau chez la reine. En me voyant elle me fait un signe d’intelligence, puis ensuite trouve le temps de me dire :
— Le comte de Vaudrenil a raison, le fait est exact.
— Dans ce cas, j’ai un compliment à faire à notre amie.
— On me blâmera! reprit Marie-Antoinette.
— Et de quoi? madame de Polignac a de la naissance, sa conduite est irréprochable, et votre majesté Thonore de son amitié. Ce titre seul est un droit.
—Non pas pour ceux qui peuvent prétendre à la charge. On va nous assaillir de demandes, il faut prendre le devant sur les gens pressés. Madame d’Adhémar, me voilà solliciteuse.
La princesse envoya savoir si elle pouvait passer chez le roi, et dix minutes après on annonça Louis XVI. Nous nous retirâmes toutes de la chambre.
— Qu’est-il arrivé? demanda le monarque, le feu a-t-il pris aux étoiles?
(Cette expression lui était familière.)
— Oui, sire, répondit la reine, il a pris du moins aux macles [i] des Rohan; le prince de
(t) Terme de blason.
SO» i VE N JUS
Guéméné a fait banqueroute de 5o millions (ce fut d’abord ce qu’on dit),
— Ah! le misérable!.... j’espère bien qu’il se démettra de sa charge ( celle de grand-chambellan); s’il l’oublie, je l’en ferai ressouvenir.
— Et sa femme, siré?
— Eh bien!
— Elle est toujours gouvernante des enfans de France?
— Elle abdiquera aussi, je ne veux ni femme ni mari.
— En ce cas, je demande la charge pour madame de Polignac.
— Elle est bien jeune pour de si hautes fonctions ?... Cependant, si cela vous était agréable...
— J’en serais heureuse, sire.
— Qu’elle soit donc gouvernante de mes en-fans..... Mais j’aurai sur les bras madame de Marsan.
— Vous lui direz que je vous ai demandé la charge.
— Très volontiers, madame.
Le roi dit cela en homme enchanté de rejeter sur autrui un fardeau pesant, puis il quitta la
io5 reine. Deux heures après il reçut un billet de la comtesse de Marsan, qui sollicitait de Louis XVI une très prompte audience. Il répondit que si c’était relativement au malheur du prince de Guéméné il n’y pouvait rien, justice devant être faite; que s’il s’agissait de la charge de la princesse, il fallait voir la reine avant que d’arriver au roi.
Nouvelle épitre à Marie-Antoinette, qui répliqua qu’elle serait visible le lendemain. Un ami conseilla à madame de Polignac de quitter Versailles jusqu’au lendemain.Elle n’était pas encore à Sèvres que madame de Marsan arrivait à sa porte. L’absence de la duchesse l’étonna. — Où est-elle? La réponse fut négative, elle ne l’avait pas dit. A onze heures du soir madame de Marsan revint, pareille réponse.
Le lendemain, la comtesse de Marsan arriva chez la reiné, roide et solennelle»
— Madame, dit-elle après les complimens d’usagés, la reine connaît le malheur qui frappe mon neveu; ma nièce n peut conserver ma charge que je lui ai cédée. Je la reprends, et vais en aller prêter serment entre les mains de S. M.
104
— Cela est impossible, répondit la reine, piquée de cette forme hautaine, car la charge est donnée.
— Donnée !... mon bien!
— Votre bien, madame! dites une grâce du roi. Depuis quand les charges royales sont-elles des apanages de la maison de Rohan? Vous avez possédé la plus belle, sans doute, et Pavez honorablement remplie; votre nièce a eu moins de bonheur, on lui retire ce que vous-même la déclarez incapable de conserver. Mais vous en investir, rendre les charges de la maison royale héréditaires dans la vôtre, c’est ce que vous ne pouvez espérer.
— On m’avait bien dit que la reine ne nous aimait pas.
— J’aime qui m’aime, et ne vois pas la nécessité de donner mon affection à..... des indiffé-rens. Vous possédez les trois premières charges, une vous reste, et vous ne pouvez accuser personne de la perte de celle que vous cessez d’occuper.
— Madame, lorsque j’élevai le roi et ses augustes frères, je comptais sur leur reconnaissance.
— Aussi ne vous a-t-elle pas manqué.
— La reine me permettra de faire valoir mes droits juridiquement.
— Je ne vous permets ni ne vous interdis rien, madame; vous avez cédé votre charge sans condition, et vous n’avez plus de droits sur elle; cela peut vous être désagréable, mais ce n’est point une injustice.
— Le roi veut-il m’entendre?
— C’est à lui, madame, de vous le faire savoir.
La comtesse partit la rage dans lame et alla chez le roi. Cette entrevue ne lui réussit pas davantage. Ce n’était plus comme pour la grande-aumônerie, il n’y avait ni promesse ni engagement écrit, aussi Louis XVI put-il prendre sa revanche. Néanmoins, il tâcha de consoler madame de Marsan; cet excellent prince souffrait du malheur des autres. La reine écrivit également à cette dame un billet respectueux. On n’en tint aucun compte, et dans un conciliabule à l’hôtel de Sou bise, on prit la ferme résolution de se venger de la reine. A ce fait, que peu de personnes ont su, se rattachera un incident sur l’aventure du fatal collier; j’y reviendrai si je m’en souviens. Au reste, je ferais mieux de franchir la
loó
distance et de dire tout ce que je sais à ce sujet. Je parlerai donc de cette horrible affaire après que j’aurai achevé de raconter ce qui regarde celle de la charge de gouvernante des enfans de France.
Madame de Polignac accourut chez la reine peu de temps après lui avoir écrit. Des larmes, des baisemens de mains manifestèrent d’abord sa gratitude ; puis elle parla de sa pauvreté > des cabales qui s’élèveraient contre elle. La duchesse de Grammont convoitait celte charge , son frère la demanderait en récompense de la couronne de France mise sur le front de l’archiduchesse.
— Mais, repartit la reine, je n’ai rien promis à personne, et je vous accorde la charge de gouvernante des enfans de France avant que nul se soit présenté. Que pourra-t-on dire de raisonnable contre cette mesure? Quant à votre pauvreté, c’est quelque chose de réel; on y avisera, vous serez satisfaite.
— Mais, madame, i’exigeance de l’étiquette veut que je ne quitte pas mes élèves pendant une seconde, et à aucun prix je ne voudrais être éloignée de la reine.
— Eh bien, on arrangera les voyages de la
SUR MA RIE-ANTOINETTE. 10} cour à votre satisfaction. Pensez-vous que je puisse me passer de votre société?
Comment se refuser à tant de bontés ? madame de Polîgnàc se rendit. Voilà commentent lieu le début de cette affaire, bien que d’autres Paient racontée d’une manière différente.
La nomination de la duchesse de Polignac à une charge aussi importante fut un autre crève-cœur pour toutes les autres cabales, car chacune y voulait sa créature. Les personnes qui composaient l’intimité de la reine formaient seules des vœux pour madame de Polignac.
Ce choix déplut jusqu’au Palais-Royal : ne s’y était-on pas imaginé qu’il devait tomber sur la comtesse de Genlis. Celle-ci écrivit à ce sujet à la reine, qui, se rappelant mes anciens rapports avec madame de Genlis, me remit sa lettre en m’enjoignant d’y répondre de vive voix en son nom, c’est-à-dire d’accueillir la requête par un refus poli.
Cette mission présentait des difficultés sans nombre, ressortant du caractère bien connu de la postulante. Cependant il fallait bien délivrer Marie-Antoinette de cette obsession, et je me déterminai à franchir le pas. Après avoir mis ma
pins belle robe, je montai dans l’un des carrosses de la reine, escortée de sa livrée, puis je me fis conduire à Belle-Chasse.
Je n’étais pas attendue ; aussi je puis dire avec Racine que je trouvai madame de Genlis
Dans le simple appareil
D’une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil.
Elle était entourée dun désordre sans exemple; tout semblait mal tenu, hors de place. Les cheveux de la gouvernante, qui n’avaient pas été peignés, soutenaient une coiffe rousse et déchirée en partie. Un pet-en-l’air taché, un jupon à l’avenant, des mules en savates, des bas sales et retombant sur les talons, complétaient l’ajustement de madame de Genlis.
Dès que la comtesse me vit, elle vint empressée à ma rencontre, et me décerna des honneurs imaginables , que dans mon embarras j’acceptai sottement. Elle fit ensuite passer en revue devant moi ce qu’elle appelait l’académie : les enfans de S. A. S. monseigneur le duc de Chartres, puis les autres élèves admis aux bienfaits de cette excellente éducations ce sont ses propres paroles. Ce préambule achevé, elle renvoya l’académie; re-
SÜR a/ÁhÍE-AÈTÒlNETTÊ. í òg venant à moi, elle médit du ton riant et ouvert d’un génie satisfait :
— Eh bien, madame? que vous semble, n’y a-t-il pas là de quoi justifier le choix de la reine ?
Je compris dans quelle erreur ma venue avait jeté madame de Genlis, et mon embarras augmenta. Cependant, forcée de déchirer le voile, je m’appuyai sur ses dernières paroles.
— Le choix de S. M., madame, répliquai-je, serait sans doute tombé sur vous, si la reine avait pu prévoir que vous le désiriez; mais dans son ignorance de vos intentions, elle a déjà pris des engagemens irrévocables.
La comtesse se mordit les lèvres jusqu’au sang.
— Quoi! s’écria-t-elle, vous ne m’apportez pas la nomination de la charge des enfans de France?
— C’est un plaisir qui ne m’est pas permis; la reine, vous ai-je dit, a fait un choix, et elle est désolée de ne pouvoir employer vos talens supérieurs.
— LL. MM. n’ont donc pas compris avec quel avantage les enfans de monseigneur le duc de Chartres paraîtront dans le monde à côté des
leurs, quelle supériorité ils obtiendront sur eux par l’éducation?.,. Et qui me préfère-t-on ? Madame dePolignac, je gage!
— Elle-même, ce modèle des vertus modestes.
— Une ignorante, qui n’a lu ni les Pères de l’Église, ni Homère, ni Virgile, ni enfin les grands auteurs... Ce choix révoltera la France, les plaintes en surgiront de toutes parts!
Blessée dans mon affection pour la duchesse, je répondis à madame de Genlis que, pour être gouvernante d’en fans au-dessous de sept ans, tant d’érudition n’était pas absolument nécessaire. Bientôt la discussion prit un ton plus aigre, et, dans un moment de colère, je ne pus m’empêcher de dire :
— Eh! madame, après toutes les horreurs qu’un certain parti et que certaines personnes ont mises au jour contre la reine, n’est-ce pas un acte de charité plus que chrétienne de sa part que d’envelopper un refus aussi délicatement ?
A ces mots, nouvelle explosion : madame de Genlis voulut me prouver qu’elle n’avait pas écrit une ligne desdits pamphlets.
— Tant mieux! répliquai-je : car, outre qu’ils dénotent de la méchanceté, le style en est détestable.
— Mais pas tant.
Et là-dessus commença une querelle digne de Molière, où la paternité d’auteur luttait contre la nécessité de nier toute participation aux libelles. Il en résulta que nous nous séparâmes plus aigres que jamais, et que cette démarche, inspirée par un amour de paix, ne fit qu’envenimer la haine que le Palais-Royal portait à Marie-Antoinette. Cependant madame de Genlis eut le bon esprit de ne rien dire do notre entrevue. Cela lui aurait nui auprès de son parti, qui lui eut demandé pourquoi elle jouait un double rôle.
Pendant un instant, madame de Guéméné, forte de l’amitié de la reine, crut qu’elle conserverait sa charge. Elle parla à S. M. avec chaleur, fit un appel solennel à son ancien attachement. Mais ses extravagances eurent plus de force que ses paroles. Croirait-on que cette malheureuse femme s’avisa, pour passer le temps, de vouloir jouer la comédie dans la terre de M. Ives, située en Normandie, où la retenait en appa-
ren ce une lettre de cachet ¡...Elle fit venir des ouvriers, ordonna la construction d’un théâtre, in-vitaàdes soupers et à des bals... en un mot, entassa sottises sur sottises. Sourde aux représentations de ceux qui étaient encore attachés à sa personne, elle indignait ses créanciers, lesquels allaient lui faire un mauvais parti, lorsque M. le prince de Soubise,son père,arriva pour mettre un terme à ses folies. Il fit démolir le théâtre, interdit tout plaisir, et menaça la princesse d’une réclusion dans un couvent si elle ne revenait pas à une conduite plus régulière,
M. de Guéméné devait, rien qu’en rentes viagères, 2,068,000 livres, qu’il s’était engagé à servir annuellement; il prenait de toute main : ses agens dans les ports de la Bretagne et de la Normandie extorquaient à de pauvres matelots leurs petites économies , sous prétexte de les leur placer à de gros intérêts. Le nombre des créanciers dépassa trois mille. La princesse, au lieu de payer les fournisseurs et les gens de service des enfans de France, touchait les sommes, et en échange imposait l’obligation de prendre des contrats.
Toutes ces choses divulguées la perdirent sans
retour; mais ce qui accabla le plus cette famille fut la 1 et ire dont j’ai parlé, écrite dans la logeât mademoiselle Guinard, et signée de toutes ces demoiselles. Jamais mieux qu’alors ne se vérifia la morale de la fable de La Fontaine l Ours et VA* matear de Jardins. On doit savoir, pour ¡intelligence de ceci, que M. de Soubise, à part 6,000 livres par mois dont il gratifiait la célèbre danseuse, dépensait une somme égale en pensions annuelles aux nymphes de l’Opéra. Lors de la catastrophe de son gendre, il cessa de venir à ce théâtre et ses petits soupers furent interrompus. Ceci occasionna une grande consternation, et en conséquence on lui écrivit en ces termes :
« Monseigneur ,
» Accoutumées, moi et mes camarades, à vous » posséder parmi nous le jour de représentation «du théâtre lyrique, nous avons observé avec le «regret le plus amer que vous vous étiez privé «non seulement du plaisir du spectacle, mais * encore qu’aucune de nous n’avait été appelée à » ces petits soupers fréquens où nous avions tour » à tour le bonheur de vous plaire et de vous ni. g
» amuser. La renommée ne nous a que trop instruites <le la cause de votre réclusion et de «votre juste douleur. Jusqu’à présent nous avons «craint de vous importuner, faisant cederla sen-«sibilité au respect. Nous n’oserions même en-«core rompre le silence, sans le motif pressant «auquel ne peut résister notre délicatesse.
« Nous nous étions flattées, monseigneur, que » la banqueroute (car il faut bien se servir d’un «terme dont les foyers retentissent) ne serait pas «aussi considérable qu’on l’annonçait, et sur-» tout que les sages précautions prises par le roi «pour assurer aux réclamans les gages de leurs «créances ne frustreraient pas l’attente générale. «Mais le désordre est monté sans doute à un «point si excessif, qu’il ne reste aucun espoir; » nous en jugeons par les sacrifices généreux aux-« quels, à votre exemple , se résignent les princi-» paux chefs de votre illustre maison. Nous nous «croirionscoupables d’ingratitude,monseigneur, »si nous ne vous imitions en renonçant aux pen-« si on s que nous a prodiguées votre munificence. «Appliquez ces revenus, monseigneur, au sou-» lagement de tant de militaires infirmes, de tant »de pauvres gens de lettres, de tant de domes-
* tiques malheureux, que M. le prince de Gué-» mené entraîne dans sa ruine.
j Quant à nous, il nous reste d’autres ressour-♦ ces, et nous n’aurons rien perdu, monseigneur, » si vous nous conservez votre estime. Nous au-» rons meme gagné si, en refusant aujourd’hui «vos bienfaits, nous forçons nos détracteurs à » convenir que nous n’en étions pas tout-à-fait «indignes.
«Nous sommes avec un profond respect.....
« Ce vendredi, 6 décembre 1782. »
En sou pan t chez la maréchale de Luxembourg, quelqu’un s’avisa de dire que la banqueroute du prince de Guémené était un acte royal.
— Dans ce cas, repartit la maréchale, espérons que ce sera le dernier acte de souveraineté que feront MM. de Rohan.
Elle se trompait, la grande et maligne dame. Cette famille, que l’on croyait arrivée au dernier degré de l’abaissement, réservait encore au monde un éclat non moins extraordinaire et d’autant plus coupable, que le nom sacré de la reine s’y trouva indignement mêlé. On présume que je signale la célèbre affaire du collier si connue.
i 16 śoti^śiiiś
Aussi je n’y ajouterai que les particularités igtîd* rées du public.
Je me promenais sur le tapis vert, avec madame de Mirepoix, MM. de Chastellux et de Fi-marcon. Nous fûmes croisées par deux jeunes femmes, jolies, de bonne tournure, qui donnaient le bras à un jeune homme d’une beauté ravissante et portant l’habit d’officier de marine. Je les avais déjà vus, et tous trois me frappèrent par une grande ressemblance de famille.
— Mesdames, saluons des gens qui croient être ici chez eux, nous ditM. de Chastellux.
— Les princes du sang, répondit la maréchale, peuvent seuls avoir cette haute prétention.
— Vous oubliez les descendans des Valois.
— Oh! cette charmante comtesse de Lamothe, s'écria madame de Mirepoix, où donc est-elle ?
— Nous venons presque de la heurter; elle se promène avec sa sœur, et son frère le baron de Valois.
— Oh! ce sont de très grands seigneurs, reprit la maréchale, mais tombés dans la misère ; néanmoins on ne peut leur contester d’être Valois Saint-Remy du côté gauche, car ils descendent d’un fils naturel du roi Henri II.
Madame de Mirepoix nous conta alors l’histoire généalogique des trois jeunes gens issus de rattachement du roi pour Nicole de Sauvigny, haute et puissante dame de Fontella de Saint-Remy et autres lieux. De cette illustre souche provinrent, au septième degré direct et sans interruption, ni louche, Jacques de Valois, baron de Saint-Remy et de Valois, né le 25 février 1755, et maintenant en service dans la marine royale, Jeanne de Valois Saint-Remy, née le 22 juillet 1756, et Marie-Anne, leur sœur, née le 2 octobre 1767. Ces enfans, malheureux dès leur bas-âge, gardaient les bestiaux. Je ne sais dans quel lieu leur beauté frappa madame de Boulainvil-liers, qui se chargea de leur éducation. Le garçon suivit la carrière des armes ; la fille aînée épousa le comte de Lamothe, gentilhomme champenois, très bien apparenté d’ailleurs, mais sans fortune. La cour aurait dû enrichir ces des-cendans d’une branche royale; cependant ils n’eurent qu’une pension de 6 à 800 francs pour tous les trois. La maréchale ajouta que la comtesse Lamothe-Valois passait sa vie à solliciter, qu’elle était protégée par le grand-aumônier de France, le prince Louis de Rohan*
— On dit en outre qu’admise dans , l’intimité de la reine, elle attend beaucoup de la munificence de cette auguste princesse.
Ici je me récriai en affirmant que cette dame était inconnue à Marie-Antoinette.
— Je crois, ma belle, repartit la maréchale, que vous vous trompez. Je tiens ce que j’avance du prince Louis lui-même, il en a la preuve.
A cette assertion je me ressouvins de cette nuée d’intrigantes qui s’étaient servies de leur liaison prétendue avec la reine. Cependant la haute naissance de cette dame, la possibilité d’audiences obtenues secrètement, m’empêchèrent de rien décider sur ce fait. Je laissai tomber la conversation ; et lorsque je me trouvai avec la reine, je laissai échapper le nom de Lamothe-Valois.
— Qui est-elle ? me demanda la princesse.
— Unedescendante de nos anciens rois, mais par bâtardise, fort protégée d’ailleurs par S. M.
— Le roi, c’est possible; quant à moi, je le nie... Si fait... j’ai reçu une quantité de placets portant cette signature ; je m’en souviens. Quant à madame de Lamothe-Valois, point ne l’ai encore vue.
— Elle est appuyée par le prince Louis,
— Encore...
La reine sourit et s’arrêta, sa bonté l’empêchant d’achever la phrase. Mais je ne vis rien en elle qui laissât deviner des rapports secrets avec madame de Lamothe-Valois.
Peu de semaines après ces deux conversations, j’appris avec toute la cour la nouvelle inexplicable et sans exemple de l’arrestation du grand-aumônier de France, revêtu de son costume et dans le château de Versailles, le 15 août i;65. Ce fut M. de Mortęmart qui me la communiqua. Il se trouvait par hasard à côté du prince Louis lorsque ce coup de foudre le frappa. Quanta moi, j’étais à mon secrétaire, écrivant à M. d’Adhé-mar, et voici en quels termes je lui mandai cet événement :
«.....Vous ne m’en voudrez pas si des » comptes annuels de Montfalcon je passe à quel-»que chose de plus intéressant... Écoutez-moi «bien, ou plutôt cherchez dans les lettres de » madame de Sévigné celle qui commence par » tant d’exclamations au sujet du mariage de la «grande demoiselle avec M. de Lauzun, et, ar-» rivé au bout, ajoutez ceci... M. le duc de Morte*
-
• inart, se promenant tout à Theure dans la gale* >rie (celle de Versailles), a vu venir à lui M. le > baron de Breteuil, accompagné de deux ou trois » officiers aux gardes. Il y avait tout proche mon-» seigneur Louis-René-Édouard de Rohan, an-» cien évêque de Strasbourg, landgrave d’Alsace, » prince état d’empire, cardinal de la sainte église » romaine, grand-aumônier de France, comman-»deur de Tordre du Saint-Esprit, proviseur de » Sorbonne, administrateur perpétuel des Quinze-» Vingts, abbé de Saint-Waast, etc., etc., etc. , > en grand costume, entouré de son clergé, pré-• cédé du porte-croix, des ecclésiastiques, sous » les ordres d’une partie de sa maison, lequel • prince Louis se 'promenait aussi fort agité. • Trente minutes auparavant on l’avait appelé » chez le roi, et il en était sorti peu de temps • après dans un état fort alarmant pour sa faveur »en cour. Aussi chacun dès lors s’éloigna de lui • pour voir venir les choses. C’est ici Tusage, » vous le savez.
ił Le baron de Breteuil, d’une voix haute et sè-» che, commanda au jeune de Jouffroy d’arrêter »M. le prince de Rohan... Quoi ! me direz-vous* >le prince Louis-René-Édouard?.^-^ Oui, en
«personne. — Le cardinal, le grand-aumônier? » — Oui, monsieur l’ambassadeur. — L’ancien » ambassadeur à Vienne, proviseur de Sorbonne, «prince évêque de Strasbourg? — Oui. — Et »le 15 août, et en habits pontificaux? — Oui , «encore une fois. — Allons, madame, c’est im-« possible : le duc de Mortemart radote, il est p d’âge à cela. — Le duc de Mortemart a toute sa P raison. D’ailleurs peut-on faire moins pour un » homme qui a volé un collier de diamans aux b joailliers de la couronne , et qui accuse la reine » de cette infamie ?
» N’est-ce pas, mon cher ami, que tout cela s vous confond, vous anéantit? Je me hâte de » vous mander ce qui vient de se passer, demain » je questionnerai les gens bien instruits, et après-• demain vous en saurez davantage. »
M. d’Adhémar m’a dit depuis que, quoiqu’il eût pleine confiance en la lucidité de mon esprit, il n’éprouva de tranquillité que lorsque trente autres lettres vinrent corroborer ce fait.
La question d’abord fut posée nettement :
i° Un collier de diamans, de 1,600,000 à
1,800,000 francs de valeur, a été volé aux sieurs Bhoemer et Bassange.
2° Les auteurs du vol sont le cardinal de Rohan de concert avec la reine.
3° La-reine a volé le cardinal.
4° Le cardinal,pour tromper les joailliers, a emprunté le nom de la reine.
On ne sortit pas de ce cercle. Cependant l’absurdité découlant de l’accusation insensée contre Marie-Antoinette, et l’adjonction de nouveaux acteurs, donnèrent une autre face à la question. On déterra la dame de Lamothe, puis on amena sur la scène le prétendu comte de Cagliostro , et l'on dit : voilà les vrais fripons ! On ne se trompait en apparence qu’à demi, carón n’a jamais bien connu le fond de cette intrigue. Je vais la révéler.
M. le duc de Chartres qui, à dater du 25 novembre de cette même année 1780, allait être duc d’Orléans par la mort de son père, et dont je lui donnerai le titre par anticipation d’hoirie, commençait déjà son plan infâme qui tendait à la ruine de la famille royale, pour élever la sienne sur ses débris. Il voulut avoir dans son
parti les Rohan, et il engagea son agent secret, le comte Cagliostro, à profiter de son ascendant sur le prince Louis, pour l’exaspérer contre le roi et la reine.
Dès que le parti philosophe et démocrate se fut assuré du concours de M. le duc d’Orléans, au moyen de la franc-maçonnerie dont on le fit grand-maître , et qu’ils en eurent même la promesse de détruire clergé, noblesse et toutes les institutions sociales, ils cherchèrent à lui procurer des agens habiles et tellement isolés que, quoi qu’ils fissent, on ne pût en les frappant atteindre plus loin qu’eux.
Dans le nombre de ces enfans perdus , on signala le fils d’un cocher de Païenne, un certain Baslamo, demi-savant, demi-fripon, chimiste et très habile aux jeux de hasard. Il ne manquait ni de babil, ni d’audace, ne se laissait déconcerter par qui que ce fût, et son adresse à éviter les querelles avec la justice permit aux roses-croix de l’avouer. Le voilà reconnu adepte et mis au premier rang. Mille voix pour le vanter s’élèvent à la fois d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre et de France ; il occupe les cent bouches de la renommée, et pourtant il ne se montre pas
encore. Cela pique la curiosité. Enfin il se laisse voir à Strasbourg ; il débute par des miracles de médecine; bientôt il se dit en confidence qu’il fait apparaître les morts, lit dans l’avenir et possède la pierre philosophale, chose très croyable pour ceux qui nient l’existence de Dieu.
Le prince Louis était au nombre des athées; aussi resta-t-il convaincu de la haute science du comte. 11 l’amena à Paris, le mit à la mode, ne jura que par lui, le consulta sur les moindres entreprises, et le comte lui insinua d’accorder pleine confiance à tout ce que lui disait la comtesse de Lamothe-Valois. Ce fait réglé, le prince tomba dans les pièges de l’intrigante; elle lui fit croire que la reine avait pour elle une bienveillance sans pareille, et qu’elle parviendrait à le faire rentrer dans les bonnes grâces de S. M. Ceci transpórtale prince; il se livra en franche dupe et acheta le collier sous prétexte de plaire à Marie-Antoinette, qui, par le fait, en faisait l’empiète en son propre nom.
Le collier une fois au pouvoir de la comtesse, elle le dépeça, envoya son mari le vendre à l’étranger, forte de la protection du duc d’Orléans et des adeptes qui ne lui manquèrent pasi
SÜâ W^ftÍE-OTOÍNEtTR* 123
On sait que ïes joailliers, alarmés sur le paiement de la riche parure, montrèrent à M. de Breteuil un marché prétendu signé par la reine. La fourberie matérielle avérée, on chercha le voleur, et les soupçons tombèrent sur le cardinal, attendu que d’abord lui seul avait paru dans cette affaire. De là , on vint à la comtesse, et je crois qu’alors on commença à regretter d’avoir ébruité ce fait; mais il n’était plus temps, il fallait le soutenir.
Le cardinal était prisonnier; sa famille affligée, inspira de la pitié. Les filles du monde adoraient les Rohan et méprisaient le roi, parce que sa conduite était régulière. Ces prostituées outrageaient la reine, et elles crièrent si haut que la masse de Paris, menu peuple, haute bourgeoisie, chapeaux noirs, marguiHiers,se déclarèrent pour le cardinal ; chose bizarre et qui fit un tort immense à la cause royale, parce qu’on put en conclure le sot proverbe : Poix du peuple, voix de Dieu. La révolution nous prouve s’il a raison.
Le parlement, à cette époque orléaniste sans savoir pourquoi, se tourna aussi vers les Rohan. Ce fut un abandon universel, désolant, et qui aurait dû éclairer LL. MM. La reine, un soir
SOUVENIRS
que nous étions au petit Trianon, nie dit :
— Eh bien! madame, n’est-il pas vrai que c’est moi qui ai volé le collier àBhœmer ?
Je fis une exclamation.
— Si vous ne le croyez pas, poursuivit-elle, vous êtes en France seule de cet avis; car, à commencer par Monsieur, il est prouvé que c’est chose commune aux femmes de ma maison, lorsqu’elles manquent de pierreries, de voler celles des joailliers de la couronne. Oui, madame, les archiduchesses font ainsi; on le dit, on l’affirme.
Et de nobles larmes coulaient de ces beaux yeux, et S. M. se redressait avec une dignité admirable.
Je pris à mon tour la parole, et me récriai vivement contre cette assertion.
— Cependant on la débite, on la soutient, et on aurait voulu que, pour assoupir cette odieuse calomnie, j’eusse payé le collier, afin de laisser éternellement planer sur moi les soupçons. Je n’ai pas dû agir ainsi ; féclat est ma sauvegarde. Mais la cour qui me voit, qui sait ce que je fais ; mais ma famille.... celle du roi, veux-je dire.,., et Monsieur en tête; ah ! c’est indigne !
faltais répondre ^ quoique péniblement embarrassée, lorsque survint M. le comte d’Artois, je me retirai à distance par respect, et, aux gestes qu’ils firent, je compris qu’ils reprenaient ta suite d’une conversation. Elle s'échauffa ; la reine refusait évidemment ce qu’on lui demandait. Peu après arriva madame la comtesse d’Artois ayant l’air confus; elle sollicitait un pardon. La reine demeure inflexible ; enfin, lasse de la persistance de son beau-frère et de sa belle-sœur , elle me fit signe de venir à elle ; j’obéis. La conversation cessa, le dépit éclatant sur le visage de ta comtesse, qui prit congé et s’en alla accompagnée de son mari.

•il

1
I

■W
SilVââ SÜ2aSîâWSi2^
EMPANS DE LA REINE. SA VIE INTER IFIRE.
Lorsque nous fûmes seules, la reine encore vivement émue, me dit :
— Si vos parens les plus proches velus attaquaient dans votre honneur, vous croiriez-vous dans l’obligation de leur montrer autant d’amitié que si leur conduite avait été parfaite ?
— Non, madame, répliquai-je sans hésiter, bien que je devinasse le motif de cette question ; mais comme j’aimais franchement la reine, j’étais indignée des complots dont elle était l’objet.
lit.
Monsieur, à cette époque, avait tenu d’étranges propos, et cela par dépit de ce qu’on ne prenait pas de ses almanachs, ma réponse parut satisfaire la princesse , qui reprit :
— Ainsi, vous témoigneriez à vos pareas votre mécontentement ?
— Oui, madame, surtout si je les avais comblés comme l’a fait V. M.
— Ah! bonne comtesse, que ne me tient-on un langageaussi sincère ! Mais point. On m’insulte en me prêchant toujours le pardon des injures* Je veux cette fois mettre mon droit à couvert, et si j’use de clémence, ce sera lorsque j’aurai convaincu le roi du tort qu’on me fait.
La reine, après ce préambule, me dit ce que je savais déjà, que Monsieur et Madame blâmaient sa conduite dans l’affaire du collier : ils avaient prétendu que ses rapports avec la femme Lamothe n’étaient pas bien éclaircis, et qu’elle affirmait des choses qu’on devait approfondir.
— C’est aussi, poursuivit la reine, ce que je souhaite : je veux que mon beau-frère et ma belle-sœur, en présence du roi, déclarent leurs inculpations et en fournissent des preuves évidentes; voilà ce que je viens de signifier à M. et
SUR MARIE-ANTOINETTË. 131 à madame d’Artois ; ils sont partis fâchés, car ici on ne s’offense que lorsque la personne blessée ose se plaindre. Les coudées franches ne sont accordées qu’au calomniateur... Je vous tiendrai au courant de ce qui adviendra, ajouta la reine.
Nous quittâmes Trianon, et le meme soir une plainte nettement formulée fut faite par S. M. à Louis XVI, avec prière de commander à Monsieur et à Madame de dire tout ce qu’ils savaient sans restriction. Monsieur fut mandé le premier; il essaya d’abord de tourner la chose en plaisanterie, mais la sévérité du roi ne lui laissa pas la liberté de poursuivre sur ce ton.
— Tout cela est fort bien , dit froidement Louis XVI; mais vous avez tenu sur la reine des propos inconvenans, les avouez-vous, oui ou non?
Poussé à bout, Monsieur répondit :
— Eh bien ! sire, comme je ne veux à aucun prix que votre colère et celle de la reine tombe sur des personnes qui ont eu confiance en moi, je déclare avoir inventé, pour intriguer la reine, ce qu’elle prétend avoir été dit; en celaje n’ai eu aucune mauvaise pensée.

iáá êôúvMííéí
— Vous n’en étés pas moins coupaLië, êt jü sais combien Madame est extravagante; elle s'est mis en tête que si le duc de Choiseul eut été disgracié un an plus tôt, elle aurait été dauphine et puis reine de France, ce qui est une grande erreur de sa part. Quant à vous, je puis vous appliquer ce vers bien connu :
Et si vous ne régnez, vous vous plaindrez toujours.
— Moi, sire,me croire capable d’un crime?
— Non , ce n’est pas d’un crime que je vous accuse, vous n’en voulez ni à ma vie ni à ma couronne; mais vous aspirez à être le chef de mon conseil, c’est comme cela que j’entends le règne et la plainte. Eh bien ! mon frère, vous pouvez avoir une haute opinion de votre science administrative, quant à moi, je n’en pense pas aussi favorablement. Je vous comblerai de biens, mais il ne me plaît pas de vous rencontrer sur ma route. Vous irez, ainsi que Madame, chez la reine lui demander pardon de vos méchans bavardages, et surtout vous ne les recommencerez pas... Bonsoir.
Monsieur, anéanti, alla trouver Madame, qui
SUR MARIE-ANTOINETTE. J 03 pleura, s’emporta, et se refusa à cet acte d’obéissance. H fallut pourtant s’y soumettre. Le couple vint seul au petit Trianon, la reine attendait dans le salon aux arabesques : là eut lieu une scène pénible; elle décida de la constante froideur qui dès ce moment exista entre les deux ménages, et que la révolution seule fit cesser en rendant les périls communs.
Le public, constamment injuste dans la fatale affaire du collier, déclara le cardinal de Rohan non coupable d’escroquerie; on se plaignit de la sévérité de la cour, personne ne se plaçait sous le véritable point de vue; le voici :
Le cardinal avait cru payera prix d'argent, par prêt ou cadeau, la faveur de la reine, ceci ressortait du procès. Ûès lors la reine et le roi pouvaient-ils voir tous les jours dans la première charge de la couronne, un homme qui avait eu de la princesse une opinion si insultante? ne convenait-il pas do le chasser sans retour, et de le punir de cette effronterie par la privation de ses charges et honneurs? Le roi fit bien, il ne s’en est jamais repenti.
J’achèverai ici ce que j’avais à dire à ce sujet ; on trouvera le reste dans une multitude d'ouvrages.
134 SOUVENIRS
J’ajouterai seulement que la cabale abandonna en partie l’intrigante ; on la laissa flétrir par la main du bourreau, afin que son exaspération contre la reine fût sans bornes, puis on ouvrit à prix d’or les portes de sa prison. La malheureuse passa en Angleterre, y dépensa les débris du collier; à la suite d’une débauche elle fut précipitée sur le pavé, et mourut écrasée dans sa chute. Ses Mémoires, tissus d’horribles calomnies, supprimés d’abord, furent réimprimés en terre papale (Avignon), par les agens du duc d’Orléans, qui s’en fit une arme puissante contre la reine pendant un temps.
Aussitôt son avènement au trône, Marie-Antoinette éprouva de vifs chagrins; les premiers, les plus pénibles sans doute, ressortirent de sa stérilité apparente. Déjà on murmurait, on parlait de la nécessité impérieuse de casser un mariage infructueux. Que de larmes ce désir hautement manifesté fit verser à la reine !
Enfin Madame royale vint au monde.....mais qu’était-ce? une fille... rien : voilà ce que la reine eut à entendre très librement, je vous l’assure. Les inquiétudes recommencèrent, deux fausses couches mirent la France en rumeur; on accusa
SUR MARIE-ANTOINETTE. 1 35 tout le monde, jusqu’au chirurgien accoucheur deS.M.
Heureusement une autre grossesse s annonça; on prit des précautions sans exemple; la reine fut condamnée et se soumit avec joie à un régime d’une sévérité excessive, se gênant en toutes ses habitudes. On alla ainsi jusqu’au 22 octobre 1781. Le bruit, vers midi, se répandit que Marie-Antoinette ressentait les premières douleurs , et fut confirmé par la vue d’un courrier, expédié, selon l’usage, au corps de ville de Paris. Dès lors, la foule accourut, environna le châ-teau, et même pénétra dans l’intérieur des ap-partemens ; les princes, le garde-des-sceaux,tous les personnages que la loi du royaume appelait autour de S. M., et qui furent prévenus à temps, arrivèrent et prirent leurs places.
Chacun était là dans l’anxiété de l’attente ; le roi demandait un fils, la reine le souhaitait, les deux frères le recevraient avec respect ; c’était tout ce qu’on pouvait exiger d’eux. Enfin à une heure et demi environ , l’enfant parut.
Un profond silence accompagna sa venue; il fut si complet que chacun crut à la naissance
d’une fille. M. de Vermont, le chirurgien accoucheur, le porta incontinent au garde des sceaux, qui constata le sexe, puis il alla le dire au roi. Louis XVI vivement ému eut besoin de boire un cordial, et la force lui étant revenue il s’approcha rayonnant de la mère, encore en proie à de cruelles angoisses.
— Madame, dit-il en l’embrassant, vous avez comblé mes vœux et ceux de la France, vous nous avez donné un dauphin.
A ces heureuses paroles la reine laissa échapper un faible cri et perdit l’usage de ses sens : elle reprit bientôt connaissance, et d’une voix ferme :
— Mon fils! s’ecria-t-elle, mon fils! je veux le voir.
On le lui apporta, elle l’embrassa et le mouilla de larmes d’allégresse. Madame de Guémené en sa qualité de gouvernante des enfans de France, s’était déjà emparée du nouveau-né lorsque la reine le lui rendit.
— Madame, dit-elle, je n’ai pas besoin de vous recommander le dépôt qui intéresse tout le royaume, il ne saurait être en meilleures mains.
SUR MARIE-ANTOJNÏTTE. 1 37 Mais pour que vous puissiez vaquer plus librement aux soins qu’il exige, je veux partager avec vous l’éducation de ma fille.
C’était témoigner peu de confiance sous la forme d’un compliment. La reine , en effet, commençait à connaître madame de Guémené, et ne se souciait pas de lui laisser la direction de son auguste fille.
Cent un coups de canon annoncèrent aux Parisiens la grande nouvelle; le page qui l’apporta à l’Hôtel-de-Ville reçut le cadeau ordinaire, de dix mille livres de rente viagère. On sonna en grande volée toutes les cloches. Le prévôt des marchands, les éche vin s, les officiers municipaux allumèrent le leu de joie sur la place de Grève. Une illumination générale eut lieu pendant trois nuits. Le parlement, la cour des comptes , tous les tribunaux et corporations multiplièrent les Te Deum. Le même soir, à la comédie italienne, la Billioni, qui jouait un rôle de fée dans les Deux Sylphes, s’avança vers les spectateurs et chanta le couplet suivant, du sieur Imbert :
Je suis fée, et veux vous conter Une grande nouvelle :
î58 SOUVENIRS
Un fils da roi vient d’enchanter
Tout un peuple fidèle.
Ce dauphin, que l’on va fêter. Au trône doit prétendre , Qu’il soit tardif pour y monter, Tardif pour en descendre.
Hélas ! ce malheureux prince n’y monta point, et ses parens en descendirent avant le temps marqué par la nature !
Croirait-on qu’un augure terrible apparut au milieu de l’allégresse universelle! Tous les corps de métiers de Versailles et de Paris vinrent en costumes élégans et frais défiler sur la terrasse du château. On les admit dans la cour royale, et là, chaque corporation excitée par une musique militaire ou autre, se mit à travailler de son état. Les ramoneurs dressèrent une chemi-née que nettoyèrent de beaux enfans ; des boulangers cuisirent dans un four des gâteaux qu’ils jetaient à la multitude, et ainsi du reste. Pendant ce temps, les femmes de la Halle, richement vêtues, improvisèrent la tenue d’un marché égayé par des scènes imitées de Vadé.
Mais au milieu de ce gai spectacle allait s’offrir un appareil propre à jeter la consternation dans tous les esprits. Les fossoyeurs où croque-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 15g morts, comme on les appelle, ne s’avisèrent-ils pas de venir prendre rang parmi la foule animée et rieuse! Us se montrèrent vêtus de noir, tenant des hoyaux, des bêches, et entourant une bière recouverte de son drap funèbre ; puis deux d’entre eux soutenaient un trophée composé d’un sablier, de faux, de têtes de morts, d’os en sautoir, le tout couronné de cyprès noués de rubans noirs parsemés de larmes d’argent. Ils avaient déjà gagné le grand corridor, lorsque madame Sophie, qui revenait de la messe , les rencontra sur son chemin. Elle poussa un cri d’horreur, et ordonna , sans attendre la manifestation de la volonté royale, qu’on chassât ce hideux cortège, auquel on donna de l’argent.
Il en résulta une impression triste et douloureuse; on en tira une interprétation si funeste , que chacun de nous y vit l’annonce de la mort du dauphin. On cacha néanmoins cet incident à la reine qui ne l’a jamais su.
Les dames de la Ilalle ne furent pas les dernières à venir offrir leur tribut d’hommages. Elles étaient cinquante , portant un costume de siamoise; on leur avait prêté une quantité immense de diamans. Trois des principales en-
i4o
trèrent dans la chambre de la reine; celle qui prit la parole était charmante et ne témoigna aucun embarras. M. de La Harpe avait composé le discours, et il était écrit sur l’éventail de la jolie harengère pour aider sa mémoire. On ma dit que depuis, elle fut l’une de celles qui, au 5 octobre , montrèrent le plus de rage contre S. M.
La reine les reçut à merveille, leur montra le dauphin et les invita à dîner. On les servit au Grand-Commun avec une sorte de cérémonial qu’elles connaissaient fort bien , et les anciennes veillaient à ce qu’on ne s’en écartât pas. Une d’elles se plaignit de ce que le maître-d’hôtel du roi qui leur faisait les honneurs delà table, oubliait de les servir le chapeau sur la tète, on fit droit à sa représentation.
Le 26 suivant, le roi alla in fiochi à Notre-Dame de Paris, remercier Dieu de la faveur qu’il venait d’en recevoir, et assister au 77e Deum d’usage; il vint train de poste jusqu’à la barrière de la Conférence, où il monta dans l’un de ses carrosses d’apparat. Il avait avec lui Monsieur à sa gauche, M. le comte d’Artois et le duc d’Orléans sur le siège de devant, le duc de
áüM miMáOoto í4 í Chãrtres ét lê prince de Cõüdè aux portières Des hérauts d’armes précédaient eh criant : P^tve le roi! et en jetant des médailles sur le chemin jusqu’à l’église métropolitaine. Le cortège suivit le quai des Théatins. 11 était environ cinq heures lorsque le roi entra à Notre-Dame, salué par de bruyantes acclamations. Le chapitre attendait S. M. à la porte principale, et le conduisit proçessionnellement, portant un dais sur sa tête jusqu’au trône situé au milieu du chœur. On remarqua que le trône n’avait pas plus de degrés que celui de l’archevêque, ce qui parut très inconvenant. Les princes delà famille et du sang, les grands dignitaires et officiers de la couronne, entourèrent le souverain. Le parlement, la cour des comptes, celle des aides, les tribunaux, le corps de ville , tout le clergé des paroisses ; une multitude d’évêques, des ambassadeurs étrangers, achevèrent de concourir par leur présence à la splendeur de la cérémonie.
Le dauphin reçut, lors "de son baptême, les prénoms de Louis-Joseph-Xavier-François. H resta peu de temps sous la surveillance de la princesse de Guémené, à laquelle, je l’ai déjà dit, succéda la duchesse de Polignac.
La naissance d’un fils donna à la reine l’influence qu’elle devait avoir. Le roi, charmé de revivre dans un dauphin, en montra une tendre satisfaction à Marie-Antoinette. Elle fut plus vive encore, lorsque, le 27 mars 1787, la reine mit au monde un autre prince, Louis-Xavier, que l’on qualifia de duc de Normandie, malheureux enfant dont le règne s’est écoulé dans un cachot, où toutefois il n’a pas trouvé la mort.
Certes, je ne veux en aucune manière multiplier les chances qui s’offriront à des imposteurs ; mais en écrivant ceci au mois de mai 1799, je certifie sur mon âme et conscience être positivement sûre que S. M. Louis XVII n’a point péri dans la prison du Temple. Promis aux Vendéens, on le leur a remis fidèlement ; mais en même temps, par une politique infernale, et pour enlever tout prix à ce gage précieux, on a répandu la nouvelle de sa mort ; on a osé publier un procès-verbal, dans lequel le consciencieux chirurgien Desault a refusé de reconnaître l’identité du cadavre qu’on lui présentait avec celui du fils de Louis XVI. Les révolutionnaires, indignés de son audace, eux à qui un crime de plus ne coûte pas, l’en ont puni par le poison. Lorsque j’arri-
SÜR MARIE-ANTOINETTE. 1^5 verai à ce moment fatal de notre histoire, je me charge de réunir en un faisceau les preuves victorieuses de ce que j’avance; mais, je le répète, je ne m’engage pas à dire ce que le prince est devenu, je l’ignore. Le seul Cambacérès, homme de la révolution, pourrait compléter mon récit, car là-dessus il en sait beaucoup plus que moi.
Laissons ce fait intéressant de nos annales sanglantes, pour revenir à la naissance de monseigneur le duc de Normandie. La reine n’avait pas renoncé au désir detre couronnée; elle en parlait souvent, et en cette occasion elle y revint avec plus d’instance. Afin de la satisfaire sans lui accorder le point essentiel de sa demande, le roi voulut qu’elle fit dans Paris une nouvelle entrée solennelle, où l’on déploya toute la pompe et toute la munificence royale. Marie-Antoinette, pour que rien n’y manquât, aurait souhaité conduire avec elle M. le dauphin; mais le jeune prince n’allait pas sans sa gouvernante ; Madame, qui devait accompagner la reine, déclara qu elle ne céderait pas sa place du fond à la duchesse de Polignac. Dès lors, la présence de M. le dauphin devint impossible.
J 44 ^ôùWiAà
Lá reiné ressentit vivement le peu dé doíripíaí* sanee de sa belle-sœur.
— Elle prend sa revanche, dit-elle; mais elle lie s’en fera pas mieux aimer pour cela.
Monsieur voulut avoir une explication sur cette phrase.
— Assurément, répondit la reine, si Madame cédait la place du fond à madame de Polignac, ce ne serait pas à la gouvernante, mais au dauphin, auquel , je présume , elle ne la conteste pas.
— Non sans doute, ma sœur, Madame sait ce qu’est votre fils aîné; mais le peuple est niais, il verrait Madame en troisième, et s’imaginerait que c’est son rang. D’ailleurs, ajouta-t-il en affectant de rire, ces maisons souveraines de par-delà les monts sont fortement à cheval sur l’étiquette.
— Eli, Monsieur ! en-decà l’est-on moins ? quand il s’agit du cérémonial monte-t-on sur un âne?
Monsieur fit la grimace, lui dont la vie s’écoulait dans des questions de préséance, qui en avait fait une querelle si ridicule le jour du baptême de Madame Royale ! aussi, il tira sa revé-
renceà la reine et partit. Mais Madame n’en persista pas moins dans sa prétention, et Marie-Antoinette dut renoncer à la joie d’être accompagnée de son fils.
S. M. se promit d’en tirer une vengeance de bonne compagnie, et n’y manqua pas. Je tarderai peu à la signaler. Les deux régi mens de gardes-françaises et de gardes-suisses firent la haie depuis Chaillot jusqu’à Notre-Dame et Sainte-Geneviève, où la reine devait aller tour à tour. Un vaisseau de poche, nommé le Dauphin , voguait alors sur la Seine ; il fit feu de toute son artillerie, tandis que le canon grondait aux Invalides, à la Grève et à la Bastille.,
Pendant la première partie de la matinée le temps était sombre; mais à mesure que le cortège avançait vers Paris les vapeurs se dissipaient, et le soleil brilla de tout son éclat au moment où la reine atteignit la barrière de la Conférence.
A Notre-Dame il y eut une riche décoration et une illumination à l’avenant; beaucoup de musique à Sainte-Geneviève; aussi admira-t-on la ferveur de la reine. Néanmoins elle fut froidement accueillie. Ce fut la première fois qu elle put s’apercevoir que l’opinion parisienne était
ni. 10
changée à son égard. Les larmes lui en vinrent aux yeux; elle eut peine à cacher son dépit, et un mouvement de frayeur que lui causa la brutale vivacité des femmes de la Halle fut mal interprété. Dès lors ces créatures vindicatives prirent en haine Marie-Antoinette, et n’ont pas cessé depuis de le lui prouver.
Madame et Monsieur s’attendaient à dîner avec la reine aux Tuileries ; mais elle se laissa malicieusement i nviter au Temple par M* le comte d’Artois, et le prince oublia de convier également à ce repas son frère et sa belle-sœur. Il en résulta qu’avec un vaste appétit, Monsieuret madame la comtesse de Provence se trouvèrent à jeun à l’heure où chacun se mettait à table. Ils durent aller demander à dîner à je ne sais qui, et ils supportèrent impatiemment cette mystification.
La reine ayant été voir jouer Panurge, revint souper au Temple; elle quitta Paris très tard, et peu satisfaite de ce voyage. De ce moment datent ses malheurs; car elle se mit malgré elle en guerre ouverte avec le peuple, que le duc d’Orléans , les d’Aiguillon et les Rohan déchaînèrent contre elle.
Marie-Antoinette à eu un quatrième enfant
SÜR MARIE-ANTOINETTE* lĄ?
peu connu, ignoré meme de certains généalogistes. Ce fut une seconde fille, madame Sophie-Hélène-Béatrix, née le 19 juin 1787. Sa mère ressentit douloureusement la perte de cette jeune princesse. Voilà quels furent les fruits infortunés de cet auguste mariage. Eux aussi essuyèrent ■ leur part de la tempête qui frappa tout ce que le royaume renfermait d’illustre. Le premier dauphin mourut rachitique à Marly, au milieu des agitations de juin 1709, madame Sophie Payant devancé. Le second dauphin , roi titulaire, a disparu dans la prison du Temple, et Madame seule, échappée aux bourreaux de sa famille, peut espérer du bonheur dans l’alliance contractée avec son cousin, monseigneur le duć d’Angouléme. Elle vient de l’épouser, que Dieu fasse prospérer cette noble union!
J’ai passé sous silence, parce qu’on ne peut tout dire, le violent chagrin que causa à la reine le décès desa mère, de la grande Marie-Thérèse. Ce fut en cette circonstance que le roi parla à l’abbé de Vermont pour la première fois.
— Monsieur, dit-il, je viens de recevoir une nouvelle douloureuse, l’impératrice ma belle-mère est morte. Je connais la vive tendresse que
la reine lui portail, et comme je ne me sens pas la force de lui annoncer cet affreux événement, veuillez vous eu charger.
L’abbé, enchanté de rendre au roi ce service, partit aussitôt, et accomplit son tristre message. Marie-Antoinette se livra d’abord à une douleur immodérée, et ne voulut voir personne que le roi.
Un peu plus tard, le roi reçut la famille royale, mesdames deLamballe et de Polignac; elle se vêtit de deuil dès la nouvelle reçue, n’attendant pas la commodité du cérémonial, et se livra à toute la violence de son désespoir. Elle daigna cependant m’admettre à lui faire ma cour avant l’époque fixée pour les dames du palais.
— Je vous dois cette distinction, me dit-elle, parce que vous aimiez ma mère , et qu’elle vous le rendait bien. Je perds une amie, un guide que rien ne remplacera. Les intérêts de mes frères sont opposés aux miens, ma mère me chérissait sans arrière-pensée, et se serait sacrifiée pour moi. Au reste, si elle me manque sur la terre, je la retrouverai dans le ciel, où certainement elle intercédera pour sa fille; car il y a des instans ou il faut s’anéantir devant la Divinité, sous peine
SUR MAR ÏE-ANTOINETTE. 149 dé se révolter contre ses mystérieux et rigoureux décrets.
Dès cette époque madame de Polignac (en novembre 1780) fit des progrès rapides dans l’affection de la reine. Sa faveur fut déclarée complète, il fallait s’incliner devant elle. Marie-Antoinette dînait presque tous les jours chez sa favorite, qui avait assisté au dîner du roi sans y prendre part. On augmenta de fio mille francs le traitement de la duchesse, afin qu’il ne fût pas dit que les repas de la reine lui étaient dispendieux; car presque tous les soirs la princesse y soupait en petit comité.
Nous éprouvions un vrai bonheur d’être admises à l’intimité de cet intérieur, bonheur qu’on nous enviait de par-delà toute croyance ; ce fut là que M. d’Adhémar, ayant fait apprécier son mérite supérieur, obtint l’ambassade d’Angleterre, fonction qu’il remplit avec tant de dignité et de talent. Je voudrais pouvoir en parler et peindre ce que j’ai vu lors de mon voyage dans ce royaume; mais ce serait multiplier les faits, et je me suis prescrit de restreindre mes souvenirs.
La reine, charmée de retrouver des visages
150 SOUVENIRS
ÿ Lisi i ' 7‘.z
connus et toujours les mêmes, se dégoûta des voyages cérémonieux de Marly ; elle eut peu de peine à déterminer le roi à y renoncer,car il ne se souciait guère de s’éloigner de Versailles, où seulement il avait ses ateliers, et c’était toujours pour lui une distraction que de s’enfermer dans sa forge.
La reine, de son côté, allait de Saint-Cloud à Trianon, à celui - ci par préférence. Là, toute étiquette était bannie, on y menait la vie de château: la promenade, la chasse, la lecture, la bouderie même étaient permises, à tel point, qu’on y jouissait d’une complète liberté. Pas de parure, les hommes en lévite, en simple frac de taffetas; les femmes en polonaise de mousseline des Indes avec un fichu de gaze et un chapeau de paille de Florence.
On eut bientôt envie de jouer la comédie. Ce n’était plus l’époque où, dans la crainte de la favorite (la Dubarry), on se réduisait à jouer dans une armoire. Un charmant théâtre fut disposé au petit Trianon; des acteurs de la Comédie-Française et des Italiens vinrent aider les débutans de leurs avis. Je me rappelle d’un certain Martelly, homme de vrai mérite et très au-dessus de son état* On
SUR MARIE-ANTOINETTE. 15 I aimait à le voir, on le traitait bien, et néan-moins j'ai entendu dire qu’il s’est fait révolutionnaire.
On débuta, si je ne me trompe, par la Gageure Imprévue et le Devin du Village. La reine remplit dans la première pièce le rôle de Gotte et celui de Co/eiiedans la seconde. La comtesse Diane madame de Clainville, madame Élisabeth Angélique, et madame dePolignac, la gouvernante,dont le nom ne me revient point. M. de VaudreuilfitM. de Clainvitle, M. le comte d’Artois aÉtieulettes, le baron de Bezenval Lafleur, M. d’Adhémar Colin, et il s’acquitta à ravir de ce rôle, ayant encore une voix très fraîche et beaucoup d’aplomb. Le Devin fut chanté par l’abbé de Ballivières en grand secret et avec un masque.
Leroi,Monsieur, Madame,et madame la comtesse d’Artois, composèrent d’abord tous les spectateurs; le roi sifflait sans façon, et l’on criait : A bas la cabale, à la porta le malveillant ; il en résultait des accès de gaieté, des éclats de rire interminables.
Je fus Tune des premières dames admises comme spectatrices,attendu ma qualité de femme d’un acteur ; je vis jouer le Barbier de Séville, la
1 5 2
Métromanie, Rose et Colas, le Roi et le Fermier, le Sorcier, le Diable-d - Quatre, les Originaux, Crispin Rival, et On ne s’avise jamais de tout, La troupe triompha dans les Plaideurs.
La reine avait la voix fausse, mais une rare intelligence; elle jouait avec le naturel d’une actrice consommée. Monsieur se montra froid, prétentieux; mais spirituel; M. le comte d’Artois, avec de l’étude, serait devenu un très bon acteur; malheureusement il ne savait jamais ses rôles. Cependant il mettait une grâce extréme à tout ce qu’il faisait, et on aimait à l’applaudir.
Après moi, on admit des dames du palais et autres, puis les officiers des gardes, ceux des princes, les écuyers du roi; enfin il y eut foule; des lors tumulte,bravos, caquets: il fallut fermer Je théâtre.
ün jour je vis tout le monde en rumeur, on allait, on chuchotait.
— Qu’est-ce? demandai-je.
— Ne le savez-vous pas? la reine a prié Madame de jouer dans Zémire et Azor, et Madame a répondu que les princesses de Piémont n'étaient pas des baladines.
—• Eh bien! elle a dit une sottise; la reine se dégrade-t-elle parce qu’elle s’amuse?
— La reine est en colère, elle a raison.
— Elle le témoigne.
— C’est un tort, elle devrait lever les épaules et rire; voilà tout ce que cela mérite.
Marie-Antoinette, trop sensible, se prit à pleurer de la réponse de Madame. M. le comte d’Artois, piqué d’un propos qui retombait sur sa sœur, madame Élisabeth, dit que ce (pie faisait une /lile de France, une demoiselle de Savoie pouvait le faire. Nos pères, ajouta-t-il, étaient rois long-temps avant que les vôtres fussent comtes des marmottes.
A ces dernières paroles, voilà madame d’Artois qui s’en mêle, et on entend de toutes parts cris, récriminations et plaintes : le roi dut intervenir; on craignait ce prince à cause de ses brusqueries; car au fond, c’était un ange. On se fit des excuses réciproques, mais le diable n’y perdit rien, et la paix de la famille en demeura irrévocablement troublée.
Le crédit de la reine parut victorieusement dans le renvoi du prince de Montbarrey et dans la nomination de MM. de Ségur et de Castries.
Le premier fut un choix malencontreux, orléaniste, parce que son père avait épousé une bâtarde du régent non reconnue, fille de la comédienne Desmares, et parée au contrat du nom pompeux de mademoiselle de Froissy: il en résulta une folle ordonnance, par laquelle on interdit au tiers-état la carrière des armes. Ce fut un coup de Jarnac de la cabale contre la branche aînée des Bourbons. M. de Ségur a seul commis cette faute, et ne peut aucunement la faire rejaillir sur le conseil, où le ministre de la guerre était tout-puissant.
M. de Castries, qui obtint le titre de duc, avait de bonnes intentions; mais sottement engoué du Genevois Necker, il prétendit qu’il était nécessaire, l’aida de son influence, et causa plus de mal peut-être que n’en fit à la reine l’ordonnance Ségur.
La nomination de M. d’Adhémar à l’ambassade d’Angleterre scella le crédit de S. M. Néanmoins elle n’était pas satisfaite; son désir eût été de vivre en dehors du bruit, avec des amis contens de leur sort, point avides, et là de se livrer à des distractions innocentes, par exemple, le célèbre descainpativos, le traîne balai, au chat! au chat!
SUR MARIE-ANTOINETTE. t 55 jeux d’enfans où il était de règle de mettre sens dessus dessous les meubles d’un appartement et d’en briser une partie. Cela est tellement vrai, que madame de Lamballe s’étant plainte de n’avoir pu se trouver à une certaine soirée, la reine répondit :
— Vous n’avez pas perdu, car on n’a rien cassé.
Les concerts finirent par l’emporter sur les représentations dramatiques, .le retrouve dans mes notes l’article suivant; il peint nos occupations du soir.
« Nous possédons,dans cette capitale, un jeune homme beau et bien fait, dont l’organe incomparable réalise tous les avantages que l’antiquité s’est complu à donner à ses Orphées : sans la plus légère notion de musique, il chante avec autant de justesse que de goût les airs et meme les partitions les plus compliquées, donnant à sa voix toutes les modifications dont la taille et la haute-contre sont susceptibles. Son oreille est d’une mémoire si scrupuleuse, soit pour la partie de l’accompagnement, soit pour la mélodie, que MM. Grétry, Piccini et autres virtuoses ont jugé que non seulement la musique lui serait inutile
mais encore qu’elle pourrait altérer ses dons naturels. ..
» Quoique toutes les voix lui soient familières, la haute-contre est la dominante.... Sur le rapport que quelques jeunes seigneurs en firent à la reine ces jours passés, cette princesse, qui aime les talens et se plaît à les produire, désira entendre ce jeune homme, et donna ordre qu’on allât le chercher samedi dernier, dans une voiture à quatre chevaux, et qu’on le conduisit chez madame de Polignac. IL reçut de Marie-Antoinette les marques les plus flatteuses de sa munificence, et les applaudissemens ne lui manquèrent pas. »
En effet, j’entendis cette merveille incomparable, le jeune Garat, de Bordeaux, où son père exerçait la profession d’avocat. Il avait à Paris un oncle de son nom rangé parmi les philosophes ; celui-ci se montrait consterné en apparence des succès de son neveu, et par dessous main il lui traçait un plan de conduite pour mettre à profit les faveurs de la cour. M. de Rivarol, qui savait son Garat par cœur, disait de l’oncle: c’est Tartufe philosophe, il avait raison. Il a tant crié dans la révolution, queje lui en veux outre mesure.
SUR MARIE-ANTOINETTE. l5^ Son neveu, qui du moins possédait un beau talent, n’était que ridicule. Il est devenu un original plaisant, une vraie caricature. Hou Dieu, qu’il est bon à voir engoncé dans sa cravate, ayant un gilet de six travers de doigt de hauteur, avec des pantalons qui montent sous les aisselles, et ses énormes touffes de cheveux, et son chapeau pointu, que sais-je! toute l'absurdité contemporaine jointe à la fatuité d’autrefois !
Malgré l’attrait que je trouve à me rapprocher de tout ce qui me rappelle la reine et mes anciens amis, je n’ai pu me résoudre à recevoir Garat; je le laisse à son honorable suffisance. 11 fit pourtant les beaux jours ou plutôt les beaux soirs de mes salons; on l’accabla de flatteries. Que lui en revint-il de solíde? rien. 11 ne savait quelle contenance tenir devant nous, comment nous aborder, nous parler, sortir surtout, sortir. C’est le désespoir des gens de peu et à quoi ils manquent toujours. Je n’en ai jamais vu un qui sût quitter un salon convenablement ; ou ils font des complimens inutiles,ou ils s’évadent en manière de filous pris en flagrant délit: ils sont très plaisans*
Garat, grâce à son amour-propre démesuré,
153 souvenirs
serait bientôt à son aise; mais il le fit maladroitement et comme quelqu’un qui chasse où il n’en a pas le droit.
J’en ai assez dît sur ce personnage subalterne; je préfère revenir à la reine, et dire quelque chose du cérémonial et des habitudes de son intérieur.
Cette maison était composée de la manière suivante, en 1789 :
Grand-aumônier, une chapelle, M. l’évêque duc de Laon, pair de France; M. de Sabran, successeur de M. de Fleury, évêque de Chartres; un premier aumônier M. l’évêque de Meaux, Poli-gnac; deux auînôniers ordinaires, ąu&tre par quartier; un clerc de chapelle ordinaire, quatre clercs de chapelle; deux prédicateurs ordinaires, les abbés Lenfant et de Dombolles; un chapelain à Trianon et deux sommiers.de chapelle.
La surintendante et chef du conseil de la reine, madame la princesse de Lamballe, Savoye Cari-gnan en son nom, et bru de S. A. M. le duc de Penthièvre; dame d’honneur, madame la princesse de Chimay dame d* atours, madame la comtesse d’Ossun.
Quinze dames du palais, madame la comtesse
de Talleyrand doyenne, et moi sous-doyenne. Puis venaient les duchesses de Duras, de Luxembourg, de Luynes; marquise de la Roche-Ay-mon, princesses dTlénin et de Berghes, duchesse de Fitz-James, vicomtesse de Polastron , comtesse de Joigne , vicomtesse de Castel la ne , princesse de Tárente, comtesse Eugénie de Grarn-mont, marquise de Maillé ; honoraire duchesse de Saulx.
Chevalier d'honneur, M. le duc de Saulx-Ta-vannes.
Premier écuyer comte de Tessé; M. le duc de Polignac en survivance.
Premier maître d'hôtel le marquis deTalaru.
Surintendant des finances M. Bertier.
Premer médecin docteur de Lassone.
Secrétaire des commandement MM. Beaugeard et Augeard.
Intendant de la maison M. de Saint-Charles. Ecuyer ordinaire le chevalier de Vievigne.
Quatre écuyers par quartier, un porte-manteau , un maître d’hôtel ordinaire, quatre maîtres d’hôtel, un gentilhomme servant ordinaire, ‘en contrônleur généna nsral, quatre contrô ni contrôleur ordinaire, deux maréchaux-des-logis;
SOÜVEXIRS
quatre premières femmes de chambre, mesdames deMiserey, Campan, Thibault ? Jarzaye ; douze femmes de chambre, un maître de la sarde-robe, un premier valet de chambre, deux valets de chambre ordinaires, un huissier ordinaire, quatre huissiers par quartier, deux huissiers de cabinet et deux de l’antichambre, quatorze valets de chambre par quartier, six garçons de chambre, un valet de garde-robe ordinaire, deux valets de garde-robe, un garde-meuble ordinaire de la chambre, deux valets de chambre tapissiers , un horloger 9 un perruquier-baigneur^ ¿tuviste Léonard François, deux coiffeurs par commission Léonard aîné et Villanoué, une baigneuse, une femme de garde-robe d’atours, un garçon de garde-robe, un tailleur ordinaire pour les habits d’amazone, deux porte-faix de la chambre, deux feutiers, un lavandier du linge de corps, une porte-chaise d’affaire mademoiselle Ronchereuil, deux frotteurs et un aide, un bibliothécaire AL Moreau , un lecteur M. l’abbé de Vermont, une lectrice madame la comtesse de Neuilly, adjointe madame deLaborde, un secrétaire du cabinet M. Campan.
Médecin ordinaire M, Lassone ñlst premier chi-
rurgien de Chavigna, un chirurgien ordinaire, deux du commun, chirurgien-accoucheur M. de Vermont, un apothicaire, un garde-malade.
Le service de la cuisine, en diverses dénominations et fonctions, comprenait soixante-trois charges. L’écurie, avec les écuyers, pages, grands valets de pied, etc., occupait soixante-quatorze personnes.
Procureur-général Inclesi avocat général de Malherbe, maître des requêtes, deux secrétaires du conseil, un interprète, un garde-livre, un agent solliciteur des affaires, un chauffe-cire, un huissier du conseil. Le chancelier n’était pas nommé en 1789.
intendant des bâtimens M. Migne , sculpteur M. Rousseau , peintre décorateur M. Le Riche , peintre décorateur ordinaire M. Rousseau de la Rollaire, peintre en miniature M. Dumont,peintre doreur M. Dulens; secrétaires de la surintendance du grand-aumônier, du chevalier d’honneur, de la chambre, de la garde-robe, du chancelier, du secrétariat des commandemens, du premier maître-d'hôtel, de l’écurie; un premier et deux seconds commis au commis du trésor, un maître de danse M. Gardeł, un maître de
musique M. de Lagarde, un maître de clavecin M. iïenon, un luthier facteur M. Nadermann, un luthier M. Caron, un Joaillier ordinaire M. Bo-
Tel était le nombre des individus employés dans la seule maison de la reine. Je n’ai désigné aucun de ceux de la maison du roi ou de celle de monseigneur le dauphin et des autres enfans de France. On comptait d’attachés au premier, à divers titres, depuis celui de gouverneur, exercé par M. le duc d’Harcourt, Jusqu’au garçon des garçons de la garde-robe, trente-cinq personnes des deux sexes. Faisant partie de la maison des seconds il y en avait cinquante-trois. Ce qui, joint aux deux cent douze de chez la reine , complétait à peu près le nombre de trois cents, lesquels vivaient des bienfaits de cette auguste princesse.
Lacharge de surintendante ava it été exercée par la princesse de Clermont jusqu’à sa mort en 1741. La reine, qui trouvait trop étendus les privilèges de cette charge, en demanda au roi la suppression. Louis XV y consentit, et on n’osa la rétablir ni pour la duchesse de Châteauroux, qui la sollicita vivement, ni pour la marquise de Pompa-
SUR MARIE-ANTOINETTE. l63 dour. Celle-ci ne s’était fait donner la grand esse d’Espagne , et en France le titre de duchesse, qu’elle ne porta jamais, qu’alin de montrer qu’elle avait assez d’illustration pour ne pas flétrir la dignité de la charge de surintendante. Le roi se renferma dans la négative, disant que sa parole d’honneur était engagée envers la reine.
Madame Du Barri ne pensa point à cette charge. D’ailleurs il n’y avait lias de reine à son avènement. Marie-Antoinette n’en demanda le rétablissement que lorsqu'une tendre amitié la lia à la princesse de Lamballe, qu’elle fit nommer surintendante.
Cette charge en cas de régence devenait éminente, parce que la personne qui en était revêtue présidait de droit le conseil de la reine. Du reste, elle nommait à toutes les autres charges, places et emplois de la maison , jugeait souverainement les contestations entre les titulaires, pouvait les suspendre, les mettre à l’amende, et même prononcer leur destitution. Cette autorité excessive nous était insupportable à toutes.
La dame d’honneur possédait aussi presque tous ces privilèges : elle invitait, écrivait au nom
de la reine, dressait l’état des dépenses, décidait des gratifications. Les bals, fêtes, soirées, corné-dies, voyages, parures, bijoux, meubles, étaient sous son inspection, et cela lui rapportait beaucoup. M. de Silhouette, le contrôleur-général, enleva une forte partie de ces bénéfices à la dame d’honneur, en faisant régler par le roi que le renouvellement général des objets aurait lieu non annuellement, mais tous les cinq ans.
Les attributions de la dame d’atours étaient de veiller à ce que la reine fût décemment habillée, à ce qu’on lui fournît les robes et vêtemens à son usage. Elle payait les mémoires sur réglement : 100,000 francs étaient affectés à cette dépense; on y suppléait quand des circonstances imprévues l’augmentaient, et cela arrivait souvent. Madame Campan, qui m’a donné une note très détaillée de tous ces points d’intérieur, y dit que la dame d’atours faisait vendre à son profit les robes, manchons, dentelles et oripeaux : le tout montait à une forte somme.
La dame d’atours, dit encore madame de Campan . avait aussi sous ses ordres une première femme de chambre, pour replier et repasser les objets oe toilette, deux valets de garde-robe et
SUR MABIE-ANTOINETTE. 165 un garçon de garde-robe; ce dernier était chargé de transporter à l'appartement des corbeilles couvertes en taffetas vert qui contenaient tout ce que la reine devait porter dans le jour; il donnaitalors à la première femme de chambre un livre sur lequel étaient attachés les échantillons des robes, grands habits, robes-déshabillés, etc. Une petite portion de la garniture indiquait de quel genre elle était. La première femme de chambre présentait ce livre au réveil dé la reine, avec une pelote. S. M. plaçait des épingles sur tout ce qu’elle désirait pour la journée : une sur le grand habit, une sur la robe-déshabillé de l’après-midi, et une sur la robe parée pour l’heure du jeu ou le souper des petits appartenions. On reportait ce livre à la garde-robe, et bientôt on voyait arriver dans de grands taffetas ce que S. M. avait choisi. La femme de garde-robe, pour la partie du linge, apportait de sou côté une corbeille couverte, contenant deux ou trois chemises, des mouchoirs et des frottoirs. La corbeille du matin s’appelait le prêt du four, le soir il en venait une autre renfermant la camisole , le bonnet de nuit, et les bas pour le matin : celle-ci s’appelait le prêt de nuit. Aussitôt la toilette ter-
minée, on faisait entrer les valets et garçons de garde-robe, qui remportaient les objets inutiles à la garde-robe, où ils étaient reployés, suspendus, revus, nettoyés avec un ordre et un soin si étonnant, que les robes, même réformées, avaient tout l’éclat du neuf. La garde-robe des atours consistait en trois grandes pièces environnées d’armoires; les unes à coulisses, les autres à porte-manteaux; de grandes tables, dans chacune de ces pièces, servaient à étendre les robes, les habits, et à les reployer.
La reine avait ordinairement pour l’hiver douze grands habits, douze petites robes, dites de fantaisie, et douze robes riches sur paniers, qu’elle portait pour le jeu, ou le souper des petits appartemens.
Les parures de l’été et du printemps servaient l’automne. Toutes ces parures étaient réformées à la fin de chaque saison, ou à moins que S. AL n’en fît conserver quelques unes auxquelles elle tenait. On ne parle point des robes de mousseline , percale, ou autres de ce genre: l’usage en était récent, et elles n’entraient pas dans le nombre de celles fournies à chaque saison; un les faisait servir plusieurs années.
SUR MARIE-ANTOINETTE. 167
Il n’y eut d’abord qu’une seule première femme de chambre; plus tard on en nomma deux en titre. et deux survivancières exerçant les fonctions. C’étaient, en général, des personnes bien nées, ou au moins de bonne bourgeoisie. J’ai vu madame de Misery, fille du comte de Chemant, titrée de cousine par la princesse de Térigny , comme ouvrière ; petite-fille d’une Montmorency, cela sonnait péniblement à mon oreille : la princesse n’y attachait aucune importance , la première femme de chambre en soupirait.
Les fonctions de premières femmes étaient de veiller à l’exécution du service de la cham-bre, de recevoir l’ordre de la reine pour les heures du lever et de la toilette, des sorties, des -voyages; en outre, elles étaient chargées de la cassette de la reine, des paiemens des pensions et gratifications. On leur confiait aussi les dia-mans; elles avaient les honneurs du service en l’absence des dames d’honneur ou autres : elles les remplaçaient également pour faire les présentations à la reine. Leurs appointemens étaient de douze mille francs: mais la totalité des bou-gics de la chambre, des cabinets et du salon de
jeu, leur appartenait chaque jour, allumées ou non ; et cette rétribution faisait monter leur charge à plus de cinquante mille francs pour chacune.
Les bougies du grand cabinet, du salon des nobles , pièce qui précédait la chambre de la reine; celles des antichambres et corridors appartenaient aux garçons de la chambre. Les robes négligées étaient, à chaque réforme , portées, par ordre de la dame d’atours, aux premières femmes. Les grands habits de parure , et tous les autres accessoires de la toilette de la reine revenaient à la dame d’atours.
Les douze femmes de chambre étaient choisies parmi des familles riches de la finance, bourgeoisie, et basse noblesse. Les prétentions à l’importance n’y faisaient faute; il fallait entendre, à ce sujet, madame Campan.
On donnait aux huit premières, trois mille six cents livres de gages , moins aux quatre dernières; mais elles approchaient du roi, de la reine : les maris s’en trouvaient bien, et quelques uns d’eux jouissaient de quatre-vingt mille livres de rente.
Parmi les notes que je dois à l’obligeance de
madame Campan, j'en retrouve une plus étendue que les autres, intitulée : Intérieur de la reine, et distribution de sa journée. On me saura gré d’aider à sa publication, car on aime tout ce qui se rattache à cette intéressante princesse.
Lorsque le roi couchait chez la reine, il se levait toujours avec elle. L’heure précise était donnée à la première femme, qui entrait précédée d’un garçon de la chambre portant un bougeoir ; elle traversait la chambre, allait ôter le verrou qui séparait l’appartement de la reine de celui du roi, et là, trouvait le premier valet de chambre de quartier et un garçon de chambre. Ils entraient, ouvraient les rideaux du lit du côté du roi, lui présentaient des pantoufles, ordinairement en étoffe d’or ou d’argent, comme la robe de chambre qu’on lui passait. Le premier valet de chambre prenait une épée courte qui était toujours placée dans l’intérieur de la balustrade du roi. Quand le roi couchait chez la reine, on apportait cette épée sur le fauteuil destiné à S. M., lequel était posé près du lit de la reine, dans l’intérieur de la balustrade décorée qui environnait son lit. La première femme reconduisait le roi jusqu’à la porte, re-
fermait le verrou, et sortait de la chambre, où elle ne rentrait qu’à l’heure indiquée la veille par S. M. Le soir, la reine était couchée avant le roi; la première femme restait assise au pied de son lit jusqu'à l’arrivée de S. M., pour reconduire, comme le matin, le service du roi, et mettre le verrou après sa sortie.
Le réveil de la reine était habituellement à huit heures, et son déjeuner à neuf, souvent dans son lit, quelquefois levée, sur une petite table en face de son canapé.
Pour détailler convenablement le service intérieur, il faut rappeler que toute espèce de service était honneur et n’avait pas d’autre dénomination. liendre les honneurs du service, c’était présenter le service à une charge d’un grade supérieur qui arrivait au moment où on allait s’en acquitter. Ainsi, en supposant que la reine aurait demandé un verre d’eau, le garçon de la chambre présentait à la première femme de chambre une soucoupe de vermeil sur laquelle étaient placés un gobelet couvert, et une petite carafe; mais la dame d’honneur survenant , elle se trouvait forcée de lui présenter la soucoupe ; et si Madame ou madame la comtesse
SUR MARIE-ANTOINETTE. 1^1 d’Artois entraient en ce moment, la soucoupe passait encore des mains de la dame d’honneur dans celles de la princesse avant d’arriver à la reine. Je ferai observer cependant que, s’il était venu une princesse du sang, au lieu d’une personne de la famille même, le service passait directement de la première femme à la princesse du sang, la dame d’honneur étant dispensée de le rendre, à moins quece ne fut aux princesses de la famille royale. On ne présentait rien directement à la reine ; son mouchoir, ses gants étaient placés sur une soucoupe longue d’or ou de vermeil qui se trouvait comme meuble d’étiquette sur la commode et se nommait gantière. La première femme lui présentait de cette manière tout ce dont elle avait besoin,
La reine déjeunant dans son lit, ou levée , les petites entrées étaient également admises. Elles appartenaient de droit à son premier médecin ou premier chirurgien, au médecin ordinaire, à son lecteur, à son secrétaire du cabinet, aux quatre premiers valets de chambre du roi, à leurs survivanciers, au premier médecin et chirurgien du roi.
Il y avait souvent dix à douze personnes à
cette première entrée. Si la dame d’honneur s’y trouvait ou la surintendante, c’était elle qui portait la table du déjeuner sur le lit. La princesse de Lamballe a très souvent rempli ces fonctions. Quand la reine se levait, la femme de garde-robe était admise pour enlever scs oreillers et mettre le lit en état d’étre fait par des valets de chambre* Elle en tirait les rideaux , et le lit n’était ordinairement fait que lorsque la reine allait à la messe.
La reine se baignait avec une grande chemise de flanelle anglaise boutonnée jusqu’au bas, et dont les manches, à l’extrémité, ainsi que le collet, étaient doublés de linge. Lorsqu’elle sortait du bain , la première femme tenait un drap très élevé pour l’empêcher d’être vue de ses femmes ; elle le jetait sur les épaules. Les baigneuses l’enveloppaient et l’essuyaient ; elle passait ensuite une longue chemise ouverte et entièrement garnie de dentelles,de plusun manteau de lit de taffetas blanc ; la femme de garde-robe bassinait le lit; les pantoufles étaient de basin garnies de dentelles. Ainsi vêtue, la reine allait se mettre au lit; les baigneuses et les garçons enlevaient tout ce qui avait servi au bain. La
SUR MARlÉ-ANÎOtNETTEi 1^5 leine, replacée dans son lit, prenait un livre ou son ouvrage de tapisserie.
Le déjeuner, les jours de bains, se faisait dans le bain même ; on plaçait le plateau sur le couvercle de la baignoire Ces détails minutieux ne se trouvent ici que pour rendre hommage à l’extrême modestie de la reine. Sa sobriété était aussi remarquable; elle déjeunait avec du café ou du chocolat ; ne mangeait à son dîner que de la viande blanche, ne buvait que de l’eau, et sou-pait avec du bouillon , une aile de volaille et un verre d’eau dans lequel elle trempait de petits biscuits. La toilette de représentation avait lieu à midi. On tirait la toilette au milieu de la chambre; ce meuble était ordinairement le plus riche et le plus orné de l’appartement des princesses. La reine s’en servait à la même place pour son déshabiller du soir. Elle couchait lacée à crever de rubans, avec des manches garnies de dentelles et portait un grand fichu. Le peignoir de la reine était présenté par sa première femme, si elle était seule au commencement de la toilette, et ainsi que les autres objets par les dames d’honneur quand elles arrivaient.
A midi, les femmes qui avaient servi pendant
vingt-quatre heures étaient relevées par deux femmes en grand habit. On admettait les grandes entrées pendant la toilette; les plians étaient avancés en cercle pour la surintendante, les dames d’honneur et d’atours, et la gouvernante des enfans de France, lorsqu’elle y venait. Les fonctions des dames du palais , dégagées de tous devoirs de domesticité. ne commençaient leur service qua l’heure de sortir pour la messe; elles attendaient dans le grand cabinet, et entraient lorsque la toilette était terminée. Les princesses du sang, les capitaines des gardes, toutes les grandes charges ayant les entrées, faisaient leur cour à l'heure de la toilette. La reine saluait de la tête ou par une inclination du corps, en s’appuyant sur sa toilette, pour indiquer le mouvement de se lever ; cette dernière manière de saluer était pour les princes du sang.
Les Ifrères du roi venaient habituellement faire leur co ur à S. M. pendant qu’on la coiffait. L’habillement de corps, lors des premières années du règne, avait lieu dans la chambre et suivant les lois de l’étiquette; c’est-à-dire que la dame d’honneur passait la chemise, versait l’eau pour le lavement des mains ; la dame d’atours passait
|e í¡
«
T
b
d à
s
s
lia
Ji
il
0 h
à
as
r
&
le jupon de la robe, ou du grand habit, posait le fichu, nouait le collier; maïs lorsque les modes occupèrent plus sérieusement la jeune reine, et que la hauteur prodigieuee des coiffures obligèrent de passer la chemise par en bas; lorsqu’en-fin elle voulut avoir à son habillement la marchande de modes mademoiselle Berlin, que les dames auraient refusé d’admettre pour partager l’honneur de servir la reine, la toilette cessa de se faire dans la chambre, et la reine saluant l’assemblée, se retirait dans ses cabinets pour s'habiller.
La reine rentrée dans sa chambre, était placée debout vers le milieu, et entourée de la surintendante, des dames donneur et d’atours, île ses dames du palais, du chevalier d’honneur, du premier écuyer, de sou clergé, et des princesses de la famille royale, qui arrivaient accompagnées de tout leur service. Tout le collège passait en ordre par la galerie pour aller à la messe. Les signatures de contrats se faisaient ordinairement au moment de l’entrée dans la chambre; les présentations des colonels pour prendre congé avaient lieu à cette heure, et le dimanche soir
après le salut celle des dames, et les prises de tabouret.
L’huissier de la chambre placé à la porte de la reine n’ouvrait les battans que pour les princes et princesses de la famille royale, qu’il annonçait à haute voix. Les dames du palais n’étaient chargées d’aucune fonction de domesticité ; la lettre du roi en les nommant, portait en autres formules d’étiquette : Vous ayant choisie pour faire la société de la reine. Il n’y avait presque point d’appoin-temens attachés à cette charge purement honorifique.
La reine dînait tous les dimanches avec le roi, seuls en public, dans le cabi?iet des nobles, pièce qui précédait sa chambre. Les dames titrées ayant les honneurs, s’asseyaient pendant le dîner sur des plians placés aux deux côtés de la table. Les dames non titrées restaient debout autour de la table. Le capitaine des gardes, le premier gentilhomme de la chambre, étaient derrière le fauteuil du roi, et derrière celui de la reine, figuraient son chevalier d’honneur, son maître-d’hôtel, et son premier écuyer. Le maître-d’hô-tel de la reine tenait un grand bâton de six à
SUR MARIE-ANTOINETTE. I 77 sept pieds de hauteur, orné de fleurs de lis eu or, et surmonté d’une couronne fleurdelysée. 11 entrait dans la chambre avec ce signe de sa charge, pour annoncer que la reine était servie. Le contrôleur lui remettait le menu du dîner. Il ne quittait point sa place, et ordonnait seulement de servir et de desservir. Les contrôleurs et gentilshommes servans posaient les plats sur la table. Le prince le plus près de la couronne présentait à laver au roi, au moment où S. M. allait se mettre à table; une princesse rendait les mêmes devoirs à la reine.
aWââ V3^l®^3às^
Vers cette époque, le bruit se répandit à Versailles que Monsieur avait proposé au roi de régner à sa place; cela parut si ridicule que l’on ne fit qu’en rire. Cependant, je remarquai que la reine était plus sombre que de coutume; elle s’enfermait avec la duchesse de Polignac et souvent M. le comte d’Artois. Celui-ci ne pensait qu’aller et venir de chez Monsieur chez le roi. Ma curiosité fut piquée, et la première fois que je me trouvai en tête à tête avec madame de Po-
lignac, je la priai de m’apprendre ce qui se passait
J’étais la seule femme à qui elle ne cachât rien, et d’un ton demi-riant, demi-sérieux :
— Monsieur est fou ! me dit-elle.
— Le plus raisonnable de la cour!
— Dites le plus raisonneur, car il extravague complètement.
— Mais enfin, en quoi consiste sa folie?
— Jeudi dernier (nous étions au lundi ), Monsieur est entré chez le roi de très bonne heure. En voyant l’air grave et composé de son frère, Louis XVI s’est attendu à quelque chose d’extraordinaire, et il l’a conduit dans son cabinet. Là, le prince a tiré de son sein une note en forme de mémoire.
— Sire, a-t-il dit, voici le résultat de mes réflexions, ce que mon amour pour la France et
SUR MARIE-ABTOJNETTE. 1 8 l ma famille me suggère. Que le roi daigne apporter à la lecture de cet écrit l’attention qu’il mérite, et surtout que sa majesté soit convaincue à l’avance que mon désir le plus ardent est de la servir.
Le roi prit le cahier recouvert en beau papier rose glacé, et le mit dans sa poche.
— Mon frère, répliqua-t-il, je ne doute ni de votre zèle, ni de votre capacité, et je vous promets de lire ceci.
A cet endroit du récit, madame de Polignac alla prendre dans son secrétaire deux feuilles de papier écrites de la main de la reine, et me les montrant :
— Tenez,me dit-elle, voici une copie exacte du chef-d’œuvre de Monsieur; faites-en un extrait, vous le communiquerez au comte ( M. d’A-dhémar), je n’ai pas besoin de vous recommander le secret.
Munie de cette pièce importante, je la transcris ici en entier :
» Comme premier sujet du roi, je lui dois la » vérité et mes services.
« La vérité me force à lui dire que le royaume «est inquiet; il y a nonchalance dans la marche a de l’administration, les finances sont dans un jétat périlleux, le malaise universel frappe Fat-» tention.
9D’où provient-il?
> De l’égoïsme des personnes investies de la » confiance du roi ; chacun agit pour soi, et il j n’est nullement question des intérêts de l’État » et de ceux de la famille royale.
«Que faut-il faire pour changer en bien ce * malaise ?
» Que le roi appelle dans le conseil un homme »dont lés intérêts soient communs à ceux du roi «et de la France, Cet homme éclairera la dis-
» cussion, dévoilera les petites intrigues, et on ne » pourra lui dire qu’il prêche pour lui, puisqu’il «sera le vicaire du roi.
« Où trouver ce personnage ?
» Où il est ; le premier après le roi, l’aîné de ses » frères, moi enfin.
«Oui, sire, moi... moi qui, étant sans enfans, » ne peux être suspect, moi branche stérile pla-»cée entre deux branches qui ont des rejetons; «moi par conséquent dénué d’ambition person-«nelle, n’ayant point d’arrière-pensée, et ne ti-» rant ma grandeur que de la vôtre. Moi enfin, » qui par des études longues, appliquées, par des » investigations opiniâtres dans notre ancien droit » public, me suis rendu familier ce que les prin-» ces ignorent généralement.
«Oui, sire, je demande une place dans le con-»seil, afin d’aider de mes lumières acquises la » perspicacité de votre esprit naturel. Vous ver-» rez que les affaires prendront une face nouvelle,
184 SOUVENIRS
» lorsque je les éclairerai du flambeau de la dis-»cussion.
» Je ne désire ni honneurs, ni avantages pécuniaires» heureux, sire, de vous prouver mon af-• fection, mon zèle et ma reconnaissance. La « reine aussi, je m’en flatte, saura apprécier toute » la tendresse que je porte à ses enfans.
"Ceci est pour le roi seul et non pour son « conseil, et, en cette occasion, sa majesté ne «doit consulter que son cœur, son expérience, » et les intérêts du royaume. »
Louis XVI, après avoir lu ce beau chef-d’œuvre, appela la reine, afin de savoir si elle en avait eu connaissance.
— Moi, sire? pas un mot.
— Mais Monsieur s’appuie de vous?
— Monsieur m’a dit cent fois que tout allait mal. Indiquez, ai-je répondu, le moyen d’y remédier.
— M’appuierez-vous ?
— Oui, très positivement.
— Or, sire, poursuivit la reine, il n’y a là-de
dans qu’une parole en l’air, et rien d’arrêté.
— Approuveriez-vous que Monsieur entrât au conseil ?
— Non, puisque le roi me demande la vérité.
Que lui répondre ?
Négativement, comme je viens de le faire.
Louis XVI n’osa pas, et pria la reine de se charger de ce soin. Elle s’y refusa à son tour, et manda M. le comte d’Artois. On dépêcha ce prince à Monsieur, qui le renvoya à Marie-An-itoinette, et ce manège ou plutôt ce tracas dura quelques jours.
Cependant MM. de Vergennes et de Breteuil, instruits de la démarche de S. A. R., opinèrent
aussi pour un refus. Monsieur alors dit que le roi devait lui faire savoir cette décision par écrit.
On rapporta à Louis XVI l’exigence de son frère, et allant aussitôt à son bureau, il écrivit les lignes suivantes ;
« Je suis bien fâché, mon cher frère, de ne » pouvoir vous être agréable; mais je ne com-» prends pas la nécessité de me doubler dans le » conseil. Vous êtes homme d’esprit, de sens et w d’étude, cependant il ne vous est pas possible » d’aimer plus que je ne le fais la France et ma » famille; je sais ce qui convient à l’une et à » l’autre.
» Quel rôle joueriez-vous dans le conseil, mon » frère, si je m’avisais de penser autrement que »vous? votre position ne serait-elle pas des plus «fausses? Puis-je répondre que nous serons tou-» jours d’accord? Néanmoins je ne rejette point • vos conseils : je vous les demanderai chaque » fois que je les croirai utiles, et je présume que »ce cas arrivera souvent.
»Je suis heureux d’apprendre que vous êtes
I» en pleine paix avec la reine. Cela vaut mieux «que ces éternelles picotones qui d ailleurs sont » préjudiciables à ces intérêts que vous prenez » tant à cœur.
» Signé LOUIS. »
Monsieur bouda. Il alla dire partout qu’on lui

¿&í^fl '(lllillt fl* «iiM
avait tendu un piège. Ce fut à cette époque et pour se venger que ce prince publia sous le voile de l’anonyme? dans le Journal de Paris, la description de la célèbre harpie trouvée au Chili. Monsieur n’avait d’autre but que de vouloir caractériser la société Polignac : chaque partie de l’animal désignait telle ou telle personne; chacun
s’y trouvait, juqu’à l’abbé Cornu de la Ballivière?
qui en était inconsolable.
— Qu’ai-je fait à Monsieur pour me déshonorer ainsi? s’écriait l’abbé : les en fans dans la rue me montrent au doigt, ils disent que je suis la corne de la harpie.
Cette idée s’inculqua si bien dans la tête du pauvre abbé, qu’en 178g il ne voulut pas rester en France deux heures après madame de Poli-
gnac, tant il craignait que la populace ne le retint en otage.
L’empereur fit en France un second voyage. Je crois en avoir parlé. Nous eûmes aussi le roi de Suède, que la reine prit en grippe je ne sais pourquoi. Cependant il fallut qu’elle traitât S. M. comme devait s’y attendre notre plus ancien et fidèle allié dens le nord.
Il arriva à ce monarque en 1784 un événement désagréable, ce fut la mort de l’un de ses deux chambellans, M. Dupéron, que le comte de la Marek tua en duel, voici pourquoi :
Plusieurs années auparavant, le comte Dupé-ron, Allemand, et non Français comme son nom semble l’annoncer (il descendait de réfugiés après l’édit de Nantes), vint prendre du service dans le régiment de la Marek. Ce corps reçut l’ordre de passer en Amérique lors de la guerre de l’indépendance ; M. Dupéron donna sa démission, alléguant la faiblesse de sa santé. Ses camarades le taxèrent de poltronnerie et ne se génèrent pas pour répéter cette cruelle allégation.
M. de la Marek écrivit au démissionnaire une lettre vive. La réponse ne le fut pas moins, et le comte Dupéron partit pour Stockholm , où le roi, qui l’aimait,l’accueillit et en fit son chambellan.
J’ai entendu dire à Rivarol que si deux montagnes pouvaient se rencontrer quelque part, ce serait à Paris, parce qu’on y vient de tous les lieux du monde. Ce fut là aussi que le comte Dupéron retrouva M. de la Marek. Celui-ci fit consigner le premier à sa porte; et le roi de Suède lui en ayant demandé la raison, il lui répondit qu’on fuyait la compagnie des lâches. Gustave le même soir rapporta ce propos à son chambellan. Un duel devint inévitable.
Les deux adversaires allèrent sur le terrain vers la fin de juillet, accompagnés chacun de trois témoins français pour M. de la Marek, et dans le nombre de ceux du chambellan était M. le vicomte de Noaïlles, suédois. M. de la Marek reçut un coup d’épée : on parlementa; mais, les ennemis ne se trouvant pas satisfaits, on se remit en garde, et cette fois l’épée du co-
I90 - SOUVENIRS
lonel atteignit M. Dupéron à l’œil droit. Le décès s’ensuivit au bout de trois quarts d’heure.
Il y eut à la même époque une histoire de duel bien différente et qui amusa beaucoup la cour.
Parmi les fermiers-généraux on distinguait les d’Aucourt, millionnaires très puissans dans leur compagnie et jouissant d’une grande considération au dehors. Ils obligeaient avec assez de grâce, et sans ruiner par une usure avide comme le faisaient certains de leurs confrères que la charité chrétienne me défend de désigner.
Les deux frères d’Aucourt étaient en procès l’un contre l’autre, ce qui les aigrissait à tel point qu’un soir le fermier-général l’ainé, étant seul avec ses deux fils, accabla de reproches son
SUR MARIÉ-ANTOINETTE* 1 9 1 puîné, et en vint jusqu’à répéter ce mot célèbre de Henri lï, roi d’Angleterre, qui coûta la vie à Becket, archevêque de Cantorbéry:
— Quoi ! n’y aura-t-il personne qui me délivre de ce misérable !
Le père d’Aucourt parlait de son frère.
Ses deux fils cherchent à le calmer sans pouvoir y réussir. Le lendemain , à huit heures du matin, le plus jeune de ses fils entre dans son cabinet où il travaillait, ferme la porte aux ver-roux et s’avance vers le vieil lard, qui, lui voyant un visage défait, lui en demande la cause.
— Je viens vous l’apprendre, répondit le jeune homme : avant-hier vous nous avez demandé de vous venger de notre oncle.
— Moi, monsieur?
— Oui, vous, mon pore; vous avez dit,/Vy aura-t-il personne qui me délivre de ce jnisé-rable !
—
I92 SOUVENIRS
— En effet, je m’en souviens.,; C’était une imprudence.
— Eh bien! j’ai répondu à votre appel.
— Quand cela ?
— Ce matin.
— Mon frère...
— N’existe plus.
— Ah! qu’avez-vous fait?... Assassiner votre oncle, car certes il n’aura pas voulu se battre... Mais fuyez... Prenez cet or, ces billets de caisse, vous en aurez besoin.
Mille louis sont ainsi donnés au jeune d’Au-court. 11 embrasse son père, s’éloigne ; puis, revenant sur ses pas :
—• Oserai-je vous avouer que j’ai des créanciers? dit-il.
— Je les paierai.
SUR MARIE-ANTOINETTE. | g5
— Je voudrais les satisfaire avant mon départ. Autrement ils feront un éclat; et, dans la circonstance...
— Je comprends... Mais partez; si on courait après vous... Ce sont des sommes folles que vous devez?
— Non, monsieur, 80,000 francs au plus.
Le financier retourne à son coffre-fort, compte 60,000 francs en bons billets de caisse, et les remet à son fils en soupirant.
— Votre extravagance me coûte 100,000 livres , dit-il ; mais vous êtes un bon fils.
Nouvel embrassement. Enfin le jeune d’Au-court part... Il s’en va tout droit, non en Angleterre, mais chez son oncle, qui, loin d’avoir été tué par son neveu, ne l’avait pas vu et n’attendait guère sa visite.
— Cher oncle! s’écrie-t-il eu entrant, mon père, las de vos querelles, n’aspire qu’à se réconcilier avec vous.
ni.
194 SOUVENIRS
— Que dis-tu?
— La vérité, et j’y ai travaillé, je vous jure, avec tant de constance que j’y ai réussi. Mon père vous prie de venir dîner aujourd’hui chez lui. Je vous y conduirai, n’est-ce pas, mon bon oncle?
D’Aucourt, charmé au fond de cette réconciliation, questionne son neveu, qui lui apprend qu’il sera seul malheureux.
— Comment cela?
— J’ai des dettes ; et mon père, piqué de la chaleur que j’ai mise à prendre votre défense, refuse tout arrêté de compte avec mes créanciers.
— Et tu dois... ?
— Une misère.
— Mais encore ?
— Quatre-vingt mille livres.
—Malepeste ! une fortune d’honnéte homme...
SUR MARIE-ANTOINETTE. 1 p5 Tenez, monsieur le drôle, donnez ceci en à-compte à vos usuriers, ils patienteront pour le reste.
Et vingt beaux billets de 1,000 francs vont grossir la bourse du jeune homme. Il se confond en remerciemens. Le temps presse, l'heure du dîner arrive; Je financier lait atteler, revêt ses plus pompeux habits, et le voilà dans l'hôtel de son frère. 11 monte, on l’annonce, trente convives ôtaient là... M. d’Aucourt, l’oeil effaré , la bouche béante, pousse une exclamation... II se doute du tour qu’on lui a joué. Cependant Je frère s’avance vers lui, fait son compliment : il est heureux que son aîné reconnaisse ses torts.
— Mes torts! que voulez-vous dire?
— Oui, mon père, s’écrie le fils, mon oncle a su par moi combien vous teniez à son amitié.
— Lui avez-vous dit aussi que vous m’aviez volé ?
— Allons, allons, mon père, qu’on s’embrasse;
196 SOUVENIRS
cela vaut mieux que des récriminations, que des procès, des injures, des duels !
Les assistans se joignent au harangueur, les deux frères finissent par s’attendrir ; et le vieux d’Aucourt, dans un moment d’épanchement, raconte la mystification qui lui a été faite. Son fils l’écoute avec un calme imperturbable.
— Eh bien! dit-il, c’est un genre de spéculation tout comme un autre, et où même on gagne des deux côtés j car mon oncle, non moins généreux...
Puis, au milieu des éclats de rire et de l’approbation générale, il fait le récit de tout ce qui s’est passé.
Nos élégans, à cette époque, employaient de plus honteux expédiens que le jeune d’Ancourt pour se tirer d’un pas difficile.
Je ne nommerai pas le seigneur, bien connu pourtant par ses folies et ses épigrammes, qui se présente devant sa femme, pâle et préoccupé.
SUR M AR IE-AK TOI NETTE.
— Vous êtes malade?
— Non, madame*
— Alors vous avez du chagrin ?
— Qui n’en a pas?
— Je voudrais les partager*
— A quoi bon?... cependant... Ma foi! je voulais vous épargner une douleur violente ; mais la nécessité...
— Que vous est-il arrivé, de grâce ?
— A moi rien, mais à votre frère.
— Le comte de B...1 qu’a-t-il fait?
— Mon Dieu! ce que nous faisons tous, des sottises, des dettes... Pourtant dans le nombre de celles-ci, il y en a de si bizarres...
~- Ne me cachez rien, je vous en conjure!
I§8 SOUVENIRS
— Eh bien! madame, poursuivit le marquis de P..., votre frère a perdu avant-hier à Marły une somme énorme, 100,000 francs.
— O ciel ! et ses ehfans !
— Il a fait pis encore.
— Volé, tué?
— Tué, non... Ï1 allait chezM. Colin dé Saint-Marc, un riche financier fort utile à connaître. Il arrive, on l’introduit dans le cabinet, le secrétaire était ouvert ■ votre frère voit un tas de billets étiquetés cent mille francs. Le comte, interprétant les offres de services faites à satiété par le sieur Colin, prend le paquet, laisse Son billet en échange, un mot de remerciement et d’excuse, et va s acquitter. Il se croyait bien en règle... Mais voilà que le financier lui écrit en style de Vautre inonde, avec des expressions... des menacés... En un mot, si votre frère ne rend pas les 100,000 livres dans la journée, cet homme est capable de courir a Versailles et de répéter ce que contient son insolente épltrc. Votre frère a
SUR MARIE-ANTOINETTE. 10g réuni Z|0,ooo francs, j’y en ai ajouté 10,000; quant au reste, il n’est pas possible de le trouver.
— J’ai mes diamans, monsieur; et pour Un frère... Cela vous déplairait-il?
— A moi, madame? c’est mal me connaître... J’avoue que je venais vous le proposer.
—Je vous en remercie .. tenez, les voilà ; allez les mettre en gage, il y en a bien pour 5o mille écus.
— Je ne prendrai que ce qui est nécessaire.
Le marquis de P... emporte l’écrin. Il en fait deux parts; l’une va chez l’usurier, l’autre est donnée à mademoiselle Rosalie. Il était à peine sorti lorsque le comte de B.... vient trouver sa sœur d’un air riant. Elle s’étonne de sa gaieté, lui en fait des reproches.
— Et pourquoi?
SOUVENIRS
— Comment ! n’avez - vous pas sur la conscience une action honteuse?
A ces mots, M. de B.... demande une explication , sa sœur la lui donne. Une juste colère anime le comte.
— Madame, dit-il, ce n’est pas moi, mais votre mari qui est un escroc, il a pris les billets de caisse de M. Colin de Saint-Marc, et volé vos diamans ! Je n’en puis douter d’après votre récit.
Ses conjectures se réalisèrent en effet, le marquis de P... refusa de lui rendre raison, tourna le fait en plaisanterie; et, le dirai je à la honte de nos mœurs? on convint généralement que la rouerie était délicieuse.
On ne pensa pas ainsi au château. Le roi indigné fit défendre au marquis de se présenter devant lui, et il ordonna que les diamans fussent rendus à la jeune femme. L’actrice s’exécuta la première dès qu’elle eut appris cette infamie; elle renvoya les pierreries et fit fermer sa porte
SUR MARIE-ANTOINETTE, 201 au marquis. Je parle peu des actrices, je n’aime pas le théâtre, et je ne conçois guère que des personnes de notre rang puissent s’intéresser aux faits et gestes de ces créatures perdues, les accueillir, et surtout les fréquenter. Combien madame de Sauvigny me parut ridicule, lorsqu’elle manifesta cette tendresse enthousiaste pour mademoiselle Clairon ! Je vis avec peine aussi la protection que S. M. accorda à mademoiselle Raucourt. Je veux bien qu’on applaudisse ces femmes sur la scène, qu’on les encourage par de la bienveillance, que même on les enrichisse; mais une barrière d’airain doit séparer la bonne et la mauvaise compagnie.
A propos de ces demoiselles, je vais raconter l’aventure de la divine Contât avec le marquis de G....
La belle actrice l’aimait d’amour, disait-on. Un jour elle voit venir chez elle l’heureux marquis avec une mine presque larmoyante. Mademoiselle Contât le questionne, il se tait, elle insiste; enfin il avoue que la veille il a perdu tout ce qu’il possédait, et de plus 10,000 livres. La
202 SOUVENIRS
rigueur des lois du jen est telle que le déshonneur frappe quiconque ne s’acquitte pas dans les vingt-quatre heures.
— N’est-ce que cela , mon ami? dit la comédienne, je puis vous sauver facilement, voilâmes bijoux, faites-íes estimer, vous me rendrez ce dont Vous n’aurez pas besoin.
Le marquis tombe aux genoux de sa dulcinée, accepte son offre, va chez un juif qui lui compte 25;ooo francs, puis il écrit à mademoiselle Contât :
«Chèrebelle,le mécréant qui est le plus hon-»nête de cette canaille, ne m’a donné que tq,ooo «francs de vos bijoux, aussi je ne vous envoie «rien; car j’ai besoin au moins de 18 mille livres. » Recevez mon cœur en échange, c’est un dépôt »à fonds perdu, puisque je renonce à le re-» prendre. »
La dernière phrase est trouvée charmante; elle fait oublier l’indélicatesse du procédé. Cependant le marquis court chez une femme dont le
SUR MARIE-ANTOINETTE. âo5
nom ne souillera pas ma plume, et lui achète deux mille écus comptant une jeune fille. Il va retrouver mademoiselle Contât, et lui dit qu’un de ses amis fort épris d’une sorte de villageoise désirerait la façonner un peu aux usages du monde, —Voudriez-vous, ajoute-t-il, vous charger de cette éducation ?
Mademoiselle Contât, toujours abusée, accepte; on lui amène la péronnelle, qui, stylée par l’actrice, devient charmante ; les choses en sont à ce point, lorsqu’un journaux Tuileries, la vieille àppareilleuse s’approche de mademoiselle Contât, et lui demande des nouvelles d’Aspasie.
— Quelle Aspasie ?
— La dernière maîtresse du marquis de G.... qu’il a mise en pension chez vous.
— Ah! jolie Mais elle appartient au duc de Fronsac.
— Oh! que nenni ! je sais toute l’histoire, car c’est moi qui l’ai vendue au marquis de G.... Et
2o4 même à telle enseigne que, n’ayant pas d’argent pour la payer, il se l’est fait donner par une vieille maîtresse qui a cru solder une dette de jeu, et la sotte a livré ses diamans pour cette oeuvre sainte.
L’enfer parut s’ouvrir sous les pieds de l’actrice; elle faillit mourir d’indignation. En rentrant elle mit à la porte la demoiselle Aspasie avec une lettre pour le marquis de G.... d’un style si énergique, que le fier seigneur rapporta le lendemain.... non les bijoux, mais une reconnaissance de la somme empruntée. Mademoiselle Contât la posa sur la cheminée de son salon, où ses nombreux visiteurs purent la voir. Aussi le marquis fut-il forcé de l’acquitter.
Je ne finirais pas si je voulais raconter tout ce que je sais d’analogue à ces faits. La dépravation de la cour était sans pareille. On osa applaudir l’abominable chanson de M. de Champrenets, dont on fit d’abord honneur à M. de Louvois. La voici :
LES JEUNES GENS DU JOUR.
Air: On compterait les diamant.
De Louvois suivant les leçons. Je fais des chansons et des dettes; Les premières sont sans façons, Mais les secondes sont bien faites. C’est pour échapper à l’ennui Qu’un homme prudent se dérange. Quel bien est solide aujourd'hui? Le plus sûr est celui qu’on mange.
Eh ! qui ne doit pas maintenant ? C’est la mode la plus constante, Et le plus petit intrigant De mille créanciers se vante.
En vain ces messieurs sont mutins, J amais leur nombre ne m'effraie ;
Ils ressemblent à nos catins : Plus on en a, moins on les paie.
Le courtisan doit sa faveur A quelque machine secrète ; La coquette doit sa fraîcheur A quelques heures de toilette : Tout s’emprunte jusqu’à l’esprit, Et c’est, dans ce siècle volage, Ce que l'on a plus à crédit, Et ce qui s’use davantage.
2o6 souvenirs
Mais avec un peu de gaîté
Tout s'excuse, tout passe en France.
Dans les bras de la volupté,
Comment songer à la dépense?
Vieux parens, en vain vous prêchez;
Vous êtes d’ennuyeux apôtres;
Vous nous fîtes pour vos péchés, Et vous vivez trop pour les nôtres.
Je dois dire qu’on se récria un peu sur les deux derniers vers. En conséquence on proposa d’y substituer ceux-ci :
Rappelez-vous vos vieux péchés.
Vous serez plus doux pour les nôtres.
Nous perdîmes le S mai 1^85 un homme dont la conduite n’avait pas été très propre à ramener vers la sévérité des mœurs antiques. Outre l’attachement plus que fraternel que l’on supposait au duc de Choiseul pour madame de Grammont et dont j’ai toujours douté, on ne pouvait nier sa persistance à obtenir les faveurs de madame de Stainville, la femme de son frère.
La dernière maladie du duc de Choiseul s’annonça sous les symptômes les plus graves. 11
SUR MARIE-ANTOINETTE. 20? comprit que son heure était venue, et dit à son médecin : Qui donnerait deux sous de ma vie ferait un mauvais marché! Dès que la nouvelle du danger fut connue, il y eut foule à son hôtel, comme au moment de sa disgrâce. Madame la comtesse de B rionne et la princesse Charlotte sa fille le supplièrent d’appeler, outre Laval, son docteur ordinaire, le célebre Barthez, premier médecin dc M. le duc d’Orléans.
Ce docteur, Languedocien de naissance et l’une des colonnes de la faculté de Montpellier, était et est encore un homme de science et d’incrédulité; habile théoricien, dangereux dans la pratique, à cause de la hardiesse de ses expériences, il s’était fait une réputation colossale qui l’attira à Paris. Il y succéda au consciencieux Tronchin, et s’y montra athée, libertin et cynique. Du reste, on ne jurait que par lui, et qui mourait sans l’avoir consulté ne partait point tranquille.
Barthez vint donc au chevet du lit de M. de Choiseul. Il ordonna de laisser agir la nature ; c’était un arrêt de mort.
2o8 souvenirs
— Alors il faut envoyer chercher un confesseur, dit madame de Choiseul, qui, bien que malade, retrouva toute son énergie, que plus tard- l’excès de la douleur lui fit perdre.
— Madame, repartit Barthez, je suis médecin du corps et non de lame; le charlatanisme d’autrui ne me regarde pas.
Plus de cent personnes cette meme nuit couchèrent dans l’hôtel, hommes et femmes du plus haut rang. Le roi et la reine envoyaient deux fois par jour demander des nouvelles du moribond. L’affluence des visiteurs allait croissant.
Le samedi 17 mai, M. de Choiseul fit appeler son notaire et demeura enfermé avec lui pendant plusieurs heures, qu’il employa à faire son testament. Il estimait ses biens 14 millions, les prétentions de ses créanciers s’élevaient plus haut. Aussi engagea-t-il par cet acte solennel madame de Choiseul à l’aider sur son propre acquêt. Il demanda à être enseveli au chef-lieu de sa duché-pairie, et qu’on plantât sur sa tombe un cyprès mâle; une place devait être réservée à côté
SUR MARIE-ANTOINETTE» 20()
cle lui pour la duchesse, à laquelle on dédierait un cyprès femelle. Il donna la rosette en diamans de sa toison d’or à madame de Brienne et le reste de cette décoration à M. le duc de Châtelet, son exécuteur testamentaire. Sa légataire universelle fut madame la duchesse de Grammont, sa sœur. La pauvre femme ne recueillit pas grand’chose de sa succession. Aussi elle ne garda que son bénéfice d’inventaire.
Le notaire parti, M. de Choiseul dit au duc de Châtelet :
— Mon ami, je ne veux pas être jeté à la voirie ; qu’on mande un prêtre.
Il y avait dix évêques dans son salon, qu’on lui nomma ; il hocha la tête.
— Et le curé de la paroisse? dit-il.
C’était M. Poupart, ayant charge d’âmes sur Saint-Eustache. On le fit mander, et il s’en retourna très satisfait des dispositions du duc, auquel on administra les derniers sacremens avec une pompe imposante.
in. 14
SOUVENIRS
Peu après le duc eut le délire, qui précéda son agonie, et le dimanche 8 mai i ^85 il expira. Madame de Choiseul, désirant faire honneur aux restes de son mari, se retira d’abord dans un couvent, avec un très médiocre domestique; elle y emporta l’estime et les regrets de toute la cour. La révolution l’a respectée, elle qui s’est montrée implacable envers la duchesse de Gram-mont.
Les préparatifs nécessaires pour étaler la pompe d’un tel enterrement retardèrent jusqu’au mercredi n courant la cérémonie funèbre. On y vit tous les ducs et pairs qui se trouvaient à Paris, meme M. le duc de Richelieu. M. le duc d’Aiguillon, par capitulation , y envoya ses carrosses.
J’étais à Versailles le soir de ce dimanche. La reine avait pleuré. Cependant elle dîna en public et se mit à son jeu ; mais personne ne parlait : on eût dit le jour des funérailles d’un prince de la famille royale. Tout-à-coup un bruit singulier se fait entendre; on se demande d’où il provient, quel est le coupable. Sa contenance le décèle :
SUR MARIE-ANTOINETTE. 211
c’est le marquis du Lan, qui, occupé d’une partie de lansquenet, n’avait pu maintenir une certaine incongruité auquel il était sujet.
Ni le souvenir de la mort du duc de Choiseul, ni le respect dû à la personne de LL. MM-, n’eurent le pouvoir de nous imposer silence. Voilà que de toutes parts s’élèvent des éclats de rire étouffés d’abord derrière l’éventail ou le mouchoir; mais lorsque Ton vit la reine céder impérieusement à riiilarilé générale, on ne se contraignit plus.
M. de Montesquieu, avec ce sang-froid qui provoque la gaieté , se tournant vers madame la maréchale de Mouchy, toujours si compassée :
— Madame, dit-il, ceci doit-il compter pour l’oraison funèbre? »
Ob', alors les rires recommencèrent sur nouveaux frais, ce fut un vrai scandale. Madame de Grammopt, à qui on raconta l’aventure , ne l’a jamais pardonnée à ce pauvre marquis de Lan, lequel était bon à voir, avec sa mine piteuse-
ment effarée, sa confusion de courtisan pris en flagrant délit.
Madame de Grammont eut à enregistrer un grief plus positif. M. le comte d’Artois oublia qu’il était de convenance d’envoyer les compagnies suisses au convoi de leur ex-colonel. Les Choiseul firent grand bruit de cette inadvertance , et la révolution arriva que l’on s’en plaignait encore.
La dépouille de M. le duc de Choiseul contenta diverses ambitions. Le duché-pairie d’Amboise revint, par une concession royale, à M. de Choiseul la Baume; mais il ne put prendre rang qu’en 1787 et en datant de cette année. Le cordon bleu passa au maréchal de Stainville, frère du défunt, ainsi que le grand bailliage de Haguenau-Morceau, d’environ quatre-vingt mille livres de rente, en outre de superbes droits honorifiques dans l’empire d'Allemagne. La survivance fut transférée au prince de Montbarrey. Le comte d’Estaing eut le gouvernement deTouraine.
Cenefutqu’aprèsledécèsdece haut personnage
Ü 15 que les ministres en pied se crurent en pleine possession de leurs portefeuilles; car, à chaque voyage de Compïègne, de Fontainebleau et de Marły, le bruit se répandait de la rentrée du duc de Choiseul. On pensait que son crédit finirait par l’emporter sur la répugnance du roi.
M. de La Harpe, littérateur distingué, élève et disciple favori de Voltaire, composa une épitaphe pour le tombeau de M. de Choiseul ; elle eut beaucoup de succès dans sa simple énergie :
Ci-gil Choiseul, ¿ont le vaste génie
Se jouait tour à tour et des rois et du sort.
Deux fois il terrassa l’envie :
Le jour de son exil et le jour de sa mort.
On s’occupa beaucoup aussi à cette époque du bruit qui se répandit que deux petites filles, élevées par madame de Genlis à Bellechasse, avec les enfans d’Orléans, et qu’on nommait Pamela et Herminie, étaient les fruits puînés du mariage de ladite comtesse avec son féal époux.
On en fit compliment aux deux aînées, mesdames de Valence et de Lawoestine, qui le prirent fort mal. Madame de Genlis soutenait que
Pamela avait été expédiée d’Angleterre par un maquignon, avec une bande de chevaux ; le tout à la demande de M. le duc de Chartres * Quant à Heræinie, elle tombait des nues à peu près.
La reines’amusa beaucoup de la pensée quema-dame de Geni ¡s, devenue gouvernante des enfans de France, aurait introduit et impatronisé dans l’intérieur de ces augustes rejetons les gages d’un amour illégitime. Cependant on se mit en quête de ce fait, et il fut constaté que le duc de Chartres était le père de ces petites filles, du moins madame de Genlis ne pouvait les amener, à ce titre, dans la maison de son mari.
M. le duc d’Orléans, que madame Dubarri appelait gros père, était, avarice à part, un excellent prince : il ne manquait pas d’esprit, il avait montré de la bravoure pendant son service ; mais depuis il s’était livré à une vie tout d’intérieur, avec des complaisans et des courtisanes. De sorte qu’on avait fini par ne plus le compter pour rien.
Sa femme, intrépide Messaline, commença le
SUR MARIE-AŃTOIWETTE. 21 5 déshonneur deM* le duc d’Orléans; il l’acheva en vivant avec une marquise dite madame de Ville-momble, et en prêtant à la petite semaine. Celte manière de s’enrichir, peu convenable à un prince du sang, lui rapporta des sommes immenses.
Monseigneur le duc d’Orléans mourut le 7 novembre 1780,au château de Sainte-Assise, où il s’était retiré avec madame de Montesson, sa femme légitime. On accusa le docteur Barthez de l’avoir tué: les médecins, par jalousie, firent courir ce bruit. Le prince mangeait beaucoup, il était prodigieusement gras, et, faisant peu d’exercice, il fut victime de son intempérance. Sa maladie dura plusieurs jours. Pendant ce temps le roi envoyait savoir de scs nouvelles de quatre en quatre heures.
Le duc de Bourbon, qui, depuis sa séparation éclatante avec sa femme, ne voyait plus son beau-père, vint à Versailles foire sa cour. Le roi lui demanda comment se portait M. le duc d’Orléans ; sur la réponse qu’il n’en savait rien, le duc reçut une sévère réprimande de la part du souverain. Humilié, il s’empressa d’aller à Sainte-
Assise, où il n’était pas attendu. Le mourant le conjura d’oublier les torts de la duchesse et de vivre bien avec elle. Ai. le duc de Bourbon, pour adoucir les derniers momens de son beau-père, lui promit ce que certes il n’avait pas l’intention de tenir.
Les Parisiens regrettèrent M. le duc d’Orléans, d’autant que le duc de Chartres, son héritier, leur devenait odieux. Ce prince, poussé par un esprit mercantile, avait bouleversé le Palais-Royal : il l’entourait d’une rangée de maisons d’un grand produit, mais qui nuisaient beaucoup aux bâtimens déjà construits par divers particuliers dans les rues Richelieu, Neuve des Petits-Champs et des Bons-Enfans.
L’intérêt mis en jeu porta les Parisiens à détester le duc d’Orléans : ils lui prodiguèrent les chansons, les épigrammes, les satires. Il lui fallut redoubler de ruses et de jongleries pour reconquérir cette estime qui était si nécessaire à l’accomplissement de ses nouveaux projets.
Afin d’aider à leur réussite, et au moment où les
Montgolfier et les baquets du mesmérisme se disputaient l’attention du public,on annonça l’apparition deCagliostro.Celui-ci, escroc consommé, se montra, ai Je dit, sous les auspices du prince Louis, qui devait être sa première victime.
Bientôt on apprit qu’il existait une franc-maçonnerie du rit égyptien, au moyen de laquelle on communiquait avec les esprits de l’autre monde. Certains prétendaient avoir soupe avec des femmes célèbres de l’antiquité. Voici à ce sujet ce que m’a raconté le malheureux maréchal duc deNoailles, dont je certifie la véracité. 11 était chez moi, avec l’évêque d’Arras , l’archevêque de Rouen, le cardinal de Larochefoucault, le duc de Sully, le marquis de Saucourt, madame la maréchale d’Aubeterre, madame de Castel-lane et la marquise de la Roche-Aymond, comme moi dame du palais. Je le laisse parler :
«C’était en 1782, au mois de juin. J’avais quelque temps auparavant manifesté au grand-aumônier le désir de me trouver avec le comte deCagliostro lorsqu’il ferait une expérience importante. Le prince Louis me répondit qu’il peu*
serait à moi au premier souper des morts qui aurait lieu. Le 14 juin je reçus un billet ainsi conçu :
« Monsieur le maréchal,
» Je n’ai pas oublié mes promesses ; je vous in-» vite à souper ce soir avec qui vous voudrez. Je » vous réponds de la chère, mais non descon-» vives : songez au vôtre, car vous devez en ame-» ner un.
» J’ai l’honneur de vous saluer, etc. »
L’heure du rendez-vous se trouvait indiquée au post-scriptum. C’était au palais cardinal, dans le propre appartement du grand aumônier, le salon des Chinois* Il y avait là le chevalier de Boufflers, le prince de Nassau * l’avocat Gerbier, M. d’Esprémenil, le maître du logis et moi. Nous nous connaissions tous, aussi la conversation ne languit point. Le prince Louis nous dit qu’il attendait le comte Cagliostro.
Lorsque celui-ci entra, notre curiosité fut vivement excitée* Il était somptueusement vêtu ;
son air grave, ses manières solennelles, nous imposèrent bien que la plupart de nous le re-gardât comme un charlatan. Il causait peu, et semblait parfois s’abandonner à une profonde méditation. A onze heures trois quarts, il prit • la parole, et s’adressant collectivement à tous les convives:
g *— Les noms que vous avez choisis, messieurs? dit-il. »
Et prenant un morceau de parchemin vierge, une plume neuve qu'il trempa dans une liqueur rougeâtre : il se prépara à écrire ce que nous dicterions. Le prince Louis, poussé par la rabia princière et cardinal, parla le premier, tandis que le chevalier de Boufflers me disait assez haut pour être entendu :
* — Voyez la distraction du prince, il oublie qu’il est chez lui. »
Le grand aumônier, que cette plaisanterie démonta, choisit le cardinal Dnperron; le chevalier de Boufflers, Jeanne d'Arc; M. le prince
cle Nassau, César; M. Gerbier, Cicéron; le conseillers d’Esprémenil, Catilina; et moi, le grand connétable Anne de Montmorency.
Tous les noms écrits, le comte de Cagliostro alluma un réchaud rempli d’étoupes imbibées d’esprit de vin, y jeta le morceau de parchemin enveloppé dans la cire blanche; et quand la flamme eut consumé cet appareil, une odeur forte, mais balsamique, se répandit dans l’appartement.
Minuit sonna... Les battans de la salle à manger s’ouvrirent d’eux-mêmes, une illumination mystérieuse éclairait cette pièce; les lustres représentaient certains signes célestes : il y avait treize couverts, treize fauteuils, et nous étions sept convives. Le prince Louis, au faite du cérémonial , nous fit passer cette fois devant lui : moi d’abord, puis, M. de Nassau, de Boufflers, le conseiller, l’avocat et lui.
La porte se referma; nous nous assîmes... Aucuns domestiques n’étaient là. Tout-à-coup, la porte du salon dont nous venions de sortir,
se rouvrit avec une violence qui nous fit tressaillir... Une femme se présente; sa taille était ordinaire, sa figure ronde, colorée, ses yeux resplendissaient, et son sourire avait quelque chose de divin. C’était Jeanne d’Arc. Elle portait un costume mi-bourgeois, mi-guerrier, très élégant, mais ne ressemblant point à celui qu’on lui donne dans nos tableaux. Nous remarquâmes sur sa cotte de maille, l’écusson d’azur quelle reçut de Charles VII, et une épée d’argent en pal croisée et pommelée d’or, soutenant de la pointe une couronne d’or, et accostée de deux fleurs de lis d’or.
Le grand César ( Jules) entra le second ; nous le reconnûmes à sa tête chauve, ceinte de lauriers, à son air simple et grave tout à la fois. Il nous examina les uns après les autres, et alla se placer près du prince de Nassau, qui recula soir fauteuil, sans doute par politesse, bien que sort visage exprimât la terreur et le dégoût.
Le troisième qui comparut, fut l’éloquent Marcus Tullius Cicéron. Je le vois encore enveloppé dans sa toge et son manteau, et ayant
le regard fixe, et autour du cou une raie rouge qui rappelait que de sa tète tranchée on avait fait un horrible ornement à la tribune aux harangues.
Le cardinal Du perron arriva ensuite, tout engoncé dans sa soutane rouge , portant le chapeau de cardinal qu’il ne quitta pas, ayant la barbe épaisse et une physionomie spirituelle.
Après lui vînt Catilina; celui farouche, mélancolique ; il tressaillit en reconnaissant ses contemporains, Cicéron et César : le premier surtout, qui avait ordonné sa mort, lui causa un geste de rage. Cagliostro étendit sa main armée d’une baguette constellée vers le fier patricien, et il tomba dans une morne immobilité d’où il ne sortit plus.
Dans cet intervalle, s’avança majestueusement le connétable Anne de Montmorency. Quelle figure noble et imposante 1 D’une main il s’appuyait sur sa gigantesque épée, tout ébréchée de la multitude des coups qu’elle avait
SUR MARIE-ANTOINETTE. s33
portés, et de l’autre il tenait un rosaire de lapis lazuli, garni de médailles, d'a^nas dei, et de 1 petits reliquaires»
Il marchait péniblement; ses yeux s’atta-|W obèrent d’abord sur César, il leva les épaules en passant devant les deux cardinaux; et quand il prit place à mon côté, il m’honora d’un salut rili obligeant.
La vue de ces personnages étranges nous avait ôté l’appétit. Nous avions grande envie de les toucher afin de nous assurer si c’étaient des corps opaques ou fantastiques, et nous n’osions. Plus hardi que les autres, et sous prétexte de débarrasser monseigneur le connétable de sa rapière, je m’en saisis... Une commotion électrique, atrocement douloureuse, brisa presque mon bras, et mota le désir de recommencer; d’ailleurs, mess ire Anne donna à ses lèvres une telle expression, que je ne songeai plus qu’à me mettre en garde contre lui, en cas d’hostilité de sa part.
Cependant, nul ne parlait, et les assiettes
2^4 SOUVENIRS
restaient pleines. Le comte Cagliostro voulant animer les convives, se tourna vers Jeanne d’Arc :
«— Mademoiselle, lui dit-il, est-il vrai que vous n’ayez pas été brûlée à Rouen , comme le prétend la famille des Armoises, qui assure que vous êtes entrée postérieurement à cette époque chez elle par un mariage ? »
L’auguste vierge sourit, et d’une voix qui nous fit tressaillir :
« — N’épargnez pas aux Anglais la honte de mon supplice, répliqua-t-elle, c’est, une tache dont ils ne pourront jamais se blanchir.
»— Vive Dieu! s’écria alors le grand connétable, chaque fois que j’ai occis ou fait pendre un Anglais, c’était dans l’intention de vous l’offrir en holocauste de juste vengeance, noble vierge, ma mie ! »
César prenant > son tour la parole, dit à
Cicéron :
SÛR M A RIE-AS TOILETTE. 2 2$
« -— Tullius, ces Gaulois que j’ai vaincus pendant dix ans, ont fait depuis assez bonne figure*
* — Empereur , reprit le connétable, ils ont plus d’une fois battu les Romains, et le grand Charles VIII, notre bien-aimé roi, est entré dans ta Rome, la visière baissée et la lance droite, appuyée sur sa cuisse en signe de con* quête.
» — C’est que César n’était plus là, répondit 1 éloquent orateur.
¿ — Ou pour mieux dire que les Français s’y trouvaient, répliqua le grand-connétable.
» César se tut, mais sourit avec tant de dédain que j’en fus blessé, cependant je n’osais me mêler à la querelle. Le cardinal Duperron, que le silence ennuyait, se mit à dire :
» — Eh ! messieurs, vivons en paix, puisque Dieu nous interdit la guerre.
b —Duperron, mon ami, s’écria Anne avec impa ence et ironie, s’il te plaisait de te taire, lorsqu
ni.
monseigneur Julius César parle! N’as-tu pas assez causé en ton vivant sans aucun résultat utile ?
» — Oh ! compère de roi, répondit le cardinal puperron sans se laisser déconcerter,vous faites sonner haut vos batailles. Mais, de par Dieu, nous n'aurions pas été implorer vos lumières dans le conseil ! Àu ‘ reste, vivons en paix pendant le peu d'heures que nous avons à rester sur cette terre.
» Là-dessus, le connétable s’adressant à César, qu’il qualifia dlmperator, lui demanda s’il savait ce que c’était qu’un cardinal, et ici commença une conversation peu édifiante, à laquelle Cicéron prit part. Nous trouvions que cette fantasmagorie devenait fatigante lorsque le comte de Cagliostro fit un signe avec sa baguette.
» Cinq des fantômes présens se levèrent, et passèrent rapidement dans le salon sans nous saluer; un seul resta à table, c’était Catilina,
» — Ne m’as-tu pas entendu? lui dit Cagliostro.
1SUR MARIE-ANTOINETTE. 227
» — A quoi bon m’en aller, répondit-il, puisqu’il faudra sitôt que je revienne? Duval d’Espré-
ménil, poursuivit le spectre en se tournant vers le conseiller au parlement, tu marches sur mes traces, tu iras presque aussi loin que moi, et, comme moi, tu mourras de la main du carnifex (le bourreau).
«Il dit, se lève, lance à son voisin un regard de haine, et prend la même route que les autres. Quant à nous, nous restâmes immobiles, moi
surtout auquel ce maudit Catilina avait dit en partant que je subirais le meme sort que le fougueux parlementaire... »
Ici j’interrompis le maréchal de Mouchy par une exclamation de terreur.
— Mais ces revenans sont des gens abominables, ajoutai-je. Quoi, monseigneur, vous le plus parfait des hommes, vous subiriez le plus affreux supplice !
•— En effet, c’est absurde, car il n’est pas probable qu’à mon âge je fasse assez d’actes de ré-
228 SOUVENIRS
bellico, peur mériter de la part du roi un tel traitement ... Mais j’ai vu, entendu, et mon récit est conforme à l’exacte vérité... je le reprends.
« Nos convives de l’autre monde partis, nous convînmes qu’ils nous avaient peu amusés. Nous nous levâmes de table sans avoir mangé, et rentrâmes en silence dans le salon; le comte de Cagliostro demanda le secret pour un temps limité, nous autorisant de le rompre dans l’intérêt de la loge, et afin de lui faire des prosélytes. »
— Avec qui croyez-vous avoir soupe, dis-je au maréchal, avec des fantômes ou d’habiles pantomimes?
— Madame, je suis persuadé que l’illusion a été complète.
— Qu’entendez-vous par là?
— Qu on nous a joués, mais avec une adresse infinie; ce qui me prouve l’invraisemblance de cette apparition, c'est la prophétie de Catilina... Cependant je les vois encore plutôt glisser que
SUR MARIE-ANTOINETTE. 2ig marcher, et pour douze cent mille francs je ne voudrais pas être soumis à une seconde épreuve de ce genre.

Après avoir écouté le récit du maréchal de Noailles, il me prit aussi l’envie de voir le comte de Cagliostro, et à cet effet, je demandai à la reine la permission d’aller souper chez le grand-aumônier,
— Qu’irez-vous faire là? me répondit Marie-Antoinette, le prince Louis va vous tourmenter
pour que vous me parliez pour lui. Il m’a gravement manqué l’autre soir, et cela afin d’insinuer que je le dédommage en secret de mes rigueurs ostensibles. Vous vous rappelez la dernière fête que j’ai donnée au comte et à la comtesse du nord au petit Trianon?
— Oui, madame.
— Eh bien ! le cardinal prince Louis, que certes je n’avais pas invité, négocie avec le concierge pour qu’il lui permette d’entrer chez lui, et de regarder la fête par une fenêtre; il donne sa parole d’honneur qu’il ne sortira pas de la maison. Mon concierge, auquel cette complaisance est payée Goo livres, consent, mais les soins de sa charge l’entraînent au-dehors. Le cardinal en profite pour descendre dans le jardin ; une simple redingote couvre les vétemeos de son ordre; on voit surtout les bas rouges, et deux fois je rencontre cet homme insolent sur mon passage. J’ai voulu punir le concierge, on m’a sollicitée en sa faveur et j’ai cédé. C’était un tort d’autant plus grand, que je désirais faire connaître à toute la France mon aversion pour le prince Louis,
SUR jMARIE-ANTOINETTIÍ. 553 cela l'empêcherait de poursuivre des intrigues dont certainement je sais le but.
Je dois signaler ici le passage à Paris du fils et de la belle-fille de la grande Catherine Auguste, impératrice de Russie. Le grand-duc Paul et la grande-duchesse, sa femme, vinrent voir la France et la cour en 1781 Tous les deux plurent beaucoup, lui malgré sa laideur, elle par sa beauté parfaite. Le prince avait un air distingué et des manières hautaines qui lui allaient à ravir: chacune de ses paroles portail. U nous laissa l’idée d’un monarque habile et sage; rien ne nous fit prévoir alor s sa conduite d’aujourd'hui.
La cour se mil en frais pour accueillir cet illustre couple. La reine multiplia ses parures et se montra dans tout son éclat. Elle témoigna beaucoup plus de bienveillance au prince et à la princesse qu’au roi de Suède et au célèbre prince Henri de Prusse, qui vinrent presque en
a 34 SOUVENIRS
même temps. Cependant ce dernier fut l’objet d’un charmant compliment. Il interrogeait un jeune élève de l’école militaire, et voulant Fem-barrasser, il lui adressa entre autres questions saugrenues celles-ci : Etes-vous né d’un œuf} Le jeune homme se tut, réfléchit, et peu après, avec l’aide, à ce qu’on croit, du chevalier deBoufflers, il écrivit le quatrain suivant qu’il remit au prince :
Ma naissance n’a rien de neuf, •l’ai suivi la commune règle : C’est vous qui naquîtes d’un œuf, Prince, car vous êtes un aigle.
On renouvela pour le comte et la comtesse du Nord et le roi de Suède, les magnificences du petitTrianon, les fêtes nocturnes, les illuminations générales. Une flottille de barques dorées, argentées, barriolées, dont les mâts et les cordages étaient garnis de lampions de couleur, navigua sur la rivière et le lac. Tous les invités portaient un costume de caractère. Mais ces merveilles furent effacées par celles de Chantilly. La reine dit à ce sujet un mot parfait :
— M. le prince de Condé, par ses somptuosités , ne nuit qu’à sa bourse ; l’exagération de
■ ■ 1 ilion i fe. I
às
Æ
fe,
celles des rois font pleurer les laboureurs et Partisan, sur qui, en définitive, elles pèsent.
Madame de Polignac, dont la faveur allait croissant, recevait de bons princes du Nord des témoignages flatteurs de considération. Aussi combien son crédit était envié!
Parmi ceux qui lui auraient voulu moins de puissance, je citerai le baron de B retenu. Ce ministre, très avant dans les bonnes grâces du roi, et bien vu de la reine, crut d’abord, dans son intérêt, qu’il devait se rapprocher de l’aimable favorite. En conséquence, il proposa le mariage de sa petite-fille, mademoiselle de Matignon, âgée de onze ans, et dont la fortune serait prodigieuse, avec le comte Armand de Polignac, fils aîné de la duchesse. Cette alliance à peu près arrêtée, madame de Polignac demanda à M. de Breteuil de lui confier sa jeune bru.
— Elle gagnera beaucoup, dit-elle, à vivre dans l’intimité des enfans de France; Madame
royale peut la prendre en amitié, et le plus tôt que vous l’enverrez sera le mieux.
Le baron, surpris de cette demande, répondit qu’avant d’y accéder, il convenait de consulter madame de Matignon. Celle-ci dit à son père qu’il était étrange qu’on voulût la séparer si vite de sa fille, etqu’elle n’y consentirait point avant le jour de son mariage. M. deBreteuil rapporta cette décision à la duchesse qui la prit mal, on sequerella d’abord en y mettant des formes, puis avec aigreur. Un certain jour. M. le duc de Polignac passe chez le baron de Breteuil, et en son nom et celui de sa femme, lui rend la parole donnée au sujet de mademoiselle de Matignon. La rupture parut de mauvais augure au ministre; il se hâta d’aller trouver la duchesse pour se plaindre de son procédé, et comme elle s’y maintint, il se leva en disant :
— Au moins, madame, ceci ne nous brouillera pas?
— Non, monsieur, car on ne se brouille qu’avec ses amis.
Ce fut une dernière rudesse dont le minisire s’effraya; mais, en homme de cour, il s’empressa
de communiquer son chagrin au roi et à la reine. LL. MM. le tonsolèrent, et le rassurèrent si bien, qu’il arrêta un autre projet de mariage pour mademoiselle de Matignon avec le fils du duc de Montmorency; on parla d’unir au comte Armand mademoiselle de Sully, qui réunissait les biens immenses des ducs de Sully et de..... ses grands - pères. Cela fit cesser la bouderie entre les deux puissances, et amena la duchesse de Polignac à dire gracieusement au baron de Breteuil :
e
—Monsieur, prenez garde une autre fois de me fâcher, car on se brouille avec ses amis, et vous êtes des miens.
1 I
Sur ces entrefaites, ma première femme de chambre me dit mystérieusement qu’une dame demandait à me voir.
— Quel est son nom?
— Je lui ai fait cette question, et elle m’a ré* pondu qu’elle n’en avait pas.
— C’est une aventurière.
— On dirai tà son accent qu’elïe est de la Gascogne; mais elle est si jolie, si bien mise et a si bon air, qu’on la prendrait pour une femme de qualité*
La curiosité s’empare de moi, et je donne l’ordre qu’on introduise l’inconnue. Elle entre; je vois que ma camériste ne l’a pas flattée.
— Madame, me dit-elle lorsque nous sommes seules, je vous appartiens par M. d’Adhémar; je suis ici pour implorer votre protection , car... j’ai commis un crime.
—• Un crime!..* m’écriai-je.
— Je me suis mal expliquée, reprit-elle froidement. Outragée dans mon honneur, ne pouvant espérer une réparation proportionnée à l’offense, j’ai résolu de punir les coupables, et je l’ai fait sans repentir, car le bon droit était pour moi.
SUR MARIE-ANTOINETTE. 23g
— Qui donc avez-vous tué, madame? m’écriai-je, effrayée de l’énergie de ses paroles.
— Ma belle-mère et son second fils.
Pour toute réponse, je levai les mains au ciel.
— Vous plairait-il de m’entendre, madame? reprit l’inconnue.
Je fis un signe affirmatif.
— Le comte de S... mon mari, est allié du vôtre; il possède dans notre province de grands biens. Je suis la fille d’un gentilhomme très pauvre, mais d’ancienne noblesse; sa généalogie ne dépare pas celle de mon mari. Celui-ci me trouva belle, je lui plus, il m’aima, me le dit; je lui accordai toute ma confiance, et il en abusa.....Un jour, mes onze frères arrivèrent au pont-levis de son château; l’aîné entre seul, accompagné du marquis de Thézan, son ami, et demande le comte de S.....
On les introduisit dans la salle de réception;
le comte y était avec sa mère; mon frère s’adressant au fils de cette dame, lui dit qu’il venait prendre ses ordres pour fixer l’heure de son mariage avec moi. A ces mots, la vieille dame s’em-porte; mon frère vient à elle, la prend respectueusement par la main, la conduit à la fenêtre la plus proche, et lui montrant mes dix autres frères :
— Madame, dit-il, nous sommes onze que M. le comte de S.....doit tuer, s’il veut se dispenser d’épouser notre sœur. Je vous préviens en outre que, si nous succombons, elle aura quatorze cousins-germains qui prendront notre place.
Un tel argument produisit son effet M. le marquis de Thézan, qui jouit d’une haute réputation dans la province, aidant de son influence , mon mariage fut résolu; il se célébra pompeusement Je me crus heureuse ; mon mari me traitait avec tendresse, je le lui rendais, lorsqu’on montant un escalier en spirale de notre château, quelqu’un placé au-dessus de moi jeta une lettre et disparut. Je n’ai jamais pu savoir qui c’était Cette
1SUR MA TJ E-A NTO WETTE. 24 1
lettre, écrite par ma belle-mère, était adressée à son second fils, lieutenant-colonel au régiment de V.... la voici en original :
w î <■. ■ . ' '
« Cher enfant, notre honte est consommée;
» votre frère a cédé au nombre : d’ailleurs il aime ^ » cette créature; j’attends de vous notre ven-
>geance; vous plaisez à tant de femmes qu’il se-»rait malheureux de ne pas réussir auprès de ikçï » celle-là ; employez tous vos moyens de séduc-;;è »tion pour la perdre, et puis on cassera le ma-
:kà » l iage. Dans tous les cas, nous nous en débarras->w «serons par la flétrissure et le couvent. Arrivez ^ b vite, j’ai hâte de me voir délivrée de cette pé-
» Tonnelle qui occupe une place dont elle est in-» digne. Vous avez un congé, profitez-en.... V. »
Le reste ne contient que choses indifférentes, poursuivit la comtesse de S..... Mon beau-frère était arrivé depuis quatre jours, il me charmait par son amabilité; je le croyais sincère, le misérable... Peut-être aurais-je dû présenter cette pièce 1 mon mari; mais je craignis son emportement, e ne voulus pas le brouiller avec sa mère et son
in. it>
2^2 frère; je patientai, ce fut un tort, néanmoins ma froideur déconcerta tout plan de séduction.
Mon mari avait un procès au parlement d’Aix; son procureur lui manda que son affaire venait d’être mise au rôle, et qu’il était urgent qu’il partit pour cette ville. Je conjurai M. de S.*, de me mener avec lui; U s’y refusa formellement, afin, dit-il, de ne pas mécontenter są mère qui aimait mą société. Je me séparai de mon mari avec une vive émotion.
Quatre jours après, un dimanche au soir, madame la marquise de S..., ma belle-mère, proposa de prendre du thé. C’est une mode anglaise que le voisinage de Marseille et de Bordeaux a introduite dans nos cantons. Nous étions trois, la marquise, mon beau-frère et moi. Jamais celui-ci ne s’était montré plus galant et même plus passionné. Je trouvai au thé un goût étrange; on m’en fit boire une seconde tasse pour m’y familiariser, et elle ne me parut pas meilleure que la première : je refusai les autres. Bientôt ma tête fut lourde, embarrassée, mes idées s’obscur-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 2^5
cirent. Je me fis conduire clans ma chambre, que je ne fermai pas au verrou, selon mon usage depuis que j’étais seule.....
Le lendemain à mon réveil, je fus instruite par instinct de l’attentat commis sur ma personne. Un homme infâme, d’intelligence avec la marquise de S..., m’avait déshonorée. Dans le pre-Îmier moment, je m’abandonnai à un lâche désespoir; je pleurai, je sanglotai, je voulus me détruire. Cela dura peu; je compris qu’un tel crime méritait une punition exemplaire.
I Avant de sortir de ma chambre, j’écrivis à mon frère aîné, et le priai de venir sans retard au château de S... « Apportez vos armes en bon »état, ajoutai-je, vous en aurez besoin : on a une » seconde fois ravi l’honneur â votre sœur! »
Un domestique de confiance porta cette missive, et lorsque je la sus en roule, je descendis. Ala belle-mère n’osa pas me regarder; son digne fils affecta des rires de triomphe, lança des demi-mots.....Je souffrais mille tortures. Un instant je me trouvai seule avec lui :
^44
— Etes-vous homme, lui dis-je, à venir ce soir, à minuit, dans ma chambre?
Son visage témoigna de la surprise.
— Parlez-vous sérieusement? me répondit-il.
— Vous êtes un misérable!
— Je vous adore!
— Qu’a vez-vous fait de moi?
— J’ai été le plus heureux des hommes!
— Ne pas avoir attendu le don de mon cœur 1 m’écriai-je.
Ces paroles le transportèrent; mais il se tut, car la marquise rentra. Cependant je le vis s’approcher d’elle; il lui conta sans doute ce qui s’était passé, et elle aussi parut an comble de la joie.
Mon frère arriva vers le coucher du soleil, on
lui fit bon accueil ; la soirée était superbe, je lui proposai une promenade dans le parterre; le vicomte de S... , pour ne point montrer trop d’empressement, refusa de nous suivre. Dès que je fus seule avec mon frère, je lui révélai le fatal secret, et lui traçai mon plan de vengeance. Il l’approuva de toute l'indignation de son noble caractère. Nous convînmes de nos faits; je le fis loger en face de mon appartement. On soupa, on joua au loto-dauphin, et on se retira à onze heures.
Minuit sonnait, poursuivit la narratrice dont le récit commençait vivement à m’intéresser, lorsque le vicomte de S... heurte légèrement à ma porte. Il entre; je la referme sur lui à double tour, je mets la clef dans ma poche, et tire les verroux. Ces précautions ne letonnent point, et Je voilà qui m’entretient de sa passion.
•— Vous avez usé de violence sur ma personne'! lui dis-je.
— C’est votre faute, madame; je vous aimais
à en perdre la raison. Vos refus constans m’ont déterminé à vous obtenir malgré vous.
— Eh bien ! puisque, de votre propre aveu, ma soeur est innocenté, s’écria mon frère en sortant de la ruelle du lit où il s’était caché, je vais Vous ôter la vie, infâme!
Le vicomte, surpris, recule d’un pas, tiré Son épée ; mais l’adresse et la vigueur incomparables de mon frère ont bientôt décidé la question. Le vicomte, percé de cinq coups, tombe baigné dans son sang. Il demande un confesseur.
— Non! dis-je, tu mourras impénitent de ma main ! Je tenais un couteau, et je l’en frappai au cœur. Cela fait, je me dirige vers Pappartement de ma belle-mère ; elle veillait encore.
— Madame, dis-je, un grand malheur a lieu chez moi! mon frère y a rencontré votre fils, ils se battent.....venez les séparer!
La marquise s’empressa de me suivre à demi vé-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 247
tue. Mon frère était sorti pour faire sèl 1er son cheval ét celui qu’il me destinait. Ma belle-mère,à là vue du cadavre de son fils, pousse des cris horribles,
— C’est vous qui l’avez tué ! lui dis-je; en voici la preuve dans cette lettre écrite de votre main. Vous l’avez poussé à me perdre..... allez le rejoindre, ét quêtant de crimes commis rétombent sur vous !
Alors, avec le fer encore teint dû sang dé mon beau-frère.....
—Assez, madame, assez! m’écriai-je à mon tour en interrompant la comtesse de S... qui n’était alliée que de très loin à M. d’Adhémar ; vous êtes donc des cannibales dans votre pays?
— Nous croyons, madame, qu’une injure faite à l’honneur ne se réparé qu’avec du sang!.... Suivie de mon frère, je me réfugiai d’abord en Espagne. Mon mari accourut ; sa mère, que j’avais mal frappée, vécut assez pour lui tout révéler, et me voici à Paris pour obtenir des lettres de rémission qui me sont dues.
34$
— Il est possible qu’elles vous soient dues, madame; mais quant à moi, je vous refuse mon assistance, car je ne puis approuver qu’un égorge ainsi son beau-frère et sa belle-mère !
— Et mon honneur, madame?
Î t V : !> ' C.J| ’ Yf f Ł-Ł / ' "VX ^’ J í Y ^ T f V H ■ V ' ■ -, - J MIS r ■ ■
— Restait intact. Un crime auquel on ne participe point, et dont on est la victime, ne peut flétrir. Vous vous êtes conduite comme une femme abandonnée de Dieu !
— Cependant j’ai la conscience fort tranquille, madame; dès mon entrée sur la terre d Łspaguę, j’ai obtenu pleine et entière rémission de mes fautes.
Cela dit, la comtesse se leva, et elle me tirait sa révérence, lorsque me reprochant la réception que je lui avais faite :
— Madame, dis-je, je sens néanmoins que je dois vous aider; avez-vous un mémoire?
— Non , madame ; je ne suis pas si folle que
de fournir des armes contre moi : il faut avant d’écrire que je sache comment on me traitera.
La comtesse ne manquait ni d’aplomb, ni d’adresse. J’en parlai à madame de Gram mont, qui s’engoua de ce caractère énergique, et s’employa si bien que madame de S... obtint grâce entière ainsi que son frère; d’autant que le testament de mort de la marquise sa belle-mère vint à l’appui de son assurance, que corroborait victo
rieusement la lettre adressée au vicomte son beau-frère. La comtesse de S... m’a toujours affirmé qu’elle la devait à un lutin ou esprit follet en possession depuis plusieurs siècles de protéger les membres de sa maison.
A ce propos voici ce qu’elle me raconta. 11 v avait dans la famille de Thézan une fortune immense, grand nombre de terres, mais un char-1 rier fort mal eu ordre. Un chicaneur (où n’en rencontre-t-on pas!), qui connaissait le mauvais état de ces archives, se mit en tète au commen-mencement du siècle de disputer au chef de la maison de Thézan un domaine dont il se dit le propriétaire légitime.
Ün procès s’engage : la partie adversé àige qu’on lui oppose l’acte de vente, èt il né śe trouve en aucun lieu. On le cherche, on fouille tous les chartriers, et cette pièce échappe aux investigations les plus minutieuses. Cependant l’instance est poursuivie ; on arrive au plaid ; lé marquis dé Thézan demande des délais, ils lui sont accordés.
Pendant ce temps les vassaux de la terré en litige, qui tous aimaient leur seigneur, font dire des prières, une neuvaine est ouverte, ét on demande au ciel d’éclairer les juges et de faire découvrir le titre de vente. Une nuit, le marquis de Thézan, qui était venu dans cette terre pour en remercier la population , entend ouvrir la porte de sa chambre : on approche, on tire les rideaux du lit. Il regarde , et voit un vieillard vêtu comme on l’était au commencement du
quatorzième siècle, qui lui dit :
« On vous fait un procès injuste : la seigneurie et le domaine utile de cette baronnie vous appartiennent. Un de vos ancêtres, qui vivait en 1320 , l’acheta d’unMauran, noble homme ét
SUR MARIE-ANTOINETTE. $51
i ¿âpitol dé Tholosè-la-Sainte. Je passai Pacte eń ma qualité de tabellion de cette paroisse. Vôtre noble et franc aïeul négligea d’en faire lever une expédition conforme. Vous le trouverez en ori-ginal à La Grasse, dans l’étude de M8 Calidis, qui a hérité de mon étude. C’est grâce aux prières dé bons vassaux qué je Suis sorti dü purgatoire. Au revoir, monsieur lé marquis; mais que cé Soit dans le ciel, et pour cela vivez en bon chré-t tien. >
Le fantôme fit alors le signe de la croix; puis il referma successivement les rideaux du lit, la porte de la chambre, et le bruit de ses pas se
Le marquis fort agité se leva avec le jour, et J1 envoya chercher le curé de la paroisse. Cet ec-1 clésiastique étant venu, M. de Thézan le pria de faire apporter ses anciens registres mortuaires; il les visita attentivement, et découvrit, à l’aide ■ des noms et prénoms qu’il avait retenus, l’épo-i que du décès de ce notaire qui lui était apparu.
^ Il conta alors soii aventure de la nuit au curé, 1^
252 lequel lui répondit qu’il y voyait le doigt de Dieu, et se retira.
Peu de temps après il revint annoncer que la tombe dudit tabellion, placée dans la nef de l’église, avait été violemment ouverte pendant la nuit, car la pierre se montrait brisée et fendue en plusieurs endroits. Le marquis se transporta lui-même sur les lieux et vérifia l’exactitude du fait. Plusieurs notables proposèrent d’ouvrir le caveau ; M. de Thézan y consentit; et, à la surprise générale, on vit une bière disjointe par vétusté, et sur la terre un cadavre vêtu de ses habits d’autrefois. Le marquis reconnut le costume et les traits du tabellion de la veille. On rescella sur la tombe une autre plaque de marbre, et mille messes furent payées par M. de Thézan pour racheter l’âme de l’infortuné tabellion.
Le marquis le meme jour alla à La Grasse ; et, ayant fourni au notaire les renseignemens que lui avait transmis l’ex-ti tul aire, l’acte de vente de messire Aid rie de Mauran de la terre de ... à M. de Thézan, vivant en 1020, fut trouvé parmi
SUK MvntE-ANTOlNFTTE. 5? 55' mie épaisse liasse d’anciennes charles mises ait rebut. Dès lors il n’y eut plus de doute sur le gain du procès, le chicaneur le perdit à l'unanimité. On ajoute que le tabellion défunt revint une seconde fois visiter M. de Thézan , pour lui dire que ses messes l’avaient retiré des flammes temporaires où il souffrait et l’en remercier.
De pareils récits ont couru de tout temps en province comme à Versailles, souvent on leur donnait une grande importance. Chaque famille privilégiée a ses histoires de revcnans, plus ef-frayantes les unes que les autres. Quelquefois chez la bonne duchesse on en racontait qui faisaient dresser les cheveux. M. le comiede Provence avait un vrai talent pour cette sorte de récits, il remportait la palme sur tous ses concur-tens. Veut-on écouter la dernière de ce genre que je lui ai entendu débiter, après un souper d’hiver, au petit Trianon?
« Une nuit, dit-il, semblable à celle-ci,où il tombait une pluie violente mêlée de neige et de grêle, où des coups de vent tourbillonnaient
dans l'air, on entendit sonner à la porte extérieure du château de Ferrais, situé sur le versant de la montagne Noire, du côté du midi et non loin de la ville épiscopale de Saint-Papoul. Des brigands d'une part et de l’autre des compagnies de protestans battaient la campagne, s’emparant de surprise des lieux qu’ils n’auraient pu emporter de vive force ; cela faisait qu’on n’ouvrait pas facilement la nuit aux personnes égarées qui demandaient l’hospitalité.
" On sonna donc à la cloche extérieure du château de Ferrais. Le concierge alla parler à celui qui désirait entrer; puis il se rendit dans la salle, où le châtelain, son fils et sa fille passaient joyeusement la veillée à chanter des pastourelles, à lire à haute voix des historiais de chevalerie et à boire d’un hypocras chaud et fortement épicé.
» — Sire, dit-il, un pauvre pèlerin, de retour de la Terre-Sainte, demande le coucher.
>-_ A-t-il dit son nom ?
« -^ Il veut le taire jusqu’à demain
SÛR MARIE-ANTOINETTE. 255
»— Eh bien! il n’entrera que quand il se sera fait connaître.
*
» — Monsieur, dit la baronne, c’est un Romieu (un pèlerin); Dieu nous punira du déni de charité.
o —• Oh! maman, fit la hère damoiselle, si c’était un noble chevalier, il tiendrait à honneur de sę faire connaître. Je gage que c’est un manant, un vilain; qu’il aille coucher au village.
» — D’ailleurs, reprit le seigneur, c’est peut-être un émissaire des voleurs et routiers voisins ; je le repousse.
» Le concierge alla rapporter cette réponse par la lucarne; et le pèlerin, poussant un profond soupir, dit d’une voix mourante :
-
» — Demain il ne sera plus temps; le froid a gagné mon cœur, et l’ouragan redouble de furie.
-
• En effet, on entendit des rugissemens terri-bles : les arbres se brisaient, des quartiers de roche tombaient de la montagne. C’était une de
ces convulsions puissantes de la nature auxquelles rien ne résiste; puis à ce bruit se mêlaient des cris, des sons discordans, des imprécations de rage, des éclats de rire sataniques ; et plus d’une fois dans le salon du châtelain l’écho apporta des paroles de menace. On se signa , on récita l’évangile de saint Jean.
»Le lendemain, au point du jour, à l’ouverture du pont-levis, on trouva étendu sur la terre un beau jeune homme vêtu d’une tunique et d’un chaperon de pèlerin. 11 avait en outre près de lui le bourdon, le rosaire et la gourde. On espéra qu’il n’était qu’évanoui; mais, hélas! la mort l’avait frappé. On le transporta dans une chambre basse du château; et la baronne de Ferrais, pieuse dame, déplorant la dureté de son mari, vint prier auprès du cadavre.
«La douleur de cette digne femme redoubla d’intensité lorsque dans ce corps défunt elle reconnut son propre neveu, le fils de sa sœur chérie. Les papiers que l’on relira de son sein achevèrent de confirmer ce malheur. Lejeune homme revenait de la Palestine, où l’avait appelé lac-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 237 complissement d’un vœu. Le baron de Ferrais, son fils et sa fille, éprouvèrent alors un vif repentir. La belle Mahaud surtout se montra inconsolable. Ce cousin lui avait été fiancé, et même avant son départ il s’était fait entre eux un échange de leurs anneaux respectifs.
* Le chagrin de la damoiselle n’eut pas de bornes : elle s’emporta jusqu’au blasphème, maudit les anges, les saints, et se dévoua elle et sa famille aux esprits infernaux.
-
• Comme le froid était piquant, on résolut de retarder l’ensevelissement du jeune homme, afin d’avoir le loisir d’inviter à ses funérailles tous les seigneurs des environs. La nuit prochaine arriva. Mahaud de Ferrais quitta de bonne heure sa famille pour aller pleurer sans témoins son fiancé. Elle se promena à grands pas dans sa chambre, lorsque l’on frappa trois coups, répétés autant de fois.
-
• Elle tressaillit et néanmoins ouvrit la porte. Quel fut son effroi! le pèlerin défunt s’offrit debout devant elle.
258 SOUVENIRS
» — Ne crains rien, dit-il. On a eu pitié de ta douleur. Inexistence m’est rendue, non complètement, mais en partie. Je viendrai chaque nuit passer une heure avec toi, et plus tard tu sauras par quel moyen tu pourras me rendre tout-à-fait à la vie.
» Cette explication, en diminuant la frayeur de Mahaud, réveilla son amour. Bientôt, plus hardie , elle osa toucher la main de son amant. Cette main était presque glacée. Les traits du jeune homme avaient sous leur pâleur l’immobilité de la mort, les paroles sortaient lentement de ses lèvres. Ce n’était plus un cadavre, et pourtant la damoiselle ne reconnaissait point en lui un être vivant.
» Néanmoins elle s’accoutuma à cet aspect. L’heure écoulée, son amant partit. Elle demeura vivement agitée, bien que satisfaite, mais surtout déterminée à garder le silence sur cet événement extraordinaire.
» Le lendemain on ne retrouva plus le cadavre, malgré les plus minutieuses recherches. Qu’é-
SUK MARIE-ANTOINETTF. 2 5$
tait-il devenu? qui l’avait enlevé? On en accusa ses parens, ses amis, les ennemis du baron de Ferrais, et même les sorciers du pic de Noi e, que l’on voit danser sur cette cime élevée les nuits de Noël, de Pâques, de la Saint-Jean et de la Toussaint. Quoi qu’il en soit, la trace de ses dépouilles fut perdue, et l’on cessa de s’en occuper.
» —Mon sang, dit-il,s’est coagulé pendant cette nuit funeste où j’expirais glacé de froid à la porte du château, tandis que toi, ton père et ton frère vous vous chauffiez à un bon feu.
» — Ah! ne me rappelle pas cette soirée ! Mais quoi ! mes caresses ne peuvent-elles ramener la chaleur dans ton sein ?
»— Non : il faut.....
» Il s’arrêta.
S 6o SOU VÊM lis
» — Parle sans crainte.
» — Du sang humain.
» — Du sang !
» Et Mahaud frissonna.
»—Oui, du sang... mais n’importe lequel, quanti ce serait celui d’un malfaiteur.
» — Ecoute, reprit la jeune fille, je suis coupable envers toi, et pour réparer ma faute j’aurai du courage... Il y a dans la prison du château un protestant que l’on veut envoyer à Toulouse : un hérétique, c’est moins qu’un homme; je tenterai.., Oh! je ne le pourrai jamais !
-
» — Allons-y ensemble. 11 dépend de toi de me rendre à l’existence, et tu hésites!
-
# Le pèlerin usa de tant d’adresse qu’il fit naître la cruauté dans le sein de cette infortunée. Il lui procura un poignard; elle alla chercher la dou-
ble clef du cachot, que sou père gardait, et la troisième nuit tous deux descendirent dans la prison où était détenu le captif II dormait... Mahaud, poussée par une inspiration infernale, le frappa au cœur : le sang jaillit à flots...
»—Retire-toi, lui dit le pèlerin, laisse-moi seul. Je te rejoindrai demain à l'heure accoutumée.
»Mahaud s’éloigna délirante , accablée de son i« nouveau crime. Elle aurait voulu prier, mais elle ne le put; il semblait que le ciel I eût repoussée.
K » L’assassinat commis passa pour un suicide. Le
corps du protestant fut jeté à la voirie en punition de ce qu’il avait attenté à ses jours; on ly traîna avec un croc, et ce qui surprit fut de ne point voir son cœur à travers sa poitrine ouverte. Qui avait pu l’en arracher?... Ceci, joint à la disparition du corps du pèlerin , donna matière à d’effrayantes conjectures, mais ne lit |[f point soupçonner la réalité, lai
^ «La nuit suivante le pèlerin vint trouver Ma-
F
haud. Il y avait plus de feu dans ses yeux, plus de mouvement dans ses muscles faciaux, dans le jeu de ses lèvres; et tandis que sa maîtresse lui prodiguait d’ardens baisers , elle sentit une vive chaleur à la peau du jeune homme; mais le cœur restait immobile, aucun battement ne trahissait son existence.
»Les plaintes de la jeune fille recommencèrent, et le pèlerin, qui travaillait à la perdition de son âme, hésita long-temps à divulguer la recette certaine qui le rétablirait dans la plénitude de ses forces et de sa vitalité. Enfin, lorsque Ma-haud eut accepté la connaissance des sciences occultes, malfaisantes et coupables, il lui dit :
» — Je n’ai pas de cœur, une bête féroce le dévora pendant la nuit.....
» — Ah! tais-toi, ne me rappelle pas cet affreux moment !
» — Oui, je n’ai plus de cœur ; mais on pourrait m’en donner un.
« — Nous n’avons plus de prisonnier.
SUR MÁRlE-ÂOíINETTE. $63
» — Tu as un frère !
» — Mon frère ! dis-tu, fhàlliëüfèuï !... Mè conseiller un pareil forfait !
» — Je me croyais aime.
» — Je ne te 1 ai que trop prouve.
» — Et quelle est cette preuve ?
* — Ma patience à tecouter, lorsque je devrais te fuir.
» — Adieu !
» Il tourna ses pas vers la porte.
» — Où vas-tu ? lili demanda Mahaüd d’une voix affaiblie.
» — Au lieu d’où je suis sorti pour venir à toi; et tu ne me verras plus, car on ne le quitte pas deux fois.
564 SOUVENIRS
» Il revint... Une discussion s’engagea ; elle fut terrible, impie. Un démon entraîna une jeune fille dans le dernier degré de la perversité ; il l’arma encore du poignard sacrilège; il lui infusa dans Pâme la rage de Ten fer, et la conduisit vers la chambre où son frère était plongé en un sommeil léthargique. Comme ils en approchaient, une figure apparut, pâle, sanglante, ayant la poitrine déchirée... Mahaud reconnaît le prisonnier égorgé ; elle frémit, recule, et le monstre qui la dirige frissonne aussi.
» — Avance ! dit-il.
» — Ne vois-tu pas ?
» — Avance....
» —Je ne puis; mais toi...
» — Je suis sans forces; d’ailleurs, cette tâche est la tienne.
■1 ■ ■ ■ •- i. i c \ / ¿anlo í ni? v ■■ ■ r ■ '
SUR MARIK-4NT0TNKTTE. sÓO ner; il y a quelque chose de miraculeux dans toyt ceci... Dieu protège celui que j allais immoler.
» Une heure s'écoula ainsi. Mahaud, enfin, entraînée par sa passion insensée , marche résolument vers le spectre, et lui recule à mesure qu’elle avance. Néanmoins elle atteint le seuil de la porte; la clef est dans la serrure, elle la tourne,les deuxbattanss’ouvrent,et elle voit...*
Monsieur, comte de Provence, en était là de son récit, lorsqu'on annonça le roi. Louis XVI avait peu de goût pour ces sortes de contes; il disait qu’ils apprenaient à tourner en dérision les choses saintes; aussi Monsieur se tut. Plus tard, il ne recommença pas, et j’avoue que j’ai eu souvent la folle envie de lui écrire pour lui demander la lin de sa narration diabolique.
La cour se divertissait de son mieux; la reine seule ne pouvait se livrer aux plaisirs qu’à la dérobée, occupée quelle était par une multitude d’affaires; on s’adressait à cette princesse de tous les coins du royaume et même de l’étranger, et
ceux qui là forçaient d’agir pour eux désifaiêôt qu’elle cherchât à s’immiscer aux intérêts de l’État.
Tant d’injustices lui rendaient la vie désagréable ; on essayait aussi à enlever à Marie-Antoinette l’affection du roi. Nous étions un soir au jeu, et M. de Beauvau passant devant moi, me dit î
— Regardez donc ce manège !
Une nouvelle mariée, rayonnante de jeunesse et de fraîcheur, se tenait en contemplation devant le portrait du roi, de manière à attirer sur elle l’attention de toute l’assemblée. Parfois elle baissait les yeux et poussait de profonds soupirs, puis elle recommençait à admirer les traits ouverts du monarque.
Pendant ce temps, des personnes de sa famille allaient çà et là , levant les épaules, ou affectant un air affligé, indigné, suivant les rôles qu’On s’était distribués.
¿uoí su 9®39^nna 91199 é4ïfiêê97r<s^ ;¿9i¡£n£b ,
Si réellement Cette jeune femme eût été àt-
SUR MARIE-ANTOINETTE. 267
teinte d’une passion malheureuse pour le roi, elle l’aurait cachée, au lieu de lui donner un tel éclat ; mais la manifester ainsi au milieu de Versailles, en paniers et en tête empanachée, ce n’était pas moins odieux que ridicule.
tí ■ . . . ■.
Ce manège de la vicomtesse dura plusieurs jours. Son frère venant faire son service, la reine, par un signe de la main, l’appela près d’elle ; madame de Tavannes était présente :
— Monsieur, dit S. M., je vous conseille de I- prévenir votre sœur que ses simagrées ont lieu en pure perte; le roi, qui s’en aperçoit, les mé-35j prise; quanta moi, elles me font pitié. Donc, ¿ i monsieur, tâchez que cela finisse; sinon toute votre famille sera, dimanche prochain, remerciée de ses services. Nous sommes à mardi, faites-y Í attention !
Ces paroles dures et méritées consternèrent pii 1 le frère; il voulut répondre, mais la reine l’arrêta par un : Allez , monsieur! II partit le cœur navré; c’était le plus ambitieux de tous les courtisans; lui seul avait, dans le principe, ima-
giné cette nouvelle manière d’attirer sur sa sœur l’attention de Louis XVI.
Lorsque le duc de..... se fut retiré, Marie-Antoinette s’adressant à madame de Tavannes, qui n’avait pas perdu un seul mot de l’allocution royale, lui dit en souriant :
— Voilà comme nous sommes sévères pour autrui, et pleins d’indulgence pour nos propres fautes! Je maltraite les amantes du roi, et depuis dix a ns je tolère l’aman £ de la reine. Hélas! reprit-elle d’un ton plus sérieux, c’est que chez celui-ci il n’y a pas de feintes grimaces ; le pauvre homme est bien assez malheureux d’avoir en entier perdu la raison !
L’individu dont parlait S. M. était un conseiller démissionnaire au parlement de Bordeaux, homme bien né, de mœurs pures, de manières affables, qui depuis dix ans adorait la reine. Il en faisait sa divinité , ne lui parla jamais, et tant qu’il le put ne laissa pas passer une journée sans chercher à la voir. On le rencontrait dans les grands appartemens, au passage de Marie-
SUR MAME~ANTOINETTE. 269 Antoinette, à la grille de Trianon , à Marly, à Fontainebleau, partout enfin où il espérait la rencontrer. Lorsque S. M. arrivait, la première personne quelle apercevait, à la descente de voiture, était M. de Castelnau en habit noir complet, poudré à blanc, ce qui faisait mieux ressortir encore l'expression effrayante de ses yeux.
Sa présence était insupportable à la reine, et pourtant jamais cette adorable princesse ne voulut commander à la police de le faire disparaître ; elle le souffrit par bonté d’âme. Il a continué» la poursuivre jusque bien avant dans la révolution ; car je l’ai revu aux Tuileries depuis 1789 à 1792. Mais après le 10 août, je ne sais ce qu’il est devenu: on n’aura pas probablement épargné celui qui était connu sous le titre dawani de la reine.
Lorsque Marie-Antoinette eut, par sa fermeté, déjoué l’intrigue ourdie contre elle avec tant d’art, on lui eu garda un profond ressentiment, et on se plaignit que la reine eût la prétention de vouloir accaparer le roi. Cela se disait en riant, mais ce n'était que pour mieux dissimuler
27O
l’aigreur renfermée dans le reproche. Il y eut d’impudentes récriminations, et on en revint à calomnier Marie-Antoinette.
J’ai déjà nommé à ce sujet le comte Alexandre de Tilly, son page, et qui n’appartenait que très indirectement à l’illustre maison dont il se disait issu. Il était de petite taille, pâle de visage, mais une grâce exquise animait ses traits; un esprit vif, malin, une audace incroyable, et des manières de grand seigneur qu’il conserva même en fréquentant la mauvaise compagnie, lui valurent un instant de succès à la cour.
Parmi ses conquêtes, une qu il afficha particulièrement fut la princesse de Mont..... qui, n’étant plus de la première jeunesse, se livra à cette étourderie. Elle lui donna rendez-vous dans une petite maison où il alla sans la connaître. Il la rencontra plus tard dans un salon de Versailles. Ce fut un coup de théâtre piquant. M. de Tilly racontait cet incident avec beaucoup d’esprit.
La reine lui témoignait une bienveillance di-
gne qui lui était innée, mais jamais elle n’alla plus loin. Comme elle le fit venir plusieurs fois pour le réprimander sur ses extravagances, ses amours désordonnés, ses jeux, ses duels, et cela seulement par bonté, ce beau monsieur en augura que la reine avait du penchant pour lui, et il osa s’en vanter. J’en éprouvai une vive indignation. Quelque temps après je rencontrai M* de Tilly chez madame de Châlons, jolie femme dont on a dit aussi beaucoup de mal, parce qu’on ne veut pas croire que la vertu puisse s’allier à la beauté. Je fis signe au comte de venir me parler.
— Monsieur, lui dis-je, vous tenez des propos qui vous perdront.
Il se récria.
— Avez-vous oublié votre langage d’hier chez madame de Polastron ?
•— Oh ! je vous comprends; j’ai des ennemis, ils me calomnient.
2^2 SOUVENIRS
— On n’a répété que la vérité, vous suivez une route dangereuse, prenez- y garde. Quoi! vous outragez ce que vous devriez vénérer à genoux ! Et dans la pitié qui a porté à payer vos dettes pour empêcher votre déshonneur, vous osez voir de l’amour.....quel nom donner à une telle conduite? Je vous engage d’abord à vous rétracter, et ensuite à vous taire.
L’orgueil et la raison se combattaient visiblement dans le cœur de M. de Tilly; le premier l’emporta, et le jeune pervers, s'armant d’un sourire dédaigneux :
— J’ai eu l’honneur de dire à madame la comtesse que j’ai des ennemis, mais en même temps, ma bouche ne trahira pas la vérité.
—Adieu, monsieur, repartis-je.
Et un signe de tête lui enjoignit de se retirer. Il alla rêver dans un coin du salon, jouer la comédie enfin, et sortit sans avoir parlé à personne. La comtesse de Châlons se prit à dire :
SUR MAlUE-ANTOf NETTE. a?3
— Ce pauvre Tilly a du chagrin depuis quelques jours.
— Ou plutôt, répliquai-je, il étouffe d’amour-propre. C’est un fat dangereux, arrogant , que l’on devrait remettre à sa place»
Ce propos fut écouté avec une attention religieuse; je vis que l’on me comprenait, et j’achevai de m’étendre sur ces chevaliers d’industrie de bonne compagnie, qui, n’ayant rien à perdre, s’exposent à tout, afin de se procurer une importance factice.
Le lendemain, d’assez bonne heure, l’on me remit la lettre suivante, ployée en losange, en forme de poulet, et monstrueusement parfumée de musc. Je dus me tenir à distance pour la lire, et voulant la garder, je la fis désinfecter par un habile chimiste :
« Madame la comtesse ,
» Hier vous me traitâtes avec rigueur, vous me » parûtes établie dans le camp ennemi. Quoi ! je » ne pourrai pas me targuer d’une auguste amitié;
in- i#
a 74
» m’en fera-t-on un crime? Mon Dieu, madame, a que la sagesse est en collet monté par le temps -qui court! elle n’excuse aucune faiblesse, elle > frappe d’anathème les sentimens les plus purs, a Soyez-moi meilleure, je tiens à votre estime, a Cependant, pour la conquérir, je ne puis man-» quer à la vérité; il est malheureux qu’elle vous a déplaise, mais qu’y faire?
-
■ Quoi qu’il en soit, en me mettant à vos ge-anoux, pour vous conjurer de me ménager, je *ne peux qu’être glorieux du motif qui m’attire a votre haine... »
Des formules d’usage terminaient cette épître insolente, monument de suffisance hypocrite qui redoubla mon mépris pour le personnage. Je ne lui fis aucune réponse, je donnai l’ordre que ma porte lui fût fermée, et il apprit, en se voyant banni de la bonne compagnie, qu’un fat n’a pas le droit de flétrir, dans l’intérêt de sa vanité, une auguste princesse respectable à tant de titres.
M. de Tilly, repoussé des maisons honnêtes,
Í vécut jusqu’à la révolution aux dépens des demoiselles de théâtre. Depuis je l’ai perdu de vue (1).
Il y avait de par le monde, et ne valant guère mieux que le comte de Tilly, un certain chevalier de Tone...., qui s’avisa aussi de cherché? à compromettre la reine. On tarda peu à s’en aperce
voir, et il lut congédié durement; c’était un bretailleur de la première force, et même un assassin, si je dois croire ce que M. de Tilly en
1W racontait.
Un soir, a un spectacle des boulevards, le chevalier de Tone... conduisait ? en la compagnie du comte de Tilly, une provinciale belle et de
tracer un portrait si peu flatteur, acheva de se perdre de réputation. Ayant séduit une riche Américaine, il accepta une forte somme des pareos de celle infortunée pour rompre le mariage contracté. Napoléon Bonaparte lui confia des missions secrètes; il lut chassé successivement d’Angleterre et de Prusse, La Restauration , qui le connaissait bien, le traita mal. Il alla en Belgique en 1816; et ayant à Bruxelles signé et employé de fausses lettres de change, il se suicida le 26 décembre de cette
année.
376
mauvaises mœurs. Un homme bien né du pays de cette femme, perdu, ruiné par elle, la rencontrant inopinément, l’apostropha en public, et la fit connaître pour ce qu’elle était. Un duel dut avoir lieu entre l’ancien et le nouveau tenant. On sortit du théâtre, laissant la dame dans un fiacre, et l’on alla le long de profondes excava’ tions qui étaient ouvertes aux environs du Temple. Là, sans témoin, s’engagea un combat furieux. Le provincial, conduit sur le bord du gouffre, est d’abord percé de part en part, il chancelle; aussitôt le chevalier de Tone... s’élance sur lui, le saisit par les bras, et le passe dans l’excavation, où le malheureux trouva deux fois la mort.
Ce trait est horrible. Au reste, le chevalier jouait, perdait, ne payait pas, et proposait le combat au créancier mécontent. Il s’en trouva un, Suisse de naissance, qui lui dit :
— Fripon, payez-moi d’abord, et puis, quand vous serez devenu honnête homme, je vous prêterai le collet ; maintenant notre position n’est
SUR MARIE-ANTOINÉTTÉ. 277
pas égale; vous me devez de l’argent, et je vous > dois des coups de bâton, parce que vous niez la dette.
Le chevalier enrageait; mais l’interlocuteur i-, était un homme de six pieds deux pouces, aux ,. épaules carrées et aux muscles vigoureux ; il fal-} lut souffrir la rude leçon et se taire; car le che-y valier ne pouvait le payer, puisqu’il ne possédait h pas une obole.
Ce beau monsieur avait łamanie desgénéalo-$ gies; il se disait d’aussi antique origine que Ma-thusalem. Un jour, il se fait inviter chez le vieux prince de Beaufremont, où se trouvaient MM. de Monaco et de Tilly. Il arrive, et dès l’abord :
— Prince, dit-il, j’ai l’honneur de vous appartenir, ce qui me rend précieux le bonheur de vous retrouver : les nombreuses alliances...
— Monsieur, interrompit le prince d’un tou ■ grave.
1»
978 SOUVENIRS
— Oui, nous sommes alliés, entre autres, par la famille royale Hyacinthe , Maximilien du Tone... et Yolande de Bourgogne.
— Monsieur!
— Oui, prince, ma maison et la maison de Bourbon ayant plusieurs fois...
—Monsieur ! ! répéta le prince de Beaufremont, étonné de ce flux de paroles, et qui rageait de ne pouvoir trouver jour à en placer une. Alors le prince dé Monaco venant à son aide, et malin d’ailleurs comme un vieux singe, dit au chevalier !
— Par grâce, monsieur, n’ajoutez rien de plus, sinon vous effrayerez M. de Beaufremont au point que sa famille n’osera jamais appartenir à votre maisoji.
Cette épigramme, non comprise, n’aurait pas mis fin à l’éloquence du chevalier, si une nouvelle visite ne fût intervenue. M. de Tone... gagna
SUR MARTE-ANTOÏNETTF. 2"g à l’éloge des pompes de sa maison ąue celle du prince de Beaufremont lui fut fermée dès ce premier jour.
Cependant, au milieu de ses vices et de ses ridicules, il avait de saines idées sur la galanterie. On dit que, se promenant dans le bois de Vin-cennes, des plaintes l’attirèrent dans un fossé; il vit un homme qui battait une femme. Sans s’informer si elle était épouse ou maîtresse, le chevalier tomba sur le personnage à coups de canne, lui brisant les os en répétant toujours : siux genoux de madame, drôle, aux genoux de madame !
Enfin, à trente-sept ans, il mourut laissant sa veuve ruinée et 4oo,ooo fr. de dettes.
Je ne sais pourquoi je parle d’un tel individu; mais il fallait démentir l’une des mille calomnies qui ont poursuivi Marie-Antoinette.
Je me plaignais un jour à ce sujet à la bonne comtesse d’Angivilliers, et elle me répondit par les vers suivans .
28a
J'ai peu connu la cour, mais la crédulité Aiguise ici les traits de la malignité.
Vos oisifs courtisans, que les chagrins dévorent. S’efforcent d’obscurcir les astres qu’ils adorent; Là, si vous en croyez leur regard pénétrant, Tout ministre est un traître,et tout prince un tyran. L’hymen n’est entouré que de feux adultères ; Le frère à ses rivaux est vendu par ses frères ; Et sitôt qu’un grand roi penche vers son déclin, Ou son fils, ou sa femme, ont hâté son destin. Je hais de ces soupçons la barbare imprudence ; Je crois que sur la terre il est quelque innocence; Et mon cœur repoussant ces sentimens cruels. Aime à juger par lui du reste des mortels.
Qui croit toujours le crime en paraît trop capable.
— Les beaux vers! m’écriai-je; à qui en est la gloire ?
— A Voltaire que vous n’aimez pas, ma chère.
— Et que j’aimerais s’il avait toujours écrit sur le même ton. Mais quelle confiance accorder à un impie, qui veut détruire Dieu pour le plus grand avantage du diable?
Madame d’Angivilliers se prit à rire; elle ajouta :
-
— Vous n’auriez pas osé tenir ce langage pendant la vie du grand homme, la frayeur des camouflets littéraires vous en eût empêchée.
-
—- Je ne me suis jamais gênée pour dire ma façon de penser; mais comme j’ai toujours été en dehors de l’atmosphère philosophique, on s’est peu inquiété de mon opinion.
— J’ai été moins heureuse que vous, répliqua-t-elle en soupirant. Lancée dans ce tourbillon, j’ai eu fort à faire pour qu’il ne m’entraînât pas. La fréquentation des gens de lettres met parfois dans d’étranges positions: il faut embrasser leurs querelles, épouser leur parti, sous peine d’être en butte aux satires, aux épigrammes; et puis, ils vous assomment de lectures en vers et en prose, fort amusantes, je n’en disconviens pas; mais cela revient trop souvent.
Et l’excellente comtesse de bâiller à ce seul souvenir.
Madame Marchais était une demoiselle bien née, mais pauvre. Elle épousa un premier valet
s8a SOUVENIRS
de chambre du roi, qui mourut lui laissant une assez belle fortune, que divers héritages augmentèrent. Devenue veuve, elle se livra à la société, reçut beaucoup de monde, et finit par se remarier, après une amourette de vingt ans, avec le comte d’Angivilliers, surintendant des bâtimens du roi.
Celui-ci jouissait de la considération générale; il avait de l’esprit, des connaissances profondes et variées. Il était gracieux, obligeant, et chacun l’aimait. Madame Marchais lui inspira une passion constante, et cependant quel esprit bizarre que le sien ! D'abord elle faisait de la nuit le jour; elle n’était visible que le soir; alors elle recevait la meilleure compagnie, qui se pressait en foule dans ses salons jusqu’à cinq heures du matin.
Sa maison, du vestibule à sa chambre à coucher, était ornée d’une profusion incroyable de fleurs, de plantes rares. On eût dit une forêt enchantée, odoriférante. Sous une voûte d’orangers, de myrtes et de productions des Tropiques, madame Marchais était à demi couchée sur des coussins de satin blanc, couverte elle-même de
SOR MARÏE^AWTOÏNETTE. 285 fleurs, de plumes, de dentelles, de nuages, de mousseline.
La charge de son amant, et ensuite son mari, lui facilitait les moyens de se livrer à ces goûts, agréables d’ailleurs. Il lui revenait une quantité de fruits, pêches, melons, fraises, raisins, figues, le tout exquis, dont elle faisait de fréquens cadeaux à ses connaissances. On l’en avait surnommée Pomone, et c’est sous cette qualification que madame du Défiant, la maréchale de Luxembourg, la duchesse de Choiseul, la princesse de Beauvau, la marquise deMirepoix, mesdames de Grammont, d’Aubeterre et autres, la désignaient dans leurs correspondances et causeries.
Elle passait au bain une partie du jour, et quel bain ! coupé de lait ou d’essence de rose. Elle s’habillait avec un luxe de peu dégoût qui frisait le ridicule. Très petite, fort mignonne, elle avait de magnifiques cheveux traînant à terre, et chaque fois qu’une personne de distinction venait voir la comtesse d’Angivilliers, le hasard ne manquait jamais d’amener un bris de peigne ou de coiffe. Si bien que tout-à-coup la maîtresse
S84 SOUVENIRS
de la maison disparaissait en quelque sorte sous le voile naturel qui l’enveloppait.
Maintenant que j’ai fait la part du diable, je vais faire celle de Dieu. Sous ces dehors presque ridicules, on rencontrait une âme chaleureuse, active, bienfaisante, toujours portée à secourir les infortunés. Point médisante ni railleuse, madame d’Angivilliers trouvait toujours le bon coté des gens, et elle le faisait valoir. Un soir, le chevalier de Chateleux, qu’elle voyait beaucoup,impatienté de l’entendre louer un sot et maussade personnage, lui dit brusquement :
— Je gage, madame, qu’en cas de besoin, vous avez assez médité sur les perfections de Lucifer, pour entamer de prime-abord son panégyrique ?
— Ne croyez pas plaisanter, répondit-elle ; sa constance à lutter contre Dieu n’est-elle pas admirable? D’ailleurs, il est si malheureux que je le plains.
S'agissait-il de irai ter une question d’art ou
SUR MARIE-ANTOINETTE» 385 de littérature, elle laissait d’abord parler les autres, puis elle descendait dans l’arène, et par des traits hardis, des définitions brèves et piquantes, elle nous sur prenait et nous éclairait tous.Elle avait pour conter un talent consommé ; sa bouche donnait du prix à la moindre historiette, et lorsqu’il courait à Versailles quelque anecdote croustillante, on disait: Ce sera bon à entendre répéter par madatne d^ngivilliers.
A la cour, où l’on est moqueur par habitude, on tournait en ridicule cette excellente femme; et pourtant elle était de toutes les parties, et même des réunions d’où son rang l’excluait. Je sais d’elle des traits charmans ; entre autres je citerai celui-ci : j’ai dit qu’elle ne sortait du bain ou de son lit que vers le soir. Un matin j’arrive à une heure chez elle ; comme intime j’étais reçue en tout temps.
— Madame est sortie, me dit mademoiselle Signo!, sa première femme, personnage important; mais si madame la comtesse veut l’attendre ....
286 SOUVENIRS
J’y consentis, voulant parler à mon amie d’un projet de bienfaisance. Elle rentra peu d’instans après, essoufflée, éblouie par la lumière du soleil qu’elle no voyait jamais.
— D’où venez-vous, coureuse? lui dis-je.
— Oh! ne m’en parlez pas, c’est une histoire, une de ces impériosités qui ne souffrent aucun délai. Figurez-vous une famille de gentilshommes, lé père, la mère, six enfans, deux tantes, et tout cela sans feu, sans alimens par le temps qu’il fait; des pauvres honteux enfin. Leur envoyer un laquais c’eût été blesser leur fierté. Si pourtant je leur avais su du pain , je n’y serais allée que ce soir;mais ils en manquaient, et j’ai oublié l’heure.
Ce mot peint toute la bonté de son âme.
Madame d’Angivilliers voyait, dans les premiers temps, le comte de Saint-Germain, le thaumaturge ; il ne sortait pas de chez elle, et y tenait le dé de la conversation. Elle a prétendu
SUR MARIE-ANTOINETTE. 287 qu’il est toujours resté en correspondance avec elle, je crois que clans cette assurance il y a de la vanité d’amitié. Aux approches de la révolution, je la vis moins, à cause de son intimité avec M. Chanderlos de Laclos, auteur des Liaisons Dangereuses. C’était un des ennemis de la reine, et l'une des trompettes payées par le Palais-Royal. On lui savait de l’esprit, mais il n’en montrait guère. Il parlait peu, froidement, et ne brillait que dans ses écrits. Du reste, homme de tête, d’exécution, il est un de ceux qui ont fait le plus de mal à la famille royale. Je l’ai su à temps; aussi ne pouvais-je le voir qu’avec chagrin et indignation.
La révolution consommée, et moi retirée à Evêquemont, où je suis encore, je n’ai plus rencontré la baronne d’Angivilliers, qui a terminé sa vie à Versailles peu de temps après la lin de la terreur. Son mari émigra en 1792, et décéda à l’étranger. Ainsi se sont rompus presque tous les anneaux d’une société délicieuse, au sein de laquelle j’espérais vieillir et mourir. Que les révolutions sont funestes ! Elles brisent des habitudes u’on voudrait ne pas voir finir; elles boule-
versent la société. Je ne le répéterai jamais assez i la meilleure est encore détestable pour le sage, et surtout pour une vieille royaliste telle que moi.
^va^ V2®®9Qsa^3àaa3»
INTRIGUES DE COUR. ÿ
Vers le milieu de 1786, la reine nie dit de manière à n’être entendue de personne :
— Demandez-moi une audience particulière et subite.
Dès que je vis que nous avions des curieux à portée de nous entendre, je formulai la prière d’être reçue en secret. Marie- A11 toi nette, avec sa grâce habituelle, me fit signe de la suivre dans son cabinet, et dès que j’eus refermé la porte :
lit.
— Vous êtes intriguée?me dit-elle.
— J’ai l’extrême désir de servir la reine.
— Ce ne sera pas elle qui vous aura directement de la reconnaissance, mais le roi. Il veut que vous trouviez un jeune homme de bonne maison, spirituel, brave, se présentant bien, et qui ne craigne pas les voyages. Ce n’est pas qu’on veuille l’envoyer outre-mer; maisilaura quelques postes à franchir, des observations à faire. 11 le faut prudent surtout. Lorsque vous aurez trouvé ce phénix, je vous remettrai les instructions nécessaires. Maintenant rentrons, le peu de minutes que je passe avec vous doivent sembler longues à ceux qui nous attendent.
En effet, lorsque nous reparûmes, tous les regards se portèrent rapidement de moi à la reine; et comme je me taisais , le bailli de Crus-sol me dit en passant :
-— Vous paraissez ployer sous le faix d’une confidence auguste.
— Ou bien je cède à une envie irrésistible de dormir, ce qui n’est pas la même chose.
SUR MARIE-ANTOINETTE. 2g 1
Le lendemain, madame de Polignac me dit en riant :
— Depuis hier, vous avez fourni matière à une foule de conjectures.
Et par cette phrase détournée, je devinai dans la duchesse l’envie de connaître ma conversation avec la reine. A la cour, peu de chose éveille la curiosité. * ł
Cependant je songeai au moyen de remplir au plus vite les intentions de la reine. Comme je m’en occupais, on annonça le vicomte de Vil..., un proche parent de mon mari. Je battis des mains pour manifester ma joie, car du premier coup j’avais rencontré le phénix : vingt-six ans, une tournure noble et une naissance à l’avenant; de grands yeux fendus en amande, noirs et à fleur de tête, de l’esprit, une physionomie gracieuse et distinguée, l’usage du grand monde, l’aplomb, et par-dessus tout une envie démesurée défaire son chemin utilement.
Tel était le vicomte de ViL... Je le question-
39*
nai, il me répondit d’une manière satisfaisante; et lorsque je lui eus révélé ce que la reine m’avait communiqué, il parut ravi.
Je n’eus rien de plus pressé que de le conduire à Versailles. Je lui indiquai où il se placerait à la chapelle, ainsi que le poste qu’il occuperait au diner de LL. MM» (c’était un dimanche), et j’allai annoncer à la reine que je lui amenais le phénix. Elle voulut le voir, j’avais prévenu son désir. Marie-Antoinette aperçut mon protégé à la chapelle et au diner, elle me dit :
— Votre protégé ira à Naples, il passera par Rome, y rendra ses devoirs à M. le cardinal de Bernis, puis poursuivra son chemin. A Naples, il se fera présenter par notre ambassadeur, et ensuite saisira l’occasion de remettre à la reine, ma soeur, le paquet que voici. Cela terminé, il remontera dans sa chaise, parcourra l’Italie en amateur: il importe surtout qu’on ne lui soupçonne pas un but diplomatique. Recommandez-lui la prudence, il court danger de mort s’il en manque. Voici en outre de quoi fournir aux frais du voyage.
SUR MAR lE-ANTOl NETTE. 29 □
Il y avait clans le porte-feuille qui accompagna la dépêche royale 100,000 livres de bonnes valeurs. A la somptuosité de la récompense, ou jugeait facilement l’importance de la mission. J’assurai à S. M. que notre cousin se conformerait à tout ce qu’elle prescrirait. Lui partit le lendemain.
Il avait pris l’engagement de m’écrire de Lyon, Turin, Florence, Rome et Naples. Il l’oublia, j’en fus fâchée. Son cœur, pensai-je, vaut mieux sans doute que sa mémoire.
Peu de temps après, la reine se penchant vers moi, me dit :
— Le vicomte de Vil.... a passé à Rome; le bon cardinal, qui l’a vu, fait l’éloge de son caractère et de sa tenue, il présage qu’il ira loin. En effet, s’il continue, il a une belle carrière devant lui.
Un mois s’écoula... Un jeudi, j’entendis chez la reine, monseigneur le cardinal de La Rochefoucauld dire à M. de Roquelaure, évêque de Sentis, premier aumônier du roi :
— Le cardinal de Bernis me mande un assassinat affreux commis à Naples sur un gentilhomme français. Le vicomte de Vil...., à la sortie du théâtre de Saint-Charles, est tombé mort, frappé de sept coups de stylet empoisonné.
En écoutant ce récit, le sang se glaça dans mes veines, je pus à peine porter un regard éteint vers la reine, et l’expression de sa physionomie m’expliqua le motif de la contrainte quelle avait depuis quelques jours vis-à-vis de mot
Lorsque j’eus repris un peu de forces, je demandai à M. le cardinal de La Rochefodèàult s’il connaissait la cause de ce meurtre. Il me répondit qu’on l’ignorait, que cette affaire criminelle était enveloppée de mystère, et que M. de Bernis se bornait à raconter le fait.
Ne pouvant me maîtriser davantage je fis part dema douleur à madame la princesse de Chimay;
sur son approbation empressée, je rentrai dans mon appartement. Dès que je fus seule, jeme mis à réfléchir sur la fatalité qui avait présidé à cette catastrophe, je me la reprochais comme si j’en
eusse été la cause directe, je craignais que la témérité du comte ne l’eut provoquée.
Deux heures après, un valet de pied de la reine m’apporta un billet de S. M. ainsi conçu :
« Chère comtesse, je savais depuis dimanche » le malheur affreux qui a frappé votre parent. » Jugez de mes regrets en songeant que j’ai en-»voyé ce gentilhomme à la mort!.....Dieu m’est » témoin queje lui avais donné tous les avis » propres à le mettre en garde contre les dangers » de sa mission; s’il s’y était conformé, nous l’au-» rions revu plein de vie et en mesure d’obtenir » de hautes récompenses. La télé lui a tourné dès » qu’il a eu misie pied à Naples, il s’est rendu le b point de mire de toute la cour ; d’autres extra-«vagances se sont jointes à celle-là. Enfin il a » provoqué avec arrogance un ennemi puissant «et redoutable. Un crime en a été la consé-» quence; le vicomte de Vil...* a été immolé à la «vengeance de cet homme, et nous demande-* rions vainement satisfaction de cet horrible as-»sassinat. On s’appuierait pour la refuser sur
» les mille Mies auxquelles s’est livrée la victime * en l’espace de trois ou quatre semaines. Elles «lui ont fait une multitude d’envieux, et dans • ce nombre, comment désigner le vrai cou-» pable?
» Je prends une part bien vive à votre douleur, » croyez à la sincérité de la mienne ; ce qui doit * nous consoler, c’est notre innocence.
» Adieu, revenez le plus tôt possible. Surtout ne * m’accusez pas, ne vous réunissez pas à ceux » qui me rendent responsable de tous leurs mal-» heurs; car voilà où j’en suis réduite... »
Cette lettre me calma; néanmoins je ne me tins pas tranquille; j’envoyai les détails de la mort du vicomte à M. d’Adhémar. Il en écrivit à Naples, à Rome, et ne reçut aucune réponse satisfaisante. Jamais nous n’avons pu réussir à obtenir d’autres lumières sur ce funeste événement.
La reine me témoigna, dès ce moment, un
SUR MARIE-ANTOINETTE. 597 surcroît de bienveillance, mais elle ne me parla plus de la mort de mon malheureux parent.
II y eut vers cette époque une histoire bien simple, et dont cependant on parla beaucoup. Les bonnes actions frappent, intéressent, en raison de leur rareté. Il existait de par le monde, un ex-fermier-général prodigieusement riche, aimant les arts: il avait un beau cabinet de tableaux et une somptueuse bibliothèque. Son hôtel était un palais; mais un bonheur lui manquait, celui d’être père. Enfin il alla un jour avec sa femme aux Enfans-Trouvés; ils choisirent une petite fille blonde, rose, l’élevèrent, et lui donnèrent une brillante éducation. Lorsqu’elle fut en âge de s’établir, ils la marièrent richement à un M. de La-ville, neveu, je crois, de l’abbé de ce nom, qui, ayant été pendant un demi-siècle premier commis aux Affaires Étrangères, mourut évêque je ne sais où.
Madame de Laville n’avait pas cessé de se montrer reconnaissante des bienfaits de ses pareos d’adoption. La femme du financier ayant succombé à une maladie dangereuse, son mari,
M. Cholan, après les premiers momens donnés à la douleur, vint trouver sa fille. Il portait une cassette contenant en or ou billets de caisse une somme de cent mille écus. C’était le produit de la vente de tout ce qui avait appartenu à sa femme, pierreries, diamans, perles, dentelles, vaisselle plate, etc., qu’elle laissait par testament à madame de Laville, en dehors de sa dot, considérable par elle-même.
La jeune femme demanda à son bienfaiteur si cette somme entrait de droit dans la communauté, ou si elle en avait la libre disposition : il lui répondît qu’elle en était absolument maîtresse. Madame de Laville, heureuse de cette assurance , alla aussitôt aux En fan s-Tro uvés, et fit don à l’hospice des cent mille écus, avec la clause que les revenus serviraient à doter chaque année deux filles prises dans le même établissement.
La générosité de cette fondation, l’absence de toute vanité qui y présida, valurent à madame de Laville les applaudissemens du public. La reine Payant rencontrée auRanelagh, la complimenta sur son modeste désintéressement.
Le comte de Castellano, en perdant au jeu douze cent mille livres, contre les sieurs Dulau et Dudrencau, deux joueurs patentés, n’obtint pas la meme approbation. Ce malheureux seigneur, mari et père, ne pouvant faire honneur à une dette aussi considérable, partit nuitamment sans qu’on sût où il allait, après avoir écrit à sa famille pour quelle s’acquittât de la somme perdue. C’est un funeste préjugé que celui qui impose une exactitude de solde si rigoureuse envers, la plupart du temps, des escrocs et des chevaliers d’industrie.
On parlait de l’infortune dc M. de Castellano, lorsque tout-à-coup survint une diversion. Il existait un certain abbé Maury, homme hardi, téméraire , plein de vanité et de jactance; mais spirituel, éloquent, habile théologien, qui s’était fait une réputation d’orateur en prononçant devant l’Académie Française un panégyrique de saint Louis: un discours de cet abbé sur saint Vincent de Paul avait également concouru à sa renommée. Cependant on ne soupçonnait point encore le vol élevé qu’il devait prendre plus tard.
Le nouveau duc d’Orléans, voulant user du droit de catafalque qui lui appartenait, relativement à la mort de son père, en fit faire un très mesquin, pauvre d’ornemens, de luminaire, en un mot, au meilleur marché possible; car il déploya en cette circonstance son caractère avide et parcimonieux. Il choisit néanmoins l’orateur à la mode, M. l’abbé Maury, pour qu’il prononçât l’oraison funèbre de S. A. S. le duc d’Orléans, récemment décédé.
L’abbé composa son discours, et le lut à madame de Montesson, qui le trouva admirable : cela devait être, car il parlait d’elle comme de la femme légitime du feu prince; puis il prit l’avis de M. Fontaine, secrétaire de comman-demens de S. A. S. monseigneur le duc d’Orléans. Ici le paragraphe ne fut pas approuvé : on lui demanda instamment de le retrancher; il n’en fit rien, malgré sa promesse du contraire.
Le 14 février, la cérémonie funèbre eut lieu à Notre-Dame; ni mon frère, ni ma sœur, ni monseigneur le comte d’Artois, ni ses fils n’y assistèrent; une disposition d’étiquette contra-
^ riant leur bonne volonté. Le prince de Condé,
•j, pris par la lièvre, ne put quitter son lit;
M. le prince de Conti, qui avait affiché de l’indécence de conduite, le jour de la mort du prince, persista à se tenir à l’écart : il ne vint
donc à Notre-Dame que le nouveau duc d’Or-
rét
I léans, ses fils, monseigneur le duc de Bour-11® 7 ’ D
bon son beau-frère, et monseigneur le duc d’Enghien son cousin : je ne sais pourquoi
M. le duc de Penthièvre ne s’y montra pas
non plus.
th-¡B! àfe iilpit ®>
mté:® iW )0¿’
.4® 0^ >
L’abbé Maury monta en chaire ; la foule était nombreuse : l’orateur produisit une impression profonde. Son éloge historique était divisé en deux parties : l’une rehaussait les vertus privées de S. A. S., l’autre ses vertus publiques. Le premier point de cette oraison, lait sur des mémoires suspects , quoique fournis par des commensaux de la maison d’Orléans, surprit les auditeurs, à cause de choses neuves, peu croyables qu’il reproduisait. Les anecdotes, les traits manquaient de vérité, et étaient peu en rapport avec l’avarice et des goûts peu louables qu’on reprochait justement «u défunt.
On ne fut guère plus satisfait de la seconde partie du discours, destinée à célébrer les qualités guerrières et extérieures du prince. Jamais le duc d'Orléans n’avait passé pour un héros, et la bataille d’Hastenbeck, dont on lui attribuait la gloire, aurait été perdue si on l’eût écouté. Aussi l’étonnement augmenta lorsque l’abbé Maury, avec un aplomb imperturbable, raconta que le prince Henri de Prusse, frère du grand roi Frédéric II, s’était écrié à la suite de plusieurs conversations avec S. A. S. :
« La France se plaint à tort de manquer de généraux, dès qu’elle possède monseigneur le duc d’Orléans! »
Le clergé blâma le passage relatif à l’inoculation approuvée par l’orateur; mais le mécontentement se manifesta plus ouvertement, lors-qu’en présence des abbés de Saint-Albin, et de Saint-Far, l’abbé Maury, après avoir condamné les amours coupables du défunt, passa à son mariage avec madame de Montesson, et déchira
le voile jeté sur cette union, par l’exprès commandement de monseigneur l’archevêque de
SÜB MA RIE-ANTOINETTE. JO 3 Paris, qui, sans cela, n’aurait pas consenti à ce qu’il fût question de cette dame.
M. le duc d’Orléans actuel avait passé sa vie à s’humilier devant sa belle-mère; aussi, après le décès de son père, il se vengea de cette soumission forcée, par une foule de mauvais procédés envers madame de Montesson ; il dut donc trouver mauvais qu’on la présentât dans la chaire de vérité comme l’épouse légitime du feu prince.
En sortant de Notre-Dame, il dit qu’il témoignerait sa désapprobation à l’orateur, et que son discours ne serait jamais imprimé; il refusa, d’ailleurs, d’envoyer le cadeau d’usage. L’abbé Maury ne fit qu’en rire; et à dater de ce moment, il se rangea parmi les nombreux ennemis de ce prince.
,1^ i Le discours dura quatre-vingt-quinze minu-?!' tes; l’orateur sut avec un art extréme attacher j? l’attention de l’auditoire, s’en rendre maître, s’en faire écouter avec plaisir.
S. A. S. et ses deux frères les abbés de Saint-Albin et de Saint-Far, nés d'une concubine, con-
nue plus tard sous le titre de madame de Ville-momble, quittèrent l’église furieux. Le premier envoya son chancelier demander le manuscrit, et l’abbé de Maury qui répondit :
— Tout beau, monsieur! mon ouvrage deviendra la propriété de M. le duc d’Orléans lorsqu’il l’aura payé; jusque là, elle restera entre mes mains.
Le chancelier dut repartir avec sa courte honte, et l’abbé se moqua de la lésinerie de monseigneur, qui prétendait disposer du bien d’autrui. Il avait en effet besoin de reunirdes sommes immenses, pour subvenir aux frais de la conspiration qu’il ourdissait, et dans laquelle ses agens enrôlaient, tous les batteurs de pavés, les escrocs, les aigrefins, en un mot cette race hideuse qui pullule dans Paris, et ne vit que du mal qu’elle fait.
M. le duc d’Orléans tira pour son complot un grand parti du malheur arrivé à Beauvais. Un soir, au théâtre de cette ville, un des gardes-du-corps de la compagnie de Noailles qui y était en garnison,s’obstinant, pour mieux voir la pièce
SUR MARIE-AN TOILETTE. 5o5 représentée, à laisser une porte ouverte, le public l’interpella durement. Le garde-du-corps, craignant d’avoir affaire à cette masse turbulente, referma la porte.
Aussitôt ses amis l’entourèrent, et lui dirent qu’il avait déshonoré leur compagnie, et qu’il fallait en avoir raison» On tira au sort pour décider qui se chargera d’insulter le public, afin d’user de représailles. Le dimanche, 26 mars, le garde-du-corps désigné se place aux premières loges, le chapeau sur la tête; et dès que la toile se lève, il est assailli par le cri d’usage : A bas te chapeau! mais il le garde fièrement, et affecte meme de l’enfoncer sur son front.
Les clameurs augmentent ; on signale le gardo du-corps, on le hue. Alors ses camarades s’emparent des issues de la salle, et, l’épée en main, descendent au parterre. Là ils percent des bourgeois désarmés, tandis qu’une autre bande des leurs empêche les victimes de se sauver en escaladant le théâtre ou les balcons; enfin c’est un véritable guet-apens: il y eut un homme tué et vingt de blessés.
L’indignation des habitans de Beauvais fut au comble ; ils prirent les armes, et c’est avec peine qu’on les empêcha d’aller mettre le feu à la caserne des Gardes. La ville députa plusieurs notables à Versailles. M. le duc d’Ayen arriva bientôt après à Beauvais; il ordonna des arrêts, cassa certains gardes, en punit d’autres militairement; mais cela ne satisfît qu’à moitié la population, qui aurait voulu un châtiment plus rigoureux.
A partir de ce jour, la bourgeoisie de Paris et de Versailles prit en haine les gardes-du-corps ; elle leur attribua des forfaits dont ils étaient in-nocens. J’ai entendu M. de Laclos raconter chez la comtesse d’AngiviHiers l’histoire d’un prétendu garde qui, après avoir grièvement insulté une jeune fille dans une rue de Troyes, avait frappé de plusieurs coups d’épée le frère de cette infortunée, parce qu’il lui demandait raison.
Le fait est faux; mais on le rapportait afin d’aigrir les esprits contre cette troupe privilégiée, dont on souhaitait la dissolution. Ce plan ne réussit que trop ; on apprit au château que partout où des gardes se présentaient isolément, ils
SUR MARIE-ANTOINETTE. 507 étaient conspués et insultés. Cette animadversion redoubla à mesure qu’on avançait vers 1789.
Ce fut de cette manière que l’on préluda à la révolution. Nous y touchions, et nul ne s’en doutait; ceux qui devaient y trouver la mort continuaient à mener une vie folle et dissipée. M. de Laborde, ex-premier valet de chambre du roi, fermier-général, homme d’esprit et de goût, musicien consommé, très bon dessinateur, employait des sommes énormes à se faire construire à Mérinville, diocèse de Sens, un jardin anglais, genre nouvellement à la mode.
Le terrain présentait d’abord d’immenses difficultés; plusieurs millions dûrent être dépensés pour donner du mouvement à cette surface plate, creuser des canaux, des vallées, éiever des collines et des montagnes, et tout cela à bras d’hommes. Puis on rapporta de bonne terre, on fit décrire un cours sinueux à la rivière d’Étam-pes; il y avait un endroit où des rochers amoncelés la contraignaient de tomber en cascades bruyantes dans un vaste bassin ; de là, elle s’échappait, calme et limpide, pour aller rouler len-
tement sous un pont qui surprenait par son élévation el sa hardiesse. C’était un composé de quartiers de roches creusées par la nature; ils formaient saillie j et semblaient prêts incessamment à crouler.
Cette manie de jardins anglais gagnait tous nos seigneurs et hommes de finances, chacun avait sa folie. C’était la qualification donnée à ces petits Edens qui ornaient les environs de Paris. Leur description rentre dans la peinture de mœurs modernes que je me suis promis de tracer; je vais donc offrir un aperçu, bien restreint à la vérité, de la Folie-Sainte-J ames.
La maison de la Folie-Sainte-James, décorée et rétablie depuis peu sur les dessins de Bellangé, premier architecte de M. le comte d’Artois, était enjolivée, du côté de la façade principale, d’un péristyle d’ordre ionique. Dans la direction opposée se détachait un perron à deux rampes, dont les extrémités, terminées par des piédestaux , supportaient des lions dans le genre antique, exécutés en marbre bleu-turquin. Ce perron, recouvert par un chapiteau à la façon
SUR MA RIE-ANTOINETTE. OOQ chinoise, dominait les jardins et un délicieux paysage borné sur la droite par le superbe pont de Neuilly, et sur la gauche par le Mont-Valé-rien.
Le jardin offrait, et offre encore, car je ne le crois pas détruit, des sites enchanteurs, pittoresquement coupés par les contours d’une rivière factice , disposée de manière que la Seine semblait en être la continuation. De tous côtés on communiquait par des ponts de pierre ou de bois à plusieurs îles formées par cette rivière.
Au centre de Tune d’elles, nommée île des Mangoliers, parce qu’on y a planté beaucoup de ces arbres venus de la Caroline, surgissait un bosquet orné d’un groupe de marbre blanc représentant Zéphyre et Flore. Trois vases également de marbre, posés sur des fûts de colonne, laissent échapper des jets d’eau. Sur la droite de cette île, la rivière forme une espèce de lac, au milieu duquel s’élève un kiosque chinois décoré de bambous; on ne peut y arriver qu’en bateau. Je ne terminerais pas si je voulais décrire partiellement toutes les beautés que renfermait ce
lieu de délices; il n’était surpassé que par ta Folie-Chartres à Mousseau, construite avec une ma* gnifîcence royale.
Mais revenons à Versailles.
Pendant les soirées d’été, la musique des divers régimens des gardes donnait vers minuit des concerts sur la terrasse du côté de l’orangerie. Souvent la reine et la société Polignac, les hommes én lévite, lés femmes en robes de mousseline, venaient écouter cette délicieuse har-monie.
Un soir entre autres, Marie-Antoinette et Madame, se trouvant éloignées du reste de la société , et ayant à leur côté un garde-du-corps , M.de Saint-Léger, elles lui firent de ces questions de lieu et de circonstance auxquelles un homme bien élevé répond avec brièveté et politesse; il se maintint donc d’abord dans un laconisme convenable; mais ayant reconnu la reine, il crut devoir profiter de cette occasion pour parler de ses services et solliciter avec importunité la protection des princesses qui gardaient Fin-
SUK MARIE-ANTOINETTE. 511 cogni to. Fatiguées enfin des instances de M. de Saint-Léger, elles s’éloignèrent en se plaignant de son peu de mesure et de tact. Le pauvre diablę en fut désespéré, et le lendemain il eut encore à essuyer les railleries de scs camarades; de plus, il subit les arrêts, car Madame, moins indulgente que la reine, fit connaître son indiscrétion au chef de sa compagnie.
Lorsque la duchesse de Polignac accoucha de son fils, le comte Jules, elle était à l’apogée de sa faveur, et par conséquent l’enfant naquit porphy-rogénète, c’est-à-dire dans la pourpre. M. le comte d’Artois, dès le jour de sa naissance, lui voua une tendre alfection, et chacun, dans le petit cercle, faisait des pronostics sur l’avenir du comte Jules.
M. de Vaudreuil dit à ce sujet que, se promenant l’avant-veille au tapis vert, une femme âgée en passant près de lui glissa dans sa main une carte sur laquelle était écrit : La Duplan raccommode les dentelles, tire les cartes et dit la bonne aventure, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Paris, la deuxième porte en entrant, A droite, par
Si fl Souvenirs
lą rue des Noyers, au quatrième, sur le derrière!
Nous voulûmes voir cette carte, le comte nous la montra; elle était sale et grasse à donner des nausées. Tout-à-coup la bonne duchesse qui se prit à rougir, dit à M. de Vaudreuil :
— Je serais curieuse de connaître la destinée de mon nouveau-né.
— Il est porphyrogénète, répliqua le comte ; né dans les palais,il mourra dans un palais à lui, après avoir fourni une longue et brillante carrière.
—Vous devriez, poursuivit la duchesse, toujours poursuivie par son idée, aller consulter pour lui madame Duplan. Je vous donnerai son thème de nativité.
— Si vous y tenez tant, madame, vous serez obéie ; mais pourquoi vous tourmenter ainsi de l’avenir? Il est quelquefois plus heureux pour nous de l’ignorer.
M. de Vaudreuil cita alors des vers d’Horace
qu’il traduisit en français, dans lesquels ce grand poète cherchait à détourner un ami de la manie de consulter un devin. Cela ne changea rien au désir de la duchesse; le lendemain le comte alla à Paris, et ne revint que très tard à Versailles.
— Eh bien ? lui dit la duchesse.
— Eh bien, madame, M. le lieutenant de police m’a prévenu; il s’est chargé de loger la veuve Duplan, elle est en prison.
Je ne sais pourquoi je ne fus pas satisfaite de la manière dont M. de Vaudreuil nous raconta cette nouvelle, tant il y a que le même soir, profitant d’une occasion favorable, je lui dis à voix basse :
— Me donneriez-vous un démenti, si je vous accusais de ne point avoir parlé vrai à la duchesse ?
— Non, car vous auriez deviné... Demain j’aurai l’honneur de vous rendre mes devoirs ; vous saurez tout.
314 SOUVENIRS
J’attendis lè comte avec impatience, il vint de bonne heure, et dès qu'il fut assis :
— Jamais, dit-il, je n’aurais pu me décider à rapporter à la duchesse les pronostics de la sorcière. Cette infâme vieille, après avoir fait les simagrées, les contorsions d’usage, s’est mise à me débiter que le nouveau-né serait un composé de sac et de corde ; qu’il passerait en prison, en vertu de condamnations judiciaires, la meilleure partie de sa vie, et qu’il mourrait ou dans les fers ou en exil. J’ai voulu qu’elle recommençât une seconde, une troisième, une quatrième fois; eh bien! ses calculs n’ont pas varié. L’envie m’a pris de faire mourir sous le bâton cette infernale sorcière, et je ne sais pourquoi je suis parti en lui jetant deux louis. Vous comprenez maintenant le motif de ma fable à la duchesse.
— Je vous approuve, repartis-je, convenez cependant que voilà une bien étrange prédiction. Que le jeune Polignac tombe en disgrâce passagère, c’est possible, mais passer presque toute sa vie en prison, mais y mourir ou en exil, voilà ce que je ne puis croire, car il faudrait pour cela
SUR MARIE-ANTOINETTE. 515
que la famille royale cessât de régner en France.
Nous fûmes d'accord sur ce point et j’écris ceci en 1600. La révolution est consommée, les Bombons ont péri ou sont en fuite; néanmoins M. le comte J nies, émigré, il est vrai, jouit d’une pleine liberté, et je doute que le reste de la prophétie s’accomplisse.
Ce fut, si je me le rappelle bien, à cette époque que madame de Monaco, toujours aimée de M. le prince de Condé, me rencontrant aux Tuileries, me prit à part et me fit une confidence assez singulière. Avant de la rapporter, je dois dire que la princesse de Monaco, ayant été au nombre des femmes du feu roi qui avaient eu des relations avec la comtesse du Barri, continua à voir
cette favorite détrônée et par là à ennoblir selon
moi ce que sa liaison avait eu de blâmable dans
^.«^ l’origine. Elle allait àLuicenne, où s’était retirée madame du Barri après la fin de son court
^tó b exil, et ce fut dans une de ces visites, que la ¿f# comtesse lui apprit le fait suivant :
o0 S’il faut croire la comtesse, le marquis de
516 SOUVENIRS
Montesquieu Fézenzac, premier écuyer de Monsieur, comte de Provence, était venu la pi évenir que S. A. R. désirait causer avec elle en maison tierce. Madame du Barri répondit par un acquiescement respectueux, et se rendit au lieu indiqué; là, Monsieur, déguisé, lui adressa une série de questions qui se rattachaient à un crime prétendu du feu roi, relativement à la postérité de son fils.
Il est affreux d avoir à rappeler de pareilles abominations; les ennemis de la famille royale avaient compté sur la stérilité delà reine, depuis qu’elle assurait dans son époux la succession à la couronne, il n’est pas d’indignités auxquelles ils ne se soient arrêtés : à les entendre, le pieux dauphin, pour venger et rétablir les jésuites, aurait tenté de faire mourir son père, et que celui-ci, par représailles, aurait privé ses petits-fils de la possibilité d’avoir des enfans.
Ces calomnies ressortent de la plus infernale méchanceté; eh bien, selon la comtesse du Barri, Monsieur se condamnant lui-même serait venu lui demander ce que le feu roi pouvait lui avoir
SUR MARIE-ANTOINETTE. 317 dita ce sujet, elle prétendit que sa réponse fut négative, parce que ce point n’avait jamais été traité devant elle.
Après que madame de Monaco m’eut raconté ce fait, je lui demandai si elle m’autorisait à en parler à la reine; elle me dit que rien ne s’y opposait, d’autant que madame Du Barri le désirait, afin de prouver à S. M. sa reconnaissance
et son repentir.
Je dois dire ici que l’ex-favorite, dès le commencement de la révolution, montra un grand dévouement pour la cause de LL. MM. ; elle fit dans leur intérêt divers voyages en Angleterre; les Jacobins l'en ont punie en l’envoyant aussi à l’échafaud.
J’avoue que, dépositaire de cette confidence odieuse, je ne savais comment m’y prendre pour la communiquer à la reine sans trop l’indigner.
Je la rejoignis dans l’une de ses solitudes à Trianon ; et mettant à profit l’absence des importuns , je commençai à débiter cet étrange chapelet. Ma tache fut tout-à-coup bien allégée,
car, aux premières paroles, je m’aperçus que Marie-Antoinette en savait là-dessus autant et plus que moi. Elle m’écouta pourtant, témoigna de la bienveillance envers madame Du Barri, puis ajouta:
i

— Il est juste que je vous apprenne, en échange de votre dévouement , ce que vous ignorez, et la source de ces infamies. Le duc d’Aiguillon en est l’inventeur, et il s’est servi de M. de Montesquiou, afin d’en fasciner Monsieur.
Je ne lui en parlerai pas, attendu que c’est par
trop pitoyable, et qu’il faudrait s’en fâcher; je suis honteuse pour lui de sa démarche auprès de la comtesse. C’est depuis son traité d’alliance avec le duc d’Orléans , que M. d’Aiguillon a accouché de ce chef-d’œuvre, dont l’un des buts était de rendre le roi irréconciliable de M. leducdeCboiseul. Un Saint-Hurugues, un Laclos, M. de La Touche et le marquis....., sont les principaux colporteurs de cette fable. Je la mépriserai, ce sera toute ma vengeance.
J’admirai la magnanimité de la reine; peu de temps auparavant, elle m’avait donné des té*
SÜR MARIE-ANTOINETTE. 31 9 moignages flatteurs de sa bonté. Lorsque j appris que M. le comte d’Adhémar avait été frappé d’une fausse attaque d’apoplexie, à Saint-James dans le palais du roi d’Angleterre, je me hâtai de prendre la poste , et je courus à Londres lui prodiguer mes soins. Ils furent inutiles; la vigueur de son tempérament le rendit vite à la santé. Néanmoins, les envieux se servirent de cet accident pour le perdre. Ils y parvinrent ; plus tard on le rappela, et la révolution arriva sans qu’on tînt la promesse solennelle qui lui avait été faite de lui donner le cordon bleu, récompense de ses longs et loyaux services.
Hélas, M. le comte d’Adhémar a été trop sensible à ces dénis de justice ! Il s’en est ressouvenu en acceptant dans la garde nationale des grades qu’à sa place j’aurais dédaignés. Lorsque la mort me l’a enlevé, il était revenu aux senlimens dignes de son affection pour LL. MAL, et de sa haute naissance.
Ceux qui entouraient la reine, au lieu de se réunir dans son intérêt, s’isolaient les uns des autres et cherchaient à se nuire réciproquement.
5âÓ SOUVENIRS
Voilà pourquoi en 1788, M. le marquis de La Luzerne remplaça M. d’Adhémar à Londres. C’était aussi dans le but de procurer au baron de Bezenval le commandement d’Alsace, que, vers la fin de 1786, on entreprit de porter le maréchal de Contades, revêtu de ce commandement à la présidence du tribunal des maréchaux de France, cette dignité exigeant la résidence.
Mais, pour cela, il fallait la démission du titulaire, M. le maréchal duc de Richelieu. M. le maréchal de Ségur, ministre de la guerre, conduisait l’intrigue ; il débuta par écrire à madame de Richelieu. Il la priait d’amener son mari à une abdication que son grand âge rendait nécessaire ; la duchesse répondit spirituellement qu’elle avait accepté le soin d’adoucir les vieux jours de son mari, et non de les empoisonner par une semblable proposition.
Cette voie de succès manquant, M. de Ségur, qui ne savait rien refuser à nos amis, continua la correspondance, toujours avec la même dame. Il y avait dans son épitre la phrase que voici:
son MAKu-AütoimÉ. 5a i
« Le roi, madame, est instruit que le grand » âge de M. le maréchal de Richelieu lui a ravi » la meilleure partie de ses facultés intellect » nielles. Il ne peut plus exercer des fonctions » importantes qui exigent une continuelle pré-» sence d’esprit. En conséquence, c’est â vous )> à le déterminer à se démettre, afin de lui » éviter le désagrément d’une révocation. »
Comme je n’ai plus sous les yeux la lettre originale, je puis me tromper dans l'arrange* ment des mots, mais j’affirme que le sens en est exacte.
Madame de Richelieu^ devinant que c’était un parti pris, se crut obligée cette fois de montrer à son mari les tendresses du ministre de la guerre.
— Oh, oh! dit le malin vieillard, me voici dans la position de Sophocle. Allons, prouvons ua cher Ségur que, bien que je ne descende point d’un prince du sang par côté gauche, je sais ce que je vaux et surtout cê que je puis,
JM, a»
5>J SOUVENIRS
Puis se mettant à son bureau, il écrivit de sa patte de chat et sans l’aide de secrétaire le billet suivant :
« Monsieur le maréchal,
» Vous avez raison ; il y a force gens qui ra-» dotent ; mais comme ils n’en conservent pas » moins leurs charges, portefeuilles et emplois, » vous trouverez bien que je garde la prési-» dence de notre tribunal, moi que vous n’ac-» cusez de radoter que de temps en temps, le soir » ou le matin.
» Donc, je ne me démettrai qu’à la mort ; les » avides doivent prendre patience.
» Je suis, avec les sentimens qué je vous » dois, etc* >»
Ce billet écrit, ployé, cacheté et expédié, lé maréchal part pour Versailles, et profitant de toutes les sortes d’entrées dont if est inveesti, arrive au roi.
SUR MARIÉ-ANTOINETTE. 3s5
^ — Sire, lui dit-il, M. le ministre de la guerre
^j. prétend que je bats la campagne. Je supplie le roi de nous permettre un interrogatoire réciproque , afin que du choc jaillisse notre plus ou moins de sens commun.
Le roi, pris à l’improviste, rassura le maréchal, et M. de Ségur, craignant une incartade publique, lui envoya faire des excuses en forme d’explication. Au reste, le duc de Richelieu termina bientôt sa carrière; il mourut en 1788, précédé d’un an par le prince de Soubise.
Cette aventure causa beaucoup de désagré-Imens à M. de Ségur, et prépara sa disgrâce. Il ne s’y attendait pas, lorsqu’au milieu de l’année il accompagna le roi dans le voyage que fit S. M. au port de Cherbourg, le départ eut lieu de Rambouillet, où la reine était venue le mer-Îcredi, 21 juin, à 5 heures du matin. Il y avait dans le carrosse du roi le prince de Poix, capitaine des gardes de service, M. le duc de Ville-rsi^’ : quier, premier gentilhomme de la chambre, et ^ M. de Coigny, premier écuyer. La cinquième Of#łl place fut occupée plus tard par M. le duc d’Har-
3¿4 SOUVENIRS
court, gouverneur-général de la province.
Dans un second carrosse étaient deux officiers des gardes-du-corps, et deux écuyers; dans un troisième,des valets de chambre. Venaient une dernière voiture de suite et un cortège de gardes-du-corps peu nombreux. Les ministres de la marine, maréchal de Castries, et de la guerre, maréchal deSégtir, le devançaient, afin que tout fût disposé pour le recevoir.
Le roi courut avec ses chevaux jusqu’à Lou-dun, où il prit la poste. Là, ayant quitté un instant le carrosse, la femme du chirurgien du lieu se jeta à ses genoux, heureuse, dit-elle, devoir son bon roi. Louis XVI la releva avec tant d’affabilité, que la pauvre femme, perdant sans doute la tête, se pend à son cou, et lui applique sur les joues deux gros baisers. Le monarque, qui la trouve jolie, ne reste pas en arrière, et, à son tour, lui donne une double accolade.
A l’aspect de Faction paternelle du roi; le peuple fait retentir les airs de vivats etd’applau-dissemens. Pendant ce’ temps, Louis XVI de-
SDK MARIE-ANTOINETTE. 525 mande à la femme du chirurgien quelle grâce il peut lui accorder.
— Je n’ai besoin de rien, sire, répond-elle; mais j’ose recommander à votre majesté une de mes voisines sans fortune, et qui a douze enfans.
Le roi fit donner à cette mère de famille cinquante louis; et s’il n’a pas fait davantage, c’est la révolution qu’il faut en accuser.
Ce soir-là, Louis XVI coucha au château d’Harcourt, dont la duchesse lui fit les honneurs. Le lendemain, à dix heures du matin, il arriva à Caen. Sa voiture s'arrêta sur la place, afin que le maire et les échevins lui présentassent les clefs de la ville. Le roi, pour premier acte de bienfaisance , fit publier un pardon en faveur <les déserteurs du régiment d’Artois en garnison dans la ville. Ensuite son carrosse roula au petit pas, n’étant escorté que par deux gardes.
— Qu’on laisse approcher tout le monde, dit-il, je ne suis entouré que de mes enfans !
Il recommandait aux 'plus téméraires de ne
5s6 SOUVENIRS
pas se Élire blesser par les chevaux et les roues.
Le roi, avant d’entrer à Cherbourg, revêtit un habit rouge avec la broderie des lieutenans-gé-néraux, entremêlée de Iis brochés en or. 11 arriva à onze heures du soir ce même jeudi. Le temps paraissant favorable pour placer le lendemain un cône, S. M. en donna l’ordre. La marée fixait le départ de ce cône vers quatre heures du matin; Louis XVI s’y rendit auparavant, pour en suivre toute l’opération.
Lorsque le cône fut à flot, le roi s’embarqua, et le suivit quelques instaos ; ensuite il alla visiter l’escadre d’évolution, commandée par M. le comte d’Albert de Rion. Il monta sur le vaisseau le Patriote, se fit rendre compte de tous les objets qui pouvaient intéresser son service, et se rembarqua pour aller s’asseoir sur le cône le plus voisin de l’emplacement destiné à celui qu’on se disposait à établir. Il vit de là l’opéra-.ration, exécutée avec une précision étonnante. Après avoir été au fort de File Pelée, le roi retourna à l’abbaye située à peu de distance de Cherbourg, où S. M. était logée. Toute la plage
SUR MARIE-ANTOINETTE. S#) était couverte de peuple au débarquement du monarque ; il fut reçu avec acclamation.
On remarqua surtout deux choses, Tune que Louis XVI connaissait parfaitement tout ce qui concerne la marine, Vautre qu’il n’avait point oublié les noms et les services des officiers qu’on lui présenta.
Le roi quitta Cherbourg le lundi 26, alla à Honfleur, puis au Havre, où il vit encore son escadre d’évolution. Le lendemain il coucha à Rouen, et rentra le lendemain à Versailles.
Tandis qu’à Cherbourg l’escadre simulait un combat, le roi fut surpris de voir que son navire ne faisait pas feu : M. d’Albert répondit que l’étiquette ne permettait ni feu ni poudre dans un bâtiment honoré de sa présence. S. M. le dispensa de la règle, et voulut juger de l’effet du ricochet des boulets sur la mer.
Dans la distribution de croix de Saint-Louis que Louis XVI donna à quelques officiers de la marine, il en réserva une. Le maréchal de Cas-
5âS SOUVENIRS J ETC.
tries lui fit alors observer qu’il avait oublié M. d’Orvilliers, le neveu de l’ancien général.
— Oh que non! je ne l’oublie pas, répliqua le roi ; mais je veux aller moi-même la lui porter à son bord.
Voilà ce qu’était Louis XVI!
FIN DU TOME TROISIÈME

TABLE
DU TOME TROISIÈME,
Í
Livre seizième. — L'empereur Joseph II.1
Livre dix-septième. — Ministres, Voltaire, et faits
divers.3g
Livre dix-huitième.St
Livre dix-neuvième.—Enfans de la reine. Sa vie in
térieure,
Livre vingtième.*79
Livre vingt-unièmx.3^
Livre vingt-deuxième. a8g
FIN DA la tabee DH TOME TROISIÈME,